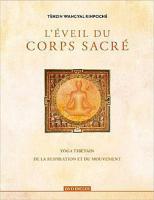La fusion de la culture hip-hop et du mouvement rastafari 2296111998, 9782296111998 [PDF]
144 44 3MB
French Pages 267 [268]
Papiere empfehlen
![La fusion de la culture hip-hop et du mouvement rastafari
2296111998, 9782296111998 [PDF]](https://vdoc.tips/img/200x200/la-fusion-de-la-culture-hip-hop-et-du-mouvement-rastafari-2296111998-9782296111998.jpg)
- Author / Uploaded
- Steve Gadet
Datei wird geladen, bitte warten...
Zitiervorschau
LA FUSION DE LA CULTURE HIP-HOP ET DU MOUVEMENT RASTAFARI
Steve Gadet
LA FUSION DE LA CULTURE HIP-HOP ET DU MOUVEMENT RASTAFARI Préface de Gilbert Elbaz
L’Harmattan
© L’Harmattan, 2010 5-7, rue de l’Ecole-Polytechnique, 75005 Paris http://www.librairieharmattan.com [email protected] [email protected] ISBN : 978-2-296-11199-8 EAN : 9782296111998
La même souffrance appelle souvent les mêmes gestes, les mêmes crispations intérieures ou les mêmes grimaces, les mêmes angoisses ou les mêmes révoltes. Introduction à La prochaine fois le feu !, James Baldwin, 1963
TABLE DES MATIÈRES Remerciements……………………………………………………...13 Préface………………………………………………………………15 Introduction générale………………………………………………..19 PREMIERE PARTIE IMPLANTATION DES MOUVEMENTS HIP-HOP ET RASTAFARI HORS DE LEUR BERCEAU GEOGRAPHIQUE………………………………….......................35 CHAPITRE 1 : LA CULTURE HIP-HOP EN JAMAÏQUE..37 1.1.1 : Relation entre culture hip-hop et culture locale…....38 1.1.2 : Moyens utilisés pour se faire connaître et fédérer la communauté hip-hop………………………………...56 1.1.3
: Perspectives d’évolution de la culture hip-hop en Jamaïque……………………………………………..59
CHAPITRE 2 : LE MOUVEMENT RASTAFARI AUX ETATS-UNIS………………...………………………………63 1.2.1 : Apparition du mouvement et réaction de la société américaine…............................................................................63 1.2.2 : Statistiques et structure sociale......................................66 1.2.3 : Le reggae aux Etats-Unis............……………...............68
7
DEUXIEME PARTIE CAUSES DES TRANSFERTS INTERCULTURELS ENTRE LA CULTURE HIP-HOP ET LE MOUVEMENT RASTAFARI......71 CHAPITRE 1 : LES MOUVEMENTS MIGRATOIRES……......................................................…...73 2.2.1 : Des îles anglophones vers les Etats-Unis…..…….......74 A/ Raisons économiques et sociales…........................74 2.2.2 : Adaptation à la ville de New York………….....…….75 A/ Problématique ethnique et raciale..........................75 B/ Relations avec la communauté africaineaméricaine...................................................................81 CHAPITRE 2 : DES EXPÉRIENCES IDENTIQUES VÉCUES PAR LES DIASPORAS NOIRES DES AMÉRIQUES………………..................................................85 2.2.1 : De la plantation au ghetto : un univers isolé……........91 A/ La traite transatlantique et l’esclavage comme événements fondateurs……………………………....91 B/ L’univers de la plantation..…………….................92 C/ L’aménagement du ghetto………….....................94 2.2.2 : Une tradition de résistance….......................................98 A/ Communiquer dans le Nouveau Monde : naissance d’un « parler singulier »………………………..........99 B/ La musique et la danse : facteurs d’endurance.....102 8
TROISIEME PARTIE MANIFESTATIONS DES TRANSFERTS INTERCULTURELS ENTRE LE MOUVEMENT HIP-HOP ET LE MOUVEMENT RASTAFARI…................................................................................107 CHAPITRE 1 : TRANSFERTS IDÉOLOGIQUES…………..........115 3.1.1 : Démarche afrocentrique.............................................115 A/ Expression du nationalisme noir dans la culture hiphop…………..……………………………………..116 B/ Expression du nationalisme noir dans le mouvement rastafari......................................................................121 C/ Précisions conceptuelles : Religion, mouvement social et culture……………...................…………...125 3.1.2 : Rôle des substances hallucinogènes………….……..128 A/ Itinéraire des substances illégales aux États-Unis et en Jamaïque………………………………………...128 a- Le cannabis aux États-Unis.…………......129 b- Le cannabis en Jamaïque………………..132 c- Le crack aux États-Unis…………............134 B/ Pourquoi vouloir une autre perception de la réalité ?......................................................................136 a- Le rap et le crack………………………...136 b- Rastafari, hip-hop et cannabis…………...141 CHAPITRE 2 : TRANSFERTS MUSICAUX……..........................151 3.2.1 : Transferts interculturels entre le rap et le reggae.......151 A/ Chronique d’une fusion musicale programmée...152 9
a-Rôle de la soul et du blues dans la naissance du reggae.......................................................156 b- Rôle du reggae dans la naissance du hip-hop et du rap…………………………….....…....158 B/ Fonctions socioculturelles………………............161 C/ Comparaison entre les thématiques des textes dans le reggae et dans le rap..............................................164 CHAPITRE 3 : LE MOUVEMENT « RASTAFARI-HIP-HOP »...213 3.3.1: I-n-I Mighty Lockdown : New Rochelle, New York………………………………………………………...214 A/ Origines socioculturelles et intégration à la société étasunienne…………………………...…………….215 B/ Expérience religieuse au sein du mouvement rastafari………..........................................................216 C/ Conception et participation au mouvement hiphop………………………………………………….217 D/ Production musicale et contenu thématique….....220 3.3.2: Duo Live : Brooklyn, New York…………………….224 A/Origines socioculturelles………......…………….224 B/ Conception et participation au mouvement rastafari......................................................................226 C/ Production musicale et contenu thématique.........228 Conclusion générale…….…………………......………...................237 Bibliographie…………………………….....………………………241 Sites Internet..........……………………………………………........257 10
Discographie………………………………………………………..259 Filmographie……………………………………………………….263 Glossaire rastafari..............................................................................265 Glossaire hip-hop..............................................................................266
11
REMERCIEMENTS Cet ouvrage a une dette particulière envers toute ma famille, tous mes amis qui m’ont soutenu et encouragé durant mon parcours universitaire. particulièrement mon épouse Nathalie, pour ses encouragements, ses prières et sa patience durant les nombreuses nuits où elle a dû s’endormir seule. Qu’elle en soit ici sincèrement remerciée! J’offre mes remerciements du fond du coeur à ma mère pour sa ténacité et son soutien inconditionnel, à mon père pour m’avoir transmis son goût du savoir, à ma petite sœur et à mes grands-parents Durimel et Gadet, au professeur Lionel Davidas, mon directeur de recherche, pour ses précieux conseils. Il a montré des ressources de patience et de disponibilité qui m'ont donné une leçon de persévérance et de perfectibilité. À Gilbert Elbaz pour ses précieux conseils et la préface. Je remercie mon laboratoire de recherche, le Centre de Recherches Interdisciplinaires en Langues, Lettres, Arts et Sciences Humaines (CRILLASH), également ceux qui ont bien voulu faire partie de mon « comité » de relecture (Carole Pétri, Stéphane Partel, Vané, Carole Louis, Mimie et Lucie Pradel). Je remercie Café et Amandine, pour leurs encouragements ininterrompus et leur précieuse aide, Gary Ramdine, toute ma belle famille, Aminata, Wayne, Doreen Preston de la Jamaïque, mon cousin Louis-Guy Lorange pour sa disponibilité et son aide. Mes fonctions à la Soguafi et à l'Université des Antilles-Guyane m'ont laissé le temps nécessaire pour avancer dans mes travaux. Mes responsables et mes collègues à la Soguafi m'ont soutenu qu'ils en soient ici remerciés! Merci à Bruce Jno-Baptiste pour ses précieux conseils, à Négus et à Jolo, à Fre du groupe Duo Live, aux étudiants de Columbia University et de Medgar Evers College, aux rappeurs et producteurs de la Jamaïque, à Phillipe Joseph, Trévor et son épouse pour leur aide durant mon voyage à Trinidad. Aux producteurs, rappeurs et danseurs de Trinidad pour leur précieuse contribution, à mon oncle Harry J. Durimel pour l’exemple et le soutien qu’il a été pour moi depuis mon enfance. Je dédie ce travail à la mémoire de mon grand-père, Clément Pierre Durimel, et de mes amis « disparus » en cours de route, Jimmy et Cyril.
13
PRÉFACE L’ouvrage de M. Steve Gadet s’intitule : « La fusion de la culture hip-hop et du mouvement rastafari ». L’auteur définit clairement son objectif, car il s’agit tout simplement d’ « examiner l’interculturalité entre le mouvement hip-hop et le mouvement rastafari ». En dressant un état des lieux, il nous fait partager une réflexion approfondie sur la notion d’interculturalité à travers des auteurs qui se sont distingués dans le domaine de la sociologie, comme Pierre Bourdieu, des Cultural Studies, comme Stuart Hall, et enfin des Post-Colonial Studies, tels Aimé Cesaire, Edouard Glissant ou Homi Bhabba. À l’ère de la mondialisation, l’auteur se refuse à se cantonner aux notions traditionnellement utilisées pour étudier ce phénomène et opte pour le concept de glocal cultures, popularisé par Andy Bennett ou celui de créolisation introduit par Raphaël Confiant, Jean Bernabé et Patrick Chamoiseau. La méthodologie, quant à elle, comprend des entretiens, une analyse des textes rap et reggae ainsi qu’une excellente analyse historique comparative. Malgré la sympathie facilement détectable de l’auteur à l’égard des deux mouvements étudiés, son approche n’en reste pas moins scientifique. Cette rigueur se confirme au parcours de la bibliographie thématique. « Le rappeur et le chanteur reggae », nous dit l’auteur, « sont des conteurs, des journalistes du ghetto qui, à l’instar des griots africains, détiennent l’histoire de leurs communautés et l’actualité de leurs quartiers dans leur mémoire ». Steve Gadet commence par se pencher sur la problématique de l’expatriation des deux mouvements hors de leur berceau géographique. En accompagnant de ses chansons les mouvements de libération des Noirs dans le monde entier, Bob Marley contribua indubitablement à la mondialisation du mouvement rasta. Cet engagement lui valut à la fois honneurs et menaces de mort mais grâce à lui, le mouvement rasta s’est largement étendu au delà des communautés noires pour englober de nouvelles vagues de jeunes d’origines diverses. On trouve maintenant des rastas européens, japonais, aborigènes, scandinaves, latino-américains. Cette popularisation a engendré un schisme entre les rastas orientés vers la politique et les rastas uniquement orientés vers l’aspect religieux, schisme dont la conséquence a été ce que l’auteur nomme « une bénédiction maudite » du mouvement. Au lieu de réduire ce phénomène au seul processus de la mondialisation, l’auteur se réfère à la notion plus subtile de « glocalisation » créée par le sociologue Roland Robertson. Malgré les mécanismes économiques et culturels mondiaux qui bouleversent le globe, chaque produit culturel est repris et réinterprété de manière unique par le contexte local dans lequel il se
15
retrouve. Sont ensuite analysés les transferts culturels entre le mouvement hip-hop et le mouvement rastafari qui tiennent compte des mouvements migratoires et de la diaspora noire, expérience identique vécue dans toutes les Amériques. Après avoir analysé leur dynamique transnationale, l’auteur est prêt à étudier les manifestations des transferts interculturels entre les deux mouvements étudiés. Ces transferts sont à la fois idéologiques et artistiques et conduisent finalement à ce que l’auteur conceptualise brillamment comme le « mouvement rastafari-hip-hop ». Il y repère des manifestations hybrides dans plusieurs expressions culturelles, y compris la musique, les arts visuels, l’infographie et le cinéma1. Pour comprendre les transferts idéologiques, une recontextualisation est nécessaire : la traite négrière, la fin du colonialisme, le développement des moyens de communications et les mouvements migratoires font partie du contexte dans lequel émergent les échanges interculturels entre le mouvement hip-hop et le mouvement rastafari. L’afrocentrisme, selon l’auteur, est au cœur des deux mouvements. La Nation de l’Islam et les Five Percenters (eux-mêmes issus du premier groupe) ont également aidé à la diffusion du nationalisme noir dans le mouvement hip-hop. Leur idéologie est un mélange de rhétorique nationaliste noire et de numérologie ésotérique. Les nationalistes affirment que le peuple noir est le peuple originel et que les mathématiques sont la clé pour comprendre la relation de l’homme avec l’univers. D’après leur système de croyances, les Noirs sont la réincarnation d’Allah à travers le soleil. La communauté hip hop se réclame aussi de Malcolm X et de Louis Farrakhan, figures centrales de la Nation de l’Islam, mais son engagement social et politique ne traduit pas toujours concrètement ces enseignements. La communauté hip-hop s’appuie davantage sur la déclaration que sur la démonstration, affirme l’auteur. Alors que le gangsta rap célèbre la violence et le machisme, le manque d’activisme sociopolitique demeure un handicap majeur. Ni le mouvement hip-hop, ni le mouvement rastafari ne possèdent de programme politique qui s’adresserait aux problèmes spécifiques de leurs membres, comme le font les partis politiques traditionnels. Ce constat est confirmé en 1987 par l’écrivain Amiri Baraka, qui, en se référant au groupe Public Enemy, déclare qu’il est difficile d’être artiste et activiste en même temps. Gadet conclut que les deux mouvements ont été piégés par la logique économique capitaliste. Dans la société contemporaine, leurs éléments
1
Pour des raisons de droits d’auteurs, les résultats de sa recherche ne peuvent apparaître dans cet ouvrage mais restent consultables dans son travail de thèse original.
16
culturels les plus visibles sont devenus, selon l’auteur, « des objets folkloriques d’une commercialisation économico-politique», illustrant ainsi l’observation de Stuart Hall : « La culture populaire est un espace dans lequel s’affrontent le consentement et la résistance ». En conclusion générale, Steve Gadet a produit un travail de recherche dont le style, le rythme, serait-on tenté de dire, n’est pas sans rappeler les déclamations du rap et du slam, un style qui séduira un grand nombre de lecteurs, du spécialiste de la culture à ceux qui prennent plaisir à écouter ces différents genres musicaux. Son travail empirique, historique et théorique brille par ses qualités innovantes et analytiques et représente incontestablement une référence dans le domaine des études africainesaméricaines et afro-caribéennes. Gilbert ELBAZ Professeur à l’Université des Antilles et de la Guyane, Shoelcher, le 28 mai 2009.
17
INTRODUCTION GÉNÉRALE À l’aube du 21e siècle, le monde est devenu un « village planétaire » où les cultures, les modes de pensée s’entrecroisent constamment. Il n’existe presque plus de barrières culturelles, pour ainsi dire. La principale raison qui nous a poussé à examiner les liens entre le mouvement hip-hop et le mouvement rastafari est l’intérêt particulier que nous portons aux phénomènes culturels, particulièrement les phénomènes culturels afrocentriques et afrodiasporiques. Notre formation d’angliciste nous a permis de nous consacrer à l’étude des littératures et des civilisations du monde anglophone. Nous avons pu observer l’influence qu’exercent les cultures des pays anglophones, particulièrement les États-Unis, sur le reste du monde (relations internationales, société, loisirs, économie…). Dans ce contexte interculturel, cette démarche nous a rendu aussi curieux de savoir quel était l’impact de notre espace socioculturel, la région Caraïbe, sur l’espace nord-américain. Le mouvement rastafari, né dans les ghettos de la Jamaïque dans les années 30, s’est exporté aux Etats-Unis, principalement par le biais du reggae, durant les années 70. Depuis le début des années 90, il semble qu’un nombre grandissant d’acteurs du mouvement hip-hop, né durant les années 70 dans les ghettos de New York, s’approprie ses croyances, ses pratiques et ses symboles. Pour évaluer l’évolution de ces transferts culturels, nous avons choisi une approche qui se veut culturaliste, autrement dit qui respecte la diversité des cultures. Lorsque nous évoquons le concept d’Amérique anglophone, nous entendons par là les sociétés qui font partie de la zone Amérique où l’anglais est reconnu comme langue officielle. Cette zone englobe la région Caraïbe anglophone, les États-Unis et le Canada. Pour les besoins de notre travail de recherche, notre espace d’étude se limitera aux États-Unis et à la région Caraïbe anglophone. L’exclusion du Canada se justifie par le fait que nous avons préféré nous concentrer sur les berceaux géographiques des deux mouvements, à savoir les États-Unis et la région Caraïbe. La période sur laquelle nous concentrerons notre étude s’étend des années 30 au début des années 2000, c’est-à-dire de la genèse du mouvement rastafari en passant par la conception du mouvement hip-hop dans les années 70, jusqu’à leurs mutations contemporaines. L’intérêt pour le chercheur en sciences humaines et sociales est de pouvoir analyser une situation d’interculturalité, non pas comme elle se présente le plus souvent, entre deux peuples, mais cette fois entre deux faits culturels qui concernent plusieurs peuples. Cela constitue un sujet de recherche original et intéressant à plus d’un titre.
19
En 1999, dans son ouvrage, Pour une éthique de la médiation : le sens des pratiques culturelles, Jean Caume déclare que « notre société contemporaine, avec le développement des techniques d’information et de communication multiplie les possibilités de rencontres et d’échanges entre les individus, eux et leurs diverses productions et entre les diverses communautés » (1999 : 106) . Le sujet de notre recherche semble renfermer les caractéristiques de ce phénomène de médiation. La culture hip-hop et la culture rastafari partagent des similitudes. Ces dernières, si elles sont vérifiées, leur permettraient de créer une expression originale et un comportement propre. Lorsque les deux philosophes Gilles Deleuze et Félix Guattari (1972, 1975, 1980) conçoivent le concept de la déterritorialisation, ils soulignent qu'il est synonyme de décentrement, de mouvement et d'exploration. Cela implique que certains phénomènes culturels ont tendance à transcender les frontières d'un territoire donné dans un monde constamment en mouvement. Par conséquent, les créations s'interpénètrent et s'envahissent. La déterritorialisation, c'est le « mouvement par lequel on quitte le territoire » (1980: 634). Elle désigne souvent le changement d'une culture ; cela ne signifie pas néanmoins que les cultures impliquées n'aient pas de point d'ancrage. Ce phénomène est aussi à l’œuvre dans nos sujets d’étude. Durant les années 70 et 80, la culture hip-hop et le mouvement rastafari ont quitté leurs territoires natifs respectifs pour s'insérer dans d'autres sociétés. En réalité, lorsqu'un phénomène culturel change, c'est parce qu'une autre culture s'y insère. Deleuze montre comment la déterritorialisation ne va jamais sans une reterritorialisation. Les cultures déterritorialisées sont reterritorialisées dans d'autres parties du monde. Le mouvement hip-hop et le mouvement rastafari, nous le verrons, sont particulièrement concernés par ces deux phénomènes. Ils sont tous deux sortis de leurs aires géographiques de naissance et se sont répandus dans d’autres espaces d'autant plus que les cultures déracinées de leurs territoires ont une signification particulière dans les nouveaux territoires où elles évoluent. Etat des lieux La recherche francophone sur la culture hip-hop commence dès le début des années 90. En 1991, David Dufrennes décrivit les acteurs de cette culture aux États-Unis et en France, en relatant l’histoire des groupes et des phases du mouvement. En 1995, le chercheur Hughes Bazin publia une critique décrivant la culture hip-hop comme une culture de résistance (1995 : 305) qui consiste à inventer une nouvelle manière de gérer son parcours social : l’individu n’est plus pris en charge par la société ou une institution puisqu’il se prend en charge lui-même. La musique rap et ses contours font
20
l’objet de plusieurs ouvrages tels que Le rap ou la fureur de dire (2000) de Jacques Lapassade et Philipe Rousselet, L’offensive rap (1996), Le dictionnaire du rap (2007), Rap stories (2008) d’Olivier Cachin, Le rap, une esthétique hors-la-loi (2003), Pour une esthétique du rap (2004) de Christian Béthune. Dans ce premier ouvrage, la musique rap est examinée dans son rapport avec le milieu économique, le sexe, le jazz, l’écriture et l’oralité, la violence, le langage et la technologie. Le hip-hop n’est plus considéré simplement comme une contre-culture, mais comme une culture à part entière. Dans le second, l’auteur s’attache à scruter les règles et les implications esthétiques du rap. Des auteurs étatsuniens ont également exprimé des critiques sur le mouvement hip-hop. Ils ont considéré son évolution au sein de l’Amérique blanche. Ainsi Nelson George, dans son livre Hip-Hop America (1998), retrace les contours de la culture aux États-Unis. Il débat aussi de l’influence du capitalisme, des substances narcotiques et du sport sur les différents participants. En 1994, Tricia Rose, dans son œuvre Black Noise, écrit sur son rôle politique, l’impact des nouvelles technologies et l’apport des femmes au sein de la culture. Des études ont également été menées sur l’aspect langagier du hip-hop Hip-hoptionary (2002) d’Alonzo Westbrook. Michael Eric Dyson, auteur d’ouvrages essentiels sur la culture africaine-américaine, tels que Reflecting Black : African-American criticism (1993), Race rules : Navigating the color line (1997), a travaillé sur la relation entre la criminalité, les croyances religieuses, le rap et la communauté africaineaméricaine dans son livre Between God and gangsta rap (1997) ainsi que sur la condition du mouvement hip-hop dans Know what i mean : Reflections on hip-hop (2007). Depuis ces dernières années, la culture hip-hop est fréquemment examinée comme une « culture du monde » et non plus comme une culture exclusivement africaine-américaine, car le vent du capitalisme a dispersé les graines du mouvement dans la quasi-totalité des pays du monde. C’est le cas de l’ouvrage Popular music and youth culture: music, identity and space (2000) d’Andy Benett et de l’article Getting real about global hip-hop2 (2002) d’Yvonne Bynoe. La première étude réalisée sur le mouvement rastafari fut publiée en 1952 par Fernando Henriquez dans Family and color in Jamaica, où il se penche sur le rôle de la cellule familiale et du mouvement rasta dans la société jamaïcaine. Le rapport commandé par le gouvernement de la Jamaïque en 1961 et rédigé par des chercheurs de l’Université des West-Indies (Rex Nettleford, Michael Garfield Smith et Roy Augier) sera le premier à
2
Georgetown University Journal on International Affairs, Culture section.
21
considérer sérieusement le mouvement comme un phénomène urbain. Il décrit les doctrines, les structures, les pratiques et les besoins de cette communauté. Ce rapport mit en évidence le fait que les rastas n’étaient pas des éléments criminels et que tous ne faisaient pas usage de la marijuana. Il changea la perception du mouvement dans l’île. Certes, il n’empêcha pas Vittorio Lantenari, dans The religion of the oppressed (1963), de dépeindre le mouvement comme une religion d’opprimés, un phénomène messianique dont les membres cherchent à échapper à la réalité. Joseph Owens, ethnologue d’origine européenne, est le premier à expliquer le mouvement de l’intérieur, allant jusqu’à vivre avec des communautés rastas en Jamaïque. C’est à partir de cette expérience qu’il publie Dread : The rastafarians of Jamaica (1976). Dans son livre The rastafarians : Sounds of cultural dissonance (1977), Leonard Barett étudia le mouvement rastafari suite à l’échec du projet de retour en Afrique. Selon lui, le mouvement s’est divisé à cause de l’interprétation de la personne d’Haïlé Sélassié, l’empereur éthiopien supposé être le représentant de Dieu sur terre pour les adeptes. Toutefois, au lieu de s’estomper avec la disparition de ce dernier en 1975, le mouvement s’internationalise. En 1987, Horace Campbell publia Rasta and resistance, une étude sur le rôle politique du rastafarisme dans la région Caraïbe et sur le continent africain. Il travailla également sur l’internationalisation du mouvement. Barry Chevannes, Maître de conférences en sociologie à l’Université des WestIndies, est une autorité dans l’étude du rastafarisme. Son ouvrage Rastafari: Roots and ideology (1994) retrace le lien avec les traditions religieuses africaines, la résistance des Africains déportés et le rôle de la paysannerie jamaïcaine dans l’évolution du mouvement ainsi que son internationalisation. De nombreux ouvrages ont été publiés dans le même but : décrire la genèse et les transformations du mouvement rastafari. (Dawes : 1999, Katz : 2003, Barrow et Dalton : 2004, Bradley : 2007). En 1994 également, dans son étude intitulée Religion and globalization, Peter Beyer examina les liens entre la mondialisation et les faits religieux. Selon lui, les mouvements religieux se serviront de plus en plus des mouvements sociaux pour propager leurs messages. De nombreux ouvrages ont été publiés sur la musique reggae, dans sa corrélation avec le mouvement rasta et également en tant que culture à part entière. En 1977, à travers Rastafarian music : an introduction study, Verena Reckford discute du rôle des artistes rastas dans la mutation de la musique populaire jamaïcaine et dans l’évolution du nationalisme. Stephen Davis consigne dans son livre Reggae bloodlines : in search of the music and the culture of Jamaica (1992) les racines et la transmutation du reggae en Jamaïque. En 1983, Timothy White, le biographe officiel de Bob Marley, retrace sa vie dans Catch a fire : the life of Bob Marley. Stephen Davis écrit également sur la vie de l’apôtre du mouvement rastafari en 1985. Ces
22
biographies sont incontournables dans la mesure où les créations et la vie de Bob Marley ont apporté une immense contribution à l’essor du mouvement. D’ailleurs, Kwame Dawes examine son talent de parolier dans Bob Marley, a lyrical genius (2002). En 1998, trois auteurs américains éditent, en collaboration avec d’autres chercheurs, une anthologie sur le mouvement rastafari. Nathaniel S. Murell, Williams Spencer et Adrian A. Mc Farlane explorent le rastafarisme en Jamaïque mais aussi en dehors de cette île, ses aspects théologiques, politiques, historiques et sociologiques. Cette collection d’essais, intitulée Chant Down Babylon : The rastafari reader (1998), est l'une des réflexions les plus stimulantes de la décennie. Ils n’hésitent pas à examiner le rôle de la femme ainsi que la construction de l’unité familiale. Cet ouvrage demeure l’une des études les plus complètes et les plus diversifiées sur le mouvement publiées au 20e siècle. Nous avons également opté pour une approche sociologique afin d'explorer la place occupée par le hip-hop et le rastafarisme. C'est dans le cadre théorique des mouvements sociaux que nous avons choisi de montrer comment évoluent le mouvement hip-hop et le mouvement rastafari. En effet, le chercheur ne peut pas comprendre le 20e siècle sans ces mouvements sociaux. Ce sont des phénomènes sans cesse changeants. Par conséquent, une sociologie des mouvements sociaux ne saurait être achevée. Le mouvement social a la particularité d'agir à travers des hommes et des femmes qui partagent des intérêts, des émotions, des espoirs. Dans son ouvrage La sociologie des mouvements sociaux, Éric Neveu le définit comme : « Une occasion privilégiée de mettre en question le monde social tel qu'il tourne, de dire le juste et l'injuste » (2005:3).
Il peut être aussi : « le levier qui fait bouger la politique et la société, l'évènement partagé qui fait référence pour une génération, une mémoire » (2005:3).
Ce sont aussi des formes d'expression liées au sentiment d'injustice. Elles ont pour objectif d'établir un nouvel ordre de vie par la résistance au changement ou par le désir de changement. Le mouvement hip-hop est une réaction des « laissés-pour-compte » face à la politique du gouvernement Reagan aux États-Unis. Le mouvement rastafari est aussi une réaction des « laissés pour compte » pendant la période coloniale en Jamaïque. Les adeptes de ces deux phénomènes partagent un sentiment d'injustice et d’aliénation. Ils partagent aussi des souvenirs, des repères et des valeurs. Pour la plupart, ils appartiennent à la même catégorie sociale même si cette caractéristique tend
23
à changer depuis l'internationalisation des deux mouvements. Ce sont des mouvements qui sont nés, certes, à des périodes différentes, mais au sein de la classe ouvrière. Selon le sociologue français Alain Touraine, le mouvement social est constitué de trois éléments : la défense de l'identité et des intérêts propres, la lutte contre un adversaire et une vision commune du mouvement. Ce sont des appels, des cris demandant une réponse à un problème donné. L'espace où ces appels sont entendus varie. Dans le cas du mouvement hip-hop et du mouvement rasta, cet espace peut être la rue, la musique, un ouvrage, les médias ou encore les rassemblements. Dans leur ouvrage, Poor people's movement (1978), les sociologues américains Frances Piven et Richard Cloward signalent que trop d'organisation et de structuration dans un mouvement social lui fait perdre sa spontanéité et son essence même (Neveu, 2005: 23). Les deux mouvements que nous étudions ne sont pas centralisés ; ils n'ont pas d'instances représentatives officielles. Ils doivent certainement leur longévité à cette caractéristique mais c'est également une faiblesse qui les empêche de définir leurs revendications et leurs convictions d'une voix claire. Pour identifier des formes et des types originaux de mobilisations qui émergent dans les années 60 et 70, la notion de Nouveaux Mouvements Sociaux (NMS) apparaît. Alain Touraine est l'un des premiers à les distinguer des conflits sociaux plus traditionnels. Ces Nouveaux Mouvements Sociaux ont plusieurs caractéristiques (Neveu, 2005: 62). Les premières lignes de clivage consistent en une défiance explicite devant les phénomènes de centralisation laissant une plus large autonomie aux membres. Les deuxièmes résident dans des formes de protestation moins institutionnalisées et plus inventives. Elles ont une forme plus ludique et anticipent la réaction des médias. Les troisièmes lignes de clivage résident dans les valeurs et les revendications qui accompagnent la mobilisation. Elles diffèrent des mouvements sociaux traditionnels. Tandis que ces derniers portaient davantage sur les revendications, l'accès aux sites de décisions, la redistribution des richesses, les NMS mettent l'accent sur la résistance au contrôle social et sur l'autonomie. Leurs revendications sont souvent non négociables. Celles-ci comportent une forte dimension expressive d'affirmation de l'identité, comme le suggère un terme tel que gaypride. La nouveauté de ces mouvements sociaux serait enfin liée à l'identité de leurs acteurs. Les mouvements de la société industrielle se revendiquaient en identité de classe. Se définir comme musulman, rastafarien, homosexuel, hispanophone ou encore comme « hip-hopper », appartenir aux « Amis de la terre », tout cela renvoie à d'autres principes identitaires.
24
Notre tâche sera de faire naître une réflexion en évitant une célébration complice de la nouveauté. Le deuxième travers que nous devrons éviter est la surestimation de l'importance et de la durabilité de l'interculturalité entre ces deux mouvements. Le temps et l'ampleur du phénomène sont des facteurs à prendre en compte pour valider complètement notre hypothèse. Dans The art of moral protest, culture, biography and creativity in social movements (1997), James Jasper souligne que participer à une revendication sociale ne se réduit pas uniquement à une revendication intéressée ; c'est aussi une manière de s'interroger sur sa propre vie, faire un travail sur soimême et exprimer une créativité inexploitée. Si participer à un mouvement social, c'est également effectuer ces démarches, nous verrons tout au long de notre travail que les adeptes du mouvement rastafari et du mouvement hiphop sont entrés dans cette dynamique. Un grand nombre d’études ont été réalisées sur la communauté caribéenne aux États-Unis (Kasinitz 1992, Palmer 1995, Fohner 2001). Pourtant, celles qui ont été menées sur le mouvement rasta à New York ou sur l’ensemble du continent américain sont peu nombreuses. Quelques articles ont traité le dit mouvement sans examiner toutes ses facettes3. En 1980, Williams Spencer rédige un article dans lequel il déclare, en se basant sur la popularité de Bob Marley, qu’il y a autant de rastas aux États-Unis qu’en Jamaïque, sans preuves tangibles de ce qu’il avance4. En 1983, il rédige un autre article sur le mouvement rasta à New York et à Philadelphie. Celui-ci met en lumière d’importantes caractéristiques du mouvement en Amérique du Nord et analyse son évolution, mais il n’a jamais été publié5. En 1989 Linden Lewis traite du mauvais traitement infligé aux rastas par les médias et les forces de l’ordre6.
3
Leahcim Tufani Semaj, “Inside Rasta : The future of a religious movement”, Caribbean Review 14, 1 (1985) : 8-11, 37-38 ; Neil J. Stavinsky, “Transnational Popular Culture and the Global spread of the Jamaican Rastafarian Movement”, New West-Indian Guide 68, 3-4 (1994) : 261-279. 4 William D. Spencer, “Rastafari: Poverty and Apostasy in Paradise”, Journal of pastoral practices N°4, 1 1980 : p 67-68. 5 Williams D. Spencer, “Manchild by the rivers of Babylon : An analysis of Rastafari’s churchly versus sectarian aspects to interpret the present and predict the future of the rastafarian experience in the United-States”, manuscrit non publié et situé à la Bibliothèque Zenas Gerig, Séminaire Théologique de la Jamaïque à Kingston, 1983. 6 Linden F. Lewis, “Living in the heart of Babylon: Rastafari in the USA” , Bulletin of Eastern Caribbean Affairs 15, 1 (Mars-Avril): 20-30. Cité dans The Rastafari reader: Chanting Down Babylon.
25
Problématique cultivant la recherche Dans nos sociétés, nombreux sont ceux qui doivent maintenant assumer leur devenir au point de rencontre de plusieurs cultures et de plusieurs groupes, plus ou moins structurants car « chaque sujet est de plus en plus le produit de métissages multiples (…) » (Warnier, 2003 : 110). Cette affirmation montre la pertinence et la réalité de notre sujet d’étude pour un chercheur en sciences humaines, sur la médiation entre les phénomènes culturels. L’originalité de notre démarche est de proposer une étude comparative des deux cultures ainsi que des deux communautés qui sont à l’origine de leur création, en mettant en évidence l’axe d’échange entre la région de la Caraïbe anglophone et les États-Unis d’Amérique. À ce jour, en dehors des observations sur le rapprochement musical entre le reggae et le rap, aucune analyse n’a été réalisée sur les transferts culturels entre ces deux mouvements et entre leurs pratiques culturelles respectives. Notre démarche consistera à mettre en évidence la médiation entre ces deux phénomènes selon une approche interculturelle. En adoptant une posture sociologique et multiculturaliste, nous tâcherons de comprendre les raisons de ces transferts culturels, les différences qui demeurent entre les mouvements, ainsi que la nouvelle dynamique transcendant les deux ensembles. Pourquoi ces deux mouvements se sont-ils rapprochés et comment se manifestent leurs échanges interculturels ? Existe-t-il des domaines dans lesquels il n’y a pas d’échanges ? Au cours de notre approche, nous nous efforcerons également de mettre en évidence les atouts et les difficultés que soulève la diversité culturelle dans un espace où la culture étasunienne est considérée comme une exterminatrice des cultures locales. Comment la culture hip-hop s’est-elle adaptée hors de son aire de naissance ? A-t-elle éradiqué les cultures locales dans les espaces où elle s’est implantée ? La culture hip-hop et le mouvement rastafari, s’exprimant dans les sociétés de l’Amérique anglophone, sont les produits d’échanges complexes entre le folklore africain et le contexte du Nouveau Monde. Ces deux phénomènes culturels sont entrés en contact au point de créer une expression singulière. En effet, les acteurs de cette nouvelle « impulsion socio-religio-culturelle » incorporent dans leurs modes de vie et leurs modes d’expression des symboles, des pratiques, des croyances provenant des deux mouvements. Existe-t-il un ou des lien(s) entre le mouvement hip-hop et le mouvement rastafari, et à une plus grande échelle entre les deux communautés créatrices, qui auraient facilité les transferts culturels pour aboutir à leur médiation ?
26
Approche théorique et méthodologique Le socle de notre démarche méthodologique et conceptuelle repose sur les notions d’interculturalité et de médiation. En effet, ces deux mouvements, leurs productions et leurs communautés ont bâti un ensemble qui les transcende, tout en gardant leurs pratiques distinctes. Nous avons besoin d’une méthode pour analyser les manifestations des échanges entre les mouvements. Nous définirons d’abord le concept de culture, que nous utiliserons au cours de notre argumentation, ainsi que le concept de médiation et d’interculturalité. Les définitions, une fois établies, nous permettront de préciser notre méthodologie. Lors d’un séminaire interdisciplinaire consacré à l’identité, Michel Serres constatait que ce que les cultures ont en commun et qui les institue comme telles, « c’est l’opération même de raccorder, de connecter » (Serres, 1977 : 125). Nous retiendrons la définition et le concept suivants du mot culture établi par l’UNESCO : « Un système de valeurs dynamique (…) acquis avec des postulats, des conventions, des croyances, des règles qui permettent aux membres d’un groupe d’avoir des rapports entre eux et avec le monde, de communiquer et de développer des capacités créatrices qui existaient en puissance chez eux ».
La culture est aussi en elle-même un langage, comme le déclare Roland Barthes dans son ouvrage Le bruissement de la langue : « (…) Pour se dire homme, il faut à l’homme un langage c’est-à-dire la culture même. ». La communauté, quant à elle, se définit par des liens affectifs forts, une appartenance difficilement révocable, la mise au profit de la communauté des efforts personnels, ainsi que des valeurs communes. La société, à l’inverse, se définit par l’individualité des intérêts, des contrats révocables et des liens affectifs faibles. La communauté et les pratiques culturelles sont donc une alternative au mode de vie et de pensée de la société en général qui, paradoxalement, exprime la structure et le dynamisme de cette dernière (Serres, 1977 : 125). La Caraïbe tient une place spéciale dans la culture américaine, en raison des connexions historiques et géographiques. La proximité des deux espaces, le flux continu d’immigrants et un passé ayant pour toile de fond l’esclavage sont autant d’éléments partagés par les descendants africains, qui assurent un échange réciproque et continu. La vitalité du métissage caribéen continue à
27
être une source d’anxiété pour la majorité des Américains en ce qui concerne la question de la race et du multiculturalisme7. La culture américaine et la culture caribéenne ont l’une et l’autre contribué au développement culturel, économique et intellectuel de leur population depuis la période de l’esclavage. Tout en gardant leur caractère, les deux cultures, leurs productions et leurs communautés bâtissent un ensemble qui les transcende. Cela nous amène à définir plus exactement le concept de médiation en termes de pratiques culturelles. Jean Caume définit la médiation comme étant l’aptitude à mettre en rapport des entités distinctes. Dans son ouvrage, il fournit une brillante analyse sociale de la médiation, des conditions nécessaires pour qu’il y ait communication interculturelle. C’est un processus actif qui se matérialise par un événement, un acte de parole, un comportement qui engage un sujet ou un phénomène dans une relation à un autre (Serres, 1977 : 198). Nos supports doivent nous permettre de faire une étude séparée des mouvements, mais aussi une comparaison et, enfin, de savoir s’il existe un lien entre eux. Dès 1990, dans son ouvrage L’interculturel, l’anthropologue Claude Clanet décrit l’interculturalité, les modes d’observation, les causes, ainsi que la culture dans ce contexte. Il définit déjà le phénomène comme étant le fait de retrouver des éléments d’une culture dans une autre. Cependant, ces éléments ne gardent pas toujours les mêmes fonctions. Par conséquent nous chercherons à savoir comment se manifeste la médiation. En premier lieu, il lui faut « un contenu », puis « des domaines d’activités » qu’elle met en relation, et enfin « des supports visibles » qu’elle utilisera. Par quel processus pouvons-nous repérer des éléments d’une culture dans une autre culture ? Cela nous amène à définir le concept d’interculturalité. Selon Claude Clanet, il nous faut proposer une définition de la culture à partir de laquelle il nous sera possible d’étudier les contacts entre cultures et les transformations qui en résultent. Cette définition de la culture doit donc prendre en compte d’une part une « composante globale », l’ensemble des comportements, productions, normes, valeurs et croyances existants et particularisés dans un groupement humain et qui font qu’on le repère comme « communauté culturelle », et d’autre part une « composante particulière, singulière », liée aux significations que prennent pour les adeptes leurs actes et leurs productions (Dallage, Ouellet, Turgeon, 1997 : 15). En définitive, la culture c’est surtout ce qui existe comme ayant du sens dans une communauté particulière. Cela suppose que les mêmes actes et les mêmes productions puissent se faire dans deux cultures différentes mais sans avoir le même sens. C’est une conclusion clé pour notre démarche
7
Journal of popular culture, p.33, Vol.21.3, 1999
28
méthodologique. Au sens où nous l’employons, le terme « interculturalité » introduit donc les notions de réciprocité dans les échanges ou relations entre cultures. L’approche interculturelle des productions « imaginaires » doit aussi intégrer les différences. Elles doivent être repérées, analysées et interprétées. Nous devrons donc détecter les « réseaux de significations » qui se recouvrent et ceux qui fondent les différences culturelles. L’interculturalité est donc un ensemble de processus psychiques, relationnels, institutionnels, rhétoriques générés par les interactions de cultures, dans un rapport d’échanges réciproques et une perspective de sauvegarde d’une relative identité culturelle des communautés qui sont en relation. La sociologie étant une science dont le principal objectif est l’étude des phénomènes sociaux humains, cette approche nous permettra d’exposer notre sujet de manière plus précise et plus pertinente. La sociologie s’est intéressée à des sujets d’études tels que les inégalités et la stratification sociale, les relations interethniques, la religion, les mouvements sociaux, la sociolinguistique, les cultures marginales, le multiculturalisme, la mondialisation, la culture populaire et le rôle de l’art, autant de sujets qui entrent directement en relation avec notre sujet d’étude. La sociologie met en évidence l’ensemble des déterminations qui rendent explicables les comportements humains. Pour chaque individu ou chaque groupe d’individus, ces déterminations sont différentes. Les adeptes du mouvement hip-hop et du mouvement rastafari et ceux qui s’identifient à ces communautés agissent en fonction d’aspirations et d’expériences uniques. Leurs réactions sont conditionnées par l’espace où ils vivent, ceux qui les entourent et la société dans laquelle ils évoluent. Dans notre approche méthodologique, nous ne pouvons pas ignorer les travaux du sociologue français Pierre Bourdieu. Dans son ouvrage Les règles de l’art (1992), sa réflexion l’amène à élaborer une méthode sociologique dans l’analyse des productions culturelles, y compris l’art visuel et la musique. Son œuvre est centrale pour la sociologie de l’art et de la culture. Dans La misère du monde (1993), il s’efforce de démontrer que la souffrance de tout individu n’est pas seulement liée à l’insuffisance de ressources et à la pauvreté matérielle, mais à sa position dans la société, une position qui facilitera plus ou moins son épanouissement et la réalisation de ses aspirations. Il ne décrit pas seulement une « misère de condition » mais aussi une « misère de position ». Il se place du côté de ceux qui s’identifient, pour la plupart, aux mouvements que nous étudions, les laissés-pour-compte, marginalisés dans une société néo-libérale impitoyable. Le dernier de ses ouvrages auquel nous nous référerons est La distinction : critique sociale du jugement (1979). Le sociologue démontre que nos pratiques culturelles et nos goûts sont déterminés par notre position dans la société. À ses débuts, le
29
mouvement rastafari a eu beaucoup de succès auprès de la classe ouvrière, des chômeurs, de tous ceux qui se sentaient aliénés dans la société capitaliste ou néo-colonialiste. Il faut signaler que, de nos jours, beaucoup d’adeptes du rastafarisme et du hip-hop sont aisés et bien placés sur l’échelle sociale. Le mouvement hip-hop a été aussi un espace où le même genre d’individus a pu se construire un habitus, un lien entre les structures sociales et leurs pratiques culturelles. Notre démarche nous a poussé à également réfléchir sur la nature des échanges culturels. Ils sont le résultat de la mondialisation de l’économie, une mondialisation qui s’opère généralement au profit des pays qui dominent l’économie mondiale. Pour désigner les activités industrielles qui produisent et commercialisent les discours, sons, images, arts et toutes autres capacités ou habitudes acquises par l’homme en tant que membre de la société, le concept d’« Industrie Culturelle » a été adopté. Ce terme semble avoir été utilisé pour la première fois en 1967 par Théodore W. Adorno et Max Horkheimer, deux sociologues de l’école de Francfort (Dallage, Ouellet, Turgeon, 1997 : 15). Ils remettaient en cause les reproductions en série de biens culturels, menaçant la création artistique et les pratiques culturelles. Cependant, la mondialisation n’empêche pas que toute culture soit singulière géographiquement ou socialement localisée. Pour mieux comprendre le lien entre la musique, la culture traditionnelle et la culture populaire, un ouvrage indispensable a été Popular music and youth culture du chercheur Andy Bennett. L’auteur explore d’abord les différents concepts utilisés par les spécialistes de la culture et des médias ainsi que les sociologues pour théoriser la culture des jeunes et la musique populaire. Dans la construction des identités culturelles autour des produits de la culture populaire, manufacturés et vendus par les industries culturelles euro-américaines, il existe une interaction entre les forces locales et mondiales. Pour théoriser cette relation entre le « global » (mondial) et le « local », Andy Bennett utilise un concept dont nous nous servirons et qui désigne la fusion des deux forces : « Glocal cultures ». Le concept de la créolisation sera essentiel dans notre réflexion car nous tenterons de mettre en évidence l’impact culturel de l’espace caribéen, malgré sa petite taille et son faible poids économique, sur les États-Unis d’Amérique. Le terme vient de la linguistique et désigne à l’origine le processus de formation des langues créoles. Il est repris par des anthropologues et des sociologues pour désigner certaines configurations du contact culturel. L’esclavage et la traite transatlantique sont des événements fondateurs de la créolisation. Ces événements sociohistoriques permirent le brassage de plusieurs cultures et donnèrent naissance à un ensemble de repères structurels et langagiers pour la population qui dut vivre au sein de
30
cette « nouvelle » société. Depuis les années 70, de nombreuses études menées par différents chercheurs soulignent les pertinences de ce métissage, de cette première mondialisation opérée par la société esclavagiste et la colonisation européenne, un métissage anticonformiste qui n’assujettit pas mais qui adopte et adapte. Cette réflexion poussa Édouard Glissant à poser la question suivante : assistons-nous à une créolisation du monde ? Tandis qu'Aimé Césaire, durant les années 30, redonne sa place à la part nègre dans ce nouveau brassage, les travaux de Glissant, comme ceux de Confiant, de Chamoiseau et de Bernabé, s'assurent qu'aucune composante ne soit survalorisée au détriment des autres. Selon lui, la créolisation est devenue significative d'un état du monde où les cultures s'interpénètrent et s'influencent mutuellement. Selon Raphaël Confiant dans un article intitulé « Éloge de la diversalité », il y a donc plusieurs leçons à tirer de l’expérience antillaise, ce phénomène inédit de brassage culturel dynamique de peuples originaires des quatre continents. Cette expérience a inventé de toutes pièces l’identité multiculturelle. Loin de fusionner jusqu’à effacer les traces de leurs origines, les composants des quatre continents se sont juxtaposés sans presque jamais disparaître en tant que tels. C’est ce phénomène que nous observons entre la culture hip-hop et le mouvement rastafari. « La mondialisation créole » valorise le multiculturalisme, c’est-à-dire le mélange, le partage des expériences, des histoires et des identités, le non-cloisonnement des imaginaires. Cela nous contraint à reconnaître que nous possédons une partie de l’autre en nous et qu’il a donc droit à notre respect absolu. Si la politique répond aux questions quant à l’organisation de la « cité », le fait religieux répond aux interrogations existentielles. Il revêt une importance particulière dans la Caraïbe puisque ce sont des sociétés fondées sur la violence, une violence qui poussa d’autant plus les individus à y trouver des réponses aux questions existentielles. Le rap et le reggae, suivant la tradition de la musique de la diaspora africaine ont, depuis leur création, été religieusement investis. Il y a eu des artistes religieux qui ont utilisé la musique pour diffuser leurs croyances. En somme, au niveau de la fonction sociale, religion et culture remplissent un rôle similaire : celui de réguler la vie de l’individu. Dans la perspective de l’anthropologie culturelle, Clifford Geertz définit la religion comme: « un système de symboles qui agit de manière à susciter chez les hommes des motivations et des dispositions puissantes, profondes et durables, en formulant des conceptions d’ordre général sur l’existence et en donnant à ces conceptions une telle apparence de réalité que ces motivations et ces dispositions ne semblent s’appuyer que sur le réel » (Banton, 1966 : 4). Ces deux concepts, religion et culture, sont les résultats de particularismes socioculturels qui, eux-mêmes, sont le résultat d’une quête d’identité. Les
31
adeptes ont le sentiment de ne pas participer suffisamment au contrôle de leur vie personnelle et de leur monde social. Un individu peut s’identifier comme étant membre d’un parti politique ou comme étant croyant, comme membre d’une classe sociale ou comme membre d’une organisation ou d’une culture quelconque. Il peut aussi, selon les crises et les situations, combiner plusieurs identifications. Pour les peuples opprimés, la religion est souvent un moyen leur permettant d’exprimer leur identité nationale. Si le politique a pu se faire religion, la religion peut aussi se faire politique, soit sur un mode attestataire qui légitime la situation politique, soit sur un mode protestataire qui légitime le changement sociopolitique. Un groupe religieux qui prône la distanciation par rapport aux affaires de la cité peut avoir des effets politiques car il n’y a aucune manière de parler de Dieu qui soit totalement neutre sur le plan politique. En effet, toute théologie véhicule une certaine vision du monde social, même celles qui n’explicitent en rien cette vision. La religion est à la fois un système social et une culture. Leurs formes naissent et disparaissent pour être remplacées par d’autres plus en accord avec les contextes sociaux. Peter Beyer, professeur au sein du Département d’étude des religions à l’université de Toronto, a écrit un ouvrage intitulé Religion and globalization (1994), qui explore la religion face au changement social et culturel dans le cadre de la mondialisation. Il étudie la manière dont les changements de situation dans le monde agissent sur les pratiques, les significations et l’influence de la religion. Selon lui, la religion peut utiliser les mouvements sociaux pour avoir une plus grande exposition. Tant qu’il y aura des problèmes que la société ne pourra régler, les mouvements sociaux continueront à émerger avec la possibilité qu’ils s’aident de ressources religieuses pour mobiliser. Sous les conditions de la modernisation et de la mondialisation, le premier moyen pour la religion d’avoir plus d’influence publique est de devenir elle-même une ressource culturelle pour d’autres systèmes. Il faut donc s’attendre à ce que des mouvements religieux fusionnent avec les mouvements socioculturels et leurs expressions. L’observation de certains aspects de la société ou d’une culture s’est traduit par des « enquêtes » de terrain visant à confirmer les hypothèses élaborées à partir de nos sources documentaires. Dans notre cas particulièrement, l’interculturalité est souvent observée par le chercheur : les acteurs n’en sont pas souvent conscients. Nous sommes allé à la rencontre de ces derniers de façon à effectuer des entretiens et collecter d’autres données. L’analyse des entretiens avec les acteurs de ces deux cultures ainsi que ceux qui sont en situation d’interculturalité nous a permis de mieux discerner le sens de leurs pratiques culturelles. Enfin, notre méthodologie comprend aussi des entrevues avec des acteurs des deux mouvements, des participants en
32
situation d’interculturalité, une analyse historique comparative, ainsi que des analyses iconographiques et cinématographiques. Une première partie intitulée « Implantation des mouvements hip-hop et rastafari hors de leur berceau géographique » analyse l’implantation du mouvement hip-hop en Jamaïque et celle du mouvement rastafari aux EtatsUnis. Le développement des moyens de communication a facilité la propagation des cultures rastafari et hip-hop, qui se sont répandues dans la majeure partie des sociétés du globe. C’est la raison pour laquelle nous étudierons cet aspect des choses en réfléchissant sur la relation entre culture locale et culture globale. Ces déterritorialisations participent pleinement aux échanges interculurels entre les deux mouvements. Étant établies dans des espaces géographiques différents, les pratiques du mouvement hip-hop et du mouvement rastafari diffèrent mais leur intention semble être identique : revendiquer une existence et une identité à part entière dans une société qui niait la participation des communautés noires créatrices. Notre hypothèse sous-entend que les motivations et les besoins socioculturels des deux communautés (latino-américaine et afro-caribéenne) étant identiques, leurs expressions sont naturellement conduites à se rapprocher. Dans une deuxième partie intitulée « Causes des transferts culturels entre le mouvement hip-hop et le mouvement rastafari », nous porterons notre réflexion sur les origines des transferts culturels entre les deux mouvements. Pour ce faire, nous examinerons les réflexions de Homi Bhabha sur les études postcoloniales, les mouvements migratoires entre la région Caraïbe et les Etats-Unis et les expériences similaires vécues par la diaspora noire des Amériques. Pour achever notre réflexion, dans une ultime partie intitulée « Manifestations des transferts interculturels entre le mouvement rastafari et le mouvement hip-hop », notre travail consistera à mettre en relief les rapprochements idéologiques et artistiques entre les deux phénomènes. Nous porterons notre attention particulièrement sur l’aspect musical en étudiant les échanges musicaux, les convergences dans la thématique des textes, puis en retraçant le parcours de deux groupes de rap composés de rastas et basés aux États-Unis.
33
PREMIÈRE PARTIE IMPLANTATION DES MOUVEMENTS HIP-HOP ET RASTAFARI HORS DE LEUR BERCEAU GÉOGRAPHIQUE
Dans cette partie nous tenterons de comprendre comment le mouvement hiphop et le mouvement rastafari se sont exportés hors de leur espace géographique « natal ». Le premier est arrivé dans la région Caraïbe dès le début des années 90 et le second aux États-Unis dès le milieu des années 70. C’est d’ailleurs cet échange culturel qui facilita la rencontre des deux phénomènes.
CHAPITRE 1 LA CULTURE HIP-HOP EN JAMAÏQUE Introduction La culture hip-hop est un phénomène nord-américain qui se répand grâce aux puissants moyens de communication mis en place par les industries culturelles étasuniennes. C’est à travers ce prisme que nous poserons la base conceptuelle de notre développement. Nous étudierons l’interaction entre la culture locale et la culture dite « globale ». Comment se développent les pratiques culturelles issues de la mondialisation dans un contexte local ? Encouragent-elles la diversification, l’interpénétration culturelle ou l’homogénéisation, voire l’hégémonie culturelle ? Pour décrire cette relation, le sociologue Roland Robertson a inventé le terme « glocalisation » (Macionnis, Plummer, 2002 : 661). Le concept a pris une importance majeure dans la sociologie contemporaine. La « glocalisation » implique que, malgré les mécanismes économiques et culturels mondiaux bouleversant le globe, chaque produit culturel est repris et réinterprété de manière unique par le contexte local dans lequel il se retrouve. Une culture est considérée comme locale lorsqu’elle représente de manière singulière une nation et son peuple. Par conséquent si le mouvement hip-hop traduit le contexte socioculturel et la particularité d’une nation, il peut être considéré comme une forme culturelle locale. Étant donné que la culture hip-hop est d’abord une culture « globale » (sauf dans son pays de naissance), nous pourrons ainsi nommer le mouvement hip-hop implanté dans les sociétés sélectionnées « culture glocale ». Le sociologue jamaïcain Orlando Patterson reconnaît également que, depuis les années 50, la modernisation et l’industrialisation ont facilité les transferts culturels. Ces transferts ont transformé les populations des autres sociétés (Bolland, 2004 : 633). Dès 1968, le musicologue Alan Lomax exprime sa crainte de voir les cultures locales disparaître sous l’influence de la culture nord-américaine (ibid. 634). Une citation d’Alvin Toffler tirée de l’ouvrage The culture consumers (1964) exprime bien les risques qui existent lorsqu’une culture se diffuse largement : gets »8
« The Law of Raspberry : the wider any culture is spread, the thinner it
8
Traduction : « La loi de la framboise : plus une culture s’étend, plus elle se restreint ».
37
Toutefois, les nouveaux phénomènes culturels ont clairement des évidences de la culture mondiale tout en étant modifiés en une forme unique reflétant la culture locale. C’est d’ailleurs cet aspect que nous nous efforcerons de souligner dans notre analyse du mouvement hip-hop en Jamaïque. Comment le hip-hop est-il arrivé sur l’île ? Est-ce que l’identité locale s’émancipe au sein du mouvement hip-hop ? Quels sont les moyens utilisés par ses adeptes pour véhiculer et maintenir en vie leurs différentes expressions ? Ont-ils des relations avec des adeptes nord-américains et entre eux dans la région Caraïbe ? La culture transmise par des moyens technologiques modernes n’est pas forcément respectueuse des traditions. Comment considèrent-ils le hip-hop : comme un produit importé ou comme une manière de vivre ? Estce une culture ayant des traditions et des éléments fondateurs ? Enfin, quelles sont leurs aspirations pour le mouvement hip-hop qui se développe dans leur espace culturel ? Autant d’interrogations qui nous permettront de saisir la dynamique du mouvement hip-hop à la Jamaïque, berceau du mouvement rastafari.
1.1.1 : Relation entre culture hip-hop et culture locale Wayne Marshall, chercheur en ethnomusicologie de l’université de Madison, a eu l’opportunité de mener des recherches sur la culture hip-hop en Jamaïque à partir de 2003. Il les a dirigées vers des artistes dancehall et reggae qui tentaient de faire fusionner le rap et leur expression9. Il a étudié l’expression de ces cultures locales à travers le rap et ne s’est pas intéressé uniquement à leurs aux adeptes (danseurs, graffeurs, DJ, producteurs et rappeurs) et à l’histoire du mouvement hip-hop en Jamaïque. Durant notre séjour dans l’île, du 3 au 13 mai 2007, nous sommes allé sur le terrain à la recherche de ces adeptes. Nous avons mené une série d’entretiens dans le cadre d’un studio d’enregistrement situé à New Kingston, la partie rénovée de la ville. Nos contacts avec les rappeurs présents pour enregistrer leurs chansons nous ont permis également de rencontrer des producteurs et des ingénieurs du son.
9
“Hip-hop in Jamaica: representing the local through international Sound”. Annual meeting of the Society of ethnomusicology, Miami, October 5, 2003. “Hip-hop in Jamaica, Reggae in Boston: A Preliminary Comparison” Wayne Marshall – communication présentée à la conférence Dance, Drum, and Drink: Transposing Heritage through Expressive and Material Culture, Department of Folklore and Mythology, Université d’Harvard, février 2004.
38
Dans le corpus de notre recherche, nous avons, en premier lieu, tenté d’établir une chronologie du mouvement hip-hop, de repérer les choix langagiers, thématiques, musicaux et idéologiques des participants. En deuxième lieu, nous avons également évalué la perception du hip-hop en Jamaïque, la relation entre culture locale et culture hip-hop ainsi que les moyens mis en œuvre par les adeptes pour maintenir et diffuser la culture. Enfin nous avons considéré les relations que les « hip-hoppers » jamaïcains entretenaient avec leurs homologues de la zone Caraïbe-Amérique. Gambling House Recordings, c’est le nom du studio où les artistes reggae, dancehall, R-n-B et rap viennent faire des prises de voix à New-Kingston. C’est également un label de production musicale structuré par trois artistes rap originaires de l’île : Alique Archer (Julio Sluggs), Kimani (Kjohn) et Sadike Johnston (Hunka Gold). La décision d’avoir leur propre studio d’enregistrement fut prise parce qu’ils ne voulaient plus payer pour enregistrer leurs chansons mais surtout parce qu’ils désiraient créer un espace musical spécialement dédié au rap, un espace avec des ingénieurs de son spécialisés en rap, car peu d’entre eux en Jamaïque s’étaient familiarisés avec cette musique. Gambling House est aujourd’hui un passage obligé pour la majeure partie des artistes rap émergeants en Jamaïque. Dans le studio, un poste de télévision est constamment allumé et branché sur la station africaineaméricaine dédiée à la musique urbaine, Black Entertainment Television (BET). La plupart des participants fument de la marijuana ; ils discutent avec passion des rivalités entre les rappeurs aux États-Unis, des ventes de disques, du comportement de leurs artistes préférés. On peut aussi les entendre discuter des rivalités entre les artistes dancehall, le courant musical dominant sur l’île. Ils sont partagés entre deux cultures qu’ils semblent vivre ouvertement. Nous nous sommes, pendant une semaine, immergé dans leur quotidien afin de mieux cerner le développement de la culture hip-hop en Jamaïque. La fierté se perçoit dans le ton et la réponse des participants lorsque nous leur demandons comment le hip-hop est arrivé en Jamaïque. Tous conscients du rôle capital de DJ Kool Herc, le jeune émigré jamaïcain qui organisa les premières fêtes de quartier à New York, donnant naissance au hip-hop, ils répondent que le mouvement hip-hop ne peut pas être arrivé en Jamaïque, puisqu’il y est né. Ils mettent un point d’honneur à démontrer que, sans la Jamaïque, le mouvement hip-hop n’existerait pas aujourd’hui. Nous pouvons comprendre ce sursaut de fierté qui les anime en tant que « petits cousins ou petits frères » de DJ Kool Herc. Sa terre natale a hérité des graines du mouvement hip-hop qu’il a fait naître à New York au début des années 70.
39
Néanmoins, il faut reconnaître que si la Jamaïque a fourni la technique du « Sound system » (nous y reviendrons un peu plus tard dans notre développement), les États-Unis ont fourni le cadre spatio-temporel, l’art oratoire des « dozens », la danse et les conditions matérielles (les bombes de peinture pour les graffitis, l’équipement audiophonique) qui favorisèrent la naissance de la culture hip-hop. Deux facteurs sont déterminants dans l'apparition du mouvement hip-hop en Jamaïque : la télévision câblée et les séjours fréquents des participants ou de leurs connaissances aux États-Unis. Étant donné la proximité entre la Jamaïque et les Etats-Unis, l’île a toujours été influencée plus ou moins par la culture nord-américaine. Les radios basées aux États-Unis émettaient en Jamaïque. Dès 1992, c’est la télévision câblée (MTV, VH1) qui perpétue cette dynamique. Les premières émissions de rap sont diffusées dans les foyers jamaïcains (Yo ! MTV raps !, Rap City ). À travers ces émissions, la jeunesse jamaïcaine découvre la culture hip-hop et ses éléments, à savoir la danse, le rap, le graffiti et le Djing (en partie, cet art existait déjà sur l’île avant la naissance de la culture hip-hop à New York). Les premiers foyers qui reçoivent la télévision câblée appartiennent aux classes sociales aisées. Durant la deuxième moitié des années 90, la télévision câblée se démocratise et devient plus accessible aux classes sociales plus modestes. Nous le verrons dans notre développement mais ce schéma aura des répercussions sur la typologie du mouvement hiphop. Selon Instinctz, un rappeur et compositeur avec qui nous nous sommes entretenu, avant la télévision, des cassettes audio circulaient et permettaient à d’autres jeunes de découvrir le mouvement. Ces cassettes arrivaient en Jamaïque par l’intermédiaire de parents vivant aux États-Unis. Aujourd’hui, avec la dancehall et le reggae, le rap nord-américain fait partie des trois sortes de musique les plus populaires de l’île. Nos entretiens nous permettent d’affirmer qu’il existe au minimum deux générations dans le mouvement hip-hop en Jamaïque : celle du début des années 90 et celle de la fin des années 90 voire du début des années 2000. Les premiers rappeurs de la Jamaïque sont inspirés par le style et l’idéologie rap du début des années 90 en provenance de la côte Est des Etats-Unis : des musiques aux sonorités sombres, des débits précis moins dansants et beaucoup d’effort dans l’écriture. Les rappeurs originaires de la côte Est tels que Nas, Wu-Tang Clan, EPMD, Blackmoon conditionnent leur manière d’écrire et de rapper. Puis, à la fin des années 90, avec la démocratisation de la télévision câblée, la deuxième génération hip-hop a accès à une culture
40
plus standardisée. Elle n’a pas connaissance des fondations musicales et historiques de la culture. Aujourd’hui, Instinctz nous fait remarquer qu’il existe des clones de rappeurs nord-américains en Jamaïque, des rappeurs qui ne comprennent pas la culture hip-hop et copient simplement ces derniers. C’est le résultat de la médiatisation et de l’uniformisation de la culture hiphop : une culture consommée comme un produit et non vécue comme un style de vie avec des traditions. Instinctz étant notre informateur le plus âgé (27 ans), c’est lui qui pouvait le mieux nous renseigner sur l’implantation de la danse hip-hop en Jamaïque. Tandis que nos autres informateurs nous assuraient que la danse hip-hop, la « Breakdance », n’avait jamais été introduite dans l’île, Instinctz affirmait le contraire. Selon lui, durant les années 80, le phénomène avait une grande ampleur. Certains de ses amis plus âgés lui parlaient de leurs groupes de danse et de leurs affrontements avec d’autres groupes. Ils lui parlaient également des chansons qu’ils utilisaient pour leur chorégraphie. Ils s’inspiraient de Crazy Legs, un pionnier nord-américain de la danse hip-hop. Les mouvements les plus populaires étaient des mouvements exécutés debout et non pas au sol. Aujourd’hui, il semble que la danse hip-hop ait perdu son élan des années 80. Malgré nos recherches et nos contacts, lors de notre séjour, nous n’avons pas pu rencontrer de danseurs. Nos autres informateurs affirmaient que la danse hip-hop ne s’était pas implantée sur l’île ou du moins, si c’était le cas, cela n’avait pas duré à cause du dynamisme de la danse locale. La musique dancehall associée à la danse, en raison de sa popularité, empêche toute évolution de la danse hip-hop en Jamaïque. S’il arrive que certains éléments de la danse hip-hop soient incorporés dans la danse associée à la musique dancehall, la danse hip-hop ne se démarque pas pour créer un courant à part. L’art graffiti ne s’est pas développé en Jamaïque. Depuis son accès à l’indépendance, l’île est très endettée envers le Fonds Monétaire International et, sa situation économique fait d’elle un pays du Tiers-Monde. Dans ces conditions, les artistes potentiels spécialistes du graffiti ne pouvaient pas avoir accès aux bombes de peinture trop onéreuses sachant qu’il en faut plusieurs pour réaliser un seul graffiti. Les inscriptions sur les murs sont de nature politique. On trouve des inscriptions d’une seule et unique couleur représentant le nom d’un parti politique (JLP ou PNP) ou encore des artistes peintres dont le travail ne nécessite pas de bombes mais de la peinture en étuis simples. Ces travaux ne sont pas des graffitis émanant de la culture hip-hop.
41
La deuxième cause principale de l’arrivée du mouvement, ce sont les contacts entre les deux espaces géographiques par le biais des échanges humains. La plupart des participants sont partis aux États-Unis pendant de courtes ou de longues périodes. Durant leur séjour, ils se sont familiarisés avec la culture hip-hop et l’ont adoptée comme moyen d’expression. Sadique (alias Hunkagold) et Kimani (alias KJohn) ont effectué une partie de leur scolarité en Géorgie et en Floride, entre 1996 et 2001. Alique (alias Julio Sluggs) a résidé à New York entre 1995 et 1999, dans le cadre de ses études supérieures. Là, il a fait partie d’un « Sound system » et ne commença à rapper qu’à son retour en Jamaïque. Sadique précise que sa rencontre avec le hip-hop a eu lieu en 1996 par le biais d’un disque du groupe The Fugees. Il commence alors à rechercher les origines du mouvement, à écouter les premiers disques et découvre le lien entre la culture jamaïcaine et la culture hip-hop. Dans le courant de l’année 2007, un jeune rappeur de 17 ans nommé Kisan Anderson alias Sean Kingston a été révélé au grand public. Ses parents sont originaires de la Jamaïque quant à lui, il y a vécu 3 ans, entre l’âge de 7 et 10 ans. Même s’il est né à Miami, Sean Kingston tient à affirmer ses liens avec la Jamaïque. Cela se traduit par le choix de son nom d’artiste inspiré par la capitale de l’île et par le fait que, dans ses apparitions photographiques ou vidéo, il arbore les couleurs de la Jamaïque. Il précise dans un entretien accordé au quotidien jamaïcain, The Gleaner, qu’il tient à affirmer ses origines10. Sentiments patriotiques ou démarche commerciale, la question reste entière. Aucun de nos intervenants n’avait, au moment de notre visite, des contacts avec Sean Kingston. Il est vrai que, dans ses chansons, il utilise un mélange de créole jamaïcain et d’argot africain-américain. Il n’hésite pas à évoquer certaines réalités de la société jamaïcaine.
10
http://www.jamaica-gleaner.com/gleaner/20070909/ent/ent2.html
42
Frank Grizzy, cliché de Steve Gadet, Jamaïque, mai 2007.
Frank Grizzy est né en Jamaïque. Il a vécu à New York entre 1987 et 1995, et est revenu en Jamaïque à l’âge de 14 ans. Son père étant musicien de profession, il l’a alors suivi lorsqu’il s’est expatrié aux États-Unis. Sosa, membre du groupe The Bullet Proof Army, vit actuellement à Brooklyn. Shermon, appartenant au même groupe, a eu l’opportunité de partir en vacances aux États-Unis. Ses liens avec des amis et des membres de familles qui vivaient aux États-Unis ont facilité son affiliation à la culture hip-hop. Leur accent, leurs expériences de la vie nord-américaine ont particulièrement éveillé sa curiosité vis-à-vis de la culture hip-hop. Instinctz, un rappeur-compositeur, a eu l’occasion de rendre visite à des amis et des membres de sa famille à plusieurs reprises. Ses voyages aux ÉtatsUnis ont stimulé sa ferveur pour le hip-hop. Ils lui ont également permis de
43
rencontrer des rappeurs nord-américains et de se ravitailler en disques de rap.
Instinctz, cliché de Steve Gadet, Jamaïque, Mai 2007.
TSD (The Sickest Drama) est né en Jamaïque mais à l’âge de 6 mois sa famille est partie s’installer dans le New Jersey aux États-Unis. Lorsqu’il revient sur l’île, il est âgé de 14 ans. Adepte du mouvement hip-hop depuis les États-Unis, il ne commence à rapper que lors de son retour en Jamaïque.
44
TSD, cliché de Steve Gadet, Jamaïque, Mai 2007.
L’exception du groupe, c’est Shaq The MC qui est né à Londres de parents jamaïcains et qui a grandi entre l’Angleterre et la Jamaïque. Il est rentré définitivement en Jamaïque à l’âge de dix ans. Il y découvre la culture hiphop et commence à y rapper en 1995. Il s’est également rendu aux ÉtatsUnis pour des séjours de courte durée chez des amis et des membres de sa famille.
45
Shaq The MC, cliché de Steve Gadet, Jamaïque, mai 2007.
Swire découvre le hip-hop à l’âge de 10 ans par le biais de MTV. Sa découverte se fait par l’intermédiaire du groupe Wu-Tang Clan en voyant leur clip vidéo. Il s’immerge encore plus dans le mouvement lorsqu’il part faire ses études supérieures dans le Wisconsin, aux États-Unis, entre 2000 et 2003. J.R. Bartley, alias Wallabee, est né en Jamaïque mais a vécu aux États-Unis depuis l’âge de 2 ans. Il revient dans son pays de naissance à l’âge de 13 ans. Il grandit avec la culture hip-hop et n’écoute que du rap. Ce n’est qu’à son retour en Jamaïque qu’il découvre la musique dancehall. Il commence à rapper à l’âge de 15 ans et retourne régulièrement aux États-Unis durant les vacances scolaires. Il en profite pour acheter des albums de rap et se tenir informé des nouvelles tendances du mouvement.
46
J.R. Bartley, alias Wallabee, cliché de Steve Gadet, Jamaïque, Mai 2007.
Aujourd’hui, selon l’un de nos informateurs, un nombre croissant de jeunes issus de milieux favorisés se tournent vers le hip-hop. Ils y sont plus sensibles, car ils ont accès à la télévision câblée et ils partent souvent aux États-Unis en vacances ou pour « faire du shopping ». Le hip-hop devient leur mode d’expression privilégié. La plupart de nos informateurs ont séjourné aux États-Unis et sont originaires de la ville de Kingston. Leur immersion dans la société d’origine du mouvement hip-hop a joué un rôle important dans leur affiliation à son mode d’expression dominant, le rap. Certains d’entre eux n’ont commencé à rapper qu’à leur retour sur l’île. En voyant l’émulation autour du phénomène en Jamaïque à leur retour, ils n’ont pas eu de difficulté à s’identifier et à participer à ce mode d’expression. Instinctz, Wallabee, TSD, Swire et Frank Dizzy ont tous fréquenté le même lycée à la même période. Leur possibilité de voyager et de faire des études supérieures aux États-Unis s’explique par leur appartenance à la classe sociale aisée de la société jamaïcaine. La plupart des membres de la culture hip-hop viennent de milieux aisés tandis que les adeptes de la culture dancehall en Jamaïque proviennent de milieux défavorisés. Ils s’identifient plus facilement à la culture des ghettos locaux. En Jamaïque, les classes pauvres sont généralement noires et l’on constate que plus le niveau social s’élève, plus la couleur de peau s’éclaircit. Lorsque nous avons demandé aux membres collectif Wallstreet (Hunkagold, KJohn,
47
Julio Sluggs) de citer l’endroit d’où ils venaient, ils se sont empressés de répondre en chœur : « Kingston ! » sans pour autant préciser un nom de quartier. Une gêne était perceptible. Dire simplement « Kingston », qui est l’une des villes les plus dangereuses au monde, laisse de la place pour l’inconnu et la possibilité d’avoir une crédibilité dans la rue. Cela peut laisser entendre qu’ils proviennent d’un environnement périlleux comme certains de leurs homologues nord-américains. Cette origine et cette connaissance du « code de la rue » sont très valorisées dans le mouvement hip-hop donc cela revêt une importance particulière. En revanche, préciser un nom de quartier, qui pourrait se trouver à Kingston mais être aisé, peut jeter le discrédit sur leur personne, leurs paroles et leur image dans le mouvement hip-hop. “We grew up with the BET influences as well as the dancehall influences”11 Alique
Nous nous sommes également intéressé aux différents éléments de la culture locale qui s’intégraient au mouvement hip-hop jamaïcain. Comment les adeptes négocient-ils leur appartenance au mouvement hip-hop en relation avec leur identité jamaïcaine ? Quelle langue utilisent-ils dans leur rap ? Comment sont-ils perçus par le reste de la population et, à travers eux, le mouvement hip-hop, comment est-il perçu ?
11
Traduction : « Nous avons grandi avec l’influence de BET et l’influence de la culture dancehall »
48
Tatouage « Gambling House Recordings » de Kimani, cliché de Steve Gadet, Jamaïque, mai 2007.
Le tatouage est une pratique très populaire parmi les adeptes du mouvement hip-hop aux États-Unis. Sur celui de Kimani, on distingue le drapeau de la Jamaïque et le nom de son label Gambling House Recordings. La musique jamaïcaine traditionnelle, ce n’est pas le rap, mais le reggae ou la dancehall. Ces musiques sont très populaires et très influentes sur l’île. Les chanteurs sont des porte-parole ; ils définissent les modes vestimentaires et les codes langagiers de la jeunesse. Indirectement, leur affiliation à un quartier a des conséquences politiques car ils sont protégés par des gangs qui sont euxmêmes affiliés aux partis politiques. Leur musique reflète les divisions sociales et raciales de l’île ainsi que la dynamique des relations entre hommes et femmes. Lorsqu’ils avouent faire du rap, les adeptes du mouvement hip-hop sont accusés de « tourner le dos à la Jamaïque » au profit d’une culture étrangère. Tandis que ces artistes utilisent le créole jamaïcain pour composer leurs textes, les rappeurs utilisent l’anglais et l’accent africain-américain. Ce fait est la principale pomme de discorde entre une partie de la population et les adeptes de la culture hip-hop. La langue est une composante incontournable de la culture ; elle transporte la mémoire et les valeurs de cette culture. Le fait de ne pas utiliser leur accent naturel et
49
leur langue est perçu comme un manque d’affirmation de soi, une trahison envers leur culture d’origine. « When you’d say you do hip-hop, first response you’d get is: youth you better do dancehall, youth you’d better do some culture»12 Frank Grizzy
Selon Kimani, ayant vécu aux État-Unis avec son frère, ils ont dû s’adapter à leur environnement. Il justifie l’utilisation de cette langue et de cet accent par le fait qu’ils leur donnent accès à un public plus large, car le créole jamaïcain n’est pas compris par tous. Leurs références sont les pionniers du mouvement. C’est la raison pour laquelle ils cherchent à se faire comprendre, juger et accepter par eux. Cependant, ils ne cherchent pas à reproduire la réalité nord-américaine, car ils ne vivent pas les mêmes expériences, donc leurs thèmes, leur vocabulaire sont différents. Kimani explique comment il arrive à négocier le lien entre culture « globale » et culture locale : « Tu dois avoir cet équilibre, tu ne peux pas dire tout ce qu’ils [les rappeurs nord-américains] disent. Tu dois trouver ta manière de le dire et le rendre compréhensible pour les Jamaïcains, pas les Américains, parce qu’ils sont les premiers à écouter notre musique avant qu’elle n’arrive aux États-Unis.» « Je ne rapperai pas à propos de Brooklyn, je n’ai jamais été à Brooklyn! J’essaie de mentionner des choses jamaïcaines, de parler du pays, de ce qui s’y passe (…) Tant que tu parles de tes expériences, c’est ce que les gens apprécient. »13
À travers les thèmes de leurs chansons, leurs images et leur choix de mots et d’expressions, ils se rapprochent de leur quotidien en Jamaïque. Parler de leur vécu et de leur environnement, indépendamment de la langue qu’ils utilisent, c’est ce qui rend leur musique originale. Shermon, un rappeur faisant partie du groupe Bullet Proof Army, ne pense pas renier sa culture en s’exprimant avec un accent. Selon lui, c’est la meilleure manière dont il dispose pour s’exprimer, étant donné qu’il a été « nourri » de rap nordaméricain depuis son enfance. C’est de cette perspective que lui vient la confiance en son art. On n’échappe pas à sa culture. Elle est subliminale et
12
« Quand tu dis que tu fais du hip-hop, la première réaction c’est « jeune homme, tu ferais mieux de faire du dancehall ! ou encore « jeune homme tu ferais mieux de faire de la culture » [du reggae conscient] » 13 Entretien mené en mai 2007, Kingston, Jamaïque.
50
ressort, qu’on le veuille ou pas. A cause de son environnement, de sa culture, son expression reste unique. Instinctz nous révèle qu’au début des années 90, lorsqu’il découvre le hiphop, il mène une double vie. Avec certains amis, il ne peut pas discuter de cette nouvelle forme d’expression. Il parle de dancehall, craignant de ne pas être compris. Avec d’autres, ceux qui la partagent, il discute de sa découverte. Lorsqu’il essaie de démarcher ses chansons vers les radios, les programmateurs l’accusent de se vendre. Il vit cette attitude comme un manque d’ouverture et de créativité et n’arrive pas à comprendre ce rejet. La plupart des Jamaïcains ne voient pas l’utilité du rap et ne le perçoient que comme une culture envahissante, voire aliénante. Selon Alique, même s’ils sont critiqués à cause de l’accent nord-américain, ils s’imposeront par leur talent. Il nous rapporte que certains jeunes Jamaïcains apprécient leur musique et disent : « J’aime quand vous rappez parce que vous rappez comme des Américains mais vous parlez de ce qui se passe en Jamaïque ! »14
Les rappeurs nous ont fourni une autre explication quant à leur choix langagier. Les chanteurs de dancehall se sont approprié le créole jamaïcain si bien que cette langue, cet accent, renvoient directement à ce type de musique. « Chanter » en créole, c’est faire de la dancehall, donc pour se démarquer de ce courant musical, ils utilisent l’anglais nord-américain qui convient plus au rap. Leur rap, c’est leur voix issue de la Jamaïque, mais destinée au reste du monde donc de manière plus compréhensible. Dans une chanson intitulée Where I’m from, Kimani décrit son île : “Where i’m from Where niggers pack rachets stones and guns, in your own house you can get hung Cause where I’m from Drug dealers and politicians with guns is really how my country is run And where I’m from Whether it’s uptown or downtown, the streets ain’t no fun Where I’m from With love from JA with big guns Kingston is where I’m from So where you from? ”15
14
Entretien mené en Mai 2007, Kingston, Jamaïque. « D’où je viens/C’est l’endroit où les Négros portent des pierres, des fusils, tu peux te faire pendre dans ta propre maison/Parce que d’où je viens/Les dealers et les hommes politiques avec des fusils, c’est comme ça que mon pays est gouverné/D’où
15
51
Il décrit la violence qui sévit sur l’île dans le milieu politique et qui touche toutes les classes sociales. Il se concentre sur les aspects négatifs : le lien entre drogue, politique et violence, la propagation des armes à feu. Kimani utilise le mot « négro » de la même manière que les Africains-Américains. Cependant, ce n’est pas un mot qui revient régulièrement dans leurs codes langagiers quand ils ne rappent pas. Ce n’est pas un mot qui est utilisé régulièrement en Jamaïque. Cette utilisation traduit clairement l’influence de la culture hip-hop nord-américaine. En général, les thèmes de leurs chansons varient : les relations hommesfemmes, la vie politique dominée par deux grands partis depuis des décennies, l’arrivée de drogue et d’armes sur l’île, des conseils aux plus jeunes, la vie nocturne, etc… Tous ces thèmes singularisent leur expression et permettent de la qualifier d’expression « jamaïcaine ». Ils écrivent aussi des textes au moyen desquels ils se mesurent aux autres rappeurs et démontrent leurs capacités lyriques et artistiques (un genre de rap dénommé « egotrip »). Dans une de ses compositions intitulée Dear son, Frank Grizzy s’adresse au père et au fils qui ont été séparés l’un de l’autre pour différentes raisons (familiales, professionnelles, etc…). Il n’hésite pas à se livrer et à parler ouvertement de son propre parcours. En réalité, le rap est une réponse à leur quête d’identité, une manière de s’identifier et de se présenter : « I just express myself, straight off the top, I freestyle just to let you know myself »16 Shermon
Il existe cependant des rappeurs qui utilisent le créole jamaïcain mais ils sont moins nombreux et nous n’avons pas pu les rencontrer durant notre séjour afin qu’ils motivent leurs choix langagiers (Beast, Cash). Des rappeurs nordaméricains originaires de la Jamaïque ont eu l’occasion de s’exprimer en créole jamaïcain dès le début des années 90 (Smiff and Wessun, connus aujourd’hui sous le nom de Cocoa Brovaz, avec le titre Sound Bwoy Bureill en 1995, Originoo Gun Clappers avec l’album Dah storm en 1996), une démarche qui leur permet de se différencier aux États-Unis et d’affirmer
je viens/Dans les beaux quartiers ou dans les bas quartiers, la rue n’a rien de drôle/D’où je viens/Avec de gros fusils et de l’amour en provenance de la Jamaïque/Je viens de Kingston/Et toi, tu viens d’où ? » 16 Traduction : « Je m’exprime simplement, sans réfléchir, je lâche une improvisation pour te faire savoir qui je suis »
52
leurs origines culturelles. La culture hip-hop en Jamaïque a été stimulée indirectement par les ressortissants de ce pays vivant aux États-Unis. Concernant le style de leur musique, il est très influencé par le reggae et la dancehall. Néanmoins, si les compositeurs produisent des œuvres en se basant sur des échantillons d’anciennes chansons reggae, ils produisent également des œuvres qui puisent dans d’autres types de musique. Le succès d’artistes nord-américains comme 50 Cent ou encore Jay Z, avec des titres composés à partir d’échantillons de reggae, les encourage dans cette direction17. Leurs débits s’adaptent au rythme de ces musiques. Ils peuvent, en effet, incorporer ces mêmes débits dans leur rap. Selon Frank Grizzy, son origine jamaïcaine fait que sa manière de poser sa voix sur la version musicale est différente de celle des autres rappeurs. En plus du rap, il peut poser indifféremment sur du reggae ou du dancehall. « My flow is never the same, just like we like the spice in everything we cook, the spice haffi de ya inna di flow» 18 Frank Grizzy
Wallabee se rappelle que, lors de ses débuts en Jamaïque, Sly et Robbie, deux compositeurs reggae de l’île bien connus, lui ont donné des versions musicales dancehall afin d’entraîner ses textes. L’art du « sound system » permit à Instinctz de développer une « oreille » pour la musique dès son plus jeune âge, aptitude importante en tant que compositeur. L’équipement des producteurs ne diffère pas de celui de leurs homologues nord-américains. Ils utilisent des logiciels informatiques et des boîtes à rythme. La culture hip-hop est une occasion d’échanger et de communiquer ses opinions, ses valeurs, son expérience. Dans cette tentative de partager sa différence, Swire, un rappeur de la scène jamaïcaine, souhaite faire intervenir dans ses vidéos rap des danseurs dancehall au lieu de danseurs hip-hop. Des danseurs dancehall qui danseraient sur ses chansons rap seraient une manière pour lui de rester proche de ses racines culturelles. Le choix du patronyme d’un rappeur révèle souvent sa personnalité, son vécu, sa devise ou encore son origine. Dans le choix que les rappeurs de la Jamaïque opèrent, aucune volonté de rappeler leurs origines ou leur
17
Window shopper de 50 Cent contient des échantillons de la chanson Burnin and lootin’ de Bob Marley ; Lucifer de Jay Z contient des échantillons de One Blood de Junior Reid. 18 Traduction : « Mon débit n’est jamais le même, comme on apprécie les épices dans tous ce que l’on cuisine, les épices doivent être dans mon débit »
53
spécificité culturelle n’apparaît. Les rappeurs dévoilent leur personnalité, mais c’est l’influence nord-américaine qui se ressent. C’est ainsi que, pour Frank Grizzy, le prénom Frank fait référence au héros d’un film nord-américain, « The king of New York ». Ce héros se nomme Frank White, un bandit sortant de prison qui jure de devenir riche et puissant par tous les moyens. Grizzy fait référence au caractère calme et sauvage de l’ours, le mot est proche de grizzli. L’intention du rappeur est d’opérer à la manière de Frank White dans le milieu de la musique, avec l’attitude du grizzli. Citons aussi Gangsta colony : gansgta signifie gangster et fait référence à la personnalité des membres du groupe. Colony renvoie à l’unité, la solidarité qu’ils veulent bâtir en Jamaïque par le biais du hip-hop. Quant à Bullet proof army, ce patronyme a été choisi pour évoquer une armée qui résiste aux assauts. On pense aussi à Instinctz : lorsqu’il a commencé à composer des versions instrumentales, ceux qui les écoutaient les trouvaient naturelles, instinctives. Par conséquent il a choisi de garder ce patronyme. S’agissant de The Sickest drama, ce choix s’est effectué en référence à la rime de Canibus, un rappeur nord-américain qui s’est décrit comme étant le « pire drame jamais arrivé dans le rap ». Cette rime traduit bien l’effet qu’il veut avoir dans le rap ainsi que l’engouement que sucite une chanson qui plaît. Quant à Shaq the MC19, son pseudonyme est le diminutif de Shaquille O’Neal, un joueur de basket nord-américain qui mesure environ 2 m 16 pour 130 kg. Étant donné qu’il n’est pas limité au rap et qu’il s’exprime aussi bien à travers le chant, le choix de ce nom exprime la variété de son talent. Le titre de « MC », signifiant maître de cérémonie, lui rappelle, qu’en sa qualité de porte-parole, l’artiste ne fait pas simplement du rap mais qu’il parle au nom d’une communauté. Quant à Wallabee, ce patronyme est inspiré par une marque de chaussure nord-américaine réputée pour sa texture douce. C’est le style de rap qu’il voudrait véhiculer, un rap qui permet à ses auditeurs de se détendre, de s’amuser. La seule exception vient d’un groupe qui n’existe plus en tant qu’entité, mais dont les membres continuent de travailler individuellement dans l’industrie de la musique. C’est le groupe Naciamaj. Ce nom évoque en réalité le mot « Jamaican », épelé à l’envers. Nous percevons un effort délibéré de mettre
19
Voir glossaire à la fin pour la signification
54
en évidence l’origine et la spécificité culturelle du groupe à travers ce choix de patronyme. Cette caractéristique se ressent moins dans le choix des autres rappeurs cités plus haut. Les rappeurs que nous avons eu l’opportunité de rencontrer étaient tous de race noire ou métissés. Aucun participant n’était de race blanche, indienne ou chinoise. Le mouvement hip-hop résonne de manière plus convaincante chez les jeunes Noirs et les jeunes Métis de l’île, qu’ils soient issus des classes moyennes ou des milieux un peu plus défavorisés. Ils s’approprient la culture hip-hop en tant que culture afro-diasporique issue du peuple noir. Nous n’avons pu répertorier que très peu de femmes pratiquant l’une des disciplines du mouvement hip-hop en Jamaïque. Lors des festivals qu’il organisait, le rappeur Shaq the MC mentionna sa rencontre avec deux jeunes femmes qui s’exprimaient mais pas directement par le rap, la danse ou le Djing. L’une d’entre elles s’exprimait par la poésie, l’autre par la musique dancehall. La seule rappeuse originaire de la Jamaïque que nous ayons pu découvrir se nomme Nadirah X. Elle ne vit pas en Jamaïque. Elle y a grandi et y a fait des études de graphisme. Dès le milieu des années 90, elle commence à rapper. Ses parents sont des activistes de la Nation de l’Islam, d’où son patronyme, Nadirah X, inspiré par la démarche de Malcolm X. Elle est aussi connue sous le nom de Nadz. En 2000, elle enregistre et produit une chanson au studio Gambling House Recordings intitulée Nuh Fraid A Yuh20. En 2002, elle gagne un concours de chant sur la radio locale Irie FM. Cette compétition lui permet de rencontrer son futur manager, Dave Steward, qui l’invite à Londres pour travailler sur de futures chansons. Elle a signé un contrat avec une maison de disques et a commencé à participer à des tournées en Europe. Nadz rappe sur des musiques rap, dancehall et des musiques influencées par le rock. Les textes de ses chansons sont un mélange de critique sociale et de spiritualité. Elle utilise l’anglais standard nord-américain mais également le patois jamaïcain dans une moindre mesure. À part Nadirah X, nous n’avons pas pu découvrir d’autres rappeuses ou d’autres participantes à la culture hip-hop en Jamaïque. Lors de notre voyage dans l’île, toutes nos tentatives pour obtenir les coordonnées de Nadz ont été infructueuses. À cause du manque de participantes et d’informations disponibles, nous n’avons pas pu dresser une analyse objective de la participation des femmes au sein de la culture hip-hop sur l’île. Le
20
http://sweetmother.org/?q=nadirahx
55
mouvement est majoritairement composé d’hommes qui mettent en place des stratégies pour fédérer la communauté hip-hop.
1.1.2 : Moyens utilisés pour se faire connaître et fédérer la communauté hip-hop « We don’t play with our entertainment, this is vital to us. Life is hard, we haffi chill, relax. Music is life in Jamaica so if you mess up with life, we don’t like you…»21 Dwayne Robinson, Manager du groupe Gangsta Colony Il était intéressant pour notre recherche de comprendre comment les rappeurs et les producteurs s’organisaient pour diffuser leur art. Par quels moyens arrivent-ils à distribuer leurs disques ? Existe-t-il des endroits particuliers où se retrouvent les adeptes du mouvement hip-hop ? Quelle importance les rappeurs accordent-ils à la scène et au partage avec le public ? En 2002, nous avons eu l’opportunité de travailler en tant que lecteur à l’université de la Jamaïque. Durant l’année, une télévision locale, « RE-TV », diffusa un clip vidéo réalisé par le groupe de rap local Naciamaj. Ils étaient les premiers rappeurs à produire une vidéo pour une chanson rap en Jamaïque. Ce fut le seul clip vidéo utilisé dans le milieu rap. Actuellement, les rappeurs n’utilisent pas ce moyen pour promouvoir leurs chansons. Leurs possibilités sont également restreintes au niveau des diffusions sur les radios locales, car le reggae et le rap nord-américain sont privilégiés dans les programmes. L’une des ruses de TSD, qui signifie The Sickest Drama, est de poser sa voix sur des versions musicales de rappeurs nord-américains connus, de remettre les chansons aux programmateurs des radios afin qu’ils les diffusent pendant les mêmes séquences. Le fait de poser sa voix sur les mêmes versions musicales que les artistes nord-américains facilite l’écoute des auditeurs qui apprécient déjà la chanson originale. Les rappeurs ne peuvent pas aller en radio pour effectuer des interviews ou pour rapper en direct dans des émissions. L’une des raisons évoquées par les rappeurs dont Instinctz est la suivante : les décideurs dans les médias les considèrent comme « des vendeurs de culture étrangère ». Ils considèrent leur pratique du rap comme une renonciation à leur culture locale. Ces
21
« Nous sommes très sérieux lorsqu’il s’agit de nos divertissements, c’est vital pour nous. La vie est difficile, nous devons nous reposer, nous relaxer. En Jamaïque, la musique c’est la vie donc si tu ne prends pas soin de la vie, on ne t’aime pas ».
56
personnes, selon lui, ignorent que le rap a ses racines en Jamaïque. Instinctz considère le rap dans le paysage jamaïcain comme un frère musical qui a quitté l’île pendant un certain temps mais qui est de retour depuis les années 90. Pour toutes ces raisons, le rap se diffuse de manière underground, autrement dit de manière officieuse. Le moyen le plus utilisé reste encore la mixtape, cette compilation produite à partir de versions musicales nord-américaines et distribuée dans la rue afin de se faire connaître. Les rappeurs posent leur voix dans leur studio et pressent eux-mêmes leur CD. Ils font leur travail d’infographie et vendent aussi eux-mêmes leur CD dans la rue. Les mixtapes se vendent pour la modique somme de 50 ou 100 dollars jamaïcains (=1 à 2 euros). Dans le but de se faire connaître et d’avoir des commentaires sur leurs œuvres, il leur est arrivé de presser des CD et de les distribuer gratuitement. Les artistes nous ont fait part de leur désir de produire des albums avec leurs propres compositions musicales, mais ces projets nécessitent plus de temps et de moyens. Ce sont d’ailleurs les projets sur lesquels ils travaillent au moment où nous écrivons ces lignes. Le deuxième moyen, à part les médias, reste la scène qui est un élément central dans la culture hip-hop. C’est le lieu où l’on expose son talent, où l’on se mesure à l’autre. De plus en plus de concerts rap sont organisés dans des discothèques de New Kingston (Village Café, Up on the Roof, par exemple). Les rappeurs ont aussi l’opportunité de se produire lors de fêtes de quartier, des sound-systems ou durant des manifestations caritatives. Compte tenu des circonstances, ils ne se produisent pas devant un public régulièrement. Certains, tel Swire, ne l’ont jamais fait depuis qu’ils rappent d’autres n’ont eu l’opportunité de se produire que très rarement en dix années de pratique. C’est le cas d’Instinctz et de Frank Grizzy. En général, leurs prestations rassemblent environ 100 à 200 personnes. Comparés aux stars du reggae et du dancehall qui peuvent rassembler des milliers de personnes, ce sont des publics relativement modestes. Afin de remédier à ce désavantage, Shaq the MC a mis en place une plateforme permettant aux différents talents de l’île de se faire connaître et de se rencontrer. Elle a eu lieu à partir de l’année 2005 pendant environ deux ans. La manifestation, baptisée « Jamaica Vibes », offrait un espace aux artistes venant de milieux musicaux moins populaires en Jamaïque, dont le milieu rap. Ils pouvaient se produire devant un public d’environ 50 à 100 personnes, dans le but d’apprendre à partager leur art avec ce dernier. La manifestation lui a permis de mettre en place un réseau d’artistes avec lequel il garde un contact régulier. Elle permit également de consolider la solidarité entre les artistes rap de l’île. Il arrive que des promoteurs leur proposent de participer à des spectacles dancehall. Selon Kimani, les manifestations hiphop devraient être organisées en marge du mouvement dancehall qui est déjà
57
très populaire. Cette démarche est nécessaire car, afin de mieux mesurer l’intérêt pour le mouvement hip-hop sur l’île, il faudrait les dissocier totalement. Étant donné que les rappeurs jamaïcains s’expriment en anglais standard nord-américain, nous avons demandé à Instinctz s’il estimait que, pour faire connaître leur musique, il devait passer par le marché nord-américain autrement dit, mettre en place une démarche de promotion et de distribution vers l’industrie musicale des États-Unis. De son côté, le rappeur Frank Grizzy avait l’intention d’envoyer ses productions à des radios nordaméricaines et anglaises. Quant au groupe Gangsta Colony, il a signé un contrat avec une maison de disques basée à New York. La réponse d’Instinctz, donnée en deux points, fut très captivante. D’une part il répondit par l’affirmative estimant que le peuple jamaïcain ne sait pas reconnaître son potentiel, sauf si d’autres personnes de l’extérieur le valorisent. Autrement dit, s’ils sont reconnus aux États-Unis, leur art sera mieux valorisé en Jamaïque. D’autre part, il répondit aussi par la négative en disant que la meilleure solution, selon lui, serait de développer le mouvement hip-hop en Jamaïque et de susciter en chacun un sentiment d’appartenance à la communauté hip-hop locale. Enfin, le troisième moyen par lequel les rappeurs font la promotion de leur art, c’est par le biais des sites et des pages Internet, tels que Myspace ou encore les divers blogs. C’est en effet un moyen peu onéreux et qui leur permet de faire connaître leur musique au monde entier et éventuellement à des directeurs artistiques de maisons de disques. C’est une manière aussi de créer des réseaux d’artistes. Les adeptes du mouvement hip-hop, en majorité des rappeurs, ont un avenir prometteur en ce qui concerne la promotion de leur art. Même si du chemin reste à parcourir, le rap est de mieux en mieux accepté aujourd’hui. En comparant la situation actuelle avec la fin des années 90, force est de constater que de plus en plus de lieux s’ouvrent à leurs concerts. Internet est devenu un moyen également fructueux pour former un réseau de contacts et faire connaître leur musique. De nos jours, ils ont les moyens de produire leurs disques et de les commercialiser. Le mouvement hip-hop intéresse les adolescents qui ont entre 15 et 18 ans. Ce sont des acheteurs et des acteurs potentiels de la culture en Jamaïque dans les années à venir. Les rappeurs de la Jamaïque n’entretiennent aucun lien avec ceux de la région Caraïbe. Par simple ignorance ou par repli sur soi, la raison nous semble être ailleurs. En réalité, ils sont tournés vers les États-Unis. Kimani nous confirme avoir des liens avec des rappeurs basés en Angleterre. Ils ne voient pas d’inconvénient à se rapprocher des acteurs du mouvement hip-hop dans la région mais il est évident qu’ils cherchent d’abord à s’imposer aux yeux de leurs premiers référents, la communauté hip-hop des États-Unis.
58
1.1.3 : Perspectives d’évolution de la culture hip-hop en Jamaïque Nous avons demandé à nos informateurs de nous exposer leurs aspirations pour le mouvement hip-hop en Jamaïque. Si nous analysons leurs déclarations, nous voyons clairement qu’ils désirent que leur dynamique puisse s’exporter en véhiculant sa différence. Ils désirent aussi s’émanciper des préjugés locaux et être reconnus comme des acteurs de la culture locale : « Free the youth dem, dat me ah defend. Let the youth do what they want (…) I expect it to be like NYC, Atlanta, LA, a station with the Jamaican style…I want it to be big, let people know it »22 Frank Grizzy
Ce qu’il nous faut comprendre dans la déclaration de Frank Grizzy, c’est l’aspiration des acteurs du mouvement à plus d’autonomie au sein de la culture jamaïcaine, une liberté qui leur donnera plus d’assurance, plus d’« autorité » pour se diffuser hors de la Jamaïque. En se diffusant, la particularité du hiphop jamaïcain pourra à son tour devenir un style bien défini et respecté aux Etats-Unis, tout comme les autres courants déjà présents. « I want our scene to be recognized…I know we can save hip-hop, I’m bringing a lot of values and respect for the traditions back » 23 Instinctz « I want us to add our perspective ‘cause we got love for the culture and we’re part of the culture. Kool-Herc comes from here. I believe we have something valuable to add » 24 TSD
22
Traduction : « Laissez les jeunes tranquilles, c’est ce que je prône. Laissez les jeunes faire ce qu’ils veulent (…) Je m’attends à ce que la Jamaïque soit comme New York, Atlanta, Los Angeles, un pôle avec le style jamaicain…Je veux que le mouvement soit grand, le faire connaître aux gens ». 23 Traduction : « Je veux que notre scène soit reconnue…Je sais que nous pouvons sauver le hip-hop, je ramène beaucoup de valeurs et de respect pour les traditions ». 24 Traduction : « Je veux que nous ajoutions notre perspective parce que nous aimons la culture et nous en faisons partie. Kool Herc est originaire d’ici. Je crois que nous avons quelque chose de valable à apporter ».
59
Les propos d’Instinctz et de TSD sont significatifs pour plusieurs raisons. Ces deux rappeurs affirment leur légitimité au sein du mouvement hip-hop aux États-Unis et dans le monde. Lorsqu’Instinctz parle de « sauver le hiphop car ils amènent des valeurs et le respect des traditions», il se positionne toujours par rapport au mouvement hip-hop nord-américain. Le respect qu’il nourrit vis-à-vis de l’histoire du mouvement hip-hop légitime leur participation, en leur permettant d’avoir une influence sur le cours des choses au sein de l’industrie musicale. Quant à TSD, il considère les origines jamaïcaines de la culture hip-hop pour justifier, non seulement leur appartenance au mouvement, mais également la valeur de ce qu’ils peuvent y apporter. «Hip-hop culture is a way of life like rastafari…I see pretty soon a dramatic explosion in this part of the world»25 Dwayne Robinson
Le manager Dwayne Robinson compare le mouvement hip-hop au mouvement rastafari en Jamaïque. C’est un style de vie régi par ses codes et ses valeurs, un style de vie qui amène celui qui y participe à jeter un regard différent sur le monde qui l’entoure. Selon lui, c’est un style de vie qui est appelé à se développer en Jamaïque. Cette comparaison résonne particulièrement bien dans le cadre de notre recherche.
Conclusion Le mouvement hip-hop en Jamaïque a été inspiré par la dynamique étasunienne ; néanmoins il a su s’en démarquer. La « glocalisation » du mouvement se perçoit sous plusieurs formes. Les thèmes et les musiques de leurs chansons sont influencés par leur environnement socioculturel. Le graffiti et la danse ne sont pas développés en Jamaïque. Pour des raisons matérielles et financières, les jeunes ne pouvaient pas se procurer le matériel nécessaire sur l’île. Quant à la danse elle s’est implantée durant quelques années mais n’a pas persisté. La pratique de la danse locale étant déjà prépondérante. L’art du « DJing » non plus car la pratique existait déjà sur l’île. Cette dernière était particulièrement dominée par la culture reggae et dancehall. Les acteurs du mouvement sont déterminés à créer une
25
«La culture hip-hop est un style de vie comme le mouvement rastafari…Très bientôt, je crois qu’elle va réellement exploser dans cette partie du monde ».
60
dynamique locale par le biais de rassemblements, la production d’albums rap, l’utilisation de leur langue locale et par des discours en rapport avec leur réalité locale. À côté de la culture rastafari, du reggae et de la culture dancehall, ils tentent de s’implanter dans un panorama culturel fortement imprégné. Cela reste un défi, car en Jamaïque les éléments de la culture hiphop sont toujours perçus comme des vecteurs de l’impérialisme nordaméricain. Le concept de la déterritorialisation conçu par les deux philosophes Gilles Deleuze et Félix Guattari (1972, 1975, 1980) explique la dynamique du mouvement hip-hop en Jamaïque et à Trinidad. En effet, ils soulignent qu'il est synonyme de décentrement, de mouvement et d'exploration. Deleuze montre que la déterritorialisation ne va jamais sans une reterritorialisation. Ce phénomène culturel, originaire des Etats-Unis, se « déterritorialise » pour se « reterritorialiser » dans ces îles. Cette découverte d'autres mondes a pour conséquence immédiate de produire « du neuf, de l'original ». Elle désigne souvent le changement d'une culture cela ne signifie pas néanmoins que les cultures impliquées n'aient pas de point d'ancrage. Le concept renvoie aussi à l'affaiblissement des liens entre une culture et un lieu précis. Les adeptes de la culture hip-hop en Jamaïque accordent, certes, une grande importance aux créateurs nord-américains, néanmoins ils sont attachés à leur patrimoine sociopolitique et cuturel immédiat. La culture hip-hop recouvre une nouvelle signification au sein de la société jamaïcaine ; elle est perçue par une partie de la population comme un vecteur de l’impérialisme nord-américain. En définitive, la culture hip-hop s'est répandue à la Jamaïque durant les années 80. Le mouvement a su s'adapter à la réalité socio-culturelle de l’île. Dans cet échange interculturel, la société jamaïcaine a également été transformée par les éléments, les codes, le langage et la musique du mouvement hip-hop. Des perspectives de recherche restent ouvertes car la culture hip-hop est présente sur la plupart des îles de la Caraïbe. Elle est devenue le dénominateur culturel commun transcendant les différences langagières, dans cet espace si varié, qui mérite toute l'attention du chercheur en sciences humaines.
61
CHAPITRE 2 LE MOUVEMENT RASTAFARI AUX ETATS-UNIS 1.2.1 : Apparition du mouvement et réaction de la société américaine Si, durant les deux premières décennies de son existence, le mouvement rasta reste confiné aux frontières de la Jamaïque, à partir des années 60 et 70, il se diffuse dans toute la Caraïbe et sur le continent américain, notamment aux États-Unis. Il se révèle comme étant l’une des forces nationalistes et anticolonialistes les plus dynamiques face à l’Europe. En effet, les jeunes immigrants caribéens dans les villes de Londres, New York et Amsterdam y trouvent une référence culturelle et identitaire. La présence du mouvement rasta aux États-Unis est une conséquence directe des vagues d’immigration en provenance de la Caraïbe durant les années 60 et 70. New York et Miami, tout comme Toronto, sont devenues les plus grandes villes « caribéennes » à ce jour à tel point que des quartiers dans ces villes prennent, respectivement, des noms comme Kingston 21 ou encore Little Jamaica (Murrell, Spencer, Mc Farlane, 1999 : 199). En 1990, la population d’origine jamaïcaine était estimée à 186 430 (Idem : 199), sans compter les immigrants illégaux et ceux qui ne se sont pas déclarés par méfiance du recensement. À la suite des mouvements migratoires dans la ville de New York, une section du quartier de Brooklyn nommée Flatbush devint l’endroit où se fixa la plus forte concentration de Caribéens de la ville (Idem : 199). On y retrouve alors un éventail de manifestations et de traditions culturelles caribéennes. L’une des plus visibles et des plus attirantes pour la jeunesse, c’est le mouvement rastafari originaire de la Jamaïque. À partir des années 70, les élections nationales en Jamaïque prirent une tournure sanglante. Le nombre de personnes tuées durant la campagne a augmenté radicalement. En 1980, lorsque les élections ont eu lieu, plus de 900 personnes (la plupart étant des jeunes) ont été assassinées (Chevannes, 1995 : 264). Beaucoup de jeunes étaient enrôlés dans des partis politiques afin de participer à des attaques meurtrières contre les opposants. Au début des années 80, les États-Unis sont devenus un refuge pour ces « jeunes hommes à tout faire » qui cherchaient à fuir la Jamaïque. La plupart des symboles rastas faisaient partie des symboles populaires de la jeunesse jamaïcaine. C’est ce qu’emportèrent avec eux ces jeunes sans pour autant
63
conserver les valeurs spirituelles du mouvement rastafari, car ils n’étaient pas des adeptes du mouvement. Les dreadlocks que portaient ces jeunes n’étaient pas seulement étranges, elles étaient intimidantes pour les Américains. Ces jeunes hors-la-loi ont été à l’origine des réseaux criminels les plus dangereux aux Etats-Unis. Ils se faisaient appeler les « Posse »26. C’est aussi l’image que perçurent les Américains confrontés au mouvement rasta. L’accueil du mouvement rastafari au sein de la société nord-américaine a été, en effet, aussi hostile que sa réception au sein de la société jamaïcaine. Si des informations précises ne sont pas disponibles, nous pouvons néanmoins supputer que le mouvement est apparu probablement à la suite des vagues d’immigration en provenance de la Jamaïque durant les années 60 et 70. La deuxième raison qui explique cette apparition, c’est l’internationalisation du reggae à travers la musique de Bob Marley. Celle-ci a su transporter les valeurs et les symboles du mouvement rastafari au sein de la société nordaméricaine. Il a su éveiller la curiosité du public en faveur du mouvement. Les premières organisations rastafari et les premières églises datent du milieu des années 70 ; les premières couvertures médiatiques sur le mouvement sont réalisées en 197127. Alors que le mouvement se démocratise et se répand dans des villes comme Washington D C, Houston, Los Angeles et Miami, les médias élaborent une représentation peu flatteuse des membres en les décrivant comme des criminels. La police n’hésite pas à appuyer cette thèse lorsqu’on retrouve, en 1977, quatre rastas morts ligotés dans un appartement de Brooklyn28. Jusqu’à la fin des années 70, la communauté rasta restera associée au trafic de drogue et aux actes de violence. Cela ne fit que renforcer les appréhensions existant vis-à-vis de l’étranger. Tout au long des années 80, la population étatsunienne sera exposée à des images effrayantes et violentes de la communauté rasta. En 1980, le journaliste Dan Rather, dans l’émission télévisée 60 minutes (Chevannes, 1995 : 264), dépeint le mouvement comme une multinationale gravitant autour de la drogue qui utilise l’étiquette de la religion pour
26
Pour plus d’informations sur les gangs jamaïcains aux États-Unis, cf. Born fi dead : A journey through the Jamaican Posse Underworld, de Laurie Gunst, Shower Posse : The most notorious Jamaican crime organization, de Duane Blake, Philip Baker, Rasta gang. 27 Hepner Randal L., “Chanting Babylon in the Belly of the Beast : The Rastafarian movement in the metropolitan United States”, Cité dans Chanting down babylon : The Rastafari reader, p. 201. 28 Idem, p. 202.
64
dissimuler le trafic de narcotiques. Le film Marked for death amplifie la mauvaise image de la communauté lorsque le seul rasta que l’on voit apparaître dans le film est un trafiquant de drogue. Le mouvement est diabolisé et présenté comme un culte de magie noire impliqué dans le réseau de distribution de crack et de cocaïne dans le pays. La propagande médiatique et les mesures policières ont largement façonné la perception du mouvement aux États-Unis. Au milieu des années 80, on dénombre plus de deux mille rastas dans les prisons de la ville de New York (Murrell, Spencer, Mc Farlane, 1999 : 203). Ce nombre ne cesse de croître à la fin des années 80 et au début des années 90 dans les prisons du pays. Il en résulte des confrontations physiques entre les rastas et les gardiens, car, à l’entrée, ils sont obligés de se faire raser les cheveux contre leur gré. Cette humiliation conduit à des mutineries, comme par exemple à la prison de Broad River en Caroline du Sud29. En réalité, selon Randal Hepner, l’attitude des forces de l’ordre et des médias étasuniens faisait partie d’une idéologie anti-drogue développée par le gouvernement. L’emprisonnement des rastas est la conséquence directe de cette politique. Il explique aussi l’hostilité de « Washington » envers ces derniers par le fait que le gouvernement de Michael Manley, Premier ministre jamaïcain au milieu des années 70, qui soutient la communauté rasta, est étroitement lié au régime castriste. Sa position politique et sa résistance face aux stratégies du Fonds Monétaire International (FMI) font de lui un opposant au gouvernement des Etats-Unis (Murrell, Spencer, Mc Farlane, 1999 : 203). La connexion entre le mouvement rastafari, Manley et Cuba a encouragé l’animosité vécue par les rastas aux États-Unis. L’influence amère des médias, des forces de l’ordre et la xénophobie ont déformé la perception du rastafarisme aux yeux de la société américaine. La liberté religieuse a eu ses limites même dans une société américaine fondée sur le principe de la liberté de culte. À la fin des années 80, l’association automatique faite entre rastafari et criminalité cessa. La presse commença à présenter le mouvement de manière moins négative (Chevannes, 1995 : 268).
29
Inmates stab five guards at prison before bringing protest to end , New York Times, April 18, 1996.
65
1.2.2 : Statistiques et structure sociale Malgré les recherches commencées dans les années 70, on ne trouve toujours pas de chiffres précis concernant la communauté rastafari aux ÉtatsUnis, comme il en existe en Jamaïque, par exemple. En 1985, le département de la police de New York a estimé qu’il y avait environ dix mille rastas vivant dans cette ville, sans pour autant indiquer les méthodes et les critères qui lui ont permis d’obtenir ces chiffres. Une étude conduite par l’organisme en charge des enquêtes sur les identifications religieuses aux Etats-Unis (National Survey of Religious Identification : NSRI), entre 1989 et 1990, a estimé le nombre de rastas vivant sur le sol américain à quatorze mille. Cependant, ces estimations sont très basses, comparées à la réalité, car étant donné qu’ils se méfient, beaucoup de rastas ne participent généralement pas aux enquêtes. Même si les chiffres ne sont pas exacts, on trouve des rastas dans la plupart des États américains. S’ils sont plus fréquemment installés dans les centres urbains de la côte Est, comme New York, Philadelphie, Boston, dans le Connecticut avec New Haven, à Miami et à Washington D C, on retrouve aussi des communautés dans des villes telles que Los Angeles, San Francisco (dans le quartier de Bay Area), Chicago et Houston (Murrell, Spencer, Mc Farlane, 1999 : 204). Le mouvement est composé en grande partie de jeunes immigrants caribéens surtout originaires des îles anglophones, la majeure partie provenant de la Jamaïque. On retrouve également un nombre croissant d’Africains, d’Africains-Américains, d’Amérindiens et d’Euro-Américains. On le voit, au fil des années, le mouvement a traversé les barrières ethniques et raciales. Comme nous l’avons déjà indiqué, les symboles et les pratiques rastafariennes se sont propagés dans la société étatsunienne à travers l’influence populaire du reggae. Le port des dreadlocks est devenu une affirmation afrocentrique aux États-Unis au lieu d’être un signe d’appartenance à la communauté rasta. Généralement, les acteurs du mouvement sont issus de la classe ouvrière et des sans-emploi. Leur milieu professionnel varie : certains occupent des emplois rémunérés faiblement d’autres occupent des postes en tant qu’ouvriers qualifiés et moins qualifiés, en tant qu’artisans ou en tant qu’artistes (Ibid. 205). Il existe également un groupe d’entrepreneurs rasta qui émergent pour répondre aux besoins de communautés assez dispersées. On les trouve à la direction de magasins de musique, d’alimentation et de produits diététiques, de restaurants végétariens (Ibid. 205). Les vendeurs d’encens, d’huile et d’autres produits voisins sont omniprésents dans les grandes villes. Comme leurs homologues dans la Caraïbe, beaucoup de rastas veulent échapper à la dépendance vis-à-vis du salaire qu’impose « Babylone », raison pour laquelle ils décident de travailler à leur compte. Néanmoins, le manque de ressources, d’opportunités ainsi que leur propre
66
consommation de marijuana sont des facteurs qui poussent certains à s’engager dans le trafic. Certes, nous n’affirmons pas, comme le prétend la croyance populaire aux États-Unis, que les rastas sont responsables du trafic de marijuana, mais certains y sont impliqués (Ibid. 205). Selon les entretiens que Randal Hepner a menés avec des hommes et des femmes rasta aux ÉtatsUnis, la « carrière » de trafiquant n’est jamais leur premier choix ; elle est relativement courte et commence souvent dans des périodes d’inactivité professionnelle. Il est vrai que des recherches doivent être entreprises dans ce domaine si sensible. Officiellement, peu de rastas consomment des substances narcotiques autres que la marijuana, du moins ceux qui abordent réellement le mouvement rasta comme un style de vie et de pensée. En effet, rares sont ceux qui s’impliquent dans le trafic de drogues dures. Au contraire, les rastas sont opposés à l’utilisation de ces substances ainsi qu’à celle de l’alcool, si bien qu’un groupe de rastas de New York a eu l’occasion de discourir sur l’abus de la marijuana par les jeunes (Ibid. 205). Il est clair que l’utilisation de la marijuana à des fins « sacrées » est une source de tension entre les forces de l’ordre et les communautés rasta. Cela a souvent été aussi un obstacle à une plus grande compréhension du mouvement, le réduisant simplement à cet aspect, en passant sous silence l’organisation sociale des communautés rasta aux États-Unis. Le mouvement rastafari nord-américain reflète le caractère non structuré et non hiérarchisé du mouvement en Jamaïque. Il n’y a pas de leader proprement dit pour s’exprimer au nom de la communauté. Toutefois, au fur et à mesure que le mouvement s’élargit et gagne de nouveaux adhérents, des modes de fonctionnement et des institutions se distinguent. Les premières institutions sont les discothèques de musique jamaïcaine (reggae, dancehall) ; les lieux où ils se retrouvent pour fumer, se procurer de l’herbe si nécessaire et discuter sont plus communément appelés les « smoking yards » ou les « weed gates ». Ce sont des réseaux sociaux informels. D’autre part, il existe des réseaux plus formels composés d’églises, de centres sociaux, d’associations politiques. Ces réseaux institutionnalisés sont surtout présents à New York, car la communauté y est plus nombreuse. Cette branche du mouvement, malgré son infériorité numérique, paradoxalement, est la plus active et la plus enthousiaste. Ces institutions, grâce à leur discipline, sont capables de mobiliser des ressources et de diffuser à une plus grande échelle les croyances et les ambitions du mouvement rasta dans la société étasunienne. Elles procurent aussi à leurs membres un statut social. Le rôle des leaders et des intellectuels est primordial, car ils peuvent articuler l’idéologie rasta à la sphère publique, la transmettre aux plus jeunes et renforcer les liens entre les membres de la communauté. La présence des lieux de culte et des centres communautaires rastafari participe à la vitalité de la vie religieuse et à la diversité culturelle de cette société.
67
Au-delà de l’aspect organisationnel, aux États-Unis, le mouvement contient deux types d’adeptes, ceux qui le considèrent comme une religion à part entière et ceux qui le considèrent uniquement comme un mouvement politique et culturel. On assiste progressivement et simultanément à un processus de sécularisation et d’innovation religieuse au sein du mouvement. Si des différences existent entre le rastafarisme en Jamaïque et aux ÉtatsUnis, un concept reste immuable, c’est le rejet de Babylone. Le cas échéant, la société nord américaine à travers le racisme dont elle fait preuve, symbolise Babylone surtout pour une grande partie des personnes de couleur qui y vivent. D’autre part, cette présence publique témoigne de la maturité grandissante du mouvement. Alors qu’autrefois le reggae était le véhicule premier du message rasta, on remarque que les organisations religieuses et sociales deviennent à leur tour d’importants véhicules pour la dissémination de ce message et d’importants facteurs dans l’approfondissement des croyances et l’échange entre les adeptes (Ibid. 208). Étrangement, à cause de sa localisation au cœur du pays qui symbolise le mieux le concept de « Babylone » pour les rastas, la dynamique rastafari étatsunienne jouera un rôle décisif dans l’institutionnalisation du mouvement en Jamaïque et dans le reste du monde. Il est vrai que le rastafarisme doit sa longévité à son manque d’institutionnalisation, mais à l’heure où ses valeurs s’essoufflent et où il n’arrive pas à les transmettre intégralement, le temps est peut-être venu de s’y prendre autrement.
1.2.3 : Le reggae aux États-Unis Comme nous l’avons signalé, de nos jours, les organisations rastafari telles que les églises, les associations et les centres sociaux, jouent un rôle important dans la diffusion de l’idéologie rasta. Toutefois, le reggae a été le principal vecteur responsable de la propagation du mouvement rastafari en Amérique du Nord. Les États-Unis représentent le plus grand marché de l’industrie musicale. Bob Marley l’avait compris car, à l’annonce de son cancer en 1981, il venait d’entamer une seconde tournée américaine (Davis, 1994 : 265-266). Il a tracé le chemin pour les artistes reggae qui allaient suivre, tels que Peter Tosh, Third World, Sly and Robbie, Black Uhuru. À travers la musique, un grand nombre de personnes se sont familiarisées avec le mouvement. Des émissions radio autour du reggae commencent dès la fin des années 70 (Chevannes, 1995 : 271). En 1981, le label RAS est créee par Gary Himelfarb, un journaliste américain d’origine juive. En 1987, le label est devenu une entreprise dotée d’un capital de plusieurs millions de dollars
68
(Chevannes, 1995 : 271). Les États-Unis sont ainsi devenus un passage obligé pour les artistes reggae dans l’organisation de leur tournée promotionnelle, d’autant plus que de grandes maisons de production et de distribution y sont basées. Des festivals musicaux sont organisés par des Caribéens installés aux États-Unis. Ce sont des événements très importants organisés dans les grands centres urbains du pays et qui servent à promouvoir le style de vie rasta et le reggae (le Cambridge River Festival à Boston, l’African Street Festival à Brooklyn, New York, et le festival annuel du reggae à Washington D C) (Chevannes, 1995 : 272). Un autre signe du développement du mouvement rastafari est l’apparition de groupes reggae étasuniens dont la plupart des membres sont rastas tels que Healin’ of the Nation et Jah Ma Roots basés à Boston, See-I et Babylon Warriors basés à Washington. Leurs noms dérivent directement de l’idéologie rastafari. Il existe aussi des groupes de musiciens tels que Riddim Section basé en Californie (Chevannes, 1995 : 272). On distingue des groupes de rock tels que Bad Brains dont les membres sont des rastas dévoués. Cette fusion entre le rock et le reggae enrichit le paysage musical américain mais permet au mouvement rasta et au reggae de pénétrer dans des milieux dissemblables. Peter Tosh30 a eu l'opportunité de mêler les deux styles musicaux. Barry Chevannes avance un autre facteur non moins important quant à l’implantation du mouvement dans la société étasunienne. Il relate les voyages entrepris par d’anciens adeptes de la Jamaïque pour donner des conférences et enseigner l’histoire et l’idéologie du mouvement aux adeptes américains. D’une part, le reggae a permis de diffuser une image du mouvement rastafari autre que la criminalité et la violence. D’autre part, il a permis aux communautés africaine-américaine et caribéenne-américaine d’affermir des valeurs communes, ce qui n’avait pas été évident depuis l’œuvre de Marcus Garvey. Une enquête a été menée par un doctorant auprès d’une soixantaine de rastas africains-américains dans la région d’Oakland en Californie. Cette enquête a révélé qu’ils s’étaient affiliés au mouvement rasta car il répondait à leur quête identitaire en tant que personnes de couleur aux États-Unis (Chevannes, 1995 : 273). La coiffure des rastas s’est répandue dans la communauté africaine-américaine comme un symbole identitaire, une
30
Ancien membre du groupe de Bob Marley et chanteur rasta connu pour son radicalisme, Peter Tosh a été retrouvé assassiné dans sa maison en Jamaïque le 11 septembre 1987.
69
affirmation panafricaine. Le port des dreadlocks ne garantit pas leur affiliation aux autres pratiques rastas, mais c’est une preuve de l’implantation du mouvement aux États-Unis. Grâce au reggae, le mouvement a aussi trouvé de la considération auprès des Américains de race blanche. La journaliste Deborah Davis relate l’histoire de cinq Américains, y compris elle-même, qui ont accepté le mode de vie rasta par le biais de cette musique (Chevannes, 1995 : 274). Ils considèrent le mouvement comme une expérience spirituelle. Ils l’ont découvert à travers leurs amis, le reggae et Bob Marley. Ils revitalisent l’aspect multiethnique et international du mouvement en l’appliquant à leur expérience personnelle aux États-Unis. Dans cette découverte de nouveaux mondes, le mouvement rastafari, comme l’illustre le concept de la déterritorialisation des philosophes Gilles Deleuze et Félix Guattari (1972, 1975, 1980), se transforme, se structure autrement aux Etats-Unis. L’ambiguïté des symboles, des croyances et le caractère individualiste du mouvement permettent à d’autres personnes en situation de quête identitaire ou de lutte sociale de s’identifier au-delà des barrières raciales et sociales. Paradoxalement, la société américaine et son gouvernement impérialiste possèdent tous les attributs de « Babylone ». Cette société a impulsé un souffle nouveau au mouvement alors qu’elle l’avait condamné au départ. Par la suite, la liberté de culte en vigueur permit au mouvement de mieux s’organiser et se diffuser par le biais de réseaux sociaux. À cause de cette organisation plus rigoureuse, la transmission des valeurs a été plus efficace. Il nous semble que l’évolution du mouvement aux États-Unis aura une importance capitale dans son évolution mondiale.
70
DEUXIÈME PARTIE CAUSES DES TRANSFERTS INTERCULTURELS ENTRE LA CULTURE HIP-HOP ET LE MOUVEMENT RASTAFARI
L’une de nos hypothèses qui expliquent les échanges interculturels entre la culture hip-hop et le mouvement rastafari, c’est le déplacement de populations entre la Jamaïque et les États-Unis. Les cultures se rencontrent au contact des hommes. Ces hommes qui se déplacent deviennent des agents culturels, autrement dit, ils « portent leur culture », donc ils peuvent aussi la transmettre dans le territoire d’accueil. Notre deuxième hypothèse considère les expériences similaires vécues par les diasporas noires aux Etats-Unis et dans la Caraïbe. Ces expériences ont certainement contribué au rapprochement de leurs formes d’expression. À ce stade de notre développement, nous nous emploierons à explorer ces pistes de réflexion.
CHAPITRE 1 LES MOUVEMENTS MIGRATOIRES À partir du début des années 80, la présence de personnages d’origine caribéenne dans des films étasuniens31 traduit certainement un phénomène visible : la présence de la communauté caribéenne dans la société américaine, et plus particulièrement dans la ville de New York. Ces productions ne représentaient pas les Caribéens de manière positive. En revanche, elles illustraient un point important : la culture prenait en compte les réalités sociales. Lorsqu’une communauté se déplace, elle le fait avec des croyances, des comportements, un langage, des habitudes qui forment sa vision du monde. Par le biais de ces déplacements de population, des individus entrent en contact. Ce sont des visions du monde qui se croisent et s’influencent dans le même élan. L’une des raisons majeures qui expliquent les transferts culturels entre la culture hip-hop et le mouvement rastafari, ce sont les mouvements migratoires entre la Caraïbe anglophone, en particulier la Jamaïque et les États-Unis. L’idéologie du mouvement rasta se répand par le biais des adeptes originaires de la Caraïbe anglophone qui arrivent aux États-Unis. Ils y trouvent une jeunesse noire (africaine américaine et caribéenne) à la recherche de repères culturels qui est d’autant plus disposée à s’approprier une culture afro-centrique. Cette jeunesse est aussi fortement exposée à la culture hip-hop, en pleine médiatisation au début des années 80. Comme nous l’avons démontré dans le chapitre précédent, la présence du mouvement rastafari aux États-Unis est une conséquence directe des vagues d’immigration en provenance de la région Caraïbe, particulièrement de la Jamaïque entre les années 60 et 70. Selon la sociologue Mary C.Waters, dans les années 80, 213 805 Jamaïcains sont arrivés sur le sol étatsunien 45% de ces immigrants sont restés dans la ville de New York (Waters, 1999 : 36-37). La visibilité des phénomènes culturels jamaïcains, dont le mouvement rastafari, s’est accrue. Les deux groupes de rap que nous avons suivis durant notre travail de recherche sont composés de jeunes rastas ayant des origines caribéennes. Quelles sont les raisons qui poussèrent les immigrants à quitter leur pays d’origine ? Comment se sont-ils adaptés à la société nord-américaine ? Ont-
31
Modern Problems (1981), Trading places (1983), Married to the Mob (1988), Clara’s Heart (1988), Marked for death (1990), Predator II (1990), Thelma et Louise (1991), Rasta rocket (1993), etc…
73
ils résisté à l’américanisation ou ont-ils adopté les traits culturels de leur société d’accueil ? Nous tâcherons de répondre à ces questions dans la partie suivante.
2.2.1: Des îles anglophones vers les Etats-Unis « C’est à travers les hommes que les cultures rentrent en contact et se transforment. » L’interculturel, Claude CLANET
A/ Raisons économiques et sociales Ces mouvements migratoires sont le résultat du postcolonialisme. Le professeur Homi Bhabha est une autorité indissociable des études postcoloniales. Dans son ouvrage Les lieux de la culture : une théorie postcoloniale (1993), il affirme que ces moments de dispersion ou de « dissémiNation » qui ont eu lieu après les périodes de décolonisation sont également des moments de regroupement dans les ghettos des métropoles (1993: 223). Cet éparpillement d'individus, originaires d'anciennes colonies, à travers les puissances mondiales permet leur rassemblement dans la cité qu'il appelle « retour diasporique » (1993: 265). Ce rassemblement regroupe des signes d'approbation et d'acceptation, des niveaux de discours et de discipline. Il facilite le rapprochement et l'échange entre les deux phénomènes culturels que nous observons. L'impact des émigrants au sein de ces sociétés peut être décisif pour concevoir le caractère transnational des nouveaux phénomènes culturels contemporains (1993: 326). C’est dans la ville de New York que l’on retrouve les plus grandes concentrations de Caribéens. La communauté constitue environ 25% de la population noire (Vickerman, 1998 : 2). À la fin du 19e siècle, l’émigration vers l’Europe, l’Amérique latine ou du Nord était devenue un phénomène courant dans les territoires caribéens. La principale cause de l’émigration depuis cette période jusqu’à aujourd’hui reste le sous-développement économique de la région caribéenne. Les Caribéens émigrants ont quitté leur île afin d’avoir accès à des emplois mieux rémunérés dans les grandes villes d’Europe ou des États-Unis. Nous pouvons diviser les mouvements migratoires vers les États-Unis en deux vagues : avant et après 1965. Dès 1889, les navires partant de New York et de Boston à destination de la Caraïbe transportaient régulièrement des touristes nord-américains et des bananes en provenance de ces îles à leur retour. Ce commerce a fait de ces deux villes des centres de l’immigration Caribéenne (Vickerman, 61). Il est
74
indéniable que la proximité géographique des États-Unis a facilité celle-ci. New York, en particulier, était une ville plus tolérante et plus accueillante que les villes du Sud quant à la question raciale. C’est durant les deux premières décennies du 20e siècle qu’il y a eu le plus grand nombre de Caribéens qui y débarquèrent. Néanmoins, cette vague s’estompa en 1924 à cause de la la crise économique et de l’adoption de lois restrictives sur l’immigration (idem, 62). Il est important de comprendre que l’immigration dépend aussi du pays qui reçoit ces populations, de sa situation économique et de sa politique d’immigration. C’est ainsi que, durant les années 60, le manque de maind’œuvre et le mouvement des droits civiques ont été des facteurs déterminants dans la libéralisation de la politique d’immigration nordaméricaine. La Jamaïque, Trinidad et Tobago sont les pays de la région Caraïbe qui fournirent les plus gros contingents d’immigrés vers les ÉtatsUnis. Entre 1951 et 1990, le nombre d’immigrés caribéens entrés aux ÉtatsUnis a été multiplié par sept (Ransford, 1996 : 11). Ironiquement, la deuxième vague d’immigration correspond également à la vague d’indépendance qui eut lieu dans la Caraïbe durant les années 60. Entre 1976 et 1986, l’immigration estudiantine est arrivée en provenance des pays Caribéens qui possédaient des systèmes économiques plus prospères, tels que Trinidad et Tobago ainsi que la Barbade (Ransford, 51). Jusqu’à aujourd’hui, les enjeux économiques continuent de jouer un rôle déterminant dans les mouvements migratoires des Caribéens vers les États-Unis.
2.2.2: Adaptation à la ville de New York A/ Problématique ethnique et raciale À cause du nombre de Caribéens d’origines différentes qu’elle accueille, on peut décrire la ville de New York comme la plus « grande ville caribéenne du monde ». La plus grande concentration de Caribéens se trouve dans le quartier africain-américain de Brooklyn, l’un des berceaux du mouvement hip-hop. Le nombre de Caribéens vivant aux Etats-Unis est estimé à environ 2,6 millions32. La République Dominicaine, Haïti, la Jamaïque et Cuba sont les pays qui fournissent le plus grand nombre
32
People’s Weekly World : www.pww.org. « Continuity and change in caribbean immigration », Martin Frazier, Juillet 2005.
75
d’immigrants. De nombreux immigrants ou descendants d’immigrants caribéens ont marqué l’histoire et la société étasuniennes par leur réussite. Leur influence et leurs initiatives ont surtout été illustrées dans le domaine de la protestation politique (Marcus Garvey, Malcolm X33, Stokely Carmichael34, Louis Farrakhan35) et de la vie culturelle36. Durant les années 60, Bertram L. Baker, originaire de l’île de Nevis, est devenu le premier homme noir à siéger à l’assemblée de l’État de New York. Shirley Chisholm, d’origine caribéenne (Barbade et Guyana), est devenue la première femme noire élue au Congrès (idem, 25). Il est clair que les Caribéens, en arrivant dans la société étasunienne, ont le désir de gravir l’échelle sociale. D’autre part, à cause de son histoire coloniale, c’est une communauté qui croit en l’efficacité de l’éducation. C’est un trait culturel. Les caribéens arrivent avec cet objectif, avoir de meilleures conditions de vie. Cependant, tout comme les AfricainsAméricains, ils doivent sans cesse surmonter des obstacles raciaux sur le marché du travail. À cause de l’existence de ces barrières, une catégorie d’auteurs37 reste sceptique quant au progrès et à l’adaptation socio-économique des Caribéens aux États-Unis. Le facteur économique joue un rôle crucial dans la vie de ces derniers. Selon Phillip Kasinitz, dans son ouvrage Caribbean New York : Black immigrants and the politics of race (1992), la présence des Caribéens dans la société nord-américaine remonte aux deux premières décennies du 20e siècle (24). Étant donné leur supériorité démographique dans leur pays, ces derniers arrivaient avec plus d’assurance et moins d’a priori raciaux que les Africains-Américains. Ils n’étaient pas fatalistes et interprétaient le concept
33
La mère de Malcolm X était d’origine grenadinne et son père africain-américain. Co-fondateur du mouvement des Black Panthers. Il est né à Trinidad et a émigré aux États-Unis en 1952. 35 Dirigeant de la Nation de l’Islam (l’une des associations religieuses africainesaméricaines les plus influentes). Louis Farrakhan est issu d’une famille dont la mère est originaire de Saint-Kitts et le père de la Jamaïque. (http://www.noi.org/mlfbio.htm). 36 Claude Mc-Kay (écrivain d’origine jamaïcaine), Arthur Schomberg (anthropologue d’origine portoricaine dont le centre de recherche sur les cultures noires à New York porte le nom), Leroi Jones (écrivain né aux États-Unis de parents d’origine jamaïcaine), Monty Alexander (musicien d’origine jamaïcaine). 37 Lennox Raphaël, West-Indians and Afro-Americans, Roy Bryce-Laporte, Black immigrants, the experience of invisibility and inequality.
34
76
de la race autrement. Pour eux, un homme noir avait autant de chances de réussite qu’un homme blanc et n’était pas voué à une position sociale inférieure à cause de sa couleur. À cause de la menace qu’ils représentaient au niveau économique pour les Africains-américains, ce trait culturel des Caribéens était une source de tension entre les deux communautés. Les travailleurs peu qualifiés ont pu jouir d’une ascension sociale en arrivant aux États-Unis tandis que ceux qui étaient qualifiés, à cause de la discrimination raciale, ont connu l’inverse, une mobilité sociale réduite d’où leur prédilection pour lancer de petits commerces (Ibid. 4). A cause de cet état de fait, Nathan Glazer et Patrick Moynihan ont avancé la théorie suivante dans leur livre, Beyond the melting pot : L’adaptation et la réussite sociale des Noirs aux États-Unis ne dépendent pas de la discrimination raciale mais de leurs traits culturels. Il est clair que la volonté de réussir est propre à l’immigrant car il vient poursuivre un rêve, une ambition. Toutefois il convient de nuancer cette affirmation car les barrières raciales aux ÉtatsUnis sont une réalité vérifiable. La plupart des Caribéens vivent, à l’origine, dans des quartiers africainsaméricains tels que Brooklyn et Queens. Les deux quartiers les plus investis par la communauté caribéenne sont East Flatbush et Crown Heigths, situés à Brooklyn (Kasinitz, 1992 : 60). East Flatbush est un quartier principalement habité par celle-ci. L’insertion communautaire se remarque à travers l’agencement des maisons, le balisage des espaces publics des artères centrales, l’animation, la musique, les commerces et le grand nombre d’églises. De ce fait, les Caribéens ont rarement l’occasion d’être en relation avec la population blanche (Ibid. 20). S’ils cherchent à s’adapter à la vie étasunienne et ils s’identifient à la lutte civique menée par les AfricainsAméricains, ils ne cherchent pas pour autant à abandonner leur identité ethnique et leur héritage culturel. Toutefois, ils doivent s’adapter à l’univers socioprofessionnel étatsunien. Ils maintiennent leur identité Caribéenne essentiellement à travers la cellule familiale (Ibid. 20). Ensuite, autour de la famille, on retrouve les associations qui participent activement à la fondation ethnique de la communauté. Ces associations sont celles qui entretiennent la relation avec la société nord-américaine38. À cause de la vitalité culturelle de la société étasunienne et de leur manque de visibilité au sein de la communauté africaine-américaine, les Caribéens marquent leur différence ethnique principalement par le biais de la musique et de la danse. Ce sont ces
38
La Chambre de commerce et d’industrie caribéenne américaine, l’Association Caribéenne américaine de Carnaval sont basées à New York. L’Organisation Interculturelle Caribéenne américaine est basée à Washington.
77
associations qui, en organisant des événements, permettent que la communauté caribéenne se démarque. Les festivals et les défilés de carnaval sont de bonnes occasions pour exprimer cette distinction ethnique. Il existe un jour spécial réservé aux manifestations Caribéennes : le « West Indian American Day Carnival»39. Ce jour commémore la présence de la communauté caribéenne au sein de cette société multiculturelle. C’est une opportunité de mettre en évidence la solidarité Caribéenne. Il est nécessaire de souligner que ces associations sont préservées par les immigrés de la première génération arrivés durant les années 60. Ce sont eux qui ne se sont jamais assimilés à la société étasunienne et maintiennent profondément leurs liens avec leur pays d’origine. Entre 1962 et 1972, une période marquée par une immigration forte, on a enregistré l’arrivée de 135 musiciens et professeurs de musique originaires des pays de la Caraïbe anglophone (Ibid. 24). Dans leurs bagages culturels, ils ont emporté avec eux leurs sonorités, leurs danses, leurs croyances et leurs rites religieux. D’un autre côté, il est intéressant de noter l’impact de l’immigration caribéenne sur les pays d’origine. Alors que l’économie des États-Unis reçoit de la main-d’œuvre, ces derniers en perdent. Ils perdent des ouvriers, des techniciens, du personnel médical et scolaire, des gérants d’entreprise, des compétences qui par leur absence perturbent la bonne marche et l’économie du pays en question. Les gouvernements ne peuvent plus prélever autant de taxes et d’impôts pour assurer le service public. Il en résulte un appauvrissement de l’économie et du système social. Les Caribéens gardent des attaches avec leur pays d’origine par le biais de contacts fréquents avec des parents et des amis qui y vivent. Cette relation leur procure une assurance et un soutien psychologique. Tout comme les autres groupes ethniques aux États-Unis, ils chérissent leur héritage culturel qui leur permet de se reconstruire dans leur nouvel environnement après le déracinement du départ. Un autre exemple d’héritage préservé, c’est le mouvement dancehall, très populaire en Jamaïque. Il s’est exporté aux États-Unis pour se fondre dans le paysage socioculturel. Il s’est répandu à travers la communauté jamaïcaine installée à New York et dans les autres grandes villes nord-américaines à partir des années 80 (Barrow, Dalton, 431). La forte présence des « Sound System » à Brooklyn et dans le Bronx a permis l’apparition d’artistes nord américains tels que Sluggy Ranks, dès 1989, et d’un dénommé Shinehead40. Il est né en Angleterre, a vécu en Jamaïque, puis a émigré aux États-Unis au
39 40
Cette manifestation est organisée à Brooklyn à la fin du mois d’août. Album: Rough and rugged (African Love, US), Troddin (Elektra, US).
78
milieu des années 70 avec ses parents (Barrow, Dalton, 431). Sa particularité a été de mélanger la musique locale, le rap et la musique dancehall. Il pouvait rapper, chanter ou « toaster » sur ses morceaux, une technique hybride qui reflétait bien ses origines et son parcours. Shaggy aussi, ou, Orville Richard Burrell de son vrai nom, fut l’un des premiers artistes basés à New York à connaître un succès international dès 1995 et à maintenir une carrière stable et au sommet depuis. L’exportation de la culture dancehall entraîne irrémédiablement des réadaptations locales notamment en prenant en compte la culture hip-hop aux États-Unis. Un autre tournant dans l’évolution de la musique dancehall, c’est la fusion avec le rap. Le groupe Born Jamericans incarne l’adaptation locale du dancehall aux États-Unis. Nés aux États-Unis de familles jamaïcaines, les membres du duo composé d’Horace Payne et de Notch Howell mélange une façon de « toaster » et un langage purement « dancehall » à des rythmiques authentiquement hip-hop. Super Cat est un deejay indo-jamaïcain installé à New York depuis 1988 qui mélange aussi des éléments de la musique rap à sa création musicale. L’un de ses titres « Ghetto Red hot » qui connut un grand succès, a été reproduit sur un rythme hip-hop. Cette alchimie a conduit à une collaboration en 1993 avec un rappeur nommé Heavy D sous le titre Dem na worry we (Barrow, Dalton, 2001: 435). L’alliance avec le rap est une démarche artistique mais aussi une démarche commerciale lucrative car, ce faisant, l’artiste accède à un marché de 100 millions de consommateurs potentiels. Pour l’artiste rap, c’est aussi un moyen de toucher les populations de la région Caraïbe et leur diaspora vivant dans les grandes villes nord-américaines et européennes. Certes, ces transferts culturels sont plus que des arrangements commerciaux. Sur le plan géographique, les espaces sont proches. Il existe de nombreux parallèles entre les deux cultures, la jamaïcaine et l’africaine-américaine, à l’origine. Elles sont toutes les deux socialement ancrées dans les classes ouvrières elles sont nées dans le ghetto. Leurs musiques ont des éléments communs : des paroles déclamées sur des rythmes syncopés et une basse très présente. Parmi les immigrés originaires de la région Caraïbe, on retrouve des innovateurs majeurs de la culture hip-hop. Afrika Bambaataa, le leader de la première organisation hip-hop créée dans les années 70, est originaire de la Barbade. Busta Rhymes, un rappeur qui innova, au début des années 90, l’art de rapper avec un débit précis et impressionnant, vient d’un foyer originaire de la Jamaïque. D’autres innovateurs et de grandes figures de la culture hip-hop ont aussi des origines caribéennes, tels Notorious BIG, Foxy Brown, Coke La Rock, le rappeur Phife du groupe Tribe Called Quest, Grandmaster Flash. Dans le cas du défunt Notorious BIG, un fondateur du style de rap New Yorkais dans les années 90, sa mère et son père sont originaires de la Jamaïque. Sa mère est arrivée aux États-Unis en 1959.
79
Jusqu’à l’âge de 15 ans, il est retourné régulièrement en Jamaïque et, de cette façon, il est resté en contact avec son héritage culturel jamaïcain (Scott, 2000 : 18-19). La présence caribéenne dans le hip-hop nord-américain ne s’arrête pas simplement à l’introduction du « sound-system » aux États-Unis. L’accent et le créole jamaïcains joueront un rôle dans l’évolution du mouvement et dans la reconnaissance de l’apport caribéen41. Au milieu des années 70, tandis que DJ Kool Herc perd volontairement son accent jamaïcain pour s’adapter à son nouvel environnement, au milieu des années 80 (Chang, 2005 : 67), le rappeur Krs-One l’adopte afin de faire resurgir ses origines caribéennes (Trinidad). Ce sera ensuite le rappeur Mos Def, au milieu des années 90 qui adoptera l’accent jamaïcain dans ses chansons. Pour DJ Kool Herc, perdre son accent était une question d’intégration. Être jamaïcain et noir aux ÉtatsUnis à son époque n’était pas compatible avec la conception de la « négritude » africaine-américaine. Lorsque Krs-One, pionnier du mouvement hip-hop, utilise l’accent jamaïcain et le rythme reggae mélangés au rap, il valide l’authenticité de la participation Caribéenne dans le mouvement. D’autres rappeurs, au début des années 90, n’hésitent pas à chanter en créole jamaïcain sur des versions instrumentales rap (FuShnickens, Das EFX, Smiff’n’Wessun). En 1998, le rappeur Mos Def incorpore le créole jamaïcain à la chanson de son groupe Blackstar « Definition » en utilisant des animations propres aux chansons dancehall (« follow me nuh ! », « Lord have mercy ! »). De plus le thème de la chanson, c’est une interrogation sur l’état du hip-hop. Dans son album produit un an plus tard Black on both sides, Mos Def n’hésite pas à faire fusionner le patois jamaïcain avec l’argot africain-américain. Il symbolise un espace où la culture Caribéenne rencontre la culture africaine-américaine et où elle a toute sa place dans la dynamique du mouvement hip-hop. Toutefois, l’insertion sociale des Caribéens demeure problématique pour plusieurs raisons. Tandis que leur présence et leurs réalisations contredisent le pouvoir des adversités raciales, leur situation ressemble beaucoup à celle des Africains-Américains. Si le revenu moyen des familles caribéennes est souvent plus élevé que celui des familles africaines-américaines, ils vivent dans les mêmes quartiers isolés. Ils sont attachés au respect de l’ordre et de la loi mais ils sont aussi victimes du harcèlement policier. Même s’ils désirent être considérés comme un groupe ethnique distinct qui travaille dur,
41
Marshall Wayne, Hearing hip-hop’s Jamaican accent, depthome.brooklyn.cuny.edu/isam/NewsletS05/Marshall.htm
80
ils sont victimes aussi de l’image négative transmise par les médias des noirs aux États-Unis. Ces contradictions font partie de l’expérience caribéenne dans la société nord-américaine. Leur désir de retourner dans leur pays et, parallèlement, leur désir de s’accomplir rendent ce retour presque impossible. Ils vivent dans une société qui les assimile aux AfricainsAméricains et, par conséquent, aux traits négatifs de cette communauté. Nous ne devons pas minimiser le fait que des éléments criminels existent dans la communauté caribéenne, notamment les gangs jamaïcains, impliqués dans le trafic de drogue. D’autre part, ils luttent pour conserver leur identité ethnique qui leur permet de se dissocier de ces derniers. Selon Roy BryceLaporte, dans le cadre des relations ethniques, cette « double pression » les met en conflit avec d’autres groupes (idem, 5). En d’autres termes, les « forces de pression » sont, d’un côté, la société dont ils proviennent et dans laquelle ils sont majoritaires, cette société caribéenne qui n’impose pas le facteur racial comme une barrière socio-économique et prend en compte le mérite de l’individu, et de l’autre côté, la société étasunienne qui offre une grande capacité d’ascension sociale mais qui impose clairement le facteur racial comme un élément clé dans sa stratification. B/ Relations avec la communauté africaine-américaine En raison de leur couleur de peau, les Caribéens vivant aux ÉtatsUnis sont souvent assimilés aux Africains-Américains. Parce qu’ils tiennent à préserver leur différence ethnique, les Caribéens cherchent constamment à se différencier de ces derniers. La raison est la suivante : être confondu avec les Africains-Américains est synonyme d’abaissement social, à cause de leur image et de leur situation dans la société étasunienne. Il est vrai que les médias contribuent à la surenchère des stéréotypes attribués à la communauté africaine-américaine. La situation des Africains-Américains (violence, drogue, pauvreté, échec scolaire…) vivant dans les zones urbaines sensibles est généralisée. Il arrive que les immigrants reçoivent un accueil hostile de la part des Africains-Américains dans les rues de New York. Il arrive aussi que certains s’entendent dire : « retournez chez vous ! » (Waters, 73). Néanmoins, malgré leurs différences ethniques, il existe une solidarité raciale entre les deux communautés étant donné que, devant la discrimination, elles sont mises sur le même plan. On note un grand nombre de mariages et d’échanges interculturels entre les deux communautés (Waters, 76). Malgré les efforts des Caribéens, ces deux communautés deviennent donc de moins en moins différenciables dans une ville comme New York qui se « caribéanise » de plus en plus.
81
Tandis que la première génération de Caribéens s’attache fermement à ses racines ethniques, la seconde (née aux États-Unis de parents immigrants) ainsi que la « génération 1.5 »42 (nés aux Antilles et ayant immigré aux États-Unis durant son enfance) réalisent leur construction identitaire autrement. La culture matérialiste nord-américaine, la tension raciale, les écoles et les quartiers ségrégués sont autant d’obstacles qui s’accumulent sur le parcours de la jeunesse caribéenne-américaine. Les artistes que nous avons rencontrés dans le cadre de notre recherche font justement partie de ces deux générations. Deux groupes se forment pendant cette construction identitaire : Ceux qui choisissent l’identité ethnique et ceux qui optent pour l’identité américaine. Le premier groupe a tendance à s’impliquer dans des événements, des organisations, des clubs de sport ou des Églises caribéennes. Les rassemblements culturels majeurs leur procurent beaucoup de fierté. Le deuxième groupe diffère, dans le sens où il accorde moins d’importance à ses racines ethniques. Simplement, ces jeunes ignorent la culture de leurs parents et s’identifient à la culture africaine-américaine. Ils écoutent du rap, parlent l’argot africain-américain et acceptent les traits culturels de leurs amis africains-américains (idem, 296). Cette orientation crée des clivages entre les parents et les enfants. Les parents refusent les traits culturels africains-américains arborés par leurs enfants. Ceux-ci leur rappellent l’image négative véhiculée par la communauté africaine-américaine. Les enfants, eux, rejettent la culture parentale qu’ils perçoivent comme un poids dans la société étasunienne. Être américain est un atout social pour ces adolescents. Quant aux jeunes arrivés récemment aux États-Unis, ils accentuent leur nationalité et leur lieu de naissance comme l’aspect central de leur identité. Ils ont, pour la plupart, gardé leur accent, leur style vestimentaire, signalant ainsi leur différence ethnique aux autres. À cause des liens familiaux gardés avec leur pays, des retours fréquents et de leur désir de retourner s’y installer, ils ne se considèrent pas comme des Américains. Les Caribéens qui vivent à New York, et aux États-Unis en général, entretiennent des liens familiaux forts avec ceux qui sont restés dans leur pays. Nombreux sont ceux qui envoient de l’argent tous les mois afin de subvenir aux besoins des membres de la famille restés chez eux. Ces contacts sont facilités par le développement des moyens de communication et des liaisons aériennes. Entre ces deux sociétés, les Caribéens développent une identité transnationale qui transforme les individus et les deux sociétés. Les liens culturels, politiques, et sociaux, qui ont donné aux différents individus
42
Terme inventé par la sociologue Mary Waters.
82
d’origine Caribéenne une identité régionale sont renforcés lorsqu’ils arrivent aux États-Unis. Le choix de certains jeunes Caribéens aux États-Unis de s’orienter vers le mouvement rastafari traduit le désir d’identification au mouvement afrocentrique, mais aussi celui d’affirmer l’identité caribbéenne. Malgré les différences ethniques entre les deux communautés, elles reçoivent le même traitement de la société américaine. La discrimination raciale est un facteur inéluctable dans leurs conditions de vie et les chemins d’identité empruntés. Elles sont aussi proches dans les réactions qu’elles développent face à ce traitement. Le hip-hop, originaire de Brooklyn, est une réponse et le mouvement rasta, originaire de Kingston, en est une autre. La migration des Caribéens à New York a ainsi facilité la création de liens entre ces deux phénomènes. S’identifier au mouvement rastafari est donc une réponse identitaire pour les jeunes ayant des racines caribéennes (une manière de vivre leur héritage caribéen) et vivant aux États-Unis. S’identifier à la culture hip-hop est une réaction à leur environnement immédiat (c’est le moyen le plus direct et le plus proche dont ils disposent pour véhiculer ce qu’ils sont aux États-Unis). C’est aussi celui qui les touche directement dans leur être, celui avec lequel ils ont commencé à connaître la société étasunienne et, paradoxalement, à s’y intégrer. Parce qu’ils ont des expériences similaires, les membres de la diaspora noire en Amérique ont développé des moyens d’expression similaires en plusieurs points. De la plantation au ghetto, en passant par le déracinement de la traite négrière, le peuple noir a systématiquement mis en place des moyens de résistance dans son nouvel univers. Ces expériences ont créé un « pont sociologique et culturel » entre le peuple noir des États-Unis et celui de la Jamaïque.
83
CHAPITRE 2 DES EXPÉRIENCES IDENTIQUES VÉCUES PAR LES DIASPORAS NOIRES DES AMÉRIQUES Pendant près de quatre siècles, des hommes et des femmes ont été capturés et transportés hors d’Afrique vers l’Amérique et la région Caraïbe. Séparés de leurs pays et de leurs familles, ils ont été réduits en esclavage dans un nouveau monde où leurs traditions étaient quasi absentes et, quand ils tentaient de les maintenir, ils étaient sévèrement châtiés. Les pays les plus industrialisés tels que la France, l’Angleterre, les États-Unis, l’Espagne, le Portugal ont profité du système esclavagiste et de l’exploitation de la maind’œuvre africaine pour stimuler leur développement économique. Cette maind’œuvre répartie sur le continent américain et dans la région Caraïbe a été l’un des moteurs de l’accumulation financière et de l’expansion économique de ces pays. Après l’accès à l’indépendance des pays de la Caraïbe et de l’Afrique, de nombreux descendants d’esclaves ont émigré vers les pays de leurs anciens colonisateurs pour des raisons économiques. Le concept de la diaspora nous permettra de souligner les processus par lesquels ces hommes et ces femmes ont pu retenir leurs traditions et reformer leurs identités. Il nous permettra aussi de mieux appréhender l’Amérique noire. Pour préciser notre hypothèse, nous avons choisi d’évaluer les expériences similaires vécues par les Africains déportés et leurs descendants en Amérique du Nord et dans la région Caraïbe, particulièrement à la Jamaïque. Quelles sont les passerelles socioculturelles qui se sont installées entre ces groupes facilitant le rapprochement des deux phénomènes culturels nés dans ces deux régions respectives, la culture hip-hop et le mouvement rastafari ? Nous nous attacherons particulièrement dans ce chapitre à relever les similitudes dans l’expérience socio-historique de ces deux groupes d’individus à l’origine du mouvement hip-hop (la communauté africaineaméricaine) et du mouvement rastafari (la communauté afro-caribéenne). La finalité étant que ces points communs nous permettent de mieux comprendre le rapprochement de ces deux cultures. Il importe en outre de ne pas ignorer l'effet rassemblant de notre approche : reconnaître un ou plusieurs points communs à ces deux communautés ne revient pas à nier leurs spécificités et leurs différences. Par conséquent, tout au long de notre analyse, nous nous attacherons à évaluer également les distinctions entre les deux communautés et les deux phénomènes. Afin de mieux conceptualiser notre démarche, nous proposons une définition du concept principal que nous utiliserons au cours
85
de notre argumentation, à savoir la diaspora. Ce concept est parfois utilisé de manière incertaine pour définir toutes sortes de dispersion des populations. Dans ses écrits sur la question, Stéphane Dufoix indique que le mot « diaspora » est un emprunt récent du français, daté de 1908, à la langue grecque et qu’il signifie « dispersion »43. Plus précisément, il vient du verbe grec diaspeirien qui signifie disséminer. Le terme a d’abord été utilisé pour décrire l’exil forcé du peuple juif, sa dispersion dans le monde au cours des siècles. Il sera appliqué à d’autres peuples à partir de la fin des années 40 et désignera « la dispersion d’une ethnie ». Comme l’a signalé Stéphane Dufoix, Max Weber parlait déjà de « diaspora calviniste » en 1905 dans L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme (Ibid. 9). Selon Denys Cuche, devant la confusion sémantique et conceptuelle, la plupart des chercheurs en sciences sociales se sont accordés sur un certain nombre de critères définissant ce qu’est une diaspora. Elle doit unir les éléments suivants : l’espace de la dispersion, la dispersion sous la contrainte, l’interpolarité et la multipolarité44, la mémoire collective, un certain refus de l’assimilation, l’état de minorité ethnique, le nombre de migrants et enfin la durée de l’état de dispersion45. Le concept de diaspora n’a jamais été transparent, à tel point que, devant une telle incertitude conceptuelle du terme, Dufoix conclut son exposé en suggérant subtilement de se débarrasser du terme pour en trouver d’autres (Ibid. 13). Nul besoin d’être aussi radical que ce dernier car, à notre avis, le terme possède assez de pertinence pour expliquer l’expérience des peuples issus de la migration forcée au départ de l’Afrique vers le Nouveau Monde. Il a souvent été utilisé dans le langage courant pour décrire la situation du peuple juif. Son utilisation en tant qu’outil scientifique est récente et provient clairement de l’intérêt que suscitent, depuis une vingtaine d’années, les déplacements des populations à l’échelle planétaire. Selon Michel Bruneau, directeur de recherches émérite au CNRS et spécialiste des diasporas, au départ de celle-ci, « il y a toujours un déracinement, un arrachement du territoire, du lieu d’origine, à cause d’un
43
Cité Dans « Généalogie d’un lieu commun « diaspora » et sciences sociales », Dufoix Stéphane, Rey (Alain), sous la dir. de, Dictionnaire historique de la langue française, Paris, Dictionnaires Le Robert, 1998 (1ère éd. en grand format 1992), p. 1076-1077. 44 La multipolarité - la diversité de la dispersion - et l'interpolarité - les liens entre les pôles dispersés - sont à la base de la définition de la diaspora par Emmanuel Ma Mung. 45 Idem, Cuche Denys, Diaspora , « Pluriel recherches. Vocabulaire historique et critique des relations inter-ethniques », cahier n°8, Paris, L'Harmattan, 2001, p. 1423.
86
événement historique majeur pour le peuple concerné, événement qui est présenté comme une catastrophe »46. À cause de l’unité culturelle prônée par l’idéologie nationale, les diasporas sont parfois perçues de manière négative. Leur double allégeance gène la politique d’homogénéisation des Étatsnations. Cependant, comme l’indique Christine Chivallon, anthropologue et directrice du centre d’études de l’Afrique noire à l’IEP de Bordeaux, dans sa brillante analyse La diaspora noire des Amériques, les diasporas continuent de se perpétuer et de former des communautés distinctes participant activement à la vie socio-économique du pays d’installation. Leur dynamisme provient de cette capacité à créer une identité particulière au sein de leur société d’accueil où « la référence au pays d’origine est traduite par un ensemble de liens matériels ou symboliques » (Chivallon, 2004 : 17). Cette vitalité est un élément fédérateur qui garantit le lien communautaire de la diaspora. Selon Bruneau, il existe quatre grands types de diasporas : un premier groupe qui se structure autour du commerce et du travail (diaspora chinoise), un deuxième dans lequel la religion souvent associée à la langue est le principal élément fédérateur (ex. : la diaspora juive, grecque…), un troisième ensemble qui s’organise autour d’un axe politique (création d’un Etat-nation, ex : diaspora palestinienne) et, enfin, un quatrième qui s’organise autour d’un axe racial et culturel (ex. : la diaspora noire avec la particularité d’être une diaspora interculturelle et multiculturelle) . Ce dernier exemple de diaspora est celui qui nous intéresse. Elle se définit comme une diaspora culturelle qui, cependant, a subi au même titre que les autres types de diasporas un déracinement physique et existentiel, d’où le besoin de recréer un lien avec la nation d’origine. Précisons que la nation d’origine peut être l’Afrique ou un pays de la Caraïbe lorsque les descendants d’esclaves africains y ayant vécu auront choisi d’émigrer vers une ancienne métropole (ex : les États-Unis, l’Angleterre ou la France). En effet, les recompositions identitaires opérées aux États-Unis ou en Europe à cause des migrations de travail à partir du 20e siècle sont d’une grande importance. La diaspora suppose un ancrage très fort dans le territoire d’installation et une séparation très nette avec le territoire d’origine. Toutefois l’être en diaspora a le sentiment d’appartenir à une nation en exil et d’être porteur d’un idéal. Cela sous-entend que les descendants d’esclaves aux États-Unis ou dans la région Caraïbe peuvent clairement faire le choix d’appartenir ou non à la diaspora noire. Ce n’est pas un sentiment inné car,
46
Bruneau Michel, Diaspora et espaces transnationaux Collection Ville-Géographie, édition Economica, Paris, 2004, p.2.
87
pour une partie de ces descendants, le besoin de se re-connecter à la terre d’origine n’existe pas. La recherche de Christine Chivallon est une pierre angulaire dans la construction théorique de la diaspora noire des Amériques. Par la précision conceptuelle de son propos, elle élargit son champ de vision pour prendre en compte la dimension historique de la dispersion et ses continuations diverses dans les Amériques. Notre seconde analyse conceptuelle concerne les Amériques noires, composées de plusieurs pays, ou encore l’Amérique noire, formant un seul et même ensemble. Sur le plan géographique, elle est composée principalement de la région Caraïbe, du Brésil et des États-Unis. Ces trois espaces sont le berceau des Amériques noires, car ils comptent le plus grand nombre de descendants d’esclaves à ce jour (idem, 36). La région Caraïbe peut comprendre l’archipel des Antilles et les pays du continent : Venezuela, Colombie, Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Belize. Elle peut aussi ne retenir que les pays du continent selon la définition de Richard Price (idem, 36). En général, la Caraïbe désigne l’ensemble des pays situés dans le bassin caribéen, baignés par la mer caribéenne, autrement dit toutes les îles, y compris les Bahamas, et l’ensemble du littoral, y compris le Sud du Mexique, toute l’Amérique centrale, le Panama, la Colombie, le Venezuela, le Guyana, le Suriname et la Guyane française. C’est selon cette définition que nous utiliserons le terme au cours de notre argumentation. Bien entendu, nous porterons une attention singulière sur les îles anglophones situées dans cet espace. Les Amériques noires sont nées du système de plantation, un système à la fois social, économique et culturel. Il y a eu au fil des années plusieurs interprétations du fait diasporique noir. Melville Herskovits est le premier anthropologue américain à avoir compris que les Amériques noires constituaient un ensemble anthropologique propre ayant au départ un même fondement : le système de plantation colonial. Son livre le plus influent, Le mythe du passé noir (1941), constitue l’aboutissement d’une réflexion sur l’Afrique et les Amériques noires. Sa théorie présente le Noir américain comme membre d’un groupe ethnique propre et possédant une culture distincte. Cette conception constitue une véritable révolution car, pendant les années 30 et 40, les Noirs étaient perçus comme un groupe racial dépourvu de tout passé propre. Il développe principalement la thèse de la continuité entre l’Afrique et le Nouveau monde, ainsi que la survivance des pratiques culturelles tout en restant sensible aux phénomènes de syncrétisme ou de réinterprétation, autrement dit « un cadre de pensée ancien pour réinterpréter des éléments nouveaux » (Chivallon, 116), une théorie se rapprochant de l’afrocentrisme. Par opposition à la thèse de la continuité,
88
l’anthropologue Franklin Frazier développe la théorie de la déstructuration qu’il expose dans son ouvrage The negro in the United States (1949). Il argumente que l’Afrique n’a plus de pertinence pour comprendre le nouvel environnement dans lequel évolue l’esclave et qu’elle n’est plus qu’un ensemble de souvenirs effacés. L’ouvrage de l’anthropologue français Roger Bastide, Les Amériques noires (1967), reproche aux deux américanistes leur explication d’une logique externe pour expliquer les cultures noires : l’Afrique ou l’absence d’Afrique pour Frazier, le pouvoir blanc ou l’esclavage pour Herskovits. Il décrit les cultures africaines-américaines selon une conception qui s’articule autour de deux grandes catégories : les communautés africaines et les communautés nègres. Les premières sont celles ou les bases africaines ont été réutilisées dans le nouvel environnement américain et les secondes sont celles qui révèlent les ruptures avec ces bases. Il est clair que l’œuvre de Bastide cherche aussi bien à rétablir l’Afrique dans le Nouveau monde qu’à montrer la coupure entre les deux mondes. Ce qui le gêne dans les thèses des deux premiers sociologues américains, c’est l’absence d’une conception dynamique de la culture car cette dernière est un ensemble en perpétuel mouvement : elle se construit et se déconstruit perpétuellement. Il ne peut y avoir de culture fixe, statique. Les communautés noires possèdent des caractéristiques différentes ; c’est l’objet principal de son livre sur les Amériques noires. Il faut absolument tenir compte des effets destructeurs de l’esclavage. Il pense que la culture d’origine est insuffisante et incomplète pour cerner les Amériques noires parce que toute culture évolue. Durant la seconde génération, les Noirs des Amériques deviennent des Nègres créoles (le mot créole désigne dans son sens initial les Européens nés sur les terres du Nouveau Monde ; la dénomination est alors appliquée exclusivement au Blanc). Les Nègres créoles sont ceux qui sont nés aux Amériques. Selon Bastide, l’Afrique n’a pas pu se maintenir dans son intégralité ; il y a eu apport réciproque. Les Noirs ont toujours été maintenus à l’écart des maîtres blancs. C’est cette frontière sociale avec les Blancs qui a facilité la création de leur propre univers culturel. La théorie de la créolisation considère le mélange des deux cultures et la reconstitution systématique des héritages sans distinction des origines et sans hiérarchie. Cette thèse est représentée dans le monde francophone par les intellectuels de la créolité que sont Raphaël Confiant, Jean Bernabé et Patrick Chamoiseau, à travers l’ouvrage Éloge de la créolité (1989). Cette théorie du creuset culturel pour décrire l’identité de la diaspora noire des Amériques doit beaucoup aux travaux proposés par deux anthropologues américains, spécialistes des Amériques noires, Sidney Mintz et Richard Price (1976).
89
Mintz a écrit Sucre blanc, misère noire47 (1991), une histoire et une anthropologie de la production sucrière. La culture du sucre vient du ProcheOrient et nécessite une abondante force de travail. Cette culture est à l’origine de l’esclavage. L’Amérique des plantations est donc initialement sucrière, mais elle va s’adapter à d’autres plantes d’exportation comme le coton, le cacao, le café, le tabac. La plantation n’est pas seulement un type d’exploitation, c’est surtout une microsociété, un univers hiérarchisé en fonction de la race qui se suffit à lui-même. Comme le déclare si habilement Christine Chivallon, les deux thèses, celle de la continuité et celle de la créativité, ne peuvent pas s’opposer lorsque la première reconnaît « la présence de l’héritage africain dans la fabrication du nouveau et quand la seconde envisage la création culturelle à partir d’une grammaire culturelle ancienne… » (p. 129). Enfin, la troisième conception majeure est celle de l’aliénation. Elle a été utilisée pour décrire la diaspora noire aux Amériques. Cette thèse conçoit la dissolution de l’identité dans un contexte de violence globale exercée sur l’individu et le groupe. Les écrits en sciences humaines aux Antilles françaises sont ceux qui ont le plus insisté sur cette conception de l’aliénation. On suppose que c’est la relation fusionnelle avec la nation française qui a favorisé cette position (Chivallon, 129-132). Durant les années 80, deux auteurs martiniquais émergent comme les phares de ce courant de pensée, Edouard Glissant (1981) et Francis Affergan (1983). Ils parviennent à proposer une approche théorique cohérente révélant une communauté dépossédée de sa capacité à se structurer. Parler de diaspora noire, c’est parler d’une communauté ethnique ayant des marqueurs culturels spécifiques, des marqueurs spécifiques que la communauté a dû préserver au-delà de la dispersion. Signalons que pour certains historiens, la présence très ancienne d’esclaves noirs en Asie permet de situer l’origine de la diaspora noire à une période antérieure à la déportation vers l’Amérique (idem, 47). Notamment, en marge de la traite transatlantique, la diaspora doit aussi être définie en fonction des mouvements migratoires contemporains, particulièrement intenses depuis la Caraïbe, qui voient se réinstaller une partie de la population noire dans les pays d’Europe et d’Amérique du Nord au cours du 20e siècle. Ce sont plusieurs styles de vie, plusieurs visions du monde qui sont mis en contact ou fusionnent, avec une violence exceptionnelle dans le cas de la diaspora noire, pour enfanter de nouveaux comportements, de nouvelles règles de vie,
47
Titre original : Sweetness and Power: The Place of Sugar in Modern History (New York, 1985).
90
de nouvelles cultures. Nous rejoignons l’opinion exprimée par Christine Chivallon en conclusion de l’exposition des trois théories mises en place pour interpréter l’univers culturel noir des Amériques. Dans la démarche qui consiste à définir la diaspora noire des Amériques, l’important n’est pas de chercher seulement à connaître la provenance des éléments formateurs de la culture mais est de connaître les significations collectives exprimées par ces composantes. En d’autres termes, savoir si un élément culturel est africain est moins important que de savoir si les populations concernées en revendiquent l’africanité (idem, 133). Cette perspective nous semble essentielle dans la compréhension de l’univers culturel des Amériques noires. Après cette clarification conceptuelle, la prochaine étape dans notre raisonnement consistera à mettre en lumière et à articuler les analogies et les connexions entre les diasporas noires recomposées aux États-Unis et dans la Caraïbe, entre la diaspora qui donna naissance au mouvement hip-hop et celle qui donna naissance au mouvement rastafari.
2.2.1: De la plantation au ghetto : un univers isolé A/ La traite transatlantique et l’esclavage comme événements fondateurs La traite transatlantique est le plus grand et le plus long mouvement de déportation organisé dans l’histoire de l’humanité. Elle est à l’origine de la formation de la diaspora noire des Amériques, d’une part, à l’origine du développement du capitalisme occidental et, de l’appauvrissement du continent africain, d’autre part48. Les sociétés du Nouveau Monde ont été fondées dans une violence extrême et ont été maintenues par la violence. La traite est un déracinement. Cependant, cet anéantissement stimulera les capacités créatrices des peuples africains prisonniers de l’entreprise esclavagiste. Loin de vouloir céder à un militantisme emprunté et à des récriminations stériles devant cette réalité troublante, nous chercherons à adopter une position lucide au cours de notre étude.
48
Pour plus d’informations sur ce sujet, voir l’ouvrage de l’historien guyanais Walter Rodney : How Europe underdeveloped Africa, Howard University Press, 1982.
91
Les bateaux négriers transportant les esclaves originaires du continent africain ont absorbé, entre autres, en Amérique du Nord et à la Jamaïque. L’histoire du peuple noir répandu dans ces deux territoires commence dans des conditions de violence effroyable. Cela commence par la capture dans des conditions épouvantables et continue par la traversée à bord des navires négriers, l’arrivée dans les colonies, la séparation des familles, le viol de l’esclave femme par le maître, le fouet, la violence symbolique du changement de nom, de religion, et enfin cela se termine par l’obligation de travailler sans salaire pour le compte d’autrui. Se questionner sur « les conditions de dispersion et les conditions d’installation » de la diaspora est primordial pour mieux comprendre l’orientation de la quête identitaire qui y est attachée (Chivallon, 2004 : 211). La traite et l’esclavage, bien qu’étant liés, sont deux aspects bien distincts du dispositif esclavagiste. La traite renvoie à l’organisation de l’itinéraire par lequel s’opère le commerce des esclaves et l’esclavage désigne l’utilisation de cette main-d’œuvre captive (Ibid. 45). Le trafic négrier commence dès 1445 et ira en s’intensifiant jusqu’en 1870 (Rodney, 1982 : 96). Selon l’historien Martin Steve, durant la période de la traite, entre 10 et 15 millions d’Africains auraient été déportés en Occident (1999 : 21). Alors que la traite a commencé depuis le 15e siècle dans la région Caraïbe, ce n’est qu’au 17e siècle que des esclaves commencent à être importés aux États-Unis. L’esclavage étant une institution antérieure à la traite transatlantique, il explique en partie la complicité de certaines élites africaines. Bien entendu, la responsabilité des puissances européennes n’est pas pour autant minimisée, car la traite est organisée, maintenue et programée depuis l’Europe. La résistance africaine à la traite doit être mentionnée : elle se manifeste par des révoltes, des mutineries et des évasions (Chivallon, 2004 : 48). Les populations noires de la Jamaïque et d’Amérique du Nord ont été composées par la traite transatlantique. Ces deux sociétés fondées dans l’extrême violence de l’esclavage, du colonialisme et de la ségrégation raciale n’ont pas permis une stabilisation psychologique et sociale souple pour les esclaves et ce, même durant la période post-esclavagiste. Ces populations ont aussi expérimenté l’esclavage qui laissa des traces profondes dans la fondation de leur univers socioculturel. Dans la prochaine partie de notre analyse, nous considérerons les structures sociales héritées de cette période qui contribuèrent au rapprochement des expressions culturelles des deux communautés afro-diasporiques. B/ L’univers de la plantation Afin de cerner les phénomènes culturels noirs, il nous faut absolument revenir à la captivité esclavagiste, car c’est à l’intérieur de
92
l’univers de la plantation que naissent les repères sociaux qui structurent l’expérience de la diaspora noire. Nous tenterons d’examiner les continuités de l’univers culturel de l’homme noir au sein duquel il doit sans cesse se recomposer au regard de la société qui l’entoure, ou à défaut l’ignore. Il est important pour nous d’analyser cet aspect des choses, car le ghetto a été le « terroir » du mouvement hip-hop et du mouvement rastafari. Il nous semble que ce point commun soulève une des principales raisons de l’attraction entre les deux mouvements. Dans l’univers de la plantation, l’organisation est conçue autour de la finalité économique. L’espace du maître, propriétaire des moyens de production, est séparé de celui du contremaître, gérant des travaux et des forces ouvrières. Ces deux espaces sont également séparés du quartier des esclaves, à distance suffisante pour symboliser la séparation des univers. L’organisation des sociétés de plantation reproduit le mode d’exploitation esclavagiste, la hiérarchie socio-raciale en découle. La société est divisée entre les propriétaires des moyens de production et les propriétés, autrement dit entre les noirs et les blancs. Par définition, la plantation est une unité agricole ayant une organisation économique caractérisée par une large force ouvrière non qualifiée résidant sur l’espace et contrôlée par un petit nombre de superviseurs (Barrow, Reddock, 2001 : 139-150). Tout au long de l’histoire, la plantation s’est établie dans les territoires où la terre était abondante. C’est une communauté hiérarchisée de manière économique et raciale les travailleurs sont séparés de ceux qui prennent les décisions. Dans un article où il théorise la société caribéenne, George Beckford emploie la notion de société de plantation. Il décrit la société caribéenne moderne comme une société héritière de l’univers de la plantation. L’Amérique anglophone alias « l’Amérique des Plantations » comme l’appelle Charles Wagley dans son analyse Plantation America : A Culture Sphere (1960), est une Amérique fondée sur la traite et l’esclavage. Au 19e siècle en Jamaïque, on trouve des plantations avec 200 esclaves ou plus tandis qu’aux États-Unis, la plupart des plantations sont de taille plus modeste. Ces petites structures encouragent « l’institution paternaliste caractéristique du système américain où despotisme et clémence affective font bon ménage pour maintenir l’autorité du maître » (idem, 71). Aux États-Unis, par rapport à l’effectif de la population blanche, les esclaves forment une minorité. L’héritage social de ce fait se retrouve dans la séparation raciale bipolaire aux États-Unis et les faits de violence perpétrés à l’encontre de la population noire jusqu’à aujourd’hui, une situation en total contraste avec la Jamaïque où les esclaves forment une écrasante majorité. En 1805, la population noire représente 91% de la population totale (Brathwaite, 1971 : 152). Une autre différence majeure entre les deux pays, c’est le renouvellement des esclaves. En Jamaïque, la population noire est maintenue par l’apport constant de nouveaux esclaves et non par
93
l’accroissement de la population déjà importée, tandis qu’aux États-Unis la population noire importée (environ 400 000) atteint 4 millions d’individus en 1860, sans apport de nouveaux esclaves venus d’Afrique. C’est une population créole qui domine aux États-Unis (Chivallon, 71). Ces données sous-entendent une présence africaine plus solidement maintenue en Jamaïque. L’autorité de la « plantocratie » blanche tire sa force d’une hiérarchisation sociale légitimée par la pigmentation de la peau. Connaître les conditions de dispersion et d’installation des esclaves nous permet de mieux cerner leur quête identitaire et celle de leurs descendants. Parlant de la situation française, Christiane Taubira-Delanon, député de la Guyane, déclare : « une des conséquences de cette histoire est bien visible : c’est la vivacité des discriminations »49. Ce commentaire décrit parfaitement la société américaine et la société jamaïcaine. En réponse au déclin de l’activité sucrière, les caractéristiques de l’époque moderne se mettent en place. La diversification agricole supplée mal aux anciens engrenages. À la Jamaïque, le pourcentage des emplois ruraux diminue alors que la population totale ne cesse d’augmenter : 695 000 habitants en 1896, 1,1 million en 1936 et 2,5 millions en 1990 (Chivallon, 85). La part de l’agriculture dans l’économie diminue de façon radicale passant de 39% du PIB en 1938 à 9% en 1972 (Ibid. 85). C’est cette baisse d’activité agricole rurale qui provoque de grands mouvements de migration urbaine vers Kingston dans les années 30. C’est ainsi que les ghettos urbains qui allaient voir apparaître le mouvement rasta se forment. C’est également ce phénomène d’exode rural du Sud vers le Nord des États-Unis qui sera à l’origine du « couffin » socioculturel du mouvement hip-hop.
C/ L’aménagement du ghetto Le mouvement hip-hop est né dans la ville de New York, le mouvement rasta dans celle de Kingston. Les deux mouvements ont débuté dans des enclaves urbaines, des ghettos au sein de ces deux villes. Il nous semble important de souligner le rôle crucial que tient la ville de New York dans la naissance et l’évolution des deux phénomènes. Marcus Garvey, dont la pensée panafricaine est à l’origine du mouvement rasta, a profondément
49
Dossier « Esclavage : la discrimination en héritage » réalisé par Laurent Urfer le 15 juin 2006.
94
transformé les quartiers noirs de New York lors du développement de son organisation, l’UNIA (United Negro Improvment Association)50. C’est à New York qu’il installe ses quartiers généraux et qu’il commence à matérialiser ses idées. New York est également le premier port où arrivent les Caribéens depuis les années 60, notamment les rastas qui ont émigré aux États-Unis. Et enfin, cette ville a été et reste le berceau de la culture hiphop ; c’est dans ces quartiers noirs et latinos que s’est développé le phénomène. Ces enclaves urbaines, qui définissent en réalité la ville de Kingston, sont l’héritage direct d’un système inégalitaire nourri par l’esclavage et la plantation. Chômage, pauvreté et violence sont le lot quotidien des habitants de ces quartiers formés en majorité par la population noire du pays. En effet, lorsque le système esclavagiste s’est écroulé, il n’y a pas eu d’autres solutions à proposer. L’opulence des classes bourgeoises, enrichie par le tourisme, la finance, l’agriculture, le trafic de stupéfiants et logées dans les hauteurs de Kingston, témoigne des inégalités vivaces héritées de cette période esclavagiste. La situation socio-économique de la Jamaïque est exemplaire dans le sens où cette société, devenue indépendante en 1962, a été abandonnée à elle-même et condamnée à bâtir sur les ruines d’un système esclavagiste dont les profits ont été investis ailleurs. Même après la période esclavagiste aux États-Unis, la ségrégation socioéconomique demeure le dénominateur commun de la population noire à l’instar de la Jamaïque. Précisons que les Noirs y sont inférieurs en nombre. Dans le Sud des États-Unis, les violences physiques et le harcèlement racial à leur encontre sont monnaie courante. Les mouvements de migration vers le Nord du pays au début du 20e siècle sont l’une des conséquences directes de cette pression sociale. Une autre cause de cette migration résulte du déclin de l’activité cotonnière après l’abolition de l’esclavage et de l’essor industriel du Nord, à tel point que certaines grandes villes comme Washington et Détroit se retrouvent avec une population noire représentant plus de la moitié de la population totale (idem, 94). Dans les grandes villes américaines telles que New York, Chicago, Philadelphie ou encore Détroit, les ghettos se forment, largement composés de Noirs et d’Hispaniques (Bates, Fusfeld, 1984 : 2). Le ghetto possède deux grandes caractéristiques : il est composé en majeure partie de minorités raciales et il est pauvre. Tout comme en Jamaïque, les villes américaines sont un contraste entre l’opulence et l’extrême pauvreté.
50
L’association universelle pour l’amélioration de la condition noire. Fondée en 1917, l’association est toujours en activité.
95
Le ghetto a servi, et sert toujours, à accueillir les immigrants mais aussi les laissés-pour-compte de la société. Les ressources du ghetto proviennent de l’activité ouvrière et d’une économie illégale et irrégulière. Le chômage, la violence, des salaires faibles, des logements insalubres, un service public de mauvaise qualité et un manque de qualifications, créant les conditions de dépression économique permanente, sont les caractéristiques de ces zones. Conséquence du développement capitaliste, le chômage de masse touche en priorité la population des ghettos. Les jeunes Noirs sont victimes de discrimination à l'embauche. L'économie souterraine se développe comme palliatif au manque de revenus et permet à des familles entières de subsister sans s'enrichir. Les barrières du ghetto sont moins physiques que raciales et sociales ; elles créent un style de vie qui rend difficile l’acceptation de ses habitants dans d’autres secteurs de l’espace socio-économique. Les attitudes racistes et non tolérantes de la population blanche sont aussi une cause de la ségrégation résidentielle que subit la population du ghetto (Ibid. 6). Ces attitudes racistes sont devenues plus intenses entre la fin du 19e siècle et le début du 20e. Dans les années 70 et 80, deux aspects ont caractérisé les grandes métropoles américaines : une forte ségrégation raciale et un fort taux de pauvreté parmi la population noire l’isolant socialement et fiscalement du reste de la population51. La population du ghetto se retrouve inévitablement maintenue dans une condition inférieure. Au début des années 80, le taux de chômage des jeunes Noirs était de 45%. C’était une « génération perdue » qui naissait, en l’occurence la génération hip-hop (Massey, 152). Lors d’une prise de conscience dans les années 60, les Noirs américains choisirent de revendiquer leur africanité et, ainsi, de marquer clairement leur attachement à la terre d’où leurs ancêtres avaient été arrachés de force. Le rapport Kerner de la fin des années 60 fait un bilan politique et social des relations intercommunautaires aux Etats-Unis ; la conclusion est lumineuse mais préoccupante : «Nous allons vers deux sociétés, une noire, une blanche, séparées et inégale »52
La continuité de l'exclusion raciale, accompagnée par la ségrégation professionnelle, résidentielle, culturelle et sociale, fait apparaître un phénomène idéologique nouveau dans la communauté africaine-américaine :
51
Cité dans Massey Douglas S., “Segregation and crime in urban America”, paru dans Problem of the century édité par Elijah Anderson et Douglas S. Massey. 52 www.haiticulture.ch, 2001.
96
alors que cette communauté a lutté pendant des siècles pour son intégration à l'intérieur de la société blanche, on voit se constituer une bulle, une identité afro-américaine sceptique à l'égard de l'idée d'intégration. Le Black Power s'inscrit justement dans ce courant de pensée. Le mouvement se donne d'abord pour tâche de libérer l'histoire et l'identité des Noirs du « terrorisme culturel » mis en place par la communauté blanche. Selon ce mouvement, le peuple noir doit se construire une image positive de lui-même : celle d'un peuple énergique, courageux, intelligent, beau et épris de paix et non paresseux, apathique, mou comme le disent les Blancs. Les Noirs doivent aussi prendre conscience que le lien qui les unit entre eux, qui les unit aussi à leurs frères africains, c’est la terre mère : l’Afrique. L'origine de l'histoire afro-américaine ne se trouve pas dans le ghetto mais sur ce continent. Par conséquent, le peuple noir doit connaître ses racines et son héritage culturel pour se situer dans la société nord-américaine. Le mouvement cherche à reconstruire des repères psychologiques, politiques et sociaux au sein de la communauté noire. Les effets du Black Power seront ressentis dans les pays de la Caraïbe et en Europe où la diaspora noire se reconnaît dans le combat mené par ses militants. La victoire acquise dans le combat pour les droits civiques durant les années 60 et consécutive à la mobilisation générale des Noirs ne résout pas la question des ghettos. « L’apartheid américain » décrit par Douglas Massey et Nancy Denton, persiste et reste une réalité de nos jours. Les ghettos sont de véritables « colonies sociales, politiques, éducatives et surtout économiques » (p.17). Ils ont été créés par les institutions blanches et leurs frontières sont maintenues par ces mêmes institutions. Malgré l’émergence d’une classe moyenne noire et malgré les lois en faveur de la déségrégation résidentielle, les noirs sont maintenus au cœur des villes et la population blanche dans les banlieues. Le ghetto demeure un lieu qui accueille les laissés-pour-compte, les individus que la société ne tolère pas dans l’espace public. Pour distinguer la ségrégation dont sont victimes les Noirs des ÉtatsUnis des autres groupes, des démographes ont dû créer le concept d’hyperségrégation (Massey, Denton, 1995 : 109). La diaspora noire en Jamaïque et aux États-Unis est victime d’une triple ségrégation : géographique, sociale et ethnique. Cette négation volontaire et cette mise à l’écart sont le dénominateur commun de la diaspora noire en Jamaïque et aux États-Unis depuis son arrivée au 15e siècle jusqu’à aujourd’hui à l’entrée du 20e siècle. Cette expérience est sans doute la continuité visible de la période esclavagiste, un héritage qui a affecté les descendants d’esclaves matériellement et psychologiquement nourrissant un sentiment de désillusion mais parallèlement un désir de justice, de bien-être et de réconciliation avec leurs sources identitaires. Par-dessus tout, ce passé commun aura établi une mémoire collective au sein de la diaspora noire de la
97
Jamaïque et des États-Unis, et par conséquent plus de « passerelles » dans sa quête identitaire à travers le mouvement hip-hop et le mouvement rastafari.
2.2.2: Une tradition de résistance Au sein des sociétés de l’Amérique anglophone où le peuple noir a été réduit en esclavage, des communautés et des moyens de résistance vont surgir, poussés par le refus de se soumettre aux autorités coloniales, les forces politiques dominantes. Cette tradition de résistance se perpétuera depuis le départ forcé du continent africain jusqu’à aujourd’hui. Ce refus de se soumettre se traduira en termes de résistance et, fréquemment, en termes de rébellion. D’ailleurs, le nationalisme noir naît du désir d’autonomie et d’autogestion de la part du peuple noir, qu’il soit situé en Jamaïque ou aux États-Unis. La manifestation de la résistance du peuple noir en Amérique anglophone revêt plusieurs facettes dont le mouvement hip-hop et le mouvement rastafari. Nous tenterons de dégager les plus opportunes en rapport avec notre thèse. La naissance d’un langage original, le phénomène religieux, la musique, la danse et le « marronnage » sont les grandes manifestations de la résistance du peuple noir dans son évolution dans le Nouveau Monde. Les recherches en histoire ont su briser le mythe de l’esclave docile. Le stéréotype de « L’oncle Tom » diffusé par Hollywood est une construction idéologique légitimée par le système en place car le même esclave qui répondait poliment à son maître le matin était capable d’empoisonner son repas le soir. Les esclaves et leurs descendants ont fait preuve de créativité dans l’élaboration des diverses méthodes de résistance. Après l’abolition de l’esclavage, la logique « oppression/résistance » ne s’est pas estompée pour autant. L’essence de la diaspora noire du Nouveau Monde n’est plus simplement l’esclavage et le colonialisme mais la résistance à l’oppression (Werner, 1999 : 5).
98
A/ Communiquer dans le Nouveau Monde : naissance d’un « parler singulier » «Three qualities of Black English—the presence of life, voice, and clarity— testify to a distinct black value system.—June Jordan » (1985)53
La résistance et la reconstruction de l’esclave passent par la création d’un langage nouveau. Répondant au besoin de l’esclave et de ses descendants, un système de communication est né au sein des communautés noires aux États-Unis et en Jamaïque. En effet, pour subsister et transmettre ses règles de vie, sa mémoire collective, un groupe d’individus a besoin d’un langage parlé. C’est un moyen de communication central et spécifique qui permet d’exprimer « ce que l’on pense à qui est capable de l’entendre » (Boysson Baride, 2003 : 9). La faculté de communiquer a participé à la survie de ces populations. Afin de coexister socialement et de survivre spirituellement, elles ont dû produire un effort collectif pour donner naissance à leur langue. Il y eut beaucoup de polémiques quant aux détails exacts de la formation de ces langues créoles (Sutcliffe, Figueroa, 1992 :11). Ce système de communication a pris naissance durant l’apogée du système « plantationnaire », entre 1700 et 1834. Baptisée « patois » en Jamaïque et parlée par une majorité de la population, la langue permet aux esclaves de communiquer entre eux et avec le maître. Aujourd’hui, elle n’est pas reconnue officiellement comme une langue à part entière mais elle participe pleinement à la définition de l’identité jamaïcaine. Baptisée Ebonics récemment, Black English ou encore African-American Vernacular English (AAVE) aux États-Unis, la langue africaine-américaine permet aussi aux esclaves, dans un premier temps, de communiquer entre eux puis avec le maître. De nos jours, c’est une langue qu’une grande partie de la communauté africaine-américaine utilise. Ces deux langues partagent des similitudes phonologiques, lexicales, morphologiques et syntaxiques certes, mais pas au point d’être reconnue comme une même langue54. Leur lexique possède une base européenne et leur grammaire dérive principalement de formes africaines. Elles appartiennent à la même famille de langues, nées à partir d’autres langues existantes : le créole. À supposer
53
Claude Brown, Spoken soul, Traduction : « Trois qualités du Black English – la présence de la vie, d’une voix et de la clarté- témoignant d’un système de valeur spécifique du peuple noir », p.5. 54 Pour plus d’informations sur cet aspect, voir System in black language, David Sutcliffe et John Figueroa, Longdunn Press, 1992.
99
que les langues soient nommées selon le pays de naissance, on devrait appeler le créole de la Jamaïque le « jamaïcain » et la langue née aux ÉtatsUnis dans la communauté africaine-américaine, l’ « Africain-américain ». L’ebonics est d’ailleurs la langue favorite des rappeurs. L’un d’entre eux Lamont Coleman, surnommé Big L, a écrit une chanson intitulée Ebonics , qui transcrit sa langue en anglais standard55. Big L retranscrit la signification de chaque mot qu’il utilise au quotidien. Il propose en réalité son dictionnaire pour les non-initiés ainsi que des valeurs propres au ghetto. Ainsi : “Cocaïne is nose candy, cigarettes is bones, and my radio is a box …” «La cocaïne, c’est de la confiserie pour le nez, les cigarettes, on les appelle des os, ma radio c’est une boîte… »
L’utilisation et la reconnaissance de ces langues dans l’espace public ont été à l’origine de débats passionnés au sein de ces communautés. Une certitude demeure, c’est que ces langues sont l’évidence même de l’héritage esclavagiste et demeurent le témoignage d’un passé commun du peuple noir en Amérique et particulièrement dans l’Amérique anglophone. Cette langue parlée par la communauté noire de l’Amérique anglophone trouve ses racines dans l’expérience esclavagiste entre le 18e et le 19e siècle impliquant l’Afrique, l’Europe et l’Amérique. Les deux langues ont une origine et une histoire parallèles. D’ailleurs les similitudes entre les réactions qu’elles suscitent ont été étudié par Jean Pryce dans un article intitulé « Similarities between the Debates on Ebonics and Jamaican »56. Les esclaves, après leur capture, étaient mélangés au cours de leur détention et de leur placement dans les plantations pour prévenir les rébellions. Précisons qu’ils venaient de divers pays d’Afrique et ne parlaient pas la même langue. La langue commune entre les esclaves à ce moment fut l’anglais. Les linguistes se mettent d’accord sur le fait qu’avec comme base lexicale l’anglais et comme base syntaxique les langues africaines, les esclaves ont commencé à former des systèmes vernaculaires pour communiquer entre eux et avec leur maître57. Puis, de génération en génération, ce mode de communication s’est installé dans leur environnement devenant la langue maternelle d’un grand nombre de leurs descendants. Une langue de transition est devenue un langage créolisé à part entière. Des emprunts lexicaux à
55
Big L, The big picture, Rawkus records, 2000. Big L. a été assassiné en 1999 dans son quartier à Harlem. 56 Journal of Black psychology, N°23 (août 1997): p. 285-300. 57 http://www.geocities.com/Athens/Ithaca/3638/blacktalk.html
100
d’autres langues étaient réguliers (espagnol, indien autochtone…). Les esclaves ou les descendants qui savaient parler l’anglais courant avaient un accès plus facile à la liberté et à la mobilité sociale. Le « parler noir » était à ce moment perçu comme la langue de la servitude. Les similitudes entre la syntaxe de ce « parler noir du Nouveau Monde » et celle des langues d’Afrique sont encore flagrantes aujourd’hui58. À la fin des années 60, aux États-Unis, l’auteur Claude Brown désigna la langue du peuple noir par l’expression « Spoken Soul », autrement dit « l’expression de l’âme ». Il faisait référence à la manière dont les AfricainsAméricains se sont approprié la langue anglaise pour interpréter leur réalité sociale, politique, culturelle et spirituelle. Même si cette langue divise l’Amérique contemporaine, même si elle est niée ou rabaissée par certains, elle s’est maintenue tout au long de l’histoire au sein des foyers, des écoles, des églises, au coin des rues, dans les salles de spectacles et dans les médias. Nous ne chercherons pas à débattre de son utilisation dans les espaces public mais à discerner son rôle. Elle s’est transmise depuis les plantations et permit à un peuple entier de véhiculer ses aspirations, ses émotions, son identité ethnique et sa personnalité. Le nom ebonics utilisé pour décrire l’anglais parlé des Africains-Américains a été inventé en 1973 par Robert R. Williams, professeur de psychologie à l’Université de Washington, à Saint Louis, c’est une combinaison entre le mot ebony (ébène qualifiant le Noir) et phonics (phonétique pour l’étude scientifique des sons). Peu importe le mot utilisé pour décrire le parler utilisé par les noirs aux États-Unis et en Jamaïque, il est clair que cette manière de s’exprimer a joué un grand rôle dans la vie de ces deux populations et dans l’évolution des deux sociétés qui l’ont vu naître. Certes les attitudes sociales autour de ces langues sont complexes et il n’est pas possible d’indiquer avec certitude le nombre d’individus qui les utilisent. Concernant le parler afro-jamaïcain, il s’est relocalisé au rythme des mouvements migratoires vers les grandes villes nord-américaines et européennes. La vitalité de ces langues est réelle : elles sont des marqueurs d’identité. Elles symbolisent une culture, un style de vie propre aux populations noires des États-Unis et de la Jamaïque. Comme le déclare Claude Brown, ces langues établissent un lien dans la diaspora noire (p.10), particulièrement entre celle de la Jamaïque (et à plus grande échelle celle de la région Caraïbe) et celle de l’Amérique du Nord. Elles permettent d’envisager le présent et marquent solidement la trace d’un passé commun.
58
Pour plus d’informations, voir Geneva Smitherman, Talkin’ and testifyin’, p. 5-8.
101
B/ La musique et la danse : facteurs d’endurance « To hear the most legitimate and contemporary Negro music, one had to go to the Negro ghetto (…) cause that’s where the musicians live. » Leroi Jones (Blues people-p. 232)59
La musique noire a été transformée par l’expérience de la diaspora noire dans le Nouveau Monde ; c’est au cœur de la séparation avec l’Afrique et de la ségrégation ethnique que cette musique s’est développée. Cette remarque d’Amiri Baraka est encore valable de nos jours. Néanmoins, depuis l’Afrique, la musique et la danse ont gardé un rôle fondamental dans le style de vie des Africains et de leurs descendants installés en Amérique du Nord et en Jamaïque. Dans des conditions de totale déshumanisation, sont apparus les courants musicaux et les danses les plus influentes de ces dernières décennies. « L’esclavage, c’est une forme de mort sociale », selon Orlando Patterson, sociologue jamaïcain60. Beaucoup d’esclaves se suicidaient. Les survivants devaient reconquérir leur humanité, apprendre à communiquer leur peine et leur joie. L’un des éléments de cette communication, c’est la musique, intimement liée à la danse, car elle met le corps en mouvement. La musique accompagne le peuple noir dans tous les aspects de son quotidien, son travail, ses peines, ses joies, sa vie spirituelle, ses luttes sociales et même la mort (au cours des veillées mortuaires). Ainsi, la musique créée par les AfricainsAméricains et les Afro-Caribéens va être utilisée pour restituer une identité aux membres de la diaspora noire et leur rappeler leur histoire, leur combat, leur souffrance, notamment à travers le blues, le jazz, le reggae et le rap. Durant la traversée transatlantique, la musique sera utilisée paradoxalement par les vendeurs d’esclaves. À bord des navires négriers, la danse et la musique sont utilisées par ces derniers à des fins thérapeutiques pour divertir leur « cargaison », pour calmer ses chagrins afin qu’elle n’arrive pas en trop mauvais état à la fin du voyage (Entiope, 1996 : 181). La musique l'escorte dans un quotidien qu’il n’a pas choisi. Sur les plantations, les esclaves sont
59
Traduction : « Pour entendre la musique nègre la plus légitime et la plus contemporaine, il fallait se rendre dans le ghetto nègre… parce que c’est là que vivent les musiciens. » 60 Cité dans L’héritage musical de l’esclavage, Conférence donnée par Denis Constant Martin, diretceur de recherches au Centre d’Etudes et de Recherches Internationales de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, professeur de Science Politique à l’université de Paris 8, dans le cadre du Café Palabre au Zango, rue du Cygne, 75001, Paris, le lundi 12 juin 2006.
102
répartis par groupes et le travail s’accomplit au rythme de la musique, du chant et de la danse. Cela servait de stimulant aux esclaves, tout comme la musique rap ou le reggae qui, dans leur essence, servaient de stimulant et de motivation face à des conditions socio-économiques déplorables. Il est clair que le travail durant la période esclavagiste n’était pas comparable au sort des descendants d’esclaves durant le 20e siècle. Et ce travail accompli en cadence n’avait certes rien de récréatif. Ces chants sont appelés les « field hollers » ou les « work songs ». La lutte dansée, pratiquée dans la Caraïbe et en Amérique du Sud, dévoile un autre aspect de la danse au sein de la diaspora noire. Les danses au bâton permettaient des règlements de compte ou simplement aux combattants de montrer leur dextérité dans le maniement du bâton (Entiope, 196-197). Malgré l’interdiction des maîtres, les assemblées dansées ont lieu dans des lieux secrets hors de l’habitation. Elles servent de rupture vitale avec la vie quotidienne des esclaves et de réaffirmation de leur identité culturelle. Elles sont aussi une forme de contestation et de révolte (Idem. 257) car elles nourrissent un esprit d’indépendance. La musique est présente également dans les moments de récréation. Elle réconforte l’homme, le divertit après une longue journée de labeur. La danse reste aussi primordiale, sa fonction récréative est similaire. Par exemple, à Kingston au 17e siècle, durant les moments de fêtes les esclaves profitent pour rompre avec leur quotidien et se divertir (Ibid. 184) en dansant et en chantant. À partir de cette même période, ils intègrent les communautés religieuses et reçoivent les rudiments de l’éducation religieuse à savoir la lecture de la bible et l’enseignement des chants à partir de cantiques et de psaumes qui donneront naissance à la musique religieuse de la communauté noire nord-américaine : le Gospel. Certains de ces hymnes sont arrivés jusqu’à nous tel que Amazing Grace (Grâce étonnante). Le chant, la musique et la danse tiennent une grande place dans les services religieux des chrétiens noirs. Les passages bibliques deviennent plus vifs et dans leur interprétation, ils expriment la révolte de toute une communauté. Ils sont aussi utilisés parfois en tant que code pour organiser des évasions d’esclaves vers le Nord. En Jamaïque, le mouvement de renaissance religieuse originaire des ÉtatsUnis à la fin du 19e siècle a des influences manifestes sur la musique et les danses. Des mélanges de rituels religieux plus ou moins africanisés naissent, tels que le Pocomania (Constant, 1982 : 43). Les chants religieux modernes américains et jamaïcains ont, par conséquent, une base commune. Cette jonction américano-jamaïcaine dans la religion et les chants annonçait les prochaines fusions entre les musiques des deux espaces. La musique noire dérivée de ses premières manifestations, avec le blues, le jazz et ses avatars tels que le rap, le reggae, la musique dancehall, le rhythm and blues ou la soul demeurent le premier espace où la culture noire
103
s’exprime. C’est une manière pour l’homme noir de dompter le silence et les préjugés que lui impose une société raciste. La musique est également un terrain propice pour exprimer les inégalités et les révoltes. Nous ne pouvons ignorer cependant que dans certains cas, des artistes noirs alimentent les préjugés de la société blanche à l’égard de la jeunesse noire. La danse et la musique restent un moyen permettant à l’homme noir de se divertir mais aussi de se recréer dans un espace à l’origine asservissant, un espace ségrégué. Ces éléments sont indissociables. Ils impliquent souvent l’ensemble de la communauté et permettent de renforcer les liens entre ses membres. Comme dans le « breakdancing » ou le rap aux États-Unis, la musique et la danse sont des moyens qui permettent de canaliser les pulsions violentes qui naissent au sein de l’oppression. Les paroles sont aussi importantes que la musique. Les musiques nées dans le Nouveau Monde créent du lien avec le passé et permettent de commenter les événements ou de donner des conseils. On remarque qu’en Jamaïque comme aux ÉtatsUnis le rythme créé par les percussions joue un rôle primordial (Leymarie, 1996 : 21). La Jamaïque possède un riche répertoire de chants et de danses folkloriques rythmant les travaux collectifs. Le culte des ancêtres (le Myal), célébré autour de danses très mouvementées et de sons de percussions, perdure jusqu’à aujourd’hui (Ibid. 107). À la fin des années 50, dans les ghettos de West Kingston, lieu de naissance du mouvement rastafari, les adeptes créent un nouveau style de percussions pour exprimer leur animosité envers les forces oppressives, noires ou blanches ; il est baptisé Nyhabinghi (Ibid. 274). Ce style naît de la rencontre entre joueurs de tambours Burru et adeptes du mouvement rastafari. Ces deux groupes insistent sur la vigueur des civilisations noires. Ils sont victimes de la même relégation et se côtoient dans le ghetto. Les deux groupes échangent doctrine contre musique en devenant une seule et même entité (Constant, 1982 : 47). Précisons que des danses ont aussi lieu durant ces moments de rassemblement. Au début des années 60, la crise socio-économique qui touche le pays embrase les ghettos. Dans l’un des plus gros succès de la musique jamaïcaine, les Wailers (première formation de Bob Marley) appellent les habitants au calme à travers le morceau Simmer Down. Un nouveau style musical est né, le ska. Il est vite repris par le militantisme du Black Power pour devenir la voix des pauvres et des opprimés de la société jamaïcaine. Le reggae, qui dérive de ce courant musical, deviendra à son tour cette voix à partir des années 70. Presque simultanément, à la fin des années 70, le rap
104
allait mettre en scène la minorité noire61 aux États-Unis d’une manière inattendue. La danse au sein de la communauté noire des États-Unis et de la Jamaïque est un remède qui ranime et revivifie. Elle lui permet de se retrouver dans un espace sans contraintes. Elle reste un mode d’expression, l’expression d’un sentiment, d’un état. C’est également une réaction à la musique, une réaction à son environnement immédiat, aux changements sociaux. La musique au sein de la diaspora noire de l’Amérique anglophone assure plusieurs fonctions. Elle possède une fonction éducative dans le sens où elle répand les valeurs de la culture dont elle émane. Elle peut aussi, dans le cadre de cette fonction, avoir un impact destructeur, par exemple avec le gangsta rap qui normalise des comportements violents et abusifs. Elle détient une fonction de commémoration elle rappelle les événements ou les personnages qui rehaussent le sentiment de fierté de la communauté. La musique africaine-américaine a « chroniqué » toutes les périodes de creux ou de croissance économique qui ont pu toucher la communauté noire. Elle remplit une fonction récréative ; elle réconforte, divertit et égaie. Sa fonction de contestation se remarque dans la prise de position politique ou sociale des chanteurs porte-paroles. Toute l’agressivité d’un ou de plusieurs individus peut se retrouver dans les paroles ou l’interprétation d’une chanson. La musique a également une fonction thérapeutique. On peut affirmer qu’elle a favorisé l’adaptation du Noir dans le Nouveau Monde. D’un autre côté, le rap et le reggae ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd’hui sans l'histoire du Nouveau Monde. En grande partie, l’expression musicale a aidé à « maintenir » la cohésion sociale des descendants d’esclaves face à l’hostilité du monde blanc en procurant un sentiment de sécurité, en constituant une thérapie. En ce sens, les musiques de la diaspora noire en Jamaïque et en Amérique du Nord ont eu des fonctions identiques qui ont contribué au rapprochement des deux modes d’expression. Conclusion En conclusion, nous dirons que l’histoire de l’oppression est, parallèlement, l’histoire de la résistance. Par divers moyens, la diaspora
61
Précisons que la communauté portoricaine a aussi largement contribué à la naissance du mouvement hip-hop car elle vivait dans les mêmes quartiers que la communauté africaine-américaine et subissait les mêmes inégalités sociales.
105
noire en Amérique a constamment cherché à nourrir son désir de survivre à des conditions sociales désastreuses. Dans un premier temps isolés socialement, les esclaves et leurs descendants ont dû reconstruire un univers détruit. Cet isolement social qu’ils ont connu sur la plantation perdure de nos jours. Nous le voyons resurgir dans le phénomène des ghettos urbains. La résistance a débuté sur le continent africain, s’est poursuivie sur les bateaux négriers, s’est intensifiée et s’est transformée en Amérique. Cette expérience est commune aux peuples noirs ayant débarqué aux Amériques mais particulièrement aux Africains-Américains et aux Afro-Jamaïcains. Ce sont des expériences historiques unificatrices pour ces deux communautés. Ces expériences analogues ont facilité le rapprochement des deux phénomènes culturels issus de ces peuples, à savoir le mouvement rastafari et la culture hip-hop.
106
TROISIÈME PARTIE MANIFESTATIONS DES TRANSFERTS INTERCULTURELS ENTRE LE MOUVEMENT HIP-HOP ET LE MOUVEMENT RASTAFARI
Introduction Depuis environ une dizaine d’années, des études ont été menées concernant le rapprochement des deux musiques phares des mouvements hip-hop et rastafari, à savoir le rap et le reggae. Curieusement, aucune étude n’a été publiée sur les échanges interculturels entre les deux phénomènes dont relèvent ces formes musicales. Havelock Nelson, une autorité dans la recherche sur le mouvement hip-hop, a écrit sur la fusion de ces deux courants musicaux dans un article « Reggae and hip-hop come together » en juillet 199662. Le professeur Carolyn Cooper (UWI, Jamaïque), en travaillant sur la dispersion de la culture dancehall, a rédigé une étude sur les similitudes entre rap et reggae63. En 2000, Elena Oumano, journaliste et maître de conférences à l’université de Miami, a également écrit un article intéressant sur l’appropriation du rap par les artistes rastas64. Dans leur rétrospective sur la musique jamaïcaine, The rough guide to reggae, Steve Barrow et Peter Dalton (2001) énumèrent les combinaisons réalisées entre artistes rap, reggae et dancehall aux États-Unis. Enfin, en 1999, le chercheur autrichien Werner Zips, auteur de Black rebels : african-caribbean freedom fighters in Jamaica met en lumière les échanges culturels entre les deux mouvements. Après avoir brièvement relaté le rôle de la musique africaineaméricaine dans la création du reggae et le rôle du reggae dans la création du rap, il déclare que l’influence réciproque entre les Africains-Américains et les Afro-Caribéens est un champ d’étude qui mérite d’être approfondi (Zips, 1999 : 236). C’est précisément le but de notre travail de recherche. Le hip-hop et le rastafarisme sont transculturels, transhistoriques, transdisciplinaires. Depuis leur naissance, leurs signes et leurs pratiques se dispersent, s’incarnent et se modifient temporairement en des lieux et chez des personnes pour redéfinir sans cesse leur trajectoire. Lors d’un séminaire interdisciplinaire consacré à l’identité, Michel Serres constatait que ce que les cultures ont en commun et qui les instituent comme telles, « c’est l’opération même de raccorder, de connecter » (1977 : 125). Cette caractéristique des cultures est particulièrement pertinente pour la validité de notre hypothèse. Les membres d’une même culture utilisent des symboles pour communiquer entre eux et se comprendre ; ils s’appuient également sur ces symboles pour former leur pensée et leurs expressions de
62
Magazine Billboard, V. 108 n. 27 p 40. « Hip-hopping across cultures » Questioning Creole : Creolisation Discoruses in Caribbean Culture, Eds. Verene A. Shepherd and Glen L. Richards, 2002. 64 « Natty Dread learns to rap » Miami New Times, February 10, 2000. 63
109
manière intelligible. Lors des échanges interculturels, ce sont ces symboles qui vont d’une culture à l’autre. Pour ceux qui appartiennent à une culture même, celle-ci a une fonction stabilisante. Selon Pierre Bourdieu65, elle donne de la régularité, de l’unité à la pratique d’un groupe. Ce patrimoine culturel immatériel est recréé par les communautés et les groupes sociaux en fonction de leur environnement, de leur interaction avec la nature et de leur histoire. Elle leur procure un sens d’identité et de continuité. La culture hip-hop et la culture rastafari participent pleinement à la définition identitaire de leurs adeptes dans le sens où elles leur donnent une vision unique du monde qui les entoure. Elles structurent aussi leur comportement dans la société Pour un grand nombre d’individus dans la région Caraïbe et en Amérique du Nord, ces deux cultures sont leurs premières fenêtres politiques, culturelles, linguistiques, musicales et idéologiques sur le monde. Ces cultures reflètent aussi des mécanismes de dominance et de résistance ; elles se forment dans l’un de ces deux contextes. La communauté, quant à elle, se définit par des liens affectifs forts, une appartenance difficilement révocable, la mise au profit de la communauté des efforts personnels ainsi que des valeurs communes. Dans le cadre de la mondialisation et dans le contexte politique international, le dialogue interculturel empêche le cloisonnement des cultures et revêt une importance particulière. Afin de mettre en rapport les deux mouvements que nous étudions, nos deux principaux outils méthodologiques sont la médiation et l’interculturalité. Selon Jean Caume, la médiation, dans bien des discours, est aujourd’hui présentée comme la « capacité de mettre en rapport des choses séparées » (139). C’est un processus actif qui se concrétise par un événement, un acte de parole, un comportement, qui, à son tour, engage un phénomène dans une relation à un autre. Sur le plan sociologique, le contact entre deux ensembles permet d’établir une proximité tout en maintenant la distance. Les transferts culturels conduisent inévitablement à des phénomènes de métissage. Les pratiques transférées sont recontextualisées ; elles prennent d’autres formes et d’autres significations. En retour, ceux qui se les approprient sont également transformés. Notre démarche vise à relater l’historique et les conséquences des contacts entre la culture hip-hop et la culture rastafari. L’interculturalité est le processus qui nous permettra d’étudier ces contacts et les transformations qui en résultent. Comment se manifeste et se définit ce
65
Bourdieu Pierre: « La production de la croyance: contribution à une économie des biens symboliques », Actes de la Recherche en Sciences Sociales, n°13, 1977.
110
processus ? Qu’est-ce qu’un transfert culturel ? Autant de questions légitimes dont les réponses alimenteront notre réflexion. L’interculturalité n’est pas un concept commode à définir à cause de sa connexion avec un autre concept, très vaste, qui est celui de la culture. Néanmoins, nous pouvons décrire l’approche interculturelle comme l’étude d’individus ou de groupes lorsqu’ils sont exposés à plusieurs univers culturels. Dans le domaine de l’anthropologie, elle découle de la comparaison entre cultures. La traite négrière, la fin du colonialisme, le développement des moyens de communication et les mouvements migratoires d’individus font partie du contexte dans lequel émergent les problématiques interculturelles entre le mouvement hip-hop et le mouvement rastafari. Dans ce cadre, la culture pourrait se définir plus simplement comme ce qui existe et qui a du sens dans une communauté particulière. Cela veut aussi dire que les mêmes actes et les mêmes productions peuvent se faire dans deux cultures distinctes, mais ne pas avoir le même sens. C’est une conclusion importante pour la suite de notre argumentation. Selon Claude Clanet, dans son ouvrage intitulé L’interculturel (1990), l’approche interculturelle des productions imaginaires doit aussi intégrer les différences. Ces dernières doivent être repérées, analysées et interprétées. Nous devrons donc repérer les réseaux de significations qui se recouvrent et ceux qui fondent les différences culturelles. Au sens où nous l’employons, le terme « interculturalité » introduit donc les notions de réciprocité des échanges ou des relations entre cultures. Ainsi, il n’y aurait pas une culture qui en ferait disparaître une autre au cours des échanges mais l’une et l’autre s’enrichiraient des éléments empruntés. Dans notre cas, l’interculturalité s’opère dans un rapport d’échanges réciproques et une perspective de sauvegarde de l’identité culturelle des communautés qui sont en relation. Nous pouvons d’ores et déjà poser la question suivante pour orienter notre méthode de recherche : Les signes, les symboles, les discours, les croyances communes qui maintiennent l’unité du groupe gardent-ils les mêmes significations de la culture hip-hop à la culture rastafari et inversement ? Les transferts culturels sont le résultat de l’interculturalité. Ils découlent d’un rapport de forces entre deux ou plusieurs groupes qui font des échanges pour s’approprier les biens culturels de l’autre dans le but de s’affirmer (Dellage, Ouellet, Turgeon, 1996 : 15). Dans son livre L’identité, le célèbre anthropologue Claude Lévi-Strauss nous rappelle que les identités culturelles ne sont pas closes et substantielles mais, au contraire, instables, continuellement transformées par les contacts, les conflits, les échanges avec
111
d’autres cultures. En réalité, les transferts culturels répondent à un besoin de la culture en question, donc de ses membres. Le mouvement hip-hop et le mouvement rastafari ont eu tous les deux recours à la réadaptation d’éléments extérieurs pour forger leurs propres expressions et leurs croyances. Le dynamisme et la résistance d’une culture ne se manifestent pas par le fait qu’elle rejette ce qui lui est étranger, mais par le fait qu’elle l’assimile. Que ce soit dans l’universalité de leur succès, dans leur appropriation par les industries de la culture ou dans la revendication identitaire, la culture hip-hop et la culture rastafari entretiennent un rapport étroit. Ces deux cultures sont les produits d’échanges complexes entre le continent africain et l’Amérique des plantations, des résultats d’échanges culturels. Cela explique également leur longévité. Elles n’ont pas rejeté la diversité mais elles l’ont pleinement adoptée en s’adaptant à divers groupes d’individus, indépendamment de leur race ou de leur classe sociale. Ce faisant, elles se sont fait l’écho de différents arguments, différents courants de pensée (Rose, 1993 : 60). En ce qui concerne le mouvement hip-hop, une autre raison qui explique son impact international, son dynamisme et son pouvoir social, c’est l’impérialisme culturel et économique des États-Unis. Ces derniers sont les plus grands diffuseurs de culture au monde. En ce qui concerne le mouvement rastafari, sa longévité et son attrait international sont liés en partie aux industries de la culture (maisons de disques, médias etc…) mais particulièrement à la revendication pro-tiers-mondiste, en faveur de ceux que Frantz Fanon a appelés « les damnés de la terre ». En effet ces défavorisés sont présents dans toutes les sociétés du monde au 21e siècle, donc l’idéologie du mouvement y trouve des échos favorables. Une dernière raison explique sa réception et sa longévité : son engagement pan africaniste qui a servi de pont pour relier la diaspora africaine dispersée dans le monde. Le dernier élément commun aux deux cultures est le désir de reconnaissance sociale hors des normes imposées par la société dominante. Malgré l’internationalisation des cultures hip-hop et rastafari, elles restent ancrées dans les communautés noires de la Jamaïque, de la région Caraïbe et des États-Unis. Dans cette partie, nous nous attacherons à décrire les expressions de l’interculturalité entre le mouvement hip-hop et le mouvement rastafari. Nous tâcherons également de déterminer les différents facteurs ayant entraîné la médiation entre les deux mouvements. Nous tenterons d’évaluer la validité des transferts interculturels entre ces deux ensembles, à savoir, dans un premier temps, repérer les éléments qui sont transférés, et dans un deuxième temps, déterminer si ces éléments, au cours du transfert, gardent les mêmes significations. Nous commencerons par repérer les transferts et
112
les différences culturels entre les deux mouvements au niveau idéologique. Puis nous tenterons de mettre en évidence ces transferts et ces différences culturels au niveau musical. Et enfin, pour terminer cette approche interculturelle entre le mouvement hip-hop et le mouvement rastafari, nous rendrons compte des transferts et des distinctions au niveau des arts visuels et de la danse.
113
CHAPITRE 1 TRANSFERTS IDÉOLOGIQUES Au cours de ce chapitre, nous tenterons de rapprocher les motivations et les courants idéologiques qui ont nourri l’évolution du mouvement hip-hop et du mouvement rastafari. Existe-t-il un héritage idéologique, commun aux deux mouvements, qui a facilité leur interculturalité ? Si oui, comment s’est-il matérialisé tout au long de leur développement ? Comment ces transferts « idéologiques » se sont-ils établis ?
3.1.1: Démarche afrocentrique En 1935, l’armée italienne commandée par Mussolini envahit l’Èthiopie. L’empereur Haïlé Sélassié s’enfuit de son pays. Il ne reviendra qu’en 1941 pour reprendre le pouvoir. Entre 1935 et 1941 la communauté africaine-américaine se mobilise pour soutenir le peuple éthiopien par différents moyens (médiatiques, financiers, militaires)66. Jusqu’aux années 60, l’Éthiopie restera le symbole de la lutte pan africaine aux États-Unis. L’éthiopianisme sera également au centre de l’idéologie rastafari dès le début des années 30 en Jamaïque. À travers le conflit italo-éthiopien, les diasporas africaines en Jamaïque et aux États-Unis se rejoignent et reconnaissent une identité partagée. Par le rapprochement du mouvement hip-hop et du mouvement rastafari, cette dynamique se remet en place en conservant le nationalisme noir comme point d’ancrage. Les deux mouvements sont des mouvements de contestation et d’affirmation identitaire, des mouvements de résistance socioculturels valorisant la fierté raciale et ethnique de leurs membres. Pour ce faire, dès leur genèse, leur point commun est une démarche afrocentrique. Face aux fractures sociales dans la région Caraïbe et aux États-Unis, la population noire lutte pour obtenir de meilleures conditions de vie, pour mettre un terme à la ségrégation raciale, à l’inégalité des chances.
66
Pour plus d’informations : Harris Joseph E., African-american reactions to war in Ethiopia (1936-1941), Scott William R., The sons of Sheba’s race: AfricanAmericans and the Italo-Ethiopian war (1935-1941).
115
A/ Expression du nationalisme noir dans la culture hip-hop Tous les chercheurs qui ont travaillé sur le nationalisme noir ne sont pas d’accord sur sa définition (Essein-Udom, 1962 ; Karenga, 1982 ; Foner, 1983 ; Van Deburg, 1996 ; Carr, 2002 ; Austin, 2006). Cependant, trois idées essentielles se répètent dans leurs écrits : La solidarité entre AfricainsAméricains, la fierté de l’héritage culturel noir et l’autonomie de la communauté africaine-américaine. Si le peuple africain-américain n’est pas uni, ses revendications et les programmes mis en place auront moins d’efficacité. Deuxièmement, le nationalisme noir veut ôter chez ce dernier le dédain envers ses racines africaines, engendré par l’establishment blanc, à force de dépeindre le continent africain comme un continent sauvage et sans culture. Troisièmement, la dernière notion consiste à encourager la prise en main de la vie économique et sociale des quartiers noirs par des Noirs. Ces trois notions sont interdépendantes. Cette idéologie prend son essor dans la région Caraïbe avec le mouvement rastafari en Jamaïque. Durant les années 30, s’appuyant sur les idées de Marcus Garvey, le rastafarisme insiste sur le retour aux critères culturels noirs et sur l’importance de l’Afrique en suggérant une identité culturelle distincte et des objectifs communs pour les Noirs dans le monde. Dans ses mémoires intitulés Merceded Ladies (2008), l'auteur africaineaméricaine Sheri Sher décrit le parcours du premier groupe de rap exclusivement féminin dans le quartier du Bronx à New York. Ce groupe fut créé à la fin des années 70 ; il était composé de quatre rappeuses et d'une disc jockey. Une anecdote de ce livre attira notre attention. Après quelques concerts réussis, le groupe accepta de travailler avec quelques personnes intéressées par le talent de ses membres. C’étaient en réalité des rastafariens originaires de la Jamaïque qui leur proposèrent de devenir leur manager et leur sponsor (88-145). Même si leur partenariat ne se termina pas dans de bonnes conditions, dès la fin des années 70, un premier contact entre le mouvement rastafari et le mouvement hip-hop est établi. Des rastafariens aident le premier groupe de femmes du mouvement hip-hop à faire connaître leur talent. C’est un « clin d’œil » du destin qui méritait d’être révélé. Durant cette même période, alors que l’apparition des gangs sème la terreur dans les quartiers défavorisés, le leader des Black Spades, un gang New Yorkais notoirement connu, décide de se repentir et de changer de style de vie. Bambaataa Kahim Aasim ne révèlera jamais son vrai nom ni sa date de naissance (Chang, 2005 : 120-121). Devant les tragédies qu’engendrent les activités du gang, il s’en désolidarise et choisit une autre orientation philosophique. Inspiré par l’art de Clive Campbell, le premier DJ de l’histoire du hip-hop, il s’adonne aussi à l’art des platines. Il crée la Bronx River Organization qui deviendra ensuite The Organization. Cette
116
association organise des soirées où les jeunes viennent écouter la prestation des DJs, danser et aussi déclamer leurs textes ou leurs improvisations sur le microphone. L’organisation de Bambaataa fédère la culture hip-hop, qui est à cette époque un mouvement naissant, sans contours précis. Finalement, la dernière appellation, The Organization, devient définitivement The Zulu Nation, en référence aux guerriers zoulous d’Afrique du Sud qui se sont défendus avec courage et dignité contre les envahisseurs européens67. Bambaataa se rebaptise Afrika Bambaataa. Durant les années 80, il va parcourir l’Europe et l’Asie pour faire connaître le mouvement hip-hop à travers l’organisation. La Zulu Nation est la première organisation unificatrice du mouvement hip-hop. Elle existe encore aujourd’hui avec des antennes dans plusieurs pays. Pour valoriser la danse et captiver l’attention des jeunes, Afrika Bambaataa s’entoure de cinq danseurs doués qui deviennent les Shaka Zulu kings ou les Zulu Kings. Afrika Bambaataa a su donner une orientation philosophique renouant les liens entre les jeunes Africains-Américains et les jeunes Latino-Américains par le biais de leur héritage culturel africain. L’histoire des guerriers zoulous d’Afrique du Sud servit de base idéologique au programme du mouvement : s’organiser de manière pacifique pour protèger son environnement, valoriser son identité pour survivre aux conditions destructrices des quartiers de New York. Jusqu’à aujourd’hui, le slogan de la Zulu Nation demeure dans la communauté hip-hop : « Peace, Love, Unity and Having Fun » (Chang, 2005 : 15). L’idéologie nationaliste se matérialise dès le début de la culture hip-hop. La Zulu Nation insiste sur la nécessité de redécouvrir l’héritage africain de la jeunesse noire et d’en être fier. En réalité, elle est à l’origine de la culture hip-hop, les références à la culture noire resta des éléments unificateurs. Indépendamment de son groupe, de son quartier, on pouvait être membre de la Zulu Nation. L’organisation était une expression de l’unité culturelle. L’éthique hip-hop naît à partir des principes mis en place par Afrika Bambaataa. On constate que le nationalisme noir ne se diffuse pas exclusivement à travers les paroles des rappeurs. Il est vrai que l’organisation ne jouit plus de la même popularité de nos jours, mais elle a définitivement posé les fondations historiques et le cadre doctrinal de la culture hip-hop. Cette éthique se propagera à travers les États-Unis grâce au succès de l’album Planet Rock réalisé par Bambaataa et son collectif, The Soul Sonic Force.
67
Dossier réalisé par www.africamaat.com
Jean-Philipe
117
Omotundé,
11
Décembre
2004.
Les fondations de la musique rap moderne se retrouvent dans la poésie d’un groupe de poètes africains-américains, The last Poets, originaires de New York. Ces derniers vont insuffler au rap et à la culture hip-hop leur conscience politique, sociale et raciale. Ils ont un désir de communiquer, d’alerter, de transformer la situation intenable de la communauté noire en se servant du passé comme point d’ancrage. Ils traduisent son quotidien avec fierté ; ils évoquent la famille, l’héritage, la tradition, la violence, les drogues, le crime. Leurs écrits examinent l’âme du peuple noir sans complaisance mais avec altruisme. Leur diction et leurs textes inspirent un grand nombre de rappeurs et annoncent des groupes radicaux tels que Public Enemy, X-Clan ou encore Dead Prez. De 1970 à 1995, ils ont produit plusieurs albums. Hustlers Convention, album solo de Jalal Mansur Nuridin l’un des membres du groupe, paru en 1973, sera joué et conservé précieusement par l’un des DJ fondateurs du mouvement hip-hop, DJ Kool Herc. Le poète et activiste Amiri Baraka les décrit comme suit : « (…) les premiers rappeurs. Le genre de nègres que vous n’avez pas envie de croiser ! Ils enseignent ce que l’Amérique fait subir aux Noirs, ce que les noirs s’infligent à eux-mêmes, et pourquoi »68. Un autre poète, Gil Scott Heron, sera également un pionnier de la musique rap. Il adopte la position idéologique déjà exprimée dans l’écriture des Last Poets. Il se fera connaître par un célèbre poème intitulé The revolution won’t be televised, paru sur l'album Small Talk on 125th and Lennox, en 1970. Comme The Last Poets, il posa les fondations de la musique rap en tenant un discours orienté vers les problèmes et les besoins de la communauté africaine-américaine. Aux États-Unis, la récession économique des années 80 est une période éprouvante pour la communauté noire, particulièrement pour les jeunes. Pendant environ 12 ans, sous la présidence de Ronald Reagan et de George Bush, leur situation socio-économique se détériore. La montée de la Nation de l’Islam menée par Louis Farrakhan et la campagne présidentielle de Jesse Jackson en 1984 et 1988 (même s’il n’a jamais épousé l’idéologie nationaliste) créent un contexte qui facilite le rapprochement du nationalisme noir et de la culture hip-hop.
68
The Last Poets repartent au front, Magazine R&R Volume 2, mars 2005.
118
La communauté hip-hop replace l’héritage de l’activisme noir à travers des leaders noirs et des organisations noires au coeur de son argumentaire. Symboliquement, les adeptes du mouvement remplacent leurs chaînes en or par des médailles représentant l’Afrique. Ils troquent les couleurs des gangs pour le rouge, le noir et le vert qui représentent le drapeau de la nation noire, inventé par Marcus Garvey. Les rappeurs s’inspirent de l’héritage du nationalisme noir aux États-Unis pour élaborer leurs critiques. L’un des exemples les plus marquants de l’histoire du rap sera l’album de KRS-One intitulé By all means necessary, inspiré par la devise du leader noir Malcolm X. Dans cet album, KRS-One incite la communauté noire à s’exprimer d’une manière ou d’une autre sur son devenir dans la société étasunienne. Sur la pochette, il reprend la posture de Malcolm X sur une photo, non moins célèbre, où il apparaît avec une mitraillette près de sa fenêtre. Cette photo traduit la pensée du rappeur sur l’autodéfense et l’autogestion69. En reprenant la pensée et l’image de Malcolm X, KRS-One s’inscrit dans le droit fil de cet héritage. À travers le rap, la culture hip-hop réintroduit auprès de jeunes auditoires des leaders noirs décédés, tels que Malcolm X, Martin Luther King, Marcus Garvey ou Stokely Carmichael. Cependant, leur engagement social et politique ne traduit pas toujours concrètement les enseignements de ces personnages. Le nationalisme s’appuie plus sur la déclaration que sur la démonstration. Largement soutenu par la Nation de l’Islam, le groupe Public Enemy contribue à faire connaître les principes du nationalisme noir à des milliers de jeunes Africains-Américains par le biais de leurs chansons. Par exemple, sur leur deuxième album It takes a million to hold us back, dans la chanson intitulée Party for your right to fight, ils invitent implicitement la jeunesse à embrasser la théorie de l’autodéfense du parti des Black Panthers. D’autres artistes tels que Ice Cube, Paris, le groupe X-Clan formulent leur discours nationaliste mais dans des organisations contemporaines et pas seulement en s’appuyant sur des personnages décédés. À leur protestation verbale, ils allient un travail de terrain de concert avec une organisation nationaliste noire, le Black Watch Movement ancrée dans plusieurs villes des États-Unis. Les rappeurs du groupe X-Clan ne se considèrent pas comme de simples artistes mais comme des éducateurs, des messagers (Zips, 1999). Leur vision est très pragmatique et très politique.
69
Ne bénéficiant pas des droits de reproduction, nous n’avons pas pu les publier ici. Se référer à internet pour voir les photos : www.basslinespin.com/BDPByAllMeans.jpg (Krs-One) www.malcolm-x.org/media/pic_10.htm (Malcom X)
119
En 2001, le groupe Dead Prez met fin à un long silence politique dans la communauté hip-hop depuis X-Clan, KRS-One et Public Enemy, en sortant son premier album Let’s get free. Son disque, qui reçoit un écho favorable dans la communauté africaine-américaine, la diaspora noire en Europe et en Afrique, s’articule autour de valeurs nationalistes radicales inspirées par le Black Panther Party. Le nationalisme noir se manifeste également par le rôle accordé à la Nation de l’Islam dans l’évolution de la culture hip-hop. Fondée en 1934, l’organisation cherche à établir l’islam comme la religion de l’homme noir. Selon ses principes, l’homme noir possède l’essence de la divinité. Après la mort du leader Elijah Muhammad en 1975, c’est son fils Wallace qui tente de reprendre la direction de l’organisation. Mais c’est avec Louis Farrakhan que la Nation retrouve sa renommée. L’enseignement de la Nation a eu un impact considérable sur la culture hip-hop. Elle fait figure d’autorité dans un milieu en mal de repères paternels. Un autre mouvement issu de la Nation de l’Islam, appelé les Five Percenters (5%), a également aidé à la diffusion du nationalisme noir dans le mouvement hip-hop. Son idéologie est un mélange de rhétorique nationaliste noire et de numérologie ésotérique. Entre autres, son enseignement affirme que le peuple noir est le peuple originel et que les mathématiques sont la clé pour comprendre la relation de l’homme avec l’univers. Il fut créé en 1964 par Clarence Jowars 13X Smith, après son expulsion de la Nation de l’Islam, avec la conviction que les Noirs sont la réincarnation d’Allah à travers le soleil. L’organisation a longtemps été considérée comme un gang (Miyakawa, 2005 :17). Les Five Percenters intègrent le mouvement hip-hop dès le milieu des années 70. Ils assurent la sécurité des rassemblements dans les cités. En 1987, ils arrivent sur le devant de la scène commerciale avec le premier MC populaire qui confesse son appartenance au mouvement, Rakim. Les 5% sont des adeptes d’un islam rigoureux. Selon Antonio Hardy alias Big Daddy Kane, l’une des plus grandes légendes du rap, lui-même converti : « 85% sont retenus en arrière parce qu’ils sont idiots, sourds, aveugles, ne respectent pas ce qu’ils sont ; on leur a volé leur nom et leur culture. Ensuite, il y a les 10% à qui on a fait croire qu’ils étaient faits pour porter des noms comme john ou Dennis. Ils ne se rendent pas compte que leurs noms sont Elijah et Kamau. Les 5% restant, ce sont ceux qui ont la connaissance de soi (…) » (Dufrene, 1991 : 14).
Parmi les adeptes des Five Percenters, on compte des rappeurs et des DJs très populaires, tels que : The Wu-Tang Clan, Brand Nubian, Queen Latifah (ancienne adepte), Guru (du groupe Gangstarr), DJ Pete Rock, Mobb Deep,
120
Busta Rhymes et Black Thought (du groupe The Roots) (Miyakawa, 2005 :37). En 1997, après le meurtre de deux icônes du rap, Tupac Shakur et Biggie Smalls, Farrakhan organise une grande rencontre avec les rappeurs. En 2001, lors de la rencontre nationale du mouvement hip-hop à New York, il appelle les rappeurs à accepter leurs responsabilités de leaders et de modèles au sein de la communauté africaine-américaine. En 2003, il sert de médiateur dans un conflit tendu entre deux rappeurs bien connus, Ja Rule et Fifty Cent70. Paradoxalement, la communauté hip-hop se réclame de Malcolm X, qui a été exclu de la Nation de l’Islam, et de Farrakhan qui la dirige aujourd’hui. Ils reconnaissent en ces personnages deux figures nationalistes révolutionnaires. Depuis les années 80, la voix des dirigeants de la Nation de l’Islam est écoutée et respectée au sein du mouvement hip-hop. Pendant l’expansion du nationalisme noir, la voix du rap a été aussi importante que celle du reggae au sein du mouvement rastafari. Dans la direction idéologique du mouvement hip-hop, grâce aux artistes qui revendiquent son idéologie et à son rôle de médiateur, la Nation de l’Islam joue un rôle majeur. Entre cette organisation et le mouvement rastafari, les similitudes dans les pratiques religieuses et culturelles sont assez nombreuses pour nous interpeller : l’abstinence vis-à-vis de l’alcool et de la viande de porc, un code de pratique différent pour les hommes et les femmes, le patriarcat et le panafricanisme. Les adeptes ont également un objectif commun : le rétablissement de la dignité du peuple noir, considéré comme le peuple élu de Dieu et dont le rôle et la culture ont été détruits par la colonisation et l’esclavage. Ce sont des thèmes qui se diffusent dans les deux mouvements et qui les raccordent solidement sur le plan idéologique.
B/ Expression du nationalisme noir dans le mouvement rastafari Dans le mouvement rastafari, le nationalisme noir se matérialise essentiellement à travers les conceptions de Marcus Garvey que les adeptes ont su implanter dans leur idéologie. Néanmoins, il nous faut préciser que le désir de retourner en Afrique est un sentiment antérieur au mouvement rasta en Jamaïque.
70
The Source Magazine, novembre 2005, N°193.
121
Depuis la période esclavagiste, les Noirs manifestent le désir de retourner sur la terre de leurs ancêtres, se donnant même la mort parfois pour accélérer ce retour. En 1784, l’éthiopisme se développe en Jamaïque par la création de la première Église éthiopienne baptiste (Lee, 1999 : 77). Selon Hélène Lee, il faut savoir que dans la bible, Aethiops « le pays des visages brûlés » désigne l’Afrique entière, tandis que le royaume éthiopien proprement dit s’appelle Abyssinie (ibid.). En Jamaïque, depuis les années 20, Garvey demande à la population noire de se tourner vers l’Afrique pour ne pas rater le couronnement d’un roi noir. Il s’agit d’Haïlé Sélassié dont le couronnement comme empereur a effectivement lieu le 2 novembre 1930. Ce sera un événement majeur par lequel il deviendra le messie de la communauté rastafari et Garvey, le prophète. Dès 1933, Leonard Howell, considéré comme l’une des premieres personnes à prêcher la divinité d’Haïlé Sélassié, fait des discours en public dans la paroisse de Saint Thomas en Jamaïque. Il est moins populaire que Garvey. Néanmoins, il est la première personne à fonder une communauté rasta et à en codifier le mode de vie. C’est à New York, dans le quartier de Harlem, que Howell s’imprègne de la pensée garveyiste. Au début des années 30, de retour à Kinsgton, il commence à diffuser ce qui sera la genèse de l’idéologie rasta. Selon lui, les noirs de la Jamaïque ne doivent plus leur adoration et leur soumission au roi d’Angleterre, mais au roi d’Éthiopie, en la personne de Sélassié. Il inclut la part religieuse et mystique dont le peuple s’inspire naturellement. Saint Thomas est une paroisse où vivent des travailleurs indiens et noirs : ses prêches y trouvent un écho favorable. C’est dans ce contexte historique que germe la dimension pan africaniste et nationaliste du mouvement rastafari. Dans une deuxième phase, après la mort de Garvey en 1940, le mouvement rasta sera l’un des seuls courants de pensée à préserver et populariser son idéologie. Sous l’inspiration des idées nationalistes de Marcus Garvey, les rastas décident de s’affranchir de la suprématie culturelle blanche et de se tourner vers l’Afrique. Parce qu’il s’oppose à l’image dégradante du Noir et à celle du Blanc représentant la pureté, le mouvement replace la conscience noire au centre de son idéologie. Comme dans la communauté africaineaméricaine avec l’Islam, le nationalisme au sein du mouvement rastafari prend un tournant religieux. Seulement, contrairement au mouvement hiphop et au garveyisme, l’idéologie nationaliste peine à se concrétiser sur le plan social et politique, ce qui conduit le sociologue Orlando Patterson à décrire le mouvement rastafari, dans son essai Ecumenical America, comme étant une forme de « négritude religieuse ». Le mouvement est né et s’est perpétué comme un antidote au racisme colonial et post-colonial. Pour ce faire, les rastas ont contesté le christianisme imposé par la société blanche où le Christ est représenté comme un homme blanc aux yeux bleus. Ils revendiquèrent un dieu et un messie noir auquel ils pourraient s’identifier sans peine et sans conflit interne. En 1930, cette « croyance nationaliste » est
122
une rébellion culturelle, religieuse, politique et sociologique. Haïlé Sélassié, considéré comme le Christ réincarné, sera ce messie noir auquel ils s’identifieront (Black Hannah, 2002 : 100 à 105). Si aujourd’hui l’organisation créée par Garvey, l’UNIA, a perdu sa notoriété, son influence sur le plan spirituel et culturel persiste. La communauté rasta contribua de manière significative à garder sa mémoire et ses idées vivantes. Le gouvernement jamaïcain éleva Garvey au rang de héros national. Aussi radicalement que celui-ci, les rastas demandent à être rapatriés en Afrique sur la terre de leurs ancêtres ; ils s’appuient sur le Psaume 68 de la Bible qui déclare : « Des grands viennent de l’Egypte, l’Ethiopie accourt (les mains tendues) vers Dieu »
L’Éthiopie, l’une des seules nations non colonisées en Afrique, représentait pour Garvey un modèle de résistance et d’indépendance. Certes, il existe des différences entre la vision du retour en Afrique que défendait Garvey et celle des rastas que nous avons pu mettre en évidence dans le chapitre 2 de la première partie de notre travail. Comme l’affirme Barry Chevannes, leur désir de retour vers l’Afrique traduit une certaine idéalisation du continent (Chevannes, 1995 : 33 à 43). Jusqu’à ce jour, si des adeptes du mouvement ont pu s’installer en Afrique, ils n’en représentent qu’une petite partie. C’est la dissemblance entre le nationalisme noir au sein de la culture hip-hop qui milite pour des institutions et une identité qui répond aux besoins de la communauté africaine-américaine aux États-Unis. Peut-on affirmer que les revendications du nationalisme noir dans la culture rasta sont plus fondamentales pour autant ? Nous répondons par la négative puisque leur impact et leur résultat n’ont pas été aussi tangibles. Si l’on considère la durée de la ségrégation, les Africains-Américains ont subi une forme de discrimination plus sévère que les descendants d’esclaves en Jamaïque et dans la région Caraïbe. Après les événements des années 60, leur vision du nationalisme s’est endurcie avec des groupes comme le Black Panther Party qui, au sens propre, prit les armes pour se défendre. Il est intéressant de noter que les racines idéologiques de la Nation de l’Islam se situent dans la pensée de Marcus Garvey. Elijah Muhammad puis Malcolm X reprennent des éléments clés de son raisonnement sur un ton nouveau : L’Afrique comme référence identitaire, la fierté raciale, donc la contestation de la suprématie blanche, l’autonomie politique et économique du peuple noir. Malcolm X, en tant que porte-parole de l’organisation, reprend la rhétorique de Garvey, la popularise durant les années 60, en défendant la théorie du « Do for Self », l’autosuffisance et
123
l’autodétermination, ainsi qu’une spiritualité adaptée au peuple noir. Il faut savoir que les parents de Malcolm X, Carl et Louise Little, étaient des garveyistes engagés dans l’UNIA71. Nous avons des raisons de croire que l’activité de ses parents au sein de cette organisation demeure un souvenir très vif chez lui. L’expression africaine-américaine « Black is beautiful » est un écho de la pensée de Marcus Garvey. Le nationalisme s’est matérialisé au sein du mouvement rastafari à travers l’éthiopianisme du 18e siècle, les premières prédications de Percival Howell et les idées de Garvey que les adeptes ont réinterprétées dans un sens religieux. Au sein du mouvement hip-hop, le nationalisme se manifeste également par la situation de Mumia Abu-Jamal, un journaliste et activiste africainaméricain. Le 9 décembre 1981, il est accusé d’avoir assassiné un agent de police à Philadelphie. Depuis, il est dans le couloir de la mort. C’est un symbole pour la communauté africaine-américaine mais aussi pour la communauté hip-hop (Abu Jamal, 1999 : 178-180). Il connaît la génération hip-hop et la croit capable d’apporter un changement significatif dans la société nord-américaine (ibid.). Mumia Abu Jamal, avant son incarcération, a eu l’opportunité de s’entretenir avec Bob Marley, l’icône du mouvement rastafari. Il porte des dreadlocks mais nous ne pouvons pas affirmer que ses nattes soient un signe extérieur de son appartenance au mouvement rastafari. Cependant, elles attestent sûrement de son engagement afro-diasporique. En revanche, en 1968, en signe de solidarité avec le mouvement de rébellion des jeunes Noirs aux États-Unis, Bob Marley coupa ses locks et adopta pendant quelque temps la coiffure afro (Davis, 1994 : 99). L’entretien mentionné symbolise la rencontre entre les deux mouvements, entre deux porte-parole de la diaspora noire. Au cours de celui-ci, Abu Jamal compare le rôle de Marley à celui d’autres activistes et hommes politiques noirs tels que Fred Hampton, Marcus Garvey ou encore Malcolm X. À la question « Quel est ton souhait pour l’avenir du peuple noir en Amérique et dans le monde ? », Marley répond : « La voie que je vois et que tu vois ça paraît simple mais c’est la vérité. Rasta for the people ! (…) C’est le chemin pour les Noirs (…) »72. Marley propose une option qui relie le destin des descendants d’esclaves en Jamaïque et aux États-Unis. La génération hip-hop saura reprendre l’engagement identitaire du mouvement rastafari et l’intégrer dans son mode de vie.
71
Marcus Garvey: Look for me in the Whirlwind, DVD American experience, produit par WGBH Boston, 2001. 72 http:/oldies.jahmusic.net/marleymumia.htm
124
C/ Précisions conceptuelles : Religion, mouvement social et culture Nous ne pouvons pas ignorer le rôle des motifs religieux dans l’organisation et la mobilisation sociale, culturelle et politique des personnes. Ils permettent aussi d’expliquer l’expérience collective et sont la réponse de ces personnes au caractère incertain de la vie. Ils permettent l’édification d’institutions culturelles et sociales qui structurent leur vision du monde qui les aident « à tenir » et donnent un sens à leurs valeurs. Dans les cultures africaines, la religion n’est pas un domaine séparé de la vie sociale. Dans la perspective de l’anthropologie culturelle, Clifford Geertz définit la religion comme : « Un système de symboles qui agit de manière à susciter chez les hommes des motivations et des dispositions puissantes, profondes et durables, en formulant des conceptions d’ordre général sur l’existence et en donnant à ces conceptions une telle apparence de réalité que ces motivations et ces dispositions ne semblent s’appuyer que sur le réel » (Banton, 1966 : 4)
Ces deux concepts, religion et culture, sont les résultats de particularismes socioculturels qui, eux-mêmes, sont le résultat d’incertitudes identitaires. Ils sont motivés par la perception que les adeptes ne contrôlent pas suffisamment leur vie personnelle et leur monde social. Un individu peut s’identifier comme étant membre d’un parti politique ou d’une communauté religieuse, comme membre d’une classe sociale ou d’une organisation ou d’une culture quelconque. Il peut aussi, selon les crises et les situations, combiner plusieurs identifications. Pour les peuples opprimés, la religion est souvent un moyen leur permettant d’exprimer leur identité nationale. Si le politique a pu se faire religion, la religion peut aussi se faire politique, soit sur un mode attestataire qui légitime la situation politique, soit sur un mode protestataire qui légitime le changement sociopolitique. Un groupe religieux comme le mouvement rastafari qui prône la distanciation par rapport aux affaires de la cité a des répercussions politiques, car il n’y a aucune manière de concevoir le divin qui soit totalement neutre sur le plan politique. Toute théologie véhicule une certaine vision du monde social, même celles qui n’explicitent en rien cette vision. Peter Beyer, professeur au sein du Département d’étude des religions à l’université de Toronto, a écrit un ouvrage intitulé Religion and globalization (1994), qui explore le rôle de la religion face aux changements sociaux et culturels dans le cadre de la mondialisation. Il étudie comment le
125
changement mondial agit sur les pratiques, les significations et l’influence de la religion. Il est vrai que celle-ci joue un rôle crucial dans le changement de l’ordre mondial et l’évolution des sociétés car elle est souvent à la base des motivations des individus. Nous l’avons constaté dans les tristes événements du 11 septembre 2001, dans la guerre entre Israël et la Palestine, dans le conflit irlandais entre protestants et catholiques, dans la lutte sociopolitique de Gandhi, de Martin Luther King, dans la mobilisation d’un million d’hommes noirs à Washington organisée par Louis Farrakhan. En analysant les attributs d’un mouvement social, on remarque les similitudes, même minimes, qui existent avec le fait religieux. Un mouvement social est non conventionnel et hors des frontières institutionnelles. Il reflète les problèmes sociaux ; c’est la réponse des individus à ces problèmes. Il est caractérisé par la présence constante d’insatisfactions. Il est instable et fragile. Pour ne pas disparaître, les mouvements sociaux sont obligés de s’institutionnaliser. Enfin, le charisme est un élément clé dans les changements qu’ils subissent. Le mouvement hip-hop et le mouvement rastafari présentent les attributs des mouvements sociaux et peuvent être examinés dans cette perspective. Ce sont, en effet, de nouveaux mouvements sociaux investis par des motivations religieuses. D’autre part, les phénomènes religieux peuvent utiliser les mouvements sociaux pour avoir une plus grande exposition comme le dit Peter Beyer : « (…) Les mouvements sociaux à base religieuse constituent par conséquent des possibilités distinctes pour combler l’espace entre les fonctions religieuses privées et les représentations religieuses publiques et influentes.» (1994 : 106)
Les mouvements sociaux élargissent la sphère d’influence des religions. Grâce à leurs expressions, les croyances religieuses qui sont à l’origine partagées dans un cercle privé peuvent être diffusées largement. C’est exactement le processus qui a eu lieu pour la diffusion des croyances rastafariennes, non seulement par le reggae mais aussi par des mouvements afrocentriques, tels que peuvent l’être le mouvement hip-hop et d’autres mouvements mobilisés contre l’oppression sociale et raciale. Tant qu’il y aura des problèmes que la société ne pourra pas régler, les mouvements socioculturels continueront à émerger avec la possibilité de s’aider de ressources religieuses pour mobiliser. Nous pensons naturellement au leader musulman extrémiste Oussama Ben Laden qui utilise l’islam pour mobiliser des individus contre le bloc économique, politique et militaire que représentent les États-Unis.
126
Même si la religion apparaît comme une réaction négative envers la mondialisation, cela ne signifie pas qu’elle est simplement une force régressive, ; elle se laisse aussi modeler par celle-ci. Sous les conditions de la modernisation et de la mondialisation, le premier moyen pour la religion d’avoir plus d’influence publique est de devenir elle-même une ressource culturelle pour d’autres systèmes. Il faut donc s’attendre à voir des mouvements religieux fusionner avec les mouvements socioculturels. Aux États-Unis et en Jamaïque, le peuple noir a longtemps été invisible, les mouvements hip-hop et rastafari ont contribué à le rendre visible et à le faire entendre. Le nationalisme noir et l’afrocentricité sont deux courants de pensée qui leur ont servi de fondation. Ces mouvements ont révélé la culture d’hommes autrefois dominés dont l’identité a subi des attaques violentes. Lorsque des peuples subissent la domination politique, l’exploitation économique, l’humiliation et l’oppression identitaire, il est normal qu’ils se reportent à leur passé pour développer un sentiment de dignité. En creusant dans ce passé, ils y recherchent en priorité les traits des êtres et des choses qui ont guidé leur histoire, afin d’établir des repères pour vivre le temps présent. Le mouvement rastafari et le mouvement hip-hop sont responsables de la résurgence du pan africanisme et du nationalisme noir au sein de la jeunesse africaine-américaine et afro-jamaïcaine. Cette inclination idéologique est le résultat de ce que Pierre Bourdieu appellera dans son ouvrage La misère du monde une « misère de position », autrement dit une pauvreté matérielle étroitement liée à la position sociale. Cette position sociale était à son tour étroitement liée à leur couleur de peau. Si, aujourd’hui, les adeptes des deux mouvements viennent de tous les horizons sociaux et ethniques, à leur début ils eurent beaucoup de succès parmi la population noire, la classe ouvrière, les chômeurs et tous ceux qui se sentaient aliénés par une société capitaliste ou néo-colonialiste. Malgré leur diversité aujourd’hui, ces deux mouvements sont toujours enracinés dans l’esclavage qu’ont connu les peuples africains du 16e au 19e siècle. Les musiques phares de ces mouvements, le rap et le reggae, sont des musiques de tension, de division mais d’unité en même temps. Ce sont des signes et des manifestations de blessures non refermées. On constate que ces deux cultures ont aussi en commun le rejet des valeurs dominantes de la société. Leurs adeptes ont essayé, sous des formes différentes, de reconstruire l’image de l’homme de couleur. L’afrocentrisme adopté avait le même objectif : inverser l’histoire de dépendance vis-à-vis de l’impérialisme culturel occidental et le convertir en un système de valeurs afrocentriste. Si les membres du mouvement hip-hop et du mouvement rastafari ont pu s’affranchir de la dépendance envers la culture occidentale, leur attachement aux substances hallucinogènes n’en reste pas moins discutable.
127
3.1.2: Rôle des substances hallucinogènes « La lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil… »73
Les substances hallucinogènes occupent une place fondamentale dans le mouvement rastafari comme dans le mouvement hip-hop. Nous ne pouvons pas ignorer leur rôle et leur influence. Les principales substances concernées sont le cannabis, le crack et la cocaïne. Au sein des deux mouvements, de nombreux adeptes et de nombreux artistes font usage d’une ou de plusieurs de ces substances. D’autres participent à son commerce. Certes, il faut préciser que ce n’est pas une pratique généralisée et que le cannabis est plus communément rattaché au rastafarisme. L'apparition de ces stupéfiants dans les communautés noires imprègne constamment les paroles des chansons rap et reggae. En réalité, la relation entre la musique populaire et les substances dites illicites est plus vieille que le rap et le reggae. Dans un premier temps, nous nous attacherons à expliquer la dynamique de la relation entre les substances hallucinogènes, le milieu artistique populaire et l’Amérique anglophone. Certainement les raisons qui motivent le commerce de ces substances narcotiques et poussent à leur consommation peuvent être bien différentes d’un mouvement à l’autre. Subséquemment nous pourrons étudier plus en détail cet aspect de notre argumentation. Dans un deuxième temps, nous tenterons de comprendre pourquoi la consommation de substances hallucinogènes est devenue un aspect « idéologique » au sein du mouvement hip-hop et du mouvement rastafari.
A/ Itinéraire des substances illégales aux États-Unis et en Jamaïque Selon le Programme Anti-Drogue des Nations Unies (UNDCP), le cannabis est la drogue illicite la plus largement produite, commercialisée et utilisée dans le monde. Elle représente 50% des saisies de drogues illicites (Booth 2005: 302). La valeur économique de ce marché ne peut pas être estimée avec précision mais les spécialistes s’accordent à dire qu’elle représente plusieurs milliards de dollars (Booth 2005: 302). Malgré la pression internationale et les campagnes de destruction, les pays producteurs font face à une demande mondiale sans cesse croissante. Contrairement à ce
73
René Char, Cahier vert cité dans Crack et cannabis dans la Caraïbe, Aimé Charles Nicolas (1997).
128
que l’on pourrait penser, la Jamaïque n’est pas le premier producteur de marijuana et de haschisch. Les principaux pays producteurs sont le Maroc (35%), le Pakistan (30%), le Liban (20%), l’Inde et le Népal (5%) et l’Afghanistan (5%). Des 772 tonnes saisies dans le monde, 400 provenaient du Maroc, tandis que 50 % de ces saisies ont eu lieu en Europe (Booth 2005: 302). La production de haschisch provenant des pays tels que le Maroc est destinée largement au marché européen mais également au marché nordaméricain. Toujours selon le programme international de surveillance des drogues des Nations Unies, en 2000, 3.5% de la population adulte (personnes âgées de plus de quinze ans) mondiale consommaient du cannabis. Cela équivaut à 147 millions de personnes. La plus grande partie des consommateurs (25%) se trouve en Asie. 50% des consommateurs se partagent entre l’Afrique et l’Amérique dans des proportions égales (Booth, 2005 : 313).
a- Le cannabis aux États-Unis Aux États-Unis, l’utilisation du cannabis est chose commune dans les lycées et dans les universités. Environ 20 millions d’Américains en consomment chaque année et 2 millions chaque jour (Schlosser, 2003 :14). Dès le 19e siècle, le cannabis était cultivé pour ses fibres. La population, blanche en majorité, ignorait tout de ses propriétés psycho-actives. Par contre, la population noire était consciente du dit potentiel psycho-actif grâce à son expérience du dagga, substance psycho-active utilisée en Afrique (Booth 2005 : 129). Ainsi, dans les États du Sud, les esclaves fumaient des feuilles de cannabis séchées. Cette pratique n’était pas étendue, mais la population blanche en était consciente et se décida à y participer. Étant donné qu’elle était pratiquée par les « Nègres », la consommation de cannabis était vue d’un mauvais oeil. L’introduction du cannabis aux Amériques est due aux Portugais et aux Espagnols (Ibid.). Au 16e siècle, les Indiens d’Amérique ne fument que du tabac et des herbes euphorisantes. L’opinion commune affirme que le cannabis est venu aux Amériques avec les esclaves noirs en provenance d’Afrique, arrivés d’abord au Brésil durant la première partie du 16e siècle pour travailler dans des plantations de canne (Ibid.). On prétend aussi que les graines de cannabis furent importées par les Portugais de leurs comptoirs en Inde, particulièrement de la région de Goa. Le cannabis est cultivé sur les plantations au nord-est du continent. C’est d’ailleurs à ce moment que les Indiens entrent en contact avec la plante et commencent à la fumer (Ibid.). Durant les années 30, New York devient la capitale du jazz, et c’est dans ce milieu que l’usage du cannabis, se répandra. Elle devient un élément essentiel dans cette culture urbaine noire, non seulement pour les artistes,
129
mais aussi pour les amateurs blancs qui fréquentent les clubs de jazz. À travers la musique, les chanteurs et les musiciens expriment leur position sur l’usage de la marijuana et d’autres substances illicites. Des chansons comme Texas tea party de Benny Goodman, If you’re a viper de Bob Howard, Gimme reefer de Bessie Smith, The reefer song de Fats Waller en font explicitement mention. Comme les Negro Spirituals chantés par les esclaves ou le rap scandé par les jeunes Africains-Américains, les Latinos et les Caribéens-Américains, ces chansons étaient des commentaires sociaux sur la dureté de la vie pour la population urbaine noire à New York. À cette époque, le terme « hip » signifiait « être branché », « être dans la tendance », et les hipsters étaient ceux qui participaient à cette nouvelle culture du jazz et la comprenaient. C’est cette même racine que l’on retrouve dans le terme « hip-hop ». La culture hip-hop est liée aussi à ce monde souterrain du jazz et de la consommation de cannabis. La génération hip-hop est composée des enfants de la génération jazz. La presse écrite dans la ville de New Orléans associe l’usage du cannabis à la communauté africaine-américaine, aux musiciens de jazz, aux prostituées et aux Blancs qui participent à la vie nocturne (Schlosser, 2003 :19). La perception du cannabis passe par plusieurs étapes dans la société nordaméricaine. Durant les années 30, son usage est criminalisé. Dans un contexte où les noirs et les immigrés sont les utilisateurs les plus répandus, son usage est considéré comme une menace pour la nation. Une loi est adoptée et en interdit l’usage. Le cannabis est perçu comme une drogue dangereuse, non pas à cause de la dépendance qu’il pouvait engendrer, mais parce qu’il peut, selon les autorités nord-américaines, encourager les relations sexuelles entre les hommes de couleur et les femmes blanches (Booth, 2005: 190). Durant les années 50, le cannabis est considéré comme la « drogue de l’homme noir ». Dans l’argot local, le point de vente est appelé le Tea-pad et le dealer est le Tea man. À Harlem, un dealer de marijuana africain-américain appelé Malcolm Little et surnommé Detroit Red sera arrêté en 1946. Il n’est pas arrêté pour cette activité, mais pour vol à main armée, et écope d’une peine de 7 ans de prison. En 1952, il en sort et, suite aux enseignements de la Nation de l’Islam lors de son incarcération, se fait désormais appeler Malcolm X, un nom qui indique la perte de son identité africaine originale. Il s’éloigne de cette vie de hipsters, pour offrir à sa communauté une alternative à la vie du ghetto. Durant les années 60 et 70, la jeunesse blanche des classes moyennes commence à utiliser le cannabis et le climat politique change. À cette époque, le cannabis est importé du Mexique, de Colombie et de Jamaïque principalement (Schlosser, 2003 :35). Il naît alors une culture qui s’oppose aux idées de la bourgeoisie blanche symbolisée par des artistes tels que les Beatles, les Doors, les Rolling Stones. L’utilisation du cannabis se
130
popularise et se décriminalise. L’usage de cette drogue augmente parmi les soldats africains-américains de retour de la guerre du Vietnam. L’effet de la substance est fort et on peut facilement se la procurer (William, 1996 : 60). Par la suite, les lois incriminant l’usage du cannabis sont jugées trop sévères et sont abrogées par plusieurs États (Ibid.). Dans la communauté africaineaméricaine, son usage continue à se répandre. Durant les années 80, Ronald Reagan mène sa campagne présidentielle en décrivant le cannabis comme étant la drogue la plus dangereuse (Schlosser, 2003 :24). Il continue la « guerre contre la drogue » commencée par Richard Nixon en 1971. En effet, celui-ci avait mis en place ce programme car de nombreux soldats revenus de la guerre du Vietnam étaient héroïnomanes (10% environ)74. Une fois élu, il a créé un bureau chargé de l’étude des effets de l’héroïne sur la jeunesse, une autre loi est votée durcissant les pénalités pour les personnes consommant, cultivant et/ou trafiquant le cannabis (Ibid.). Une véritable hystérie s’empare de l’opinion américaine. Une vaste campagne d’arrestations a lieu. Un grand nombre d’Africains-Américains et de Latinos, surtout des hommes, sont incarcérés et perdent leurs droits civiques à leur sortie de prison. Aujourd’hui, la loi fédérale considère comme illégale la possession de marijuana. Malgré les lois, le temps et les grosses sommes d’argent investies dans la prévention et la répression, durant les années 90, son usage a augmenté parmi la jeunesse nord-américaine75. En 1982, lorsque Ronald Reagan lance son programme contre la drogue, 88.5% des lycéens américains déclarent qu’il leur est relativement facile de se procurer du cannabis. En 2000, 88.5% font une déclaration identique à cette dernière (Schlosser, 2003 :71). Les jeunes Africain-Américains sont plus susceptibles de commencer à consommer du cannabis que les autres groupes raciaux aux États-Unis. En 2003, alors que l’usage du cannabis est en baisse chez les jeunes Blancs, chez les jeunes Hispaniques et les jeunes Africains-Américains, le pourcentage de consommateurs reste le même76. Le cannabis reste facilement accessible pour eux d’une part, et d’autre part, ils n’estiment pas que son usage a un impact nocif sur leur comportement et leurs relations sociales77. Ce stupéfiant est la première substance hallucinogène que les jeunes Africains-Américains admis en centre de désintoxication avouent avoir utilisés. 72% de ces derniers se rendent dans ces centres pour soigner
74
Lacoste Yves, « Le cancer des drogues illicites », Hérodote, revue de géographie et de géopolitique, 2004. 75 www.narconon.org/druginfo/marijuanna_hist.html 76 Partnership Attitude Tracking Study, Teen Study, 2003. 77 Idem
131
leur dépendance au cannabis contre 60% de jeunes Blancs, 62% d’Asiatiques et 66% de jeunes Hispaniques78. Cependant, selon une enquête menée en 2003, de moins en moins de jeunes Africains-Américains considèrent l’utilisation du cannabis comme une pratique acceptable79. Conformément aux lois anti-drogues aux États-Unis, un consommateur de cannabis est plus sévèrement puni qu’un meurtrier. La psychose autour de cette substance est telle que les peines sont parfois irréalistes et excessives. Elles ont souvent été appliquées à partir de préjugés raciaux, d’objectifs politiques ou encore de peurs irrationnelles. Selon Eric Schlosser, auteur de Reefer madness, un ouvrage traitant de l’économie illégale dans la société nord-américaine, les risques devraient être expliqués clairement aux utilisateurs mais la répression ne devrait pas être aussi accablante, car elle n’a pas découragé les fumeurs potentiels (74). Comme cela s’est produit dans les années 60 avec la « génération jazz », durant les années 90, les lois n’ont pas empêché la « génération hip-hop » de consommer du cannabis.
b-Le cannabis en Jamaïque « Ganja », c’est le vocable utilisé pour désigner le cannabis à la Jamaïque. Ce terme fut emprunté aux Indiens venus travailler sur les plantations dans le pays après l’abolition de l’esclavage. La plupart des rapports de police et des études sociales convergent vers une seule conclusion : ce sont les travailleurs sous contrat venus de l’Est de l’Inde en 1838 après la libération des esclaves qui ont généralisé l’usage du cannabis (même s’il a pu exister, du temps de l’esclavage, chez certains Africains). Les Indiens ont transmis aux Noirs de la Jamaïque les techniques pour faire pousser la plante et la fumer. Tant que le cannabis n’a concerné que les indiens, son usage a été mis au compte de leur folklore, au même titre que leur musique ou encore leur nourriture. Il permettait aux planteurs britanniques de faire tenir leurs hommes tranquilles, si bien qu’au 19e siècle, ils en importaient par bateaux pour le revendre aux travailleurs indiens, particulièrement à Trinidad (Campbell, 1987 : 108). D’un point de vue chronologique, la diffusion du cannabis parmi la population noire de la Jamaïque correspond exactement à l’essor du mouvement rastafari (Lee, 1999 : 196). En 1938, selon des rapports de police, le cannabis est présent lors de chaque émeute (Lee, 197). Il est retrouvé en possession des fauteurs
78
Treatment Episode Data Set, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, 1992–2002. 79 Partnership Attitude Tracking Study, Teen Study, 2003.
132
de trouble qui s’en servent pour se donner de l’audace. La population noire qui possède du cannabis, contrairement aux Indiens, a de réelles raisons de se rebeller contre la classe dirigeante. Entre 1939 et 1940, les condamnations pour possession de cannabis augmentent de 40%. La première communauté rasta indépendante, le Pinnacle, devient l’un des premiers lieux de commerce du cannabis à grande échelle. De plus c’est un véritable eldorado pour les planteurs. Le cannabis n’est pas seulement fumé, les utilisateurs s’en servent également pour faire des tisanes et la cuisine. Lorsqu’en 1941 les lois anticannabis commencent à être votées, pour le gouvernement cela équivaut à faire disparaître le mouvement rasta (Campbell, 1987 : 108). De nombreux membres sont systématiquement arrêtés et emprisonnés, car le cannabis fait partie de leur culte religieux. Jusqu’en 1960, le cannabis était cultivé à la Jamaïque sur de petites parcelles. C’est à partir de cette date, avec l’arrivée du mouvement hippie aux États-Unis, que les paysans ont commencé à produire de plus grosses quantités pour répondre à la demande grandissante. Ces derniers deviennent de plus en plus audacieux, n’hésitant pas à s’armer pour résister aux incursions policières. La production devient de plus en plus commerciale, le climat de l’île correspondant parfaitement à la culture de la plante. C’est également à cette époque que le crime organisé se développe par rapport au trafic en infiltrant les douanes et les services d’immigration jamaïcains et nord-américains. Durant les années 70, on estime à 70% le nombre de personnes, tout âge confondus, qui consomment du cannabis sur l’île sous forme de cigarettes, de condiment ou de thé. Il n’est pas utilisé spécifiquement pour ses propriétés hallucinogènes, mais aussi pour ses propriétés relaxantes, thérapeutiques et même magiques (contre les mauvais esprits). En Jamaïque, si la consommation de cannabis est interdite et reste un comportement social à risque, une grande partie de la population en consomme. C’est une pratique inscrite dans les mœurs locales de la classe ouvrière. Selon La Lettre Internationale des Drogues de février 2001, rédigée par l’Association d’Études Géopolitiques des Drogues, « en 1985, les exportations de cannabis, dont plus de 2000 tonnes distribuées aux ÉtatsUnis, ont rapporté entre 1 et 2 milliards de dollars, soit plus que le revenu des principaux produits d’exportation (bauxite et sucre) ou celui du tourisme ». À part les gangs locaux, parmi les exportateurs, on retrouve une secte rasta appelée Ethiopian Zion Coptic Church. La plupart des adeptes sont blancs et résident aux États-Unis, à Miami généralement. En 1977, 105 tonnes de cannabis sont saisies dans les bâtiments de leur Église à Miami. En 2007, le cannabis reste largement cultivé en Jamaïque son commerce est un éléments considérable dans la vie politique, car les fonds qui en résultent sont d’une manière ou d’une autre utilisés par les partis politiques durant leur campagne (Booth 2005: 259). La musique reggae se positionne comme
133
l’avocat du cannabis. L’île contient de nombreuses plantations. Cependant, les artistes reggae sont des cibles visibles pour les forces de police. Comme beaucoup de pays dans le besoin, la Jamaïque a besoin d’une monnaie d’échange : le cannabis en est une.
c-Le crack aux États-Unis Si le cannabis tient une place majeure dans la communauté rasta et sur l’île de la Jamaïque, le crack a eu une présence comparable au sein de la communauté africaine-américaine à l’origine du hip-hop. L’utilisation et le commerce des deux substances sont régulièrement évoqués dans le rap. Elles sont toutes deux devenues des enjeux financiers considérables. C’est la raison pour laquelle nous avons choisi de considérer le rôle de cette substance dans le mouvement hip-hop et au sein de la communauté africaine-américaine. À partir de 1986, le gouvernement américain lance une campagne médiatique exposant les dangers d’une nouvelle substance obtenue à partir de la cocaïne mais sous une forme encore plus destructrice : le crack. Cette nouvelle drogue est apparue à la fin de l’année 1984 tout d’abord dans les zones urbaines pauvres africaines-américaines et hispaniques (Reinarman, Levine, 1997: 2). New York, Miami et Los Angeles sont les premières villes à être touchées. Le crack c’est de la cocaïne sous une forme qui se fume. Son nom vient du bruit que fait la substance quand elle est chauffée. Elle s’obtient facilement en faisant cuire un mélange de cocaïne en poudre, d’eau et de bicarbonate. En réalité, cette substance n’était pas si nouvelle, car son principal ingrédient celui qui crée une accoutumance, c’était la cocaïne. Durant les années 70, le freebase, répandue dans la communauté africaineaméricaine, c’est aussi de la cocaïne qui se fume. Le crack est une invention « marketing ». C’est la manière de l’emballer afin de vendre de petites quantités à bas prix qui fait la différence (Ibid.). La clientèle était également différente. La cocaïne était réservée à une clientèle riche, tandis que le crack était vendu par des Africains-Américains et des Hispaniques à une clientèle issue des cités pauvres. Le succès de cette substance aux États-Unis et particulièrement dans les zones urbaines défavorisées est dû à deux réalités : premièrement, une grande majorité des jeunes au chômage était prête à saisir l’opportunité d’avoir un revenu considérable. Vendre du crack leur donnait la possibilité de gagner beaucoup plus d’argent qu’ils ne pourraient le faire avec un travail légal. Deuxièmement, le crack était une substance plus puissante qui donnait au consommateur un effet plus intense mais plus court (Reinarman, Levine, 1997: 2). Contrairement à la cocaïne qui faisait un effet plus subtil, ce « flash » intense et bon marché « convenait » mieux à cette clientèle démunie.
134
Les gangs prirent le contrôle de ce nouveau marché. L’effet du crack étant plus court, les consommateurs revenaient plus rapidement pour acheter d’autres quantités. Le trafic enrichit rapidement les dealers, et la compétition entre les gangs grandit. La violence résultant de cette compétition explosa également et se fit ressentir brutalement dans les quartiers, une violence entre dealers mais qui venait aussi des drogués prêts à tout pour se procurer leur dose quotidienne. Des familles ont été brisées, des magasins, des aires de jeux, des entreprises ont été dévastés. 40% des consommateurs étaient des femmes, qui n’hésitaient pas à délaisser leurs enfants pour se procurer du crack, devant parfois donner leur corps en échange de leur dose (George, 1998 : 41). À la fin des années 80, le crack faisait partie du quotidien des communautés Africaines-Américaines. Il avait radicalement détruit leur mode de vie, les relations familiales et les institutions sociales. En 1992, on estimait à 150 000 le nombre de personnes employées par le marché de la drogue dans la ville de New York (George, 1998 : 40). L’explosion du trafic de crack eut deux conséquences majeures. La montée du « gangsta rap », un style de rap s’inspirant du mode de vie des dealers, et l’augmentation du nombre de jeunes Africains-Américains incarcérés. La misogynie, la loyauté envers son gang, l’absence de sentiments et d’émotions pour faire face au quotidien, la haine des autorités sont des thèmes récurrents dans le gangsta rap, qui expliquent l’augmentation du nombre des incarcérations. La cocaïne, depuis les années 60, arrive dans les pires ghettos nordaméricains en abondance et très facilement (New York, Washington, Los Angeles et Chicago). Quand le crack fait son apparition, il arrive aussi facilement dans les ghettos les plus malfamés sans grande résistance des forces douanières et policières. Depuis longtemps, au sein de la communauté africaine-américaine, des rumeurs évoquaient la responsabilité du gouvernement dans l’arrivage de la cocaïne et du crack dans les ghettos. Ces rumeurs se sont confirmées lorsqu’un ancien officier de la police de Los Angeles, Mike Rupert, attesta l’implication de la CIA et de la police locale dans le trafic. La CIA facilitait délibérément l’arrivage de cocaïne de haute qualité dans les ghettos africains-américains, grâce à des agences spécialisées. Ces agences avaient pour rôle de collaborer avec les barons de la drogue originaires d’Amérique du Sud en facilitant leur accès aux ÉtatsUnis ainsi que celui de leurs marchandises. Le gouvernement tournait en rond. D’un côté il dépensait des millions de dollars pour enrayer le trafic de drogue, d’un autre côté, il « coopérait » avec les grands traffiquants80.
80
http://www.youtube.com/watch?v=LYOVQezWaCY et Whiteout: The CIA, Drugs and the Press, Alexander Cockburn et Jeffrey St. Clair, 1999.
135
Pendant longtemps, la sénatrice africaine-américaine Maxine Waters a interpellé de manière énergique les autorités responsables. Le mouvement des droits civiques a profité plus largement aux classes moyennes noires, mais le prolétariat n’a pas vécu de progrès significatifs et tangibles dans sa condition socio-économique, son pouvoir politique et dans ses perspectives d’emploi. Le cynisme et la colère qui se retrouvent dans le gangsta rap sont le résultat de ces désillusions. De nombreux jeunes de couleur vont alors se tourner vers le commerce de substances illicites pour goûter au « rêve américain ».
B/ Pourquoi vouloir une autre perception de la réalité ? a - Le rap et le crack « Cocaine is running this rap shit… »81
Mos Def, The rape over
Les premières références à la cocaïne dans le rap remontent à 1983, avec la chanson White lines interprétée par Grandmaster Flash and The Furious Five, et à 1985 avec Battream par Toddy Tee (George, 1998: 40). White lines est un titre anti-cocaïne, le crack n’étant pas encore apparu. De 1991 à 2006, de nombreux albums de rap ont été produits dont les thèmes majeurs sont la production et le commerce de la cocaïne et du crack : Scarface : Mr Scarface is back, 1991 Eightball and MJG : Comin’ out hard, 1993 Young D Boyz : Sellin’ cocaïne as usual, 1994 E40 : In a Major way, 1995 Master P : Ghetto D, 1997 Ghostface : Bulletproof Wallet, 2001 Scarface : The fix, 2002 The Clipse : Hell hath no fury, 2006 Cette liste n’est absolument pas exhaustive. Il existe d’autres albums du même genre. Tous ces albums contiennent des références au crack, au style de vie des dealers et aux bénéfices financiers du trafic. De nombreux artistes hip-hop ont eu, et ont encore, des problèmes à cause de leur consommation de crack ou de cocaïne. DJ Kool Herc, l’un des fondateurs de
81
« La cocaïne contrôle le rap … »
136
la culture hip-hop, a consommé du crack pendant quelques années. Le rappeur Earl Simmons, connu sous le nom de DMX, a été arrêté de nombreuses fois en possession de crack pour son usage personnel. Le rappeur Ol'Dirty Bastard, appartenant au groupe mythique Wu Tang Clan de New York, est mort d’une overdose de cocaïne. D’autres rappeurs ont également avoué avoir lutté contre leur tendance à consommer cette substance (Coolio de Los Angeles, Beanie Siegel de Philadelphie et Raekwon de New York). Mais la plupart des albums rap qui traitent du crack ont toujours abordé le sujet de la vente, non de la consommation personnelle. En réalité, la musique populaire a toujours eu des affinités avec les substances hallucinogènes. Les artistes rap n’ont pas été novateurs dans ce domaine. La seule différence, c’est qu’ils ont osé en parler sur leurs disques, en donnant le plus souvent le point de vue du dealer. Depuis la période du blues, les musiciens et chanteurs ont eu recours aux drogues. Musiciens blancs et noirs ont eu recours à la cocaïne. Un agent important résume le milieu de la musique en ces termes : « Coke is the music business drug, it’s done in offices during the day »82. Le trafic de crack est parfois un moyen de commencer des affaires légales. Des maisons de productions, des studios, des lignes de vêtements ont été financés par l’argent du trafic. Certains artistes l’admettent ouvertement. Master P, célèbre producteur et rappeur de la Nouvelle-Orléans, est aujourd’hui l’une des plus grandes fortunes dans le milieu de la musique aux États-Unis. Son premier album, Ghetto D, produit en 1997, est un album détaillant sa vie de dealer. Suge Knight, ancien producteur du label Death Row, le plus prolifique en 1996, a, selon la rumeur, bénéficié de l’argent de la drogue pour lancer sa maison de production. Ces allégations n’ont jamais été prouvées par la police, mais elles n’en restent pas moins vraisemblables. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette relation entre le crack et le rap. Il existe une ambivalence dans le rap. Si les grands consommateurs de crack sont considérés comme des pestiférés, les grands dealers, dans la communauté africaine-américaine, sont admirés et respectés. Le prestige social dont ils jouissent, ils ne l’auraient pas eu avec un normal un travail normal et légal. L’argent du trafic est un moyen de ne plus dépendre des programmes sociaux, un moyen de vivre mieux, sur le plan matériel. Les jeunes Africains-Américains des ghettos sont en quête de dignité mais dans un environnement hostile et dénué de valeurs morales. Cette dignité ne s’acquiert que par les possessions matérielles. Les jeunes admirent les
82
Shappiro Harry, Waiting for the Man. Traduction: « La cocaïne est la drogue de l’industrie musicale ; elle est consommée dans les bureaux durant la journée ».
137
dealers. Ces mêmes jeunes deviennent parfois des artistes rap et véhiculent ces valeurs dans leur musique. « Only know two ways of gettin’: either rap or unwrap »83
The Clipse
« The streets is a short stop: either you slingin’ crack rock or you got a wicked jump shot»84 Notorious BIG
Pour des jeunes de couleur sans moyens aux États-Unis, le sport, le trafic de crack ou la musique ont souvent été les seules options envisagées pour sortir du ghetto. Des aspirations parfois irréalistes mêlées au désespoir mènent souvent ces jeunes sur le chemin du trafic de drogues. Dans le coke rap, ce qui compte c’est la densité de l’histoire, la réputation, la violence que l’on peut endurer ou faire subir85. Les vies perdues ne sont pas comptées ni estimées dans la course au bien-être matériel. Lorsque l’argent facile est à portée de main, lorsque d’autres exibent leur réussite, lorsque les valeurs morales ou les études ne sont pas des critères de respect et de réussite, pour certains la violence et le trafic de crack deviennent des options viables pour goûter à une autre vie. Ces jeunes veulent acquérir des richesses matérielles sans travailler légalement, sans aller à l’école, mais en prenant des raccourcis. Malheureusement le crack devient plus qu’une option pour sortir du ghetto ; c’est un moyen de s’enrichir matériellement. Le film Scarface produit par Martin Bregman en 1983 aura un impact dévastateur sur la jeunesse latino-américaine et la jeunesse africaineaméricaine. Les réalisateurs présentent le parcours d’un réfugié cubain à Miami se battant avec rage pour parvenir au sommet de l’empire de la cocaïne. Même s’il présentait un côté impitoyable et ultra-violent du rêve américain, le film a été un détonateur. La vie de dealer est dépeinte de manière attrayante. La mise en scène de ce réfugié commençant à zéro pour arriver au sommet quelques années plus tard a donné envie aux jeunes d’imiter ce style de vie. Ce film est devenu un film culte dans les cités américaines. Dans une scène du film New Jack City, qui sortira environ 10 ans après, le personnage principal, un trafiquant africain-américain nommé Nino, visionne Scarface. Une autre génération a été influencée par le
83
Traduction : « Je connais seulement deux façons de gagner des thunes : raper ou déballer » (des sachets de drogue, ndlr) 84 Traduction : « Dans la rue, t’en as pas pour longtemps : soit tu deales du crack, soit t’as un bon shoot » (tir au basket, ndlr) 85 Ex Kris, History of cocaïne rap, XXL Worldwide, décembre 2006.
138
personnage de Nino dans ce film. L’unique façon dont ces jeunes arriveront à imiter Scarface au mieux, ce sera dans leur tendance à s’entretuer. Depuis la mise en place de la Rockefeller Drug Law, en 1973, condamnant les individus en possession de 5 grammes de crack lors de leur première arrestation à 15 ans de réclusion, 96% des condamnés sont africainsaméricains et latino-américains86. La terreur qui accompagne l’économie souterraine du crack est réelle. Cette violence de la part des dealers est nécessaire pour garder leur position. Et la violence de la part des drogués pour arriver à leurs fins est aussi réelle. Cet univers et ces histoires se transforment simplement en rimes dans le rap. C’est toujours une description donnée du point de vue du dealer, rarement de celui du consommateur. Parallèlement, il existe un autre courant de pensée. D’autres rappeurs considèrent le dealer de crack comme un poison et un traître pour la communauté. Le rappeur Big Daddy Kane dans sa chanson Another victory ne comprend pas d’où vient le plaisir de vendre un produit dangereux à un autre membre de la communauté. Dans le même mouvement, s’opposant à la banalisation du trafic de drogue dans les ghettos noirs, deux groupes de rap, Outlaw et Dead Prez, se sont alliés sur l’album qu’ils ont intitulé Can’t sell dope forever (Tu ne peux pas vendre de la drogue indéfiniment). C’est une manière de dire que ce style de vie ne peut pas être une occupation permanente. Dans ces chansons, des thèmes divers en rapport avec le monde de la drogue sont abordés, tels que son impact sur la structure familiale, la solitude, la volonté de s’en sortir, la vie du dealer de quartier, etc… Cet album maintient une lueur d’espoir dans une industrie de la musique qui n’hésite pas à commercialiser des histoires sordides pour que d’autres, dans le confort de leur chambre, puissent vivre les risques pris par ces jeunes au quotidien. Les valeurs de ce « monde du crack » se transmettent de la même façon au sein de la jeunesse de couleur issue des classes ouvrières et des ghettos. Dans la même catégorie, on peut se référer à King of Kings, un documentaire antidrogue produit par le réalisateur Charles Fisher aidé de Lance Furtado, un ancien trafiquant de drogues africain-américain repenti. Ce dernier y explique l’ascension et la chute de son empire. Après vingt ans de chassé-croisé avec la justice américaine, en 1995, son gang est démantelé. Aujourd’hui, Lance Furtado, avec l’aide d’activistes, de producteurs, de rappeurs, mène une campagne de prévention contre l’usage et le trafic de drogues dans la communauté africaine-américaine.
86
Cité par le Dr Ben Chavis dans King of Kings lors d’une conférence tenue au Baruch College.
139
Dans le mouvement rastafari, la doctrine interdit la consommation de substances autres que le cannabis. L’usage de la cigarette, de la cocaïne et du crack est formellement prohibé. Dans leurs chansons, les artistes rasta en dénoncent clairement l’usage et le commerce : « I will remain the same Hailing rastafari name And watch dem going up in flames For all the innocent going down the drain You have to pay for the shackles and chains And pay for these washing of the brain And pay for these guns and cocaine »87
En 2000, sur son album More Fire, le chanteur rasta Capleton condamne les « faux rastas » qui consomment de la cocaïne, dans une autre chanson intitulée Bun Dung dreddie. Nos recherches officielles n’ont pas pu confirmer que des artistes rasta en consommeraient mais une chose est évidente, dans le monde du spectacle, même s’ils refusent d’en consommer, ils n’y sont pas totalement étrangers. Si certains rastas ont recours à cette substance, cela reste un sujet tabou. Dans sa biographie de Bob Marley intitulée Catch a fire, Timothy White explore la criminalisation de la marijuana et les effets désastreux de l’apparition des cartels de cocaïne et d’héroïne durant les années 80. Marley a plusieurs fois eu l’occasion de tester d’autres substances comme la cocaïne durant sa carrière mais a toujours refusé à cause de ses principes religieux (Booth, 2005 : 267). Après la sortie de son album Uprising, le biographe de Marley, Timothy White, affirme que la cocaïne et l’héroïne ont affecté le mouvement rasta d’autant plus que la Jamaïque était devenue un point de passage, en provenance de la Colombie à destination de la Floride. L’impact s’est également fait ressentir sur le reggae où les messages devenaient de moins en moins religieux pour laisser la place à un ton et à des propos très agressifs. Cette étape coïncida avec l’essor de la musique et du mouvement dancehall88.
87
Capleton, That day will come : « Je resterai le même saluant le nom de Rastafari/Je les regarderai brûler pour les innocents qui meurent ils vont payer pour les chaînes, payer pour ces lavages de cerveau payer pour ces fusils et la cocaïne ». 88 Pour plus d’informations sur le mouvement Dancehall voir Inna di dancehall (2006) de Donna P. Hope, Wake the town and tell the People (2000) de Norman C. Stolzoff.
140
b - Rastafari, hip-hop et cannabis Dans cette partie de notre développement, nous tenterons de discerner les différences et les similitudes concernant la consommation de cannabis entre le mouvement hip-hop et le mouvement rastafari. Pour ce faire, nous observerons l’évocation de cette pratique à travers les paroles de chansons. Enfin, nous analyserons le rôle des rastas dans le commerce du cannabis dans la ville de New York. La consommation de cannabis est une pratique commune au mouvement hip-hop et au mouvement rastafari. Selon les adeptes, la différence réside dans les intentions qui motivent la consommation. Les adeptes du mouvement rastafari l’utilisent afin de communier spirituellement et de méditer. Dans le mouvement hip-hop, les rappeurs déclarent clairement qu’ils fument pour s’évader, pour oublier la réalité, vulgairement pour « se défoncer ». L’expression qui rend bien ce sentiment est « to get high » : elle signifie « s’élever » sous-entendu au-dessus de la réalité. Elle est également utilisée par les rastas. Dans le cas du mouvement rasta, il est assez difficile de déterminer si une consommation est spirituelle ou récréative parce que la plupart des rastas n’ont pas d’heure ni de lieu spécifiques pour fumer. Si certains fument à l’intérieur des églises lors de leur rassemblement, ils ne sont pas nombreux, car la plupart des rastas n’appartiennent à aucune église. Cette consommation a été revendiquée de nombreuses fois dans les textes des artistes hip-hop et des artistes rasta à travers le reggae, le rap ou la musique dancehall. Dès 1973, Bob Marley apparaît avec une cigarette de marijuana sur la pochette de l’album Catch a fire. Néanmoins, c’est le chanteur Peter Tosh qui va ouvertement demander la légalisation de la marijuana dans son album Legalize it, en 1976. Dans le mouvement hip-hop, dès 1989, les Beastie Boys, des rappeurs blancs, font référence à leur consommation de cannabis dans leur album Paul’s boutique. En 1989, le rappeur Tone Loc parle du cannabis qu’il vend dans une chanson intitulée Mean green et de sa consommation dans le morceau intitulé cheeba cheeba, un synonyme de cannabis. Au sein de la communauté hip-hop nord-américaine, les rappeurs, les DJ, les graffeurs et les danseurs consomment de la marijuana enroulée dans des feuilles de cigares communément appelées blunts. Le blunt est fumé pour se détendre, se relaxer :
141
«Everytime I smoke a reefer that indo high makes me fly If everybody smoked a blunt, relieve the mind, the world could be a better place”89 ”Smokin' on purple ease my mind /this that shit that we get high to»90
Si des rappeurs mentionnent leur consommation de blunts comme étant simplement une partie de leur quotidien91 : «Even in the morning like the flavor of juice/A blunt adds spice and a blunt can spruce up your day but I'm not advertising just telling of aspect a part of our lives»92
une majorité tels que Snoop Doggy Dog, Yukmouth, Ludacris, The Alkoholics, Cypress Hill, Redman, Method Man, Bone-Thugs and Harmony, Doctor Dre, Dead Prez et bien d’autres la vantent ouvertement comme une habitude bénéfique pour leur bien-être. En 1992, Andre Young, alias Doctor Dre, produit un album intitulé The Chronic, un surnom du cannabis. Toutes les chansons ne font pas l’apologie de l’ivresse « cannabique », à part le titre The Roach . Cependant, le titre de cet album rend clairement hommage à la consommation de cannabis. Doctor Dre fume pour expérimenter un état de « non-conscience », pour se déconnecter de la réalité : «Cannabis Sativa Or in the heart of LA known as the chronic… God dam I'm fucked up That shit ain't no joke Ohh shit no I want no more I want shit
89
Bone Thugs and Harmony, Weed song Traduction : « A chaque fois que je fume cette herbe/elle me fait décoller/Si tout le monde fumait un joint, moins de stress/Le monde serait un meilleur endroit ». 90 Lil’ boosie, Smokin’ purple, (2006). Traduction : « Fumer de l’herbe, ça me détend/C’est avec ça qu’on se défonce » 91 Ex: Notorious BIG, Party and Bullshit, Nas, Life’s a bitch, Tupac Shakur, High Till i die. 92 Guru Take Two and Pass : «Même le matin comme un parfum de jus/ Le joint ajoute de la saveur et il peut épicer ta journée mais je ne fais pas de publicité, je parle juste d’un aspect de nos vies ».
142
Just leave me alone Just let me chill out and listen to this shit I'm high»93
Le groupe latino-américain Cypress Hill est également une référence concernant la popularisation de la consommation de cannabis dans le mouvement hip-hop. En mars 1992, le magazine pro-cannabis High Times commente leur premier album en ces termes : « Le premier album de Cypress Hill contient plus de références à la marijuana que des albums traditionnels de Bob Marley ou de Peter Tosh »94
Dans son second album Black Sunday, le groupe n’hésite pas aborder l’histoire de l’usage du cannabis dans ses chansons ainsi que la revendication de sa dépénalisation dans des titres tels que I wanna get high, Hits from the bong et Legalize it. La consommation de marijuana peut aussi donner de l’assurance lors des actes de violence : «I been smoking blunts with the devil /thats why my eyes are red as fuck Now tell me do I look like the type that will be scared to bust ?»95
Ce genre de consommation transporte les fumeurs dans un état de « toutepuissance » ; ils se croient capables d’affronter leurs ennemis ou d’entreprendre toutes sortes d’actions sans craindre la défaite ou la mort. Dans la culture hip-hop, l’acte de fumer du cannabis est un acte de rébellion et de courage. Ce sont les « durs » qui fument et lorsqu’on fume ou que l’on boit, il faut pouvoir tenir le coup, s’affirmer, tandis que dans le mouvement rastafari, selon Rinaldo Walcott, l’auteur de Black like who ? , un adepte se démarque par sa façon de comprendre ce qui lui arrive, de raisonner et non par le fait de fumer simplement du cannabis96.
93
« Cannabis Sativa ou au coeur de Los Angeles alias la chronique/ nom de Dieu, je suis défoncé/elle est forte Oh merde, non je n’en veux plus foutez-moi la paix! Laissez-moi juste tranquille et écoutez ça je plane » . 94 http://cannabisculture.com/articles/3582.html 95 Soulja Slim, The Streets Made Me. Traduction : « Je fumais des joints avec le diable c’est pour cela que mes yeux sont si rouges maintenant dites-moi est-ce que j’ai l’air d’avoir peur de tirer ? » 96 http://cannabisculture.com/articles/1846.html
143
Dans les textes des artistes rasta, la violence associée à la consommation de cannabis n’existe pas (Murrell, Spencer, Farlane, 1998 : 355). Contrairement au mouvement rasta, dans le mouvement hip-hop, la consommation de cannabis est généralement liée à la consommation d’alcool. Les rappeurs ne se contentent pas de fumer, ils consomment également des boissons alcoolisées. Les textes des chansons de reggae, depuis l’album de Bob Marley Catch a fire et celui de Peter Tosh Legalize it, ont souvent milité pour la dépénalisation du cannabis. Le groupe Artifact reste l’un des rares groupes de rap, à part Cypress Hill, à prôner la légalisation du cannabis dans ses textes : «Spark that blunt, represent, don't front I just wanna say that ahh! A lot of you cats, that don't think marijuana should be legalized well you're all fucked»97
La nouvelle génération de chanteurs rasta tels que Sizzla, Anthony B., Bushman, Natural Black continue à relater librement la consommation de cannabis dans leurs chansons. Au début des années 90, les DJ’s jamaïcains Buju Banton, Capleton, Terry Ganzie, Spragga Benz, chantaient tous des gun lyrics (des paroles glorifiant l’utilisation des armes à feu), mais sous l’influence des artistes rasta ils chantent aujourd’hui des chansons qui prêchent rastafari, la non-violence. Ils militent contre les drogues dites « dures ». Leur message est d’une importance capitale en Jamaïque où la situation des ghettos n’a cessé d’empirer et où la cocaïne, le crack et les armes à feu font des ravages. Selon la théologie rastafari, le cannabis est un moyen de méditer, un moyen de se purifier spirituellement. Cette pratique se fonde sur un verset de la Bible dans le livre de la Genèse au verset 1 du chapitre 1. Les rastas considèrent, à partir de ce verset, que le cannabis est un don de Dieu, donc il devrait être autorisé à être consommé librement sans risques de poursuites pénales. L’utilisation du chalice (une pipe à eau), de la marijuana a un but méditatif (Psaumes 18.9) : « Une fumée montait à ses narines (celle de Jah), un feu dévorant sortait de sa bouche ; accompagné d’étincelles brûlantes»
97
Artifacts, Lower the boom: «Allume le joint sans faire de fioritures. Je veux juste dire ça/beaucoup d’entre vous ne croient pas que la marijuanna devrait être légalisée ben, vous êtes tous baisés ! »
144
Nous n’avons pas pu lister un nombre significatif de chansons exprimant cet aspect spirituel de la consommation des rastas : « Passe-moi la marijuana, je rends grâce et je loue Jah aujourd’hui, passemoi la marijuana »
Néanmoins, lorsqu’en 1975 Bob Marley part en tournée aux États-Unis, durant une conférence de presse, il avoue que cela fait 9 ans qu’il consomme régulièrement du cannabis. Il dira à la presse : « When you smoke herb, herb reveals yourself to you. All the wickedness you do, the herb reveals it to yourself, your conscience show up yourself clear, because herb make you meditate. It is only a natural thing and it grows like a tree »98
Bob Marley a émis ses commentaires dans le cadre de l’idéologie rastafari. Il n’a pas laissé entendre qu’il fumait pour le plaisir, même si cette notion n’est pas à écarter. Lorsqu’il apprit qu’il était atteint d’un cancer, il refusa de subir une amputation du pied en partie à cause de sa croyance dans le pouvoir curatif du cannabis (Murrell, Spencer, Mc Farlane, 1998 : 355). La relation entre le monde de la musique et celui des substances narcotiques existe depuis la période du blues. Le jazz, le funk, la soul, le rock et donc naturellement le reggae et le rap l’ont aussi expérimenté. L’auteur Harry Shappiro l'approfondit et la développe dans son ouvrage Waiting for the man: The story of drugs and popular music (1999). Le cannabis y est présenté comme un élément essentiel aux deux mouvements pour trois raisons. Premièrement, un aspect commun aux adeptes des deux cultures dans leur utilisation du cannabis, c’est ce désir de se relaxer, mais aussi d’échapper au monde réel dans lequel ils évoluent. Le cannabis sert d’anti-stress pour les rappeurs et les chanteurs rasta. Le chanteur rasta Ziggy Marley, le fils de Bob, défend sa consommation de la manière suivante : «Oh Lord! Sometimes I feel the pressure But I know that I'll be fine, yeah
98
Booth Martin, Cannabis: a History, p 266, 2005. Traduction : « Quand tu fumes l’herbe, elle te montre qui tu es. Toutes les mauvaises choses que tu fais, l’herbe te les révèle, ta conscience se clarifie parce que l’herbe te fait méditer. C’est quelque chose de naturel et elle grandit comme un arbre ».
145
Just as long as you got me Something for my mind»99
De même Bob Marley écrit dans son titre Easy Skanking : « Pardonnez-moi le temps que j’allume mon spliff Bon dieu je dois décoller Je ne peux pas échapper à la réalité…»100
Le rappeur David Styles, alias Styles P., originaire de New York, explique ses motivations dans le titre Good times (I get high) : « I get high cause I'm in the hood, the guns is around And take a blunt just to ease the pain that humbles me now And I'd rather roll something up cause if I'm sober dawg, I just might flip, grab my guns and hold something up »101
Paradoxalement, dans le même titre, Styles P. établit encore le lien entre la consommation d’herbe des rastas et celle des membres de la communauté hip-hop en se comparant à Bob Marley : « Ay yo, I smoke like a chiminey Matter fact I - smoke like a gun when a killa see his enemy I smoke like Bob Marley did…»102
Si le cadre et la musique changent, la principale raison reste identique, fuir une réalité trop oppressante. Les rappeurs et les chanteurs sont les parties visibles, les voix des adeptes des mouvements, dont ils reflètent entièrement
99
Album: Ziggy and The Melody makers Live, One good spliff, 2001. Traduction: « Oh Seigneur! Parfois je sens la pression/ Mais je sais que ça ira tant que tu me donnera quelque chose pour mon esprit ». 100 Album : Kaya, Island, 1978. 101 Traduction : « Je décolle parce que je suis dans le quartier/il y a des fusils partout et je fume un joint juste pour calmer la douleur qui m’humilie et je préfère rouler quelque chose parce que si je suis sobre, je peux changer, prendre mes fusils et braquer quelque chose » 102 Traduction : « Je fume comme une cheminée, en fait, comme un fusil quand un tueur voit son ennemi, je fume comme Bob Marley (…) ».
146
les pensées essentielles. Nous pouvons imputer ces idées au reste des communautés hip-hop et rastafari. Deuxièmement, grâce à son pouvoir hallucinogène, le cannabis, selon certains artistes, intensifie la créativité. À la question « En quoi le cannabis change-t-il ton écriture ? », le rappeur Gary Grice alias GZA (à prononcer Jizza) répond : « (…) it has you thinking about all types of stuff. Your mind is just working faster. You’re thinking about so much but then half of the stuff you might just, delete, or not even use, but you think about so much that you’re constantly thinking about things and you’re writing stuff down. That feeling is great to be stimulated like that. I always recorded records like that…»103
Ziggy Marley chante cette même notion dans son titre One good spliff : « Keep giving me the good vibration It's giving me that inspiration, And I love that good sensation »104
L’exception existe dans le mouvement hip-hop et dans le mouvement rastafari. Le rappeur O’Shea Jackson, alias Ice Cube, émet une critique sévère à l’égard de ceux qui ne peuvent pas fonctionner sans la stimulation du cannabis : « I know some people who are dependant on weed. If they don’t have it, they can’t function in the studio, on stage, whatever. To me that’s a weak individual who goes into that and starts to be like “I need this to do this”. So I decided to write sober. »105
103
http://www.allhiphop.com/features/?ID=1521. Traduction : « Tu penses à beaucoup de choses. Ton esprit fonctionne plus vite. Tu penses à tellement de choses mais tu n’en gardes pas la moitié ou tu l’oublies, mais tu penses à tellement de choses que tu es constamment en train de réfléchir et tu écris. C’est une manière d’être stimulé qui est géniale. J’enregistrais toujours de cette manière… » 104 Traduction : « Elle me donne la bonne vibration, elle me donne l’inspiration et j’aime cette bonne sensation ». 105 « Je connais des gens qui sont accros à l’herbe. S’ils ne l’ont pas, ils ne peuvent pas être productifs dans le studio ou sur scène. Pour moi ce sont des gens sans
147
La dernière raison qui explique le lien privilégié entreles deux mouvements et l’herbe est moins évidente. Le cannabis n’est pas perçu comme une drogue proprement dite. Étant donné que c’est une plante, sa consommation est mieux acceptée que celle des drogues dites dures, comme le crack, l’héroïne ou la cocaïne. Les adeptes des deux mouvements n’estiment pas être des « drogués » comme on pourrait le dire vulgairement de ceux qui consomment des drogues illicites. Pour des raisons de santé ou simplement en se rendant compte de leur accoutumance, des rappeurs ont arrêté de consommer du cannabis. Sticman, du groupe Dead Prez, donne l’explication suivante : « Just like any time a person’s been an addict to something, it’s a daily struggle. I’ve stopped smoking weed for a week, two weeks, you know, different periods of time and then started smoking weed again. Now I haven’t smoked since November. Health. Definitely health. But more than anything though, when you smoke and you’re high, you’re lacking security. I’m striving to sharpen my warrior potential, so certain things I had to discipline myself away from…»106
Inspectah Deck a lui aussi décidé d’arrêter sa consommation de cannabis pour des raisons de santé : « Twenty years of smoking…blunts …you have to stop at some point. That many years of smoking (…) are harsh to the lungs or the body (...) I stayed tired. I would take like four or five naps a day. That’s how it was. So I just had to leave that alone »107
En ce qui concerne la consommation de cannabis, la connexion entre le mouvement hip-hop et le mouvement rastafari se retrouve à un autre niveau : le trafic. Les rastas installés à New York ont participé à l’importation et au
personnalité qui commencent à raisonner de la sorte « J’ai besoin de ça pour faire ça ». Donc j’ai décidé d’écrire en étant sobre. » 106 « Lorsque quelqu’un est dépendant de quelque chose, c’est un combat de tous les jours. J’ai arrété de fumer de l’herbe pendant une semaine, deux semaines, à différents moments de ma vie, mais j’ai recommencé après. Je n’ai pas fumé depuis novembre. [J’ai arrêté pour des raisons de] « …santé. Absolument la santé. Mais au dessus de tout, parce que quand tu fumes, tu es vulnérable. Je lutte pour augmenter mon potentiel en tant que guerrier donc j’ai dû m’éloigner de certaines choses… » 107 « Vingt ans de consommation de joints. Il faut savoir s'arrêter à un moment. Autant d’années à fumer endommage les poumons et le corps. J’étais souvent fatigué. Je faisais quatre à cinq siestes par jour. C’est comme ca que les choses étaient. Donc il fallait que j’arrête. »
148
commerce de cannabis dans les quartiers tels que Brooklyn. Durant les années 70, dans les quartiers de New York où se sont installés les immigrants Caribéens, des Africains-Américains et des Latino-Américains fumaient du cannabis, mais aucun réseau de distribution n’existait. Ansley Hamid, professeur associé en anthropologie au John Jay College of Criminal Justice de New York, traite du rôle des rastas dans le trafic de marijuana aux États-Unis et à Trinidad dans son ouvrage The ganja complex : rastafari and marijuana (2002). Le cannabis est devenu plus qu’un moyen de se divertir pour ces jeunes Caribéens c’était un moyen de travailler, d’avoir des ressources et de se définir au sein de la société nord-américaine (Hamid, 2002 : 121). Au début des années 30, plus de 300 000 Noirs originaires des États du Sud et de la Caraïbe résidaient à Harlem (Booth, 2005 : 162). La plupart d’entre eux espéraient une vie meilleure et étaient en quête d’emplois qu’ils ne trouvèrent pas facilement. Nombre d’entre eux se tournèrent donc vers la drogue pour adoucir les effets moraux de la misère. Une minorité s’adonne l’héroïne, mais en majeure partie, ils se tournèrent vers la marijuana, avec laquelle ils étaient déjà familiers. Les rastas d’origine caribéenne servaient de lien entre les producteurs des îles et les consommateurs de cannabis aux États-Unis, particulièrement à New York, à partir des années 70. Hamid explique que la communauté rasta de Brooklyn s’est enrichie grâce à ce commerce et a réussi à réinvestir ses bénéfices dans des propriétés immobilières et des commerces (restaurants, magasins d’alimentation, de confiserie, de disques, d’arts rasta etc…). C’est aussi à partir de ces mêmes commerces que continuait de s’opérer le commerce du cannabis (Hamid, 2002 : 125-126). Les bénéfices financiers furent également réinvestis dans la création de deux écoles primaires, d’un journal hebdomadaire, dans le développement de la carrière de groupes reggae et le financement d’études universitaires des adeptes. Conclusion Nous pouvons affirmer que les substances hallucinogènes ont fortement influencé l’évolution et l’idéologie des mouvements hip-hop et rastafari principalement pour des raisons économiques et psychologiques. Le trafic de ces substances fut une source de revenus rapide et considérable pour les membres des communautés dont sont issus les mouvements : le ghetto. Ces substances sont également devenues un moyen de surmonter les difficultés que rencontraient certains individus issus ou non du ghetto. Pour d’autres, c’était aussi un moyen de s’amuser. Si la ligne de séparation entre la consommation de marijuana de manière spirituelle et la consommation
149
hédoniste est très fine, nous pouvons affirmer, d’un point de vue idéologique, que ces pratiques n’ont pas le même sens dans le mouvement hip-hop et dans le mouvement rastafari. Cependant, elles ont débuté dans des conditions similaires et répondent à un même besoin, trouver un équilibre psychologique dans des conditions de vie néfastes. La propagation des drogues illicites va donc sans doute continuer avec ses graves conséquences sanitaires, culturelles et, dans de nombreux pays, politiques. Faute de pouvoir réduire radicalement le phénomène, il importe d’en connaître les réseaux et d’essayer d’en freiner la prolifération par la surveillance, la répression, mais surtout la prévention en direction de la population et particulièrement des jeunes.
150
CHAPITRE 2 TRANSFERTS MUSICAUX Dans le domaine musical, des échanges entre le mouvement rastafari et le mouvement hip-hop ont lieu depuis les années 90. C’est cet aspect du dialogue interculturel et de la fécondation croisée que nous étudierons dans ce chapitre.
3.2.1: Transferts interculturels entre le rap et le reggae Lorsque des groupes d’individus développent un mode de vie particulier, ils donnent naissance à des formes d’expressions qui reflètent leur réalité sociale et matérielle. Entre autres, la musique est une expression de la réalité vécue par la diaspora noire en Amérique anglophone, particulièrement aux États-Unis et dans les îles de la Caraïbe. Elle permet de transmettre des émotions. C’est un facteur de motivation, positif ou négatif. Elle fait réfléchir, calme les douleurs, permet de parler de ses luttes et de ses désillusions. Elle participe totalement à la construction identitaire. Bien que le rap et le reggae soient des musiques issues des communautés noires, nous ne voulons pas les conceptualiser comme étant uniquement des musiques noires, car le contexte des années 80 n’est plus le même. Compte tenu du développement des moyens de transmission (essentiellement les médias et les moyens de transports), ces deux musiques sont produites aujourd’hui par des hommes d’origines ethniques différentes avec autant d’authenticité. Toutefois, au-delà de l’aspect biologique, le schéma « call and response »108 est une caractéristique essentielle dans la structure de la musique noire. Nous ne tenons pas non plus à entourer ces expressions de frontières raciales. Selon Brian Longhurst, professeur de sociologie et auteur de Popular music and society, les musiques noires ont, au contraire, instauré des liens interraciaux (131-154). Certes, il nous faut admettre que ces musiques évoluent principalement en fonction du quotidien de la communauté noire. Si elle est en quête identitaire, la musique le sera aussi. Si elle se complaît à travers des valeurs matérielles ou spirituelles, la musique le reflétera. En clair, ce qu’elle valorise sera représenté dans les
108
C’est l’interaction entre celui qui chante et ceux qui participent à l’événement chanté. Le « call and response » se retrouve dans la majorité des musiques noires (les chants de travail des esclaves, le blues, le jazz, etc…).
151
œuvres musicales. Sa situation sociale, sa position dans la sphère politique, son langage seront aussi reproduits dans sa création musicale. Le contexte social de création, l’expérience des communautés noires a une implication capitale dans la création du rap et du reggae. Ces courants musicaux demeurent largement produits et consommés par la population noire. Au sein du mouvement hip-hop et du mouvement rastafari, la musique occupe une place principale ; c’est la partie visible de ces deux icebergs. Pourquoi ces deux courants musicaux sont-ils devenus un seul ensemble ? Comment leurs concepteurs ont-ils commencé à échanger des éléments ? Comment se manifestent ces transferts culturels au niveau des discours et de la musique ?
A/ Chronique d’une fusion musicale programmée Le rap et le reggae sont respectivement des courants musicaux dominants dans la culture populaire des États-Unis et de la région Caraïbe. Ces deux musiques ont toutes deux commencé en étant rejetées par la société dominante. Aujourd’hui elles sont des composantes prédominantes de la vie culturelle de leurs deux régions de naissance ainsi que du reste du monde. Lors de la préparation de notre travail de recherche en Master, nous avons fait un constat intéressant : un nombre croissant d’artistes reggae et dancehall incorporait des éléments de la musique rap dans sa création et vice-versa. Depuis le début des années 90, des artistes dancehall tels que Super Cat ont commencé à incorporer ces éléments rap dans leur musique109. Durant les années 90, plusieurs albums révèlent que la collaboration entre artistes des deux courants se matérialise, indiquant l’ascension du rapprochement « reggae-rap ». Citons, par exemple, Reggae Meets Hip-hop (Massive B records) en 1996, Massive B All Stars (Massive B Records), My X-perience de Bounty Killer dans lequel des artistes rap viennent collaborer avec lui sur plusieurs titres (Jeru Da Damaja, The Fugees, Raekwon, Mobb Deep, Cocoa brovaz, Noreaga et Killah Priest), Shabba Ranks, Prophecy de Capleton où on retrouve Method Man, un artiste rap. Le rappeur KRS-One a
109
Avec les titres Mud’up en 1986, Ghetto Red Hot en 1992 remanié par Bobby Khonders, un disc jockey issue de la culture hip-hop, et enfin une collaboration avec un rappeur nord-américain bien connu Heavy D sur le titre Them no worry we. Cf. The rough guide to reggae, Barrow et Dalton: 2001, 435.
152
été le premier innovateur à matérialiser la fusion entre reggae et rap110. Sur l’album Ghetto music: The Blueprint of Hip-hop en 1992, KRS-One introduit l’élément reggae dans le rap avec un morceau intitulé The style you haven’t done yet111. Dans des chansons telles que Black Cop, Da sound of the Police, il allie l’oralité jamaïcaine à l’oralité africaine-américaine. KrsOne « toaste » en créole jamaïcain sur des rythmes rap. Il est intéressant de noter que Chris Parker, de son vrai nom, est issu d’une famille dont la mère est jamaïcaine. À la direction d’une organisation112 en charge de véhiculer les principes et l’histoire de la culture hip-hop, il est considéré comme un pionnier, particulièrement du rap « social et politique ». Plus qu’un simple rappeur, son activisme fait de lui un authentique leader politique noir. Chris Parker a amplement contribué à l’implantation du reggae dans le mouvement hip-hop en travaillant notamment avec des artistes tels que Shabba Ranks, le duo de musiciens jamaïcains Sly and Robbie et Ziggy Marley, le fils de Bob. Ces échanges interculturels ont commencé à partir d’un désir commercial des artistes reggae/dancehall jamaïcains, un désir que nous pouvons certes comprendre, car le marché nord-américain représentait plus de 200 millions de consommateurs potentiels. Néanmoins, au-delà de l’aspect commercial, il semble que les similitudes entre les réalités sociales des classes ouvrières noires des États-Unis et de la Jamaïque ainsi que la proximité entre les deux espaces géographiques demeurent les raisons majeures de cette médiation musicale. Depuis leur création, ces deux expressions musicales ont permis à leurs créateurs de rassembler des « morceaux de vie déconstruites » et d’en faire un message selon l’expression du révérend Jesse Jackson : “(…) the youth pick up the bits and pieces of life as it is lived, and transform mess into a message (…)”113
Nous nous sommes souvent interrogé au cours de notre réflexion sur la réaction qu’aurait eue Bob Marley vis-à-vis du mouvement hip-hop et du rap en particulier, s’il était encore en vie. Aurait-il participé à ses formes
110
Consulter les albums : Ghetto Music (1989)-Da sound of the police: Une chanson sur laquelle KRS-One chante en patois jamaïcain sur une rythmique rap. Return of the Boom Bap (1993) Black Cop : Une autre chanson sur laquelle KRS-One toaste en patois jamaïcain également sur un rythme rap. 111 Traduction : « Le style que vous n’avez pas encore fait ». 112 The temple of hip-hop. 113 Jackson Robert Scoop, The last black mecca: hip-hop, Research Associates, 1994, p. 1. Traduction: « Les jeunes ramassent des bouts de vie en l’état et transforment le chaos en message (…) »
153
d’expression pour diffuser son message ? Aurait-il collaboré avec les artistes et producteurs hip-hop ? Une chose est certaine, son désir était de toucher les masses africainesaméricaines avec le message rastafari. Durant les années 60, en signe de solidarité avec les mouvements de protestation noirs en Amérique du Nord, en Afrique et dans la Caraïbe, Bob Marley coupa ses dreadlocks et adopta la coiffure afro (Davis, 1994 : 99) comme nous l’avons déjà dit. Le public de l’Amérique noire préférait la musique disco et le funk. Il avait toujours repoussé ses conceptions et n’avait pas totalement adopté sa musique mais en octobre 1979, à l’Apollo Theatre de Harlem, avec son groupe, il allait donner le coup d’envoi de leur tournée nord-américaine. L’Apollo Theatre est une scène mythique au sein de la communauté noire, notamment dans le mouvement hip-hop. Les plus grands chanteurs de la musique noire, tels que Billy Holiday, Duke Ellington, Bessie Smith, Sam Cooke ou encore James Brown y ont donné des concerts. De célèbres artistes rap, tels que Notorious BIG, ont été découverts dans les murs de cette salle lors de concours. Les premières représentations rap ont eu lieu à l’Apollo Theatre. Marcus Garvey y a tenu des discours dans le cadre de l’UNIA. En 1978, Marley avait été frappé par une citation du nationaliste africainaméricain W E B Dubois dans laquelle il déclare : « (…) si le jeune Noir-Américain veut survivre et avoir une vie décente, il faut qu’il se rende compte que, tout en étant américain, il a des intérêts qui le rapprochent plutôt des races sombres hors d’Amérique que de ses compatriotes blancs. » (Davis, 1994 : 304, 305)
Depuis cette lecture, Marley a toujours voulu établir une présence rasta aux États-Unis. Dans le spot publicitaire qu’il avait enregistré pour les radios africaines-américaines de New York, il se présentait en disant : « Salut, c’est Bob Marley et « Survival » sur WLIB, le meilleur des deux mondes » (Davis, 1994 : 305).
De quels mondes parlait-il ? Le monde des Africains-Américains et celui des Afro-Caribéens ? Certainement, Marley discernait le rassemblement de ces deux composantes de la diaspora noire vivant dans l’Amérique des plantations. Pour répondre à notre première interrogation, à savoir quelle orientation il aurait prise en face de l’apparition du rap, c’est son fils lui-même qui nous apporte des éléments de réponse. En novembre 1999, Stephen matérialise son rêve, celui de toucher la jeunesse des ghettos africains-américains, en produisant une compilation sur laquelle une dizaine des titres de son père sont réenregistrés en collaboration avec la voix de ces ghettos, des rappeurs
154
africains-américains. L’album, inspiré par les chansons et le combat de Marley, est intitulé Chant Down Babylon. Il aurait très bien pu s’intituler Rap Down Babylon. Cette expression rasta est l’équivalent de l’expression hip-hop « Fight the Power » popularisée par le groupe Public Enemy. Il permet aussi à un jeune auditoire issu du mouvement hip-hop, qui n’a pas connu Marley, de se familiariser avec sa musique et son message. Dans son titre intitulé Roots, rock, reggae, Marley chante : « Play I on the R&B wo-oh! Want all my people to see We bubbling on the top 100, just like a mighty dread»114
Il n’est pas difficile de comprendre qu’il voulait être diffusé sur les ondes africaines-américaines afin de s’immiscer dans le quotidien de ces communautés et d’y apporter sa vision. Cette compilation était une façon pour les fils de Marley, qui ont d’ailleurs grandi entre l’Amérique du Nord et la Jamaïque, de démontrer la proximité des valeurs de la culture hip-hop et de la culture rastafari. Ce faisant, les adeptes des deux mouvements pouvaient aussi bien l’exprimer sur le même support. Dans la préface du livre de Bruno Blum, Le reggae, Sly Dunbar (musicien et producteur du célèbre duo jamaïcain « Sly and Robbie ») déclare : « Bob écrivait des chansons comme Is this love ou No woman, no cry ; c’étaient des chansons pour tout le monde. Il ne faut pas essayer de retourner en arrière. Tout ce dont j’ai besoin, c’est d’une chanson. Tout le monde comprend ce que « One love » veut dire. Peu importe si c’est sur un rythme hip-hop, funk ou folk ».
Cette préface, intitulée « Retrouver le message », souligne bien l’accent mis sur le message et moins sur le support. Quant à Robbie Shakespear, dans sa préface du même ouvrage intitulée «La musique du ghetto », il affirme : « C’est pourquoi toutes les chansons de Bob (Marley), Peter (Tosh), Burning Spear, Bunny (Wailer) étaient comme ça. Les gens chantaient ce qu’ils vivaient. C’est ce que font les rappeurs américains aujourd’hui probablement. Tu ne peux pas parler de la vie d’un autre il faut que tu parles de la façon dont toi tu vis. C’est ça le reggae ! »
114
« Puis-je passer à la radio R’n’B? Je veux que tous les gens voient que nous culminons au top 100 juste comme un puissant rasta ».
155
Et c’est ça le rap : dire ce que l’on vit sans complaisance! Ironie du sort, lors de son concert au Madison Square Garden de New York en 1979, Marley partageait la scène avec le rappeur Kurtis Blow115, l’un des premiers rappeurs à être médiatisés au niveau national. Cette rencontre allait annoncer la rencontre des deux communautés et des deux genres musicaux. D’autre part, en considérant leurs acteurs et leurs objectifs, on peut conclure que, tôt ou tard, ces deux expressions musicales se seraient entrecroisées pour n’en devenir qu’une seule. Néanmoins, il est indispensable de comparer leurs contextes de création et de considérer les faits musicaux dont elles se sont inspirées. a-Rôle de la soul et du blues dans la naissance du reggae La naissance du reggae est antérieure à celle du rap. Selon Denis Constant, aux sources du reggae se trouve le groupe Toots and the Maytals, en 1968, avec la chanson Do the reggae (Constant, 31). Le mot apparaît avec ce morceau, et l’acte de naissance du courant musical est signé par ce groupe. Le reggae est l’aboutissement d’un processus complexe mélangeant héritages jamaïcains et influences étrangères. Il s’est construit entre les États-Unis et les Antilles. L’influence principale qui conditionne cette musique à ses débuts et qui lui permet de se démarquer est celle de la soul music africaine-américaine. Lorsque les Jamaïcains partis pour travailler en Floride lors de la récolte sucrière revenaient sur l’île, ils ramenaient avec eux des disques de rhythm and blues. La radio, quant à elle, diffusait à certains moments de la country music (Nigel, 2004 : 637). Les jeunes chanteurs jamaïcains tels que Bob Marley, Peter Tosh, Bob Andy et d’autres ont commencé leurs carrières en imitant les chansons d’artistes soul africainsaméricains. L’échange complexe entre culture locale et culture étrangère allait s’affirmer lorsque ces artistes commençaient à ajouter leur cadence musicale aux rythmes soul. Petit à petit, un nouveau style musical accompagné d’une nouvelle danse est apparu : le ska, l’ancêtre du reggae et le prédécesseur du rock steady. Étant donné que la plupart des Jamaïcains ne pouvaient pas s’acheter de disques, la pratique du sound system s’est popularisée. Elle consistait à monter une discothèque ambulante en plein air avec des haut-parleurs imposants qui diffusaient de la musique gratuitement. Les rivalités entre propriétaires de sound systems dégénéraient parfois en bagarre. Petit à petit, les disc jockeys ont commencé à parler par-dessus les chansons qu’ils
115
Allen Harry, Livret Chant Down Babylon, 1999.
156
diffusaient dans les sound systems. Leurs commentaires se faisaient de manière rythmique et n’avaient pas forcément de sens précis. En réalité, leur voix était utilisée comme un instrument musical additionnel. Cette pratique appelée le toasting allait devenir une caractéristique fondamentale du reggae. Le disc jockey était amené à manier ses platines pour arrêter ou commencer les morceaux, d’où parfois les bruits étranges qui sortaient des haut-parleurs. Lorsque les paroles de chansons d’amour africaines-américaines ne leur plaisaient pas, les disc jockeys n’hésitaient pas à faire des commentaires politiques sur la vie locale. Le reggae, comme le rap, se faisait l’écho du mécontentement populaire. Cette pratique, qui consiste à « parler » ou « rapper » par-dessus la musique, est expérimentée en premier lieu par Lee « Scratch » Perry pour stimuler les danseurs. D’autres toasters apparaissent tels que I-Roy (Roy Reider), U-Roy (Ewart Beckford) et acquièrent une notoriété considérable sur l’île (Leymarie, 1996 : 278). Ils improvisent en rythme également sur une version instrumentale, une partie musicale dont a été enlevée la partie vocale. Également appelée Dub ou Dubbing, cette pratique utilise différentes techniques sonores tels que : le scratch, les collages, l’accélération ou le ralentissement du tempo. C’est à partir du Dub qu’apparaît le concept de la « version » qui consiste à avoir simplement la version musicale permettant d’y placer des paroles à sa guise. De la même manière que les chants religieux contribuèrent à la formation de la soul music, ils concoururent, dans un second lieu, à l’élaboration du reggae (Constant, 1982 : 31). Jimmy Cliff, « chanteur-architecte » de l’internationalisation du reggae, confie lors d’un entretien : « Le rythme du reggae vient de la soul music, mais c’est du reggae » (Constant, 1982 : 31). La soul music influence le reggae musicalement mais aussi sur un plan idéologique. L’idéologie soul proclame, par la voix de James Brown, « I’m black, I’m proud »116, ou encore « Black is beautiful »117. Le reggae se situe dans le prolongement de la musique noire, le « blues continuum ». Il s’est formé à partir d’éléments africains-américains articulés en fonction de l’héritage musical et du contexte socio-historique jamaïcain. Cette dynamique entre les États-Unis et la Caraïbe a été vitale dans la formation du reggae (Constant, 1982 : 40). Alors que la musique africaine-américaine avait inspiré la création du reggae parmi les masses prolétaires de la Jamaïque, à son tour, le reggae allait stimuler l’apparition de la culture hiphop au sein des masses ouvrières de la ville de New York. La dette jamaïcaine, de ce fait caribéenne, allait alors être acquittée.
116 117
Traduction : « Je suis noir et fier de l’être » Traduction : « Le noir c’est beau! »
157
b-Rôle du reggae dans la naissance du hip-hop et du rap Le reggae a été un élément fondateur dans le développement du rap et de la culture hip-hop aux États-Unis. Le reggae et la culture jamaïcaine en général ont été le terreau culturel du mouvement hip-hop. La pratique du dub et du toast sont les précurseurs de l’emceeing ou rap et du deejaying. Le sound system, pratique culturelle jamaïcaine, allait devenir le centre de la vie nocturne à New York. En 1967, Clive Campbell, âgé de 12 ans, quitte sa Jamaïque natale pour s’installer avec ses parents à New York, dans le Bronx. Deux ans plus tard, il commence à animer des fêtes dans ce quartier. Ses animations se font en plein air. Il utilise la technique des sound systems jamaïcains, en jouant avec d’énormes enceintes. En 1975, Clive Campbell, surnommé « DJ Kool Herc », à cause de son physique imposant, est connu par la majorité des habitants du Bronx. Il affirme, dans un entretien, avoir été influencé en Jamaïque par un dénommé George, qui lui aussi avait pour habitude de sortir son sound system directement dans la rue118. Il confie également avoir réadapté des pratiques de la Jamaïque en les modulant à « sa manière » : “I did a lot of things from Jamaica, and I brought it here and turned it into my own little style”119
À la question Qu’est-ce que le hip-hop?, DJ Kool Herc répondra : « Le hip-hop…l’ensemble provient de la Jamaïque. Je suis né en Jamaïque et j’y écoutais de la musique américaine. Mon artiste préféré c’était James Brown. C’est lui qui m’a inspiré. Je mettais beaucoup de ses disques. Quand je suis arrivé ici (aux ÉtatsUnis), je me suis simplement adapté au style américain, je jouais de façon à ce que les gens puissent danser. »120
118
www.rastaexperience.com/demusic.htm Idem. Traduction : « J’ai fait beaucoup de choses originaires de la Jamaïque, je les ai ramenées ici et je les ai faites à ma sauce » 120 www.daveyd.com/koolherc.html. «hip-hop… the whole chemistry of that came from Jamaica... I was born in Jamaica and I was listening to American music in Jamaica.. My favorite artist was James Brown. That's who inspired me.. A lot of the records I played was by James Brown. When I came over here I just put it in the American style and a perspetcive for them to dance to it » 119
158
Ce commentaire est particulièrement éclairant, pour plusieurs raisons, la première étant que Kool Herc réaffirme l’influence de la musique africaineaméricaine en Jamaïque. Deuxièmement, il nous confirme qu’une partie des racines de la culture hip-hop se trouve en Jamaïque, l’autre partie étant sur le continent africain. Enfin, il nous révèle la relocalisation de la pratique du sound system et les changements amenés par ce nouvel environnement. Kool Herc ne pouvait pas non plus diffuser du reggae durant ses soirées car les New Yorkais n’appréciaient pas ce style de musique. Il est devenu le premier DJ de l’histoire du mouvement hip-hop. Il est également devenu le premier MC, dans le premier sens du terme, c’est-à-dire animateur, du mouvement hip-hop. Il symbolise parfaitement le trait d’union entre la Jamaïque et les États-Unis et entre la culture reggae et le rap. Sur le plan technologique, le reggae a été particulièrement instrumental dans l’élaboration de la musique rap et de la technique du DJ hip-hop. Grâce à la pratique jamaïcaine du dub, l’utilisation de la version instrumentale d’une chanson, est née, ce que les adeptes de la culture hip-hop ont baptisé les breaks. Aux breaks succéderont les boîtes à rythmes qui permettront de créer les versions instrumentales pour les rappeurs. Dans l’art du dubbing, des sons et des rythmiques d’une chanson pouvaient très bien se retrouver sur la version instrumentale d’une autre chanson, créant une nouvelle bande. Le dubbing était aussi un montage de sons, un kaléidoscope sonore. Le producteur jamaïcain Lee Perry, surnommé Scratch, a l’idée d’injecter des effets sonores dans les versions musicales. C’est de cette pratique que lui vient son surnom Scratch qui signifie « gratter ». Il utilisait des sons de sirènes de police, des coups de feu, des pleurs d’enfants, des bruits de verres qui se brisent, des sons qui appartiennent au quotidien des personnes vivant dans les quartiers défavorisés de la Jamaïque et des États-Unis. On retrouve cette technique de l’échantillonnage d’effets sonores dans le rap quelques décennies plus tard, par exemple, avec le morceau du groupe N.W.A Straight outta Compton où les effets sonores retransmettent la réalité urbaine de Los Angeles121. La pratique du dubbing s’est transformée aux États-Unis pour devenir les breaks et le scratch. Kool DJ Herc a été un acteur fondamental dans l’implantation de la culture hip-hop aux États-Unis. Il a inventé les breaks devenus le breakbeat. C’est une pratique qui consiste à jouer le même disque sur deux platines, de façon à reproduire à sa guise la partie
121
Board Jamie Ann, Reggae’s impact on hip-hop, www.thedreadlibrary.com
159
instrumentale du disque en passant d’une platine à l’autre. Pour ce faire, Kool Herc reprenait la partie de son choix et la repassait autant de fois qu’il voulait, en utilisant tour à tour ses deux platines, afin de créer la version instrumentale sur laquelle les danseurs et les rappeurs allaient s’exprimer. Le breakbeat est l’ancêtre de la version instrumentale du rap il existe encore aujourd’hui avec les rythmiques des années 80, mais cette forme est plus régulièrement utilisée par les danseurs hip-hop, son rythme « très saccadé » facilitant leurs pas de danse. Cette pratique du deejaying s’est répandue rapidement à New York, puis dans le reste du pays, car le matériel nécessaire (deux platines de disques vinyles, des haut-parleurs et un micro) était accessible et peu coûteux pour les jeunes issus des quartiers pauvres. Joseph Saddler alias Grandmaster Flash est un autre DJ important dans l’évolution du hip-hop. Son père était d’origine barbadienne. Les DJ cherchaient à utiliser leurs platines comme des instruments à part entière. Il avait une manière unique d’utiliser les « bouts de phrase », connus sous le nom de punch phrasing, dans ses démonstrations122. Grandmaster Flash est aussi l’auteur de la première chanson à caractère social traitant du style de vie de la communauté africaine-américaine et intitulée The Message. Selon David Cook alias Davey D., journaliste et historien de la culture hiphop, la pratique du toast en Jamaïque123 a contribué à la naissance du rap. Les premiers DJs, dont Kool Herc, et les premiers MCs avaient pour habitude de saluer la présence de leurs connaissances lors des fêtes de quartier. Le toast, qui consistait à avoir un Maître de Cérémonie qui animait le sound system avec des commentaires, est annonciateur du rôle du MC dans la culture hip-hop. Une précision s’impose. En Jamaïque, celui qui anime avec les platines se nomme le Selector, aux États-Unis on le nomme le DJ. En Jamaïque, celui qui anime avec ses commentaires et ses chants se nomme le Deejay, aux États-Unis c’est le MC ou le rappeur. À cause de la rivalité entre les groupes, les rassemblements lors des block parties et des sound systems engendraient parfois des rixes. En Jamaïque, le phénomène des rude boys est devenu une sous-culture des sound systems. Les propriétaires des sounds recrutaient des gangsters chargés d’interrompre les groupes adverses (Foehr, 2000 : 93). Au sein de la culture hip-hop, la compétition entre les danseurs, les MCs, les graffeurs et les DJs pouvait engendrer des confrontations physiques. Les combats de rue, la
122
Carlis Scott, Hip-hop and reggae: The common links of Politics and music, 25 avril 2002, www.dreadlibrary.com 123 www.daveyd.com. Hip-hop’s history, le 13 avril 2000.
160
consommation de substances illicites, le machisme étaient monnaie courante, un style de vie qui conduisait inévitablement à des confrontations avec la police. Avec l’utilisation des platines vinyles et des haut-parleurs en plein air, la participation d’un animateur, les versions instrumentales et les effets sonores, le reggae a fourni le cadre du développement technique du rap. Le principe du sound system a été un élément central dans l’animation des block parties ou fêtes de quartiers à l’origine du mouvement hip-hop aux États-Unis. À son tour, cette animation musicale a été le vecteur de la danse, du rap et du deejaying au sein de la culture hip-hop.
B/ Fonctions socioculturelles Quand nous considérons le contexte social qui donna naissance au rap, nous constatons les similitudes avec celui qui donna naissance au reggae. Le reggae allait devenir le porte-parole du mouvement rastafari durant les années 70. Le rap est devenu la voix des sans-voix aux États-Unis. Ces deux musiques sont nées au sein de communautés démunies, où le chômage était prédominant et les conditions de logement misérables. Elles étaient coupées du reste de la société et vivaient dans une atmosphère d’insécurité et d’anxiété. Ces conditions de création culturelle similaires sont toujours des facteurs de leur interculturalité à l’entrée du 21ème siècle. Au sein de ces communautés et de ces quartiers, la musique est devenue un moyen de vocaliser les injustices économiques et sociales, les frustrations vécues au quotidien, voire de les oublier124. La musique a permis aux communautés noires aux États-Unis et en Jamaïque d’introduire des thèmes de leur vie quotidienne et de défendre des causes communes (Jackson, 1994 : 2, 64, 65). Cette fonction a été remplie par d’autres musiques africaines-américaines ou jamaïcaines, telles que le mento, le ska, le rock steady, le dancehall, le blues, la soul, le funk et le jazz. Le rap et le reggae sont littéralement des loupes placées au centre de la vie des communautés noires aux États-Unis et en Jamaïque. Certes, ils ne leur appartiennent plus exclusivement néanmoins, ils en demeurent les créateurs phares. Ce sont également les messages des individus vivant en marge de la société en raison de la complexité de leur existence. Tous ne trouvent pas de
124
Pour plus de détails sur cet aspect, se référer au travail de thèse de Stéphane Partel, Les fonctions socioculturelles et politiques du rap aux Etats-Unis de 1980 à nos jours.
161
solutions, tous ne veulent pas en sortir et tous ne partagent pas un angle de vue comparable. Le rap et le reggae ne sont pas seulement des musiques de protestation, ce sont également des musiques qui permettent de se détendre, de s’amuser, qui expriment des comportements divers. Certains artistes prônent l’utilisation de la drogue, d’autres la condamnen ;, certains autres prônent la promiscuité et la violence comme seul moyen de résoudre les conflits, d’autres le contraire. Le rap et le reggae permettent de partager ses croyances, sa position politique, de faire de la publicité, de parler de soi, des siens et de ses aspirations. Les thèmes sont divers, tels que : des histoires d’amour, le harcèlement policier, l’oppression socio-économique, le chômage, la violence au sein du quartier, les filles-mères, l’amusement, la consommation de drogues, la politique, la foi etc…Néanmoins le rap dans sa thématique a été plus ouvert que le reggae qui a été surtout le cri du mouvement religieux inspiré par la condition des masses pauvres noires de la Jamaïque, un cri contre le néo-colonialisme, un cri en faveur de l’autodétermination et de la fierté noire. Le reggae et le rap ont répondu à plusieurs besoins similaires au sein des communautés africaine-américaine et afro-jamaïcaine. Le premier besoin a été celui d’être entendu. Les communautés où ils sont nés communiquent principalement de manière orale. L’information, l’histoire et les valeurs se transmettent oralement. La deuxième nécessité a été le besoin de transmettre des valeurs, autrement dit ce qui a du sens, de l’importance pour ces communautés. Les valeurs participent à la formation de l’identité des générations à venir. L’histoire du quartier, l’histoire des leaders de ces communautés, les protestations, les déviances et les codes n’ont été transmis par le rap et le reggae. Le dernier besoin est celui d’être socialement interactif, le besoin d’être en relation avec des personnes qui partagent les mêmes motivations, les mêmes causes, les mêmes principes. Le mot reggae a été inventé par Toots Hibbert en 1968 mais plusieurs thèses ont été avancées. Il tirerait son origine du surnom donné aux prostituées en Jamaïque streggae ou encore du nom d’une tribu Bantu en Afrique, les « Rega ». La thèse la plus vraisemblable reste celle de Toots Hibbert qui enregistra un morceau intitulé Do the Reggae à la suite duquel il nomme le courant musical reggae. Selon lui, ce nom s’est imposé à cause du rythme saccadé de la musique. Le message de cette musique concernait directement les gens originaires du ghetto qui ne pouvaient pas avoir ce dont ils avaient besoin (Foehr, 2000 : 105). Selon Kwame Dawes, auteur de Natural mysticism, towards a new reggae aesthetic in caribbean writing, le message du reggae est clair : rendre les auditeurs conscients de la situation des masses noires mais aussi de l’existence d’un être spirituel plus grand que les hommes. Le reggae, comme le rap, aide à créer un nouveau sens de
162
l’identité. Il s’agit de s’affirmer avec ses propres attributs, de se battre pour le droit de se forger une nouvelle identité et d’exprimer celle-ci. Le reggae a imposé la référence à l’Afrique dans la quête identitaire jamaïcaine à l’intérieur d’un contexte colonial hostile. Il a défait les fondations de la culture dominante valorisant la race blanche et la référence européenne. En ce sens, le reggae a été un instrument révolutionnaire. Ce message de libération socioculturelle a joué un rôle important dans le processus de décolonisation des années 70, à tel point que Bob Marley a été invité à chanter, en avril 1978, pour clôturer les cérémonies de la célébration de l’indépendance du Zimbabwe, l’ancienne colonie britannique (Davis, 1994 : 315). Le gouvernement de l’ancienne Rhodésie l’a convié à cet événement majeur à cause d’une chanson Zimbabwe, enregistrée auparavant et qui s’est répandue en Afrique, dans laquelle Marley prônait la libération du pays. Dès 1984, des artistes comme Sister Carol produisent des titres tels que Liberation for Africa. À cause de ses propos et de ce qu’exprimait sa musique, Marley a été considéré comme un porte-parole de valeurs. Les paroles de sa chanson ont été un soutien moral pour les soldats de l’armée du Zimbabwe, la ZANLA (Zimbabwe African National Liberation Army) en lutte contre le pouvoir ségrégationniste. La musique de Marley et le reggae à plus grande échelle ont joué un rôle motivant dans la libération des pays africains. Ironiquement, vingt ans après ces événements, le président Robert Mugabe, figure émancipatrice, s’est transformé en dictateur. Le rap, tout comme la lutte pour les droits civiques, a confronté l’Amérique à une réalité violente et injuste qu’elle s’efforçait de cacher au fond des quartiers noirs. Le message des rappeurs, des danseurs, des graffeurs et des DJs de la culture hip-hop, au même titre que celui des rastas à travers le reggae, était le suivant : Je suis ce que je suis et je n’en ai pas honte ! Vous devez m’écouter et m’accepter tel quel ! Les deux formes musicales sont devenues, dans les années 70 et 80, le fonds commun des mutations sociales en Jamaïque et aux États-Unis. Le rap n’a pas entretenu un message exclusivement social ; il est devenu le reflet de la société étasunienne avec ses traits violents, matérialistes et misogynes, tandis que le reggae a toujours gardé une ligne directrice plus centrée sur les revendications sociopolitiques, l’amour et la spiritualité rastafari. Cette tendance s’explique par l’appropriation du reggae par le mouvement rasta durant les années 70. Reggae et rastafari, bien qu’étroitement liés, ne sont pas superposables. Le mouvement rasta a assuré au reggae une assise idéologique et constante que le rap ne possède pas. L’artiste rasta a pour objectif d’éduquer et de transmettre des valeurs niées par les pouvoirs institutionnels. La musique s’est internationalisée parce qu’elle a été investie par les intérêts du mouvement rasta : la fierté noire qui passe par une
163
spiritualité adaptée et nécessite des changements sociaux. Ces intérêts sont devenus ceux de la diaspora noire en Europe, aux États-Unis, ceux du peuple noir en Afrique et ceux des peuples en pleine revendication identitaire (en Polynésie par exemple). Par un langage codé, un vocabulaire distinct, le rap et le reggae ont servi de support musical reflétant les préoccupations et la vie de la diaspora noire aux États-Unis et dans la région Caraïbe, en Jamaïque en premier lieu. Ce sont des musiques qui tirent leur essence de la rue, de la classe ouvrière pauvre, de ceux qui souffrent des conséquences sociales du libéralisme et des conditions d’existence au sein de la société où ils vivent.
C/ Comparaison entre les thématiques des textes dans le reggae et dans le rap « (...) Des mots pouvaient tout changer comme une fenêtre dans une pièce close (...) » (De Certeau, 1993 : 31).
Selon Maureen Sherridan, auteur de Bob Marley : l’intégrale, lorsque Stevie Wonder composa la chanson Masterblaster Jammin’ en hommage à Bob Marley, c’était non seulement une reconnaissance du caractère unique de sa musique, mais aussi une allusion prophétique au fait que, un jour, les Noirs de la Jamaïque, voire de la Caraïbe et des États-Unis, pourraient être réunis par la force de la musique (73). Après la mort de Bob Marley, avec qui il s’était lié d’amitié, Stevie Wonder lui rendra de longs hommages dans la plupart de ses concerts (Lavige, Bernadi, 2003 : 129130). Pour les besoins de notre démonstration, nous avons choisi de nous concentrer sur le reggae en tant que musique véhiculant le message rastafari. Comme nous l’avons précisé, certaines branches (par exemple : les Bobo Dreads) ne considèrent pas le reggae comme la musique proprement dite du mouvement. En considérant le lien évident entre reggae et rastafarisme, nous nous sommes appuyé en majeure partie sur les compositions d’artistes affiliés au mouvement. Nous l’avons vu, le rap et le reggae sont des langages propres à la culture de la rue, des ghettos aux États-Unis, en Jamaïque et à une échelle plus vaste, dans toute la région Caraïbe. Ils procèdent tous deux des « réactions face à la décomposition sociale environnante » (Stebe, 1999 : 105) (enclavement géographique, destruction de la cellule familiale, violences urbaines, économie souterraine, chômage, politique ségrégative). Au sein des cultures
164
hip-hop et rastafari, ils ont servi de « moyen d’adaptation aux conditions de vie précaires et hostiles » (Idem) de leurs créateurs. À l’occasion de la sortie de la compilation Chant Down Babylon, lorsque l’on demandera au fils de Bob Marley, Stephen, de parler des motivations qui l’ont attiré vers le mouvement hip-hop, sa réponse sera claire : « Nous avons la même vibration qu’eux (les stars du hip-hop) parce que la musique vient de la rue (…) C’est l’élément qui a m’attiré. »125
C’est un espace de création commun qui légitime le rapprochement de deux mouvements de conscience et des deux musiques véhiculant leur message. L’expérience du peuple noir est mise au centre les images utilisées transforment une expérience singulière en une expérience universelle. Les peuples opprimés dans les autres parties du monde peuvent alors s’identifier à leurs revendications. Elles répondent au besoin d’être vu, reconnu et entendu. Elles étanchent également une soif de dignité. Le rappeur et le chanteur reggae sont des conteurs, des « journalistes » du ghetto, qui, à l’instar des griots africains, détiennent l’histoire de leurs communautés et l’actualité de leurs quartiers dans leur mémoire. Dans leurs textes, ils verbalisent les préoccupations de leurs semblables. Ils diffusent cette actualité et la rendent accessible pour ceux qui n’ont pas physiquement accès à leurs cadres de vie. Étant donné qu’ils sont conscients des préoccupations de leur communauté, ils peuvent aussi l’avertir, la conseiller. Ils ont une fonction éducative certaine à l’instar de la chanteuse hip-hop Lauryn Hill qui, dans sa chanson Dat thing126, exhorte les jeunes filles à se méfier des jeunes gens qui ne sont intéressés que par des relations sexuelles avec elles. L’art de la parole et la notion du verbe sont des concepts fondamentaux au sein de la culture hip-hop et du mouvement rastafari. Ces notions participent pleinement à la reconstruction de l’identité des participants. En réalité, les rastas sont des « rappeurs » selon Stephen King, une autorité dans la recherche sur le reggae et l’auteur de l’ouvrage Reggae bloodlines (52). Comme les rappeurs durant des joutes verbales, les rastas sont prompts à
125
Inter Press Service (IPS), Kingston, le 28 juillet 2000. « We have some vibes like them (hip-hop stars) because the music coming from the streets (…) That’s the element that attracted I-n-I to it ». 126 Album : The miseducation of Lauryn Hill, Ruffhouse: 1998.
165
réagir verbalement, en délivrant un sermon à la moindre provocation. Au sein du reggae et du rap, tout ce dont on a besoin pour comprendre le monde qui est dépeint de manière symbolique, c’est d’une clé qui ne s’obtient qu’en s’immergeant dans les cultures dont ces musiques découlent. Nous avons tenté de mettre en évidence des thèmes majeurs communs au rap et au reggae tels que : la réhabilitation raciale et l’histoire des Noirs, l’oppression de « Babylone », l’Afrique, la femme noire, la critique sociale et, les commentaires politiques, la libération mentale et psychologique et enfin, la religion. Les textes de rap et de reggae se rejoignent régulièrement dans leur argumentation. Néanmoins, ils n’expriment pas systématiquement les mêmes opinions. Sur le plan religieux, les artistes reggae pratiquant la religion rastafari vont fréquemment parler de leurs croyances et du style de vie que cela implique (régime alimentaire, reconnaissance envers Haïlé Selassié, etc...). Les artistes hip-hop, eux, vont, la plupart du temps, discourir sur la réalité sociale qui les entoure, sur leurs aspirations, leurs communautés, sans obligatoirement avoir un point de vue spirituel autant de différences que nous nous efforcerons de mettre en exergue dans notre analyse. Pour débuter, nous étudierons les points communs développés dans la thématique du rap et du reggae selon les grands thèmes que nous avons mis en évidence. Ensuite, nous discuterons de l’interculturalité entre le rap et le reggae. Comment se manifeste-t-elle? D’un point de vue idéologique, nous présenterons, à travers deux groupes phares, des manifestations précises de cette médiation entre la culture hip-hop et le mouvement rastafari. 1/ La réhabilitation raciale et l’histoire des Noirs Le rap et le reggae sont des langages de survie. À travers ces formes musicales, certains artistes ont su retranscrire l’énergie de ceux qui composent le bas de la société. Ils ont su retranscrire leur volonté de réécrire l’histoire pour se redéfinir et se repositionner dans l’Amérique anglophone. Cette négritude indocile s’est clamée le poing levé. Au sein de sociétés dans lesquelles ils ont été reniés, évités et aliénés, l’un des premiers thèmes qui se dégage des textes, c’est la réhabilitation raciale. Que l’histoire du peuple noir soit connue et enseignée a été une revendication claire. Dans l’un des titres, le rappeur/MC Krs-One pose la question Why is that ? (Pourquoi les choses sont comme ça ?). Il s’étonne que l’histoire du peuple noir ne soit pas enseignée aux enfants noirs à l’école :
166
«Nous ne sommes pas là pour le côté glamour ou la mode/Mais je me pose une question/Pourquoi est-ce qu’on n’enseigne aux enfants Noirs que des bouts d’histoire ?/On leur apprend seulement à lire, écrire et agir/C’est comme apprendre à un chien comment être un chat/On n’enseigne pas aux enfants Blancs à être Noir. Pourquoi est-ce que les choses sont comme cela ?/Est-ce parce que nous sommes la minorité ?/Les enfants, suivezmoi…/Le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 10/ explique la généalogie de Sem /Sem était un homme noir en Afrique, si tu répètes ça, on ne peut pas se moquer de toi !Genèse 14, verset 13, Abraham entre en scène/En tant que descendant de Sem, ce qui est prouvé, Abraham aussi était noir (…) Corrigeons ce qui est faux, l’information que nous recevons de nos jours est nulle mais pose-toi la question : Pourquoi est-ce que les choses sont comme cela ? »127
KRS-One s’érige en professeur d’histoire pour ces enfants qui n’ont pas accès à la « vraie information ». C’est d’ailleurs le patronyme qu’il s’octroie, celui qui enseigne « The teacha ». Il remet en question les origines « blanches » de personnages bibliques clés tels que Moïse, Abraham ou encore Sem, qui n’est autre que le fils d’Adam. Il donne sa conception de la Bible en s’inspirant des travaux d’un de ses professeurs, le Dr Yoseph Ben Jochanon, historien et égyptologue noir. L’idée que certains personnages bibliques tels que Noé, Abraham et Moïse soient noirs n’est pas nouvelle en soi. En général, le seul personnage biblique identifié comme noir était Caïn, jaloux de son frère Abel au point de le tuer. Selon la Genèse, Caïn a été maudit par Dieu et condamné à une vie d’errance, un sort que la société blanche se plaisait à utiliser pour justifier la situation des Noirs. KRS-One termine son couplet en sollicitant la rectification de l’information erronée et pousse intelligemment son auditeur à s’interroger sur cet état de fait : Pourquoi est-ce que les choses sont comme cela ? Dans une autre chanson intitulée You must learn (Tu dois apprendre), KRSOne s’insurge toujours contre le manque d’enseignement relatif au peuple
127
Ghetto music: The blueprint of hip-hop, Boogie Down Production, 1989, Jive records. L’album se vendra à plus de 500 000 copies. «We’re not here for glamour or fashion/ Here’s the question I’m asking/Why is the young black kids taught ash?/They’re only taught how to read, write and act/It’s like teaching a dog to be a cat/You don’t teach white kids to be black/Why is that? /Is it because we’re the minority? /Well black kids follow me…/Genesis chapter 11 verse 10 explains the genealogy of Shem/Shem was a black man in Africa, if you repeat this fact, they can’t laugh at ya! Genesis 14 verse 13, Abraham steps on the scene/Being a descendant of Shem which is a fact means Abraham too was black (…) Correct the wrong, information that we get today is just wack but ask yourself: why is that?»
167
noir dans les écoles américaines, cette fois-ci en évoquant ses conséquences. Il y notifie aussi les origines de l’eurocentrisme : « (…) il me semble que dans une école d’ébène, L’histoire africaine devrait être soigneusement enseignée mais ce n’est pas le cas et cela doit cesser »128
Ensuite, KRS-One explique les conséquences de ce manque d’enseignement sur la cohésion sociale. Il parle également des grands inventeurs et des grands personnages noirs afin d’insuffler l’estime de soi à la jeunesse noire : « Je crois que si vous enseignez l’histoire/Vous devez enseigner des faits et non des mythes/Enseignez aux elèves ce qu’ils ont besoin d’apprendre/Parce que les enfants noirs et les enfants blancs ne cherchent pas à savoir/Lorsque l’un ne connaît pas la culture des autres/L’ignorance s’abat comme un vautour/Parce que tu ne sais pas que tu n’es pas seulement un concierge/Personne ne t’a parlé de Benjamin Banneker/Un brillant homme noir qui a inventé l’almanach/Tu ne vois toujours pas où Krs veut en venir/Avec Elie Whitney , Haïlé Selassié/Grandville Woods a conçu le talkie-walkie (…)/Charles Drew a beaucoup fait pour la médecine/Garett Morgan a inventé les feux de circulation/Harriet Tubman libérait les esclaves pendant la nuit/Mme CJ Walker a inventé le peigne à défriser/Mais tu ne peux pas savoir cela si on ne te l’enseigne pas/Ce que je veux dire est peut-être dur/Mais nous vivons avec le cerveau lavé »129
128
Album : Ghetto Music : The blueprint of hip-hop. « (…) It seems to me that in a school that’s ebony/ African history should be pumped up steadily but it’s not and this has got to stop (…)” 129 « (…) I believe that if you’re teaching history/Deal with straigth up facts no mystery/Teach the students what needs to be taught/Cause Black and White kids both take shorts/When one does not know about the other ones’ culture/Ignorance swoops in like a vulture/Cause you don’t know that you ain’t just a janitor/No one told you about Benjamin Banneker/A brillant black man that invented the almanac/Can’t you see where KRS is coming at/With Elie Whitney, Haile Selassie/Granville Woods made the walkie talkie (…) Charles Drew did a lot for medicine/Garett Morgan made the trafic lights/Harriet Tubman freed the slaves at night/Madame CJ Walker made a straightening comb/But you won’t know this if you weren’t shown/The point I’m getting at might be harsh/Is we just walking around brainwashed (…)»
168
Ne pas connaître son histoire représente un danger, selon KRS-One, un risque de ne pas s’accepter donc de ne pas se valoriser. Ce qui manque à la jeunesse africaine-américaine, c’est l’estime de soi ainsi que des perspectives. Le 9 septembre 1989, dans l’éditorial du New York Times, il déclare : « (…) Sachez cela : si vous arrachez son identité à un gamin, il ne lui reste plus rien. Ce vide se remplit de son environnement. Si cet environnement est froid, négatif et violent, il devient froid, négatif et violent »130.
D’autre part, ne pas connaître l’histoire de l’autre conduit à l’intolérance et fragilise la cohésion sociale. Comme un vautour, l’ignorance annonce la mort. Notons qu’il fait référence à Haïlé Selassié, le personnage central du mouvement rastafari, en tant que personnalité noire importante. Certes, cette citation n’a pas de signification religieuse pour KRS-One, mais elle montre l’intérêt de la réhabilitation raciale, terrain fertile pour le rastafarisme, dans le message de la culture hip-hop. Le reggae s’engage dans une quête analogue. Jimmy Cliff exprime clairement dans sa chanson My ancestors que l’homme noir, pour affronter la vie et préparer ses lendemains, doit puiser sa motivation dans sa propre histoire : «Mes ancêtres étaient rois des temps anciens/Ils régnaient sur le monde et tous ses peuples/Mais regardez-moi, oh regardez-moi, Regardez-moi seulement/Je suis un étranger dans ce pays/Regardez moi j’essaye de m’en tirer/Regardez-moi j’essaye de m’en tirer/Aidez-moi, aidez-moi à être simplement un homme/Mes ancêtres étaient des hommes puissants/Et mon fils, lui, sera l’un d’entre eux/Et ils le regarderont et diront/C’est un homme, mon fils est un homme »131
130
Cité dans Yo! Révolution rap : l’histoire, les groupes, le mouvement, Dufresne David, 1991, p.61. 131 Jimmy Cliff, My ancestors, cité dans Aux sources du reggae, Constant Denis, p. 90 : “My ancestors were kings of old/ They rule the world and all of his people/But look at me, oh look at me/Just look at me…/I’m a stranger in this land/Watch me stand to/Help me, help me to be just a man/My ancestors they were mighty men/And my son he will be one of them/And they’ll look at him and say/He’s a man, my son’s a man.”
169
Par ailleurs, Bob Marley affirmera, en 1974, dans la chanson Natty Dread : « Enfants, récupérez votre culture et ne restez pas là à gesticuler »132
De même en 1989, la chanson Acknowledge your own history du groupe de rap Jungle Brothers retentit comme un écho : « Ce qu’on trouve à lire ne parle que de l’esclavage/Jamais du courage de l’homme noir (…) Page un, page deux, page trois et je ne trouve toujours rien sur moi. »133
Un peu moins de dix ans plus tard, en 1997, le chanteur rasta Capleton continue à exprimer les interrogations du mouvement rasta. Elles concernent toujours l’histoire des Noirs qui n’est pas introduite dans les programmes scolaires : « Mais il y a une chose que je n’arrive pas à comprendre/Ils n’enseignent rien à propos de mon ancien clan/Dans les écoles, les universités et les institutions/ Les informations que je reçois sont européennes/Ils m’apprennent l’histoire de Marco Polo et de Napoléon/Ils ne m’apprennent rien à propos du Nil, là où la civilisation a réellement commencé »134
Comme Capleton, les membres du groupe de rap Dead Prez, originaires de New York, partagent le même point de vue sur le système scolaire. À travers le morceau They school, le groupe critique ce système inadapté à leurs perspectives et à leur vie sociale en tant qu’hommes noirs aux Etats-Unis :
132
« Children get your culture and don’t stay there and gesture ». « All you read about is slavery/ never ‘bout the black man’s bravery (…) Page one, Page two, page three/ And still no signs of me ». 134 Capleton, I testament, Def Jam Recordings: 1997. « But dis is one thing i can’t overstand /They don’t teach me nothing about mi ancient clan/Inna di school, di college an’ di institution/Di curriculum dat I get is European/They teach me about Marco Polo and Napoleon/They don’t teach me nothing about the river Nile Bang/Where civilisation did began (…) »
133
170
«Je suis allé à l’école avec des cous rouges/À l’époque ou Third bass a sorti l’album « Cactus »/ Mais moi je lisais Malcolm/J’ai changé mon nom en 1989, ça m’a nettoyé le cerveau comme un neuf millimètre (…) « apprends tes leçons! » c’est ce que ma mère me répétait/J’ai essayé d’être attentif mais leurs cours n’étaient pas intéressants/On dirait qu’ils glorifiaient seulement les Européens/Ils prétendaient que les Africains n’étaient que les 3/5 d’un être humain ». «Leur école ne peut rien nous enseigner/Mon peuple a besoin d’être libre, on essaie d’avoir ce que nous pouvons/Tous mes professeurs de lycée peuvent me sucer la b*te/Ils me racontaient les mensonges de l’homme blanc, que des conneries !/Leurs écoles ne nous enseignent pas ce dont nous avons besoin pour survivre/Leurs écoles n’éduquent pas, tout ce qu’elles nous enseignent ce sont des mensonges. »135
Leurs propos font montre d’une fermeté idéologique rare dans le milieu hiphop de nos jours. Il faut savoir que ce sont également des activistes sociaux. Si l’espace géographique et le support musical changent, le discours ne varie pas énormémement entre le reggae et le rap. Les héros qui se sont levés pour la cause du peuple noir sont aussi célébrés. Marcus Garvey, prophète malgré lui du mouvement rasta et leader politique qui tenta d’insuffler la fierté à la diaspora est célébré dans de nombreuses chansons. Burning Spear lui dédie un album entier intitulé Marcus Garvey. Capleton lui dédie une chanson intitulée Don’t dis the trinity136 ainsi qu’à Haïlé Sélassié dans son album Prophecy. Quant aux membres du groupe de rap Dead Prez, ils se décrivent comme des héritiers de Garvey dans la chanson O.G (Original Garvey)137. Au sein de la communauté africaineaméricaine, un OG (Original Gangsta), c’est un bandit qui a fait ses preuves et qui est respecté. Malgré ses activités criminelles, il a un rôle social ; il
135
Dead Prez, Let’s get free, Loud Records : 2000. «They schools can’t teach us shit/My people need freedom, we tryin to get all we can get/All my high school teachers can suck my dick/Tellin me white man lies straight bullshit /They schools aint teachin us, what we need to know to survive/ They schools dont educate, all they teach the people is lies» 136 Capleton, Prophecy, Def Jam et African Star, 1995. 137 Dead Prez, Turn off the radio, the mixtape vol 2, Get free or dye tryin’, Boss up records, 2003.
171
vient en aide aux plus démunis et sert de médiateur dans les conflits. Dead Prez veut conserver l’influence de l’Original Gangsta, son refus de se soumettre aux autorités tout en ayant une perspective sociale et afrocentrique. En 1991, alors que l’Arizona et le New Hampshire sont les deux seuls Etats du pays à ne pas reconnaître l’anniversaire de la mort de Martin Luther King comme un jour férié national, le groupe Public Enemy va s’ériger en porteparole de la communauté noire dans la chanson By the time i get to Arizona (Quand j’arriverai en Arizona). Le groupe écrit une chanson pour dénoncer le refus acharné de ces deux États rendre hommage à un héros noir qui a consacré sa vie à la réconciliation raciale aux États-Unis par la nonviolence. Paradoxalement, Public Enemy propose des méthodes violentes pour rétablir ce qu’il vit comme un manque de considération : Se rendre en Arizona pour assassiner le gouverneur et faire exploser les bâtiments fédéraux. Dans la chanson Fight the Power, Chuck D, le rappeur du groupe, s’en prend violemment aux héros de la société blanche étasunienne, en dénonçant le déséquilibre entre leur représentation dans la société et celle des héros noirs. Ils se décrivent comme des « rebelles sans pause » contrairement à l’acteur James Dean, héros de la jeunesse blanche américaine qui symbolise cette jeunesse sans repères dans le film Rebel without a cause : «Elvis était un héros pour beaucoup/ Mais en ce qui me concerne, j’en avais rien à foutre/Cet emmerdeur était un vrai raciste/C’est aussi simple qu’il aille se faire foutre lui et John Wayne/Parce que je suis noir et je suis fier Je suis prêt et super excité/La plupart de mes héros n’apparaissent sur aucun timbre/Regarde en arrière et tu verras/Que des cous rouges depuis 400 ans »138
Le constat et les commentaires de Public Enemy sont aussi durs que la situation des Noirs est critique aux Etats-Unis en 1991. La répression policière, la ségrégation immobilière, la réduction des minimas sociaux sont leur quotidien. Tout est mis en oeuvre pour les « gommer » de la société. Ces
138
« Elvis was a hero to most/But he never meant shit to me you see/Straight up racist that sucker was/Simple and plain Mother fuck him and John Wayne/Cause I'm Black and I'm proud/I'm ready and hyped plus I'm amped/Most of my heroes don't appear on no stamps /Sample a look back you look and find/Nothing but rednecks for 400 years (…) »
172
sentiments se reflètent dans les paroles de Chuck D qui, au lieu de prendre ses repères sur les héros blancs, proclame fièrement son appartenance à la communauté noire. 2/ L’oppression de « Babylone » ou des forces gouvernementales Les conditions de vie du peuple noir et l’oppression des « forces gouvernementales » sont des thèmes que développent les paroliers au sein du mouvement rastafari, par le reggae, et du mouvement hip-hop, par le biais du rap. Dans le mouvement rastafari, « Babylone » désigne un système qui entretient la misère des pauvres et établit la violence. Le chanteur Bunny Wailer synthétise bien la dure réalité du ghetto dans sa chanson Johnny too bad : «Johnny grandit dans une baraque d’une pièce tordue Et mal foutue dans le ghetto/La vie était dure et la tranchée de la survie devenait un pic dans le ghetto/C’était voler et piquer et piller et tirer et c’est trop atroce/Johnny devint dur et sa part de survie, c’était de rançonner le ghetto/Johnny ne perdit jamais une bagarre et il n’a jamais, jamais arrêté d’agrandir son territoire/Johnny tu es trop mauvais…Aussi fort et aussi malin qu’il était, il se fit avoir, piéger, coincer et descendre dans le ghetto/Maintenant, tout ce que Johnny laisse derrière lui c’est une femme qui se bat et deux fils dans le ghetto. »139
À cause de la pauvreté, la survie de ce personnage du ghetto, Johnny, le conduit à diriger sa violence vers ceux qui partagent son sort. Babylone l’enferme dans un piège dont il ne peut sortir. Finalement c’est la violence instituée par le système qui mettra un terme à son style de vie. Par conséquent, son absence du foyer créera une pauvreté encore plus grande pour ceux qu’il laisse dans le ghetto.
139
Cité dans Aux sources du reggae, p98. « Johnny was grown in a twisted/Broken down one room shack ina di ghetto/The going was rough and the ditch of survival was getting steep ina di ghetto/It was robbing and stabbing and looting and shooting and it’s too bad/Johnny grew rough and his task of survival was to plunder ina di ghetto/Johnny never lost no fight and he never, never stop to conquer/Johnny you too bad…As smart as Johnny was strong, he was tricked and trapped cornered and shot down ina di ghetto/Now all Johnny left behind is a struggling woman and two sons ina di ghetto ».
173
S’inspirant de la même réalité, le groupe Dead Prez, composé de Lavon Alfred (M1), originaire de la Jamaïque, et de Clayton Gavin (Sticman), rappe le cheminement typique d’un jeune du ghetto aux États-Unis, fustigeant la spirale de violence dans laquelle il se retrouve à cause de la pauvreté et du manque d’encadrement familial : « Le petit Kenny fume de l’herbe depuis l’âge de douze ans/Aujourd’hui il a 25 ans et il est enfermé (...)/On le surnomme « Triple K » parce qu’il a tué trois Négros/Un autre enfant du ghetto devenu un tueur/Son père est un vétéran du Vietnam qui se droguait à l’héroïne/L’Amérique blanche l’a utilisé comme un pion/Sa mère ne pouvait pas gérer le stress et elle est devenue folle/Grand-mère a dû élever le bébé/Un jeune garçon né pour une vie de pauvreté/Qui faisait de la débrouille, des cambriolages, tout ce qui pouvait ramener de l’argent à la maison/Il tenait son revolver comme un aveugle tient sa canne/Il avait des tatouages sur toute la poitrine pour que tu connaisses son nom/Mais tu sais comment ça se passe/La police a enfoncé la porte d’entrée et devine qui elle est venue chercher/Un jeune Négro va vers le pénitencier, il aurait pu être, il aurait dû être/Il ne reverra plus le quartier. »140
Le parcours de ce jeune ressemble de près à celui de Johnny décrit par Bunny Wailer dans la chanson Johnny too bad un environnement instable, indépendant de sa volonté qui l’entraîne vers le cercle vicieux de la violence et la prison. Cette misère sociale et ce désespoir nourrissent la colère envers les pouvoirs institutionnels, tenus pour responsables : «Leur ventre est plein mais nous avons faim, un peuple affamé est un peuple en colère/La pluie tombe mais la crasse est tenace, il y a une marmite pour cuisiner mais la nourriture est rare/Le coût de la vie augmente tellement que les pauvres et les riches commencent à
140
Dead Prez, Let’s get free, Loud records, 2001. « Little Kenny been smokin lucy since he was 12/Now he 25 locked up (…)/They call him Triple k, cuz he killed 3 niggas/Another ghetto child got turned into a killa his pops was a vietnam veteran on heroin/Used like a pawn by these white north americans/Mama couldnt handle the stress so went crazy/Grandmama had to raise the baby/Just a young boy, born to a life of poverty/Hustlin, robbery, whatever brung the paper home/Carried the chrome like a blind man hold a cane/Tattoos all over his chest so you could know his name /But yall know how the game go/Deez kicked in the front door and guess who they came for/A young nigga headed for the pen, coulda been, shoulda been/Never see the hood again »
174
pleurer/Maintenant les faibles doivent devenir forts/Ils disent « Oh! Mon dieu, que de tourments ! »141
Les plaintes de Marley, sa description des conditions de vie du peuple noir en Jamaïque, écrites près de 20 ans avant celles de Dead Prez, sont encore d’actualité aux États-Unis. Dans la chanson Ambush in the night (Attentat dans la nuit), écrite après la tentative d’assassinat dont il a été victime en Jamaïque, Bob Marley décrit la manière dont les hommes au pouvoir se servent de la misère dans le ghetto pour créer un climat de violence et alimenter la division : «Regarde-les se battre pour le pouvoir/mais ils ne connaissent point l’heure de la fin/alors ils corrompent avec leurs fusils, leurs gadgets et leur argent/ils essaient de nuire à notre intégrité maintenant/ils disent que ce que nous savons c’est à eux que nous le devons/et que nous sommes tellement ignorants/qu’ils peuvent nous atteindre avec leurs stratégies politiques/Ils nous maintiennent affamés, et quand tu dois aller chercher à manger, ton frère devient ton ennemi »142
The Message, composé par Grand Master Flash, est la première chanson rap décrivant la situation des communautés pauvres aux États-Unis. Ce titre retrace une réalité qui se juxtapose aisément à celle dont parle Bunny Wailer. C’est, en fait, un appel au secours. La « galère » urbaine est mise en musique afin de ne pas « craquer » : «Partout du verre brisé,Les gens qui pissent dans l’escalier/ Ils en ont rien à foutre/ Ras le bol de cette odeur, marre du bruit/ J’ai pas d’argent pour sortir de là/ Je crois que je n’ai pas le choix/ Il y a des rats dans la pièce de devant des cafards dans celle de derrière/Les junkies dans le couloir avec une batte de base-ball/ J’ai voulu me casser mais je n’ai pas pu aller loin/ Parce qu’un type avec une remorqueuse est venu reprendre ma voiture/ Ne me poussez pas plus parce que je suis à bout/ J’essaie de ne pas perdre la
141
Bob Marley, Natty Dread, Island records, 1974. « Them belly full but we hungry, a hungry mob is a angry mob/A rain a fall but the dirt is tough, a pot a cook but the food no’nough(…) Cost of living get so high, rich and poor they start to cry/Now the weak must get strong/They say oh! What a tribulation! » 142 Bob Marley and The Wailers, Survival, Island Def Jam: 2001. « See them fighting for power/but they know not the hour/so they bribing with their guns, spareparts and money/trying to belittle our integrity now/they say what we know is they teach us/and we’re so ignorant/cause everytime they can reach us through political strategy/They keep us hungry/and when you gott get some food, your brother got to be your enemy »
175
tête/ Ça ressemble à une jungle et quelquefois je me demande comment je fais pour ne pas craquer.» 143
La notion de jungle, l’agressivité des conditions de vie où règne la loi du plus fort sont également évoquées par Bob Marley dans sa chanson Concrete jungle : « Aucun soleil ne veut briller pour moi aujourd’hui/La lune haute et jaune ne veut pas sortir jouer/L’obscurité a recouvert ma lumière/ Et changé ma journée en nuit./Où est-ce que je peux trouver l’amour, quelqu’un me le dira-t-il ?/Ouais/Au lieu de cette jungle de béton où la vie est plus difficile »144
Ces conditions sont vécues comme une privation de liberté et conduisent inexorablement à des appels à la lutte. Lorsque Bob Marley, l’apôtre le plus influent du mouvement rastafari, dit : «Viens, nous allons incendier Babylone à nouveau/viens nous allons chanter et dénoncer Babylone à nouveau car ils sont faibles, ils sont faibles. »145
Le groupe de rap Public Enemy dit « Fight the Power ! » (Combats le pouvoir !). La musique devient un moyen de combattre, de se faire entendre mais surtout de se révolter contre les pouvoirs institutionnels et médiatiques : «Vous devez nous donner ce que nous voulons/Vous devez nous donner ce dont nous avons besoin/Notre liberté d’expression c’est la liberté ou la mort/Nous devons contrer les pouvoirs en place/Laissez-moi vous entendre dire/ Combattons le pouvoir ! /
143
« Broken glass everywhere People pissing on the stairs/You know they just don’t care/Can’t take the smell, can’t take the noise/ Got no money to move out/Guess I got no choice/ Rats in the front room, roaches in the back Junkies in the alley with a baseball bat/Tried to get away but I couldn’t get far Cause a man with a tow-truck repossessed my car. Don’ push me cause I’m closed to the edge, I’m trying not to loose my head, It’s like a jungle sometimes it makes me wonder How I keep from going under. » 144 « No sun will shine on my day today/The high yellow moon won’t come out to play/Darkness has covered my light/And has changed my day into night/Now where is this love to be found, yeah/Instead of concrete jungle where the livin’ is hardest (…) ». 145 Album : Confrontation, Island Records, 1983. « Come, we go burn down Babylon one more time, come we go chant down Babylon one more time for them soft, yes them soft ».
176
Nous avons besoin d’être conscients, on ne peut pas se permettre d’être négligents/Vous dites Qu’est-ce qui se passe ?, mes bienaimés mettons-nous au travail. »146
Les protestations se sont fréquemment dirigées vers les forces de police. Une grande partie des membres des communautés noires aux États-Unis et en Jamaïque ne se sentait pas protégée par la police mais plutôt harcelée. C’est un thème récurrent dans le mouvement hip-hop et dans le mouvement rastafari. Les adeptes des deux mouvements étaient durement réprimés par les forces de police. Certaines de leurs pratiques culturelles (notamment l’usage de substances illicites dans le cadre du mouvement rasta et du mouvement hip-hop, l’utilisation illégale d’espaces publics pour les graffitis dans le cadre du mouvement hip-hop, etc…) ont été durement réprimées par la police, ce qui engendra une confrontation systématique entre les deux parties. Pour remettre en question le rôle de la police au sein des quartiers noirs, KRS-One écrit un texte intitulé Who protects us from you ? (Qui nous protège de vous ?) : «Vous avez été placés là pour nous protéger Mais qui nous protège de vous? A chaque fois que vous dites que c’est illégal/Cela ne veut pas dire que c’est vrai/Votre autorité n’est jamais remise en question/Personne ne vous pose de questions/Si je vous frappe, je serai tué/ Mais si vous me frappez ? Je peux vous intenter un procès/Ou devrais-je demander, qui estce que vous protégez ? Les riches? les pauvres? Qui ? »147
Ce rappeur remet en question les motivations et l’autorité de la police. Aux États-Unis, sur les voitures de police, on peut voir inscrite la devise « serve and protect »148. En réalité KRS-One, en tant que porte-parole du ghetto, récuse cette devise qu’il estime ne pas être effective pour cette frange de la population.
146
Public Enemy, Fear of the black planet, Def Jam records, 1990. « Got to give us what we want/Gotta give us what we need/Our freedom of speech is freedom or death/We got to fight the powers that be/Lemme hear you say/Fight the power!What we need is awareness, we can't get careless/You say “what is this?” My beloved lets get down to business (…) ». 147 Album : Ghetto Music : The blueprint of hip-hop, 1989. « You were put here to protetc us/But who protetcs us from you? Every time you say that’s illegal/Doesnt mean that thats true (uh-huh)/Your authority’s never questioned/No-one questions you/If I hit you Ill be killed /But you hit me? I can sue/Or should I say, who are you protetcing? The rich? The poor? Who? ». 148 « Servir et protéger ».
177
En 1993, sur l’album Return of the boom bap avec la chanson Sound of the police, il établit un lien, une continuité entre le rôle de la police et celui du contremaître sur la plantation. Ce sentiment d’être constamment surveillé et systématiquement soupçonné, à cause de sa couleur de peau, est toujours actuel dans la vie de l’homme noir aux États-Unis : «Voici une petite vérité Ouvre bien les yeux/Pendant que tu analyses le rythme Boom Bap Écoute l’exercice/Prends le mot contremaître comme un échantillon/ Répète le rapidement plusieurs fois Overseer, Overseer, Overseer, Overseer, Officer, Officer, Officer, Officer, Ouais, d’officier à contremaître/Tu as besoin d’un peu d’explications? Ecoute la ressemblance ! Le contremaître rodait à travers la plantation L’officier patrouille dans toute la nation. »149
KRS-One, en répétant le mot « overseer » plusieurs fois arrive à prononcer le mot « officer ». La proximité sonore des deux mots révèle aussi la proximité des deux concepts. En effet, singulièrement, il les relie par l’oralité, mais également en décrivant les fonctions et les pouvoirs des deux personnages. Son insoumission se traduit par une déclaration violente. Dans la rue, l’environnement du hip-hop, il conteste l’autorité du policier en portant une arme plus puissante que la sienne. Tout au long de l’histoire du rap, des chansons ont été enregistrées par les rappeurs critiquant les forces de police. La première fut F*ck tha police du groupe Niggers With Attitude150, qui déclencha un tollé dans la société américaine. Il y en eut aussi une autre encore plus violente, Cop Killer du rappeur Ice T. Dans la chanson I shot the sheriff, Bob Marley assure que s’il a tiré sur le shérif, le représentant de la loi, il l’a fait en état de légitime défense, car il se sentait menacé. Dead Prez ne parle pas simplement de la police mais du gouvernement comme d’un « État-police » ne laissant pas d’espace privé au peuple. Dans cette critique, ils vont plus loin en proposant une vision politique. Ils proposent de réorganiser la vie économique de leur quartier en fonction
149
« Now here's a likkle truth/Open up your eye/While you're checking out the boom-bap, check the exercise /Take the word "overseer," like a sample /Repeat it very quickly in a crew for example/Overseer, Overseer, Overseer, Overseer, Officer, Officer, Officer, Officer!Yeah, officer from overseer/You need a little clarity? Check the similarity! The overseer rode around the plantation/The officer is off patroling all the nation ». 150 NWA, Straight outta Compton, Priority Record, 1989.
178
d’une politique socialiste qui permettrait, selon eux, une distribution plus équitable des richesses : « Je veux être libre de vivre, capable d’avoir ce dont j’ai besoin pour vivre/Ramener le pouvoir dans la rue où le peuple vit/On en a marre de travailler pour des miettes, de remplir les prisons/ de mourir pour de la thune, et de dépendre de la religion pour être aidés/On travaille pour nousmêmes comme les fourmis d’une fourmilière/On organise les richesses en fonction d’une économie socialiste/Un style de vie basé sur le besoin commun/Et tous mes camarades sont prêts, nous n’avons plus qu’à semer les grains»151
Dead Prez se rallie à la tradition du nationalisme noir aux États-Unis en citant le leader des Black Panthers, Huey P. Newton. Le sentiment d’être surveillé et maintenu dans la pauvreté est évident dans les paroles de cette chanson. Ils désirent sortir de cet état, s’organiser pour ne pas dépendre de l’appareil gouvernemental. Comme KRS-One dans la chanson Who Protects us from you ?, Bob Marley évoque aussi la brutalité policière ajoutée à la misère dans un morceau intitulé Burnin’ and lootin’ et le sentiment de révolte qui en découle inévitablement : « Ce matin je me suis levé au milieu du couvre-feu Mon Dieu, j’étais moi aussi prisonnier/Je ne pouvais pas reconnaître les visages au-dessus de moi Ils portaient tous l’uniforme de la brutalité/ Combien de rivières devons-nous traverser avant de pouvoir parler au patron? Tout ce que nous avons semble être perdu Nous avons vraiment dû payer le prix. C’est pourquoi nous allons brûler et piller ce soir »152
151
Dead Prez, Police state, Let’s get free, Loud records, 2000. « I want to be free to live, able to have what I need to live/Bring the power back to the street, where the people live/We sick of workin for crumbs and fillin up the prisons/Dyin over money and relyin on religion for help/We do for self like ants in a colony/Organize the wealth into a socialist economy/A way of life based off the common need/And all my comrades is ready, we just spreadin the seed » 152 The Wailers, Burnin’, Island records, 1973. « This morning i woke in a curfew /Oh God, I was a prisonner too/Could not recognize the faces standing over me/They were all dressed in uniform of brutality/How many rivers do we have to cross before we can talk to the boss ? All that we have it seems we have lost/ We must have really paid the price/That’s why we gonna be burnin and lootin tonight …»
179
Les descriptions faites par les paroliers du mouvement hip-hop et du mouvement rastafari sur les conditions de vie de l’homme noir aux ÉtatsUnis se rejoignent. Le même sentiment d’oppression et d’injustice est vécu par ces deux peuples descendants d’esclaves, malgré le fait qu’ils évoluent dans des espaces différents. Le désir de révolte, l’appel à la mobilisation se fit aussi entendre de manière distincte dans les deux mouvements. 3/ L’Afrique L’Afrique demeure un point d’ancrage essentiel dans l’idéologie rastafari et dans le discours hip-hop. Dans de nombreux textes écrits par les artistes des deux mouvements, les références à l’Afrique sont récurrentes, le désir d’y retourner est manifeste. Elle est assez souvent vue de manière romantique, embellie. C’est la terre des ancêtres, la terre à laquelle l’homme noir doit se référer s’il veut retrouver un équilibre culturel et psychologique. Cette conscience de la diaspora noire n’est pas partagée par tous les adeptes du mouvement hip-hop. Il existe des paroliers qui légitiment la place de l’Afrique dans la quête identitaire des Africains-Américains. Ce sont ceux-là que nous avons sélectionnés. Ils rejoignent les paroliers du mouvement rastafari qui s’expriment à travers le reggae. Ces éléments nous permettront de mieux aborder les deux mouvements que nous étudions, voire de meixu les appréhender. Au début des années 90, il y eut au sein de la communauté hip-hop une période d’affirmation raciale avec des groupes phares comme X-Clan, Public Enemy, Boogie Down Productions, Brand Nubian et Jungle Brothers, pour n’en citer que quelques-uns. Ce mouvement de pensée a été inspiré par la période Soul des années 60, avec James Brown et sa légendaire chanson I’m black, I’m proud. Cet état d’esprit aura sa résonance au sein du mouvement rastafari et il ira en s’accentuant après la vague d’indépendance sur le continent africain durant les années 60. Cette idéologie exprimée dans le mouvement rastafari prend le contre-pied des idéologies colonialistes dans la Caraïbe, avec l’aliénation qui y est liée. Chez Peter Tosh, ex-chanteur et guitariste des Wailers, ces affirmations ont un caractère politique : «Ne t’occupe pas d’où tu es venu Si tu es noir, tu es Africain. Qu’importe ta nationalité ton identité est celle d’un Africain.
180
Qu’importe ta couleur de peau Tu ne seras pas rejeté Tu es un Africain Qu’importe comment on t’appele C’est de la ségrégation tu es un Africain»153
En 2001, le groupe de rap Dead Prez confirmait de la même façon, dans un style musical différent, les propos de Peter Tosh : « Je suis africain, je n’ai jamais été africain-américain Je suis plus noir que le noir/ Je remonte à mes origines La même peau haïe par les hommes du Klan Un gros nez, de grosses lèvres, de grosses hanches et de grosses fesses qui dansent, et alors ? » « Non je ne suis pas né au Ghana mais l’Afrique est ma mère et je ne suis pas arrivé là à cause d’un mauvais karma ou à cause du basket/ En vendant beaucoup de crack et en rappant/ Peter Tosh a essayé de nous expliquer les choses Il disait que si tu es Noir tu es africain Donc ils devait le tuer et le faire passer pour un mauvais Parce qu’il enseignait aux enfants Je le comprends, il essayait de nous donner une vraie pierre précieuse »154
Le duo de rappeurs déclare radicalement en premier lieu ne pas se reconnaître dans une identité partagée entre les États-Unis et l’Afrique. En deuxième lieu, il cite la chanson de Peter Tosh et partage sa vision de l’identité africaine. Néanmoins, malgré leurs intentions, Dead Prez ne peut pas nier la part des États-Unis dans la construction de leur identité car ils ont vécu la plus grande partie de leur existence dans ce pays : Peter Tosh non plus d’ailleurs. Dans la même chanson, les rappeurs soutiennent :
153
Cité dans Aux Sources du reggae, Peter Tosh, Album : Equal rights, Titre : African. « Don’t you worry where you came from/As long as you’re a black man, you’re an African No mind your nationality/You have got the identity of an African No mind your complexion There is no rejetcion You’re an African/No mind your denomination That’s segregation You’re an African ». 154 Dead Prez, I’m an African, Let’s get free, Loud Records, 2001. « Im an African, never was an African-American blacker than black I take it back to my origin Same skin hated by the klansmen Big nose and lips, big hips and butts, dancin, what (…) » “(…) No I wasnt born in Ghana, but Africa is my momma and I did not end up here from bad karma or from b-ball/ Selling mad crack or rappin Peter Tosh try to tell us what happened/ He was saying if you black then you African So they had to kill him, and make him a villain cuz he was teachin’ the children I feel him, he was tryin to drop us a real gem ».
181
« Mon environnement a fait de moi le négro que je suis »155
En citant Peter Tosh, Dead Prez rapproche les luttes sociales et les quêtes identitaires du peuple noir aux États-Unis et à celles du peuple noir en Jamaïque. Le groupe affirme également que la mentalité rastafari n’est pas totalement indissociable du discours hip-hop. Les deux mouvements de pensée ne s’accordent pas sur tous les principes et le vocabulaire employé. Ainsi le chanteur rasta Capleton s’offusque de se faire appeler « Négro » aux États-Unis. C’est, en effet, un mot dont l’usage est très controversé dans la société américaine156. Il est néanmoins utilisé de manière courante dans le mouvement hip-hop et dans une partie de la communauté africaine-américaine. Dans une chanson, il se démarque des rappeurs, chez qui l’usage de ce mot, discriminatoire selon lui, est habituel. La violence de ses propos révèle l’aspect agressif du mouvement rastafari : «Qui est-ce que tu appelles Négro?! Qui est-ce que tu appelles Négro?! Tu me prends pour Pac, Smalls ou Jigga? Qui est-ce que tu appelles Négro?! Tu me prends pour Busta Rhymes ou Usher. Qui est-ce que tu appelles Négro?! Qui est-ce que tu appelles Négro?! Va te faire foutre ! Sélassié est celui qui vit à jamais Qui est-ce que tu appelles négro?! Si tu déconnes, j’appuie sur la gâchette »157
Dans le morceau Zimbabwe, Bob Marley milite pour la libération du continent africain, plus particulièrement l’ancienne Rhodésie qui deviendra le Zimbabwe. Il appelle au droit de chaque peuple à se gouverner : « Chaque homme a le droit de choisir sa propre destinée et dans ce jugement il n’y pas de favoritisme/Bras dessus, bras dessous, nous combattrons cette petite bataille parce que c’est le seul moyen de triompher de ce petit ennui/ On va craindre Natty au
155
« My environment made me the nigga I am » Se référer à l’ouvrage Nigger: the strange career of a troublesome word, Randall Kennedy. 157 « Who yuh callin nigga?! Who yuh callin nigga?! Yuh tink this is Pac, or Smalls or Jigga? Who yuh callin nigga?! Who yuh callin nigga?! Yuh tink this is Busta Rhymes or Usher/ Who yuh callin nigga?! Who yuh callin nigga?! F*ck you! Selassie is the di longest liver/ Who yuh callin nigga?! Who yuh callin nigga?! If yuh fuck round mi known fi press di trigga. » 156
182
Zimbabwe/Faites tout exploser au Zimbabwe/Ecrasez tout au Zimbabwe/Les Africains vont libérer le Zimbabwe. »158
Les rappeurs vont s’approprier la sagesse africaine pour inciter leurs auditeurs à libérer leurs énergies créatrices. Dans sa chanson Africa Dream, Talib Kweli cite un proverbe zimbabwéen : « Si tu peux parler, tu peux chanter. Si tu peux marcher, tu peux danser » 159
Faire référence à un proverbe africain est aussi une manière de revaloriser cette part de leur héritage. Le continent africain demeure au centre de leur quotidien d’autant plus que sa libération et son unification profiteront à la diaspora noire dans le monde entier : «Afrique unis-toi, nous quittons Babylone Nous allons sur la terre de nos pères Unis-toi pour le bénéfice de ton peuple. Unistoi pour les Africains à l’étranger. Unis-toi pour les Africains au pays. »160
Le rapatriement vers l’Afrique, la terre de liberté, la terre des ancêtres est clamé par un rappeur du nom de Burk dans le titre Afrika : « Je veux aller en Afrique au lieu d’être exploité comme une prostituée en Amérique »161
Le chanteur rasta Fred Locks exprime son désir de retourner vers la terre promise par le biais de la Blackstar Line, la ligne de voyage mise en place par Marcus Garvey :
158
Bob Marley, Zimbabwe, Survival, Island Records, 1979. «Every man has the right to decide his own destiny and in this judgement, there is no partiality/ So arms in arms, with arms, we will fight this little struggle ‘cause that’s the only way we can overcome our little trouble (…)/Natty dread it inna Zimbabwe/ Set it up inna Zimbabwe/ Mash it up inna Zimbabwe/Africans ah liberate Zimbabwe» 159 Talib Kweli and Hi-Tek, Reflection Eternal-Train of thought, Rawkus Records, 2000. « If you can talk, you can sing, if you can walk, you can dance. » 160 Bob Marley, Africa Unite, Survival, Island records, 1979. «Africa unite, cause we’re moving out of Babylon We’re going to our father’s land (…) Unite for the benefit of your people Unite for the Africans abroad unite for the Africans a yard» 161 Burk, Get free or die tryin’, Boss up records, 2003. «I wanna go to Afrika instead of being pimped like hoe in America. »
183
« Sur sept miles, les bateaux de la Blackstar line accostent. C’est le rapatriement, la libération noire/ Je peux les voir arriver. Je peux les voir et lire leurs noms/ Je peux entendre le chef dire voici les jours pour lesquels nous avons prié. Marcus Garvey nous enseigna que la liberté est une exigence. Il nous annonça : les bateaux de la Blackstar line viendront un jour nous chercher. »162
Parallèlement, la Blackstar Line joue un rôle analogue, mais de manière symbolique et culturelle, pour le groupe Brand Nubian, dans son titre inspiré par le projet de Garvey : «Suivez-moi encore sur la Blackstar Line On oublie tout, on oublie Brand Nubian on retourne en Afrique maintenant Blackstar Line, c’est la Blackstar Line Allez tout le monde montez encore et libérez vos esprits à bord. »163
Dans sa chanson Africa’s inside of me, le groupe de rap Arrested Development exprime le rôle de l’héritage africain dans la construction de la nouvelle identité. L’Afrique devient la force intérieure qui soutient la lutte pour la libération psychologique : « C’est l’Afrique en moi qui fait quelque chose à partir de rien/ L’Afrique est en moi/ Elle reprend son enfant/ Elle me donne de la fierté et me libère. »164
Le chanteur Sizzla, un leader du mouvement rasta dans le titre Made of, affirme aussi la présence des traditions africaines chez l’homme noir, malgré sa déportation :
162
Fred Locks, Blackstar Liner, In the land of reggae Vol. 1. «Seven miles of blackliners coming in the harbour. It’s repatriation/ Black liberation, I can see them coming. I can see and read their names I can hear the header say these are the days for which we’ve been praying/ Marcus Garvey told us freedom is a must. He told us Blackstar liners, one day is coming for you. » 163 Album : In God we trust, Elektra Entertainment, 1992. «Follow me again upon the black star line/Off for the rest and for Brand Nubian/Now we go back to Africa again Black Star line, it’s the Blackstar line/ Everybody come on board and free your mind». 164 Album : Zingalamaduni, Chrisalys Records, 1994. « It’s Africa within me making something out of nothing. Africa’s inside of me/Taking back her child. She’s giving me pride and setting me free. »
184
« De quoi est constitué le peuple noir ? Des traditions africaines sans aucun doute. Cela fait longtemps qu’ils nous ont emmenés dans cet hémisphère ouest. Ils n’ont pas réussi à nous briser. »165
Bob Marley et le groupe de rap X-Clan ont tous deux des chansons portant le même titre à savoir Exodus pour Marley et XODUS pour X-Clan. Elles ne sont pas identiques dans leur message mais elles s’adressent une diaspora noire qui partage une expérience historique similaire. Les textes réclament un retour sur la terre des ancêtres et revendiquaient leur héritage. Indirectement, ces artistes s’adressent à ceux qui, indépendamment de leur couleur de peau, remettent en cause l’hégémonie culturelle de l’Europe et des États-Unis. Les rappeurs du groupe X-Clan ne se considèrent pas comme de simples artistes mais comme des éducateurs, des messagers qui contribueront au progrès de la communauté africaine-américaine. Ils s’inspirent de la pensée d’activistes politiques et de chercheurs tels que Martin Bernal et Cheikh Anta Diop. Ces derniers défendent la thèse selon laquelle les débuts de la civilisation ont eu lieu en Afrique et que la science, les mathématiques, la philosophie ainsi que les arts ont commencé en Egypte. Le groupe dans sa chanson Xodus prône le nationalisme noir et le pan-africanisme au sein de la communauté africaine-américaine. Tandis que Marley parle d’un retour physique en Afrique, X-Clan prône un retour radical aux références culturelles africaines. Comme Peter Tosh dans sa chanson Mama Africa, le groupe de rap Stetsasonic reconnaît l’Afrique comme la terre mère dans sa chanson A.F.R.I.C.A. Nous retrouvons des idées similaires au service de deux mouvements différents. Comme nous l’avons illustré, la participation du continent africain à la construction identitaire de la diaspora noire dans l’Amérique anglophone a été très plébiscitée dans les textes rap comme dans les textes reggae. C’est, en réalité, la réponse de deux peuples, les Afro-Jamaicains et les AfricainsAméricains, à une expérience similaire d’aliénation culturelle.
165
Sizzla, Freedom cry, Jammin’ Records, 1998. « What does black people made of ? African traditions I tell you straight up. So long that they take us inna this western hemisphere, dem could not break us. »
185
4/ La femme noire Un autre thème majeur dans le discours reggae et le discours rap, c’est la femme mais singulièrement, la femme noire. Les paroliers partagent leurs opinions sur son rôle, ses caractéristiques, sa personne. Le discours consiste à chanter les louanges de la femme noire, à reconnaître l’importance de son rôle affectif et social dans la communauté noire. Ses problèmes et ses handicaps sont aussi pris en compte dans les discours hip-hop et rastafari. Dans le cadre du rap, tandis que son image est exploitée dans les clips vidéos et qu’elle est dénigrée dans les textes de chansons populaires, un certain nombre de rappeurs se démarquent en valorisant une image plus édifiante. C’est ainsi que le groupe Blackstar, un duo originaire de Brooklyn, New York, rappe les qualités qu’ils perçoivent chez la femme noire, qu’elle soit aux États-Unis dans la Caraïbe ou en Afrique : «Sais-tu ce que certains font pour te ressembler? Des collants foncés, des talons aiguilles, du rouge à lèvres et tout le bazar mais devines? Sans maquillage, tu es belle/ Pourquoi te faut-il mettre de la peinture?/ On ne s’intéresse pas aux critères de beauté européens ce soir ! Eteignez la télé et déposez les magazines/ Regarde dans le miroir et dis moi ce que tu vois/ L’évidence de la présence divine/ Les femmes dans la caraïbe, elles ont le soleil en or je sais que les femmes sur le continent l’ont aussi. Au Nigeria et au Ghana, tu sais qu’elles l’ont En Tanzanie, en Namibie et au Mozambique Au Botswana, parlons des femmes latines des Colombiennes (...) bien sûr les femmes de Brooklyn sont d’accord/ Les femmes du Bronx aussi les femmes du Queens aussi, à New York, Atlanta, Los Angeles, Cincinnati, Bay Area »166
166
Brown Skin Lady, Mos Def and Talib Kweli are Blackstar, Rawkus Records, 1999. « You know what some people put themselves through to look just like you? Dark stocking, high heels, lipstick, alla tha You know what? Without makeup you're beautiful! Whatcha you need to paint the next face for? We're not dealin with the European standard of beauty tonight. Turn off the TV and put the magazine away. In the mirror tell me what you see. See the evidence of divine presence. Women of the Carribean, they got the golden sun. I know women on the continent got it Nigeria, and Ghana, you know they got it Tanzania, Namibia and Mozambique and Bothswana, to let it speak about Latinas, Columbianas (…), of course the Brooklyn women walk that walk and the Bronx women walk that walk. Honeys from queens walk that walk, NYC, ATL, LA, Cincinnatti, the Bay Area »
186
Dans ce texte, les rappeurs de Blackstar parlent de la femme noire, mais pas seulement aux Etats-Unis car ils la replacent dans le contexte de l’Afrique et de la diaspora noire. Elle n’est pas évaluée en fonction des critères de beauté européens, mais par ceux de la communauté noire, qui la mettent en valeur. À l’heure où les artifices féminins sont à la mode, sa beauté naturelle est acclamée. D’autres rappeurs feront des éloges similaires de la femme noire. Citons par exemple Black woman du groupe Jungle Brothers, Brown skin lady de KRS-One. À cause des injures proférées à l’encontre des femmes dans le rap, KRS-One rappelle le respect que l’homme noir doit à sa compagne : «Tu dois respecter ta chérie, toutes les femmes noires Si tu manques de respect à ta femme, tu as tout à zéro Donc ferme-la jusqu’à ce que tu comprennes. »167
Il va à l’encontre des stéréotypes et de l’argot établis dans le rap où la femme se résume à un objet de plaisir pour l’homme, souvent assimilée à une prostituée, lorsqu’il déclare : « Femme à la peau noire, tu es une reine, pas une pute. Ceux qui disent ça sur le micro, on les hue/ Femme noire ils ne peuvent pas te manquer de respect parce que tu es la meilleure/ Ils t’appelent par toutes sortes de quolibet mais tu le sais, tu n’es pas une pute. »168
Sizzla, le chanteur rasta, déclare de la même manière sa loyauté envers la femme noire, une manière de dire qu’il ne conçoit son couple qu’avec une femme de la même race : «Femme et enfant noirs ouais! J’ai tellement d’amour pour vous. Les billets de dollars et les pièces disparaîtront. Ils ne pourront jamais me rendre aussi fier. Femme et enfant noirs ouais! J’ai tellement d’amour pour vous. Les billets de dollars et les pièces disparaîtront Ils ne pourront jamais me rendre aussi fier. »169
167
Brown skin woman, Return of the Boom Bap, Jive Records, 1993. «You must respetc your love, all brown skin 'oman! If you diss your woman, you not come wit no plan. So shut up your mowf, til you must understand. » 168 « Brown skin woman, you a queen, not a hoe. Any man that drop the lyric what we give them the BO/ Brown skin gwal them can't diss yo /Cause you run the showow-ow! Them call you all type of bimbo / But you know you're not a hoe-oe-oe!». 169 « Black woman and child, yeh yeh yeah! For you I really have so much love. Dollar bills and coins will fade away. They could never make I so proud/ Black
187
L’aspect romantique apparaît également quand l’homme considère les sentiments de la femme et lui fait la cour. Dans une chanson peu conventionnelle intitulée Mind Sex, le duo de rap Dead Prez aborde ce thème. Il faut se rappeler que nous sommes dans un contexte plus large où dans le rap, ce type de message prônant le respect de la femme, n’est pas commun : «Parle-moi de ce que tu aimes princesse africaine/ Attends, laisse-moi deviner ma chérie/ Tu aimes sûrement la poésie. Ecoute un peu ce que j’ai écrit au cas où je t’apercevrais. Je vais saisir cette opportunité. Est-ce que tu veux passer un moment avec moi en buvant du thé aux herbes ? faire une promenade verbale, construire un lien parce que je suis sûr que ta main ira bien dans la mienne/ Et c’est comme si on parcourait l’espace quand tu flirtes avec moi/ Allons-y, quelques caresses ne nous feront pas de mal. »170
Dans cette chanson, Dead Prez aborde les relations sexuelles. Selon son point de vue, ces relations ne sont pas que physiques, elles impliquent le mental, et donc le fait de discuter et d’apprendre à se connaître est important. Ces paroles et cette approche n’existent pas dans la culture hip-hop. Avant Dead Prez, cette pudeur ne s’était jamais révélée dans des paroles de rap : « Avant faisons l’amour mentalement/Pas la peine d’enlever nos vêtements maintenant. On peut allumer de l’encens et seulement discuter, se relaxer Relaxe toi, j’ai les bonnes vibrations. Avant de faire l’amour, prenons le temps de bien discuter »171
woman and child, yeh yeh yeah! For you I really have so much love. Dollar bills and coins will fade away. They could never make I so proud. » 170 Dead Prez, Mind Sex, Let’s Get Free, Loud Records, 2001. «African princess, tell me yo interests! Wait, let me guess boo, you probably like poetry. Here’s a little something I jotted down in case I spotted you around. So let me take this opportunity. Would you share a moment with me, over herbal tea? Take a walk verbally, make a bond certainly/Cuz in my hand I bet your hand fit perfetcly and it’s like we floatin out in space when you flirtin wit me. Come on, a little foreplay dont hurt » 171 Dead Prez, Mind Sex, Let’s Get Free, Loud Records, 2001. «But first we have mind sex, we aint got to take our clothes off yet. We can burn the incense, and just chat, relax, I got the good vibrations. Before we make love lets have a good conversation. »
188
Bob Marley était connu pour ses conquêtes féminines. Certes, il n’a pas fréquenté uniquement des femmes noires, mais la séduction, les relations hommes-femmes ont été aussi l’objet de ses compositions. Dans Turn your lights down low, il exprime comme Dead Prez son désir envers sa bienaimée : «Baisse un peu ta lumière et ferme tes rideaux, Oh laisse la lune briller à nouveau dans nos vies, je veux te donner de l’amour. »172
La femme séduit les artistes mais ils savent aussi voir quand elle ne va pas bien. Tandis que le groupe de rap Public Enemy décrit les effets pervers de la télévision sur une jeune femme, Bob Marley parle des effets de la drogue et du show business sur une autre jeune femme : «Je ne pense pas pouvoir le supporter. Elle zappe de chaîne en chaîne. Sans relâche, elle recherche ce héros Elle regarde la chaîne zéro. Ma sœur voit trouble parce que je sais qu’elle est ignorante, je vois que son cerveau est reprogrammé par une petite télécommande. La révolution est une solution pour tous nos enfants mais tous ses enfants ne sont pas aussi importants que l’émission. Regarde-la vouer un culte à l’écran. Elle est accro à la pub et vraiment ça me rend dingue. »173
Dans Pimpers paradise, Bob Marley parle de l’effet de la drogue sur une jeune femme, une situation qu’il a sûrement dû vivre dans le monde du spectacle : «Elle aime faire la fête, se donner du bon temps Elle a l’air si sincère, bien dans sa peau. Elle aime fumer Parfois elle sniffe de la coke Elle rigole quand il n’y a rien de drôle un paradis artificiel, c’est tout ce qu’elle était (…) Elle s’éclate et elle cherche à planer haut maintenant elle flippe alors qu’il n’y a rien de triste »174
172
«Turn your lights down low and close your window curtain. Oh let the moon come shining into our lives again (…) I want to give you some love. » 173 « I don't think I can handle! She goes channel to channel. Cold lookin' for that hero. She watch channel zero Trouble vision for a sister because I know she don't know, I quote her brains retrained by a 24 inch remote Revolution a solution for all our children but all her children don't mean as much as the show, I mean Watch her worship the screen, and fiend for a TV ad and it just makes me mad ! » 174 « She loves to party, have a good time. She looks so hearty, feeling fine. She loves to smoke, sometimes she sniff coke. She’ll be laughing when there ain’t no
189
Chuck D, l’un des rappeurs du groupe, conscient du fait que les hommes noirs n’ont pas toujours su accorder un soutien affectif et financier aux femmes noires, rappe : «À mes sœurs Mes soeurs, oui on vous a lâchées. Rassemblons nous pour construire une nation. »175
D’autre part, dans sa célèbre chanson No woman no cry, Marley écrit un hymne de courage à Rita, sa femme d’abord, puis à la femme noire, aux femmes de son pays et à la femme en général, peu importe sa nationalité et sa couleur de peau : « Non femme, ne pleure pas, petite chérie ne verse pas de larmes »176
La femme noire est un sujet récurrent et omniprésent dans le discours hiphop et le discours rastafari. Tandis que dans la culture dancehall et le rap médiatisé, elle est dévalorisée, son image et son apport sont revalorisés dans les textes de rap, certes moins populaires, et dans les textes de la majeure partie des artistes rastafari. Il reste à savoir si ces textes trouvent un écho dans la réalité des artistes. 5/ La critique sociale et les commentaires politiques La critique sociale et les commentaires politiques ont été les « fers de lance » du rap et du reggae. Parce qu’elles ont leurs racines dans les masses, ces deux musiques ont été investies par ces causes. Elles se sont donc naturellement érigées en « voix des sans-voix » concernant la vie politique et sociale de la Jamaïque et des États-Unis. Le reggae s’est développé à partir des années 70 dans le ghetto de Trenchtown en Jamaïque. Il exprimait déjà à cette époque le malaise social. Le rap s’est instrumentalisé à partir du milieu des années 70 dans les cités du Bronx. Ce n’est qu’à partir de la fin de cette décennie qu’il commence à
joke. A pimpers paradise, that’s all she was now. Pimpers paradise, that’s all she was (…) She’s getting high, trying to fly to the sky. Now she is bluesing when there ain’t no blues. » 175 Power to the people, Album : Fear of the black planet. « To my sisters Sisters yes we missed ya. Let's get it together make a nation. » 176 « No woman, no cry, little darling don’t shed no tears. »
190
exprimer le malaise social de ses habitants. Le rap et le reggae sont deux formes de « musiques de contestation ». Ces musiques sont caractérisées par des reproches aux injustices et à l’oppression infligées à certains groupes d’individus. Le but de cette musique et de ceux qui la produisent est de s’opposer à toute forme d’oppression et d’exploitation exercée par une élite ou par des membres d’un groupe dominant sur un autre groupe de personnes. Le rap et le reggae ont, au fil des années, su exposer les problèmes sociaux et politiques auxquels devait faire face le peuple noir en Amérique anglophone. Lorsque Bob Marley crie la souffrance du ghetto dans la chanson Them belly full, il conteste l’inégale répartition des richesses en Jamaïque entre les classes bourgeoises et les classes pauvres. Marley chante en effet :
« Leur ventre est plein mais nous, on a faim. »177 tandis que Earl Simmons, connu sous le nom de DMX, un rappeur africainaméricain, chante dans la même lignée : «Vous avez assez mangé, arrêtez de tout prendre/ Faites ce qu’il faut et donnez aux nécessiteux »178
Les paroliers arrivent à décrire, avec clairvoyance, les structures qu’ils perçoivent comme des antagonismes. Dans sa chanson Small axe, Marley décrit la relation entre les oppresseurs et le peuple : «Si tu es un grand arbre, nous sommes la petite hache affûtée pour t’abattre, prête à t’abattre, oh oui»179
Même si les moyens ne sont pas les mêmes, la ténacité et la volonté sont les premières armes dans le combat. Dans une combinaison avec Stephen Marley, le groupe de rap Dead Prez articule les conséquences de la domination économique de l’homme blanc sur la communauté noire :
177
Bob Marley, Natty Dread, Island Records: 1974. « Them belly full but we hungry » Album : It’s dark and hell is hot, Stop being greedy,1998, Def Jam. « Ya been eating long enough now, stop being greedy, Keep it real partner give to the needy. » 179 « If you are a big tree, we are the small axe sharpened to cut you down, ready to cut you down, oh yeah. » 178
191
« Partout ou l’homme blanc va, il y amène la misère. L’histoire le prouve, regarde. Tout ce que ces têtes chauves touchent, ils le détruisent. Tous les gouvernements qu’ils mettent en place ils sont corrompus. »180
Ces commentaires politiques ne sont pas médiatisés dans le monde de la musique aux États-Unis, mais ils sont d’une sagacité inaccoutumée dans la culture hip-hop : « J’ai vu deux camps, nous contre eux. Les policiers patrouillent à quatre ou cinq hommes. Le marché de la prison se développe, les sénateurs sourient. Les gens cherchent des réponses, où commencer ? Le capitalisme est né sur le dos des Noirs. Les Blancs se reposent et vivent les pieds en l’air. On a travaillé dur pour bâtir ce pays pour être ensuite exploités par les classes pour de l’argent. »181
Le système social et politique est conçu comme une machine qui agrippe les forces vives, les plus pauvres, et les conditionne à son avantage. Bob Marley fait écho aux commentaires précédents de Dead Prez : «Le système de Babylone est un vampire qui suce les enfants jours après jours/ Le système de Babylone est un vampire qui suce le sang des malheureux »182
Le rap et le regae ont, à un moment donné, su mettre en évidence les obstacles à l’évolution du peuple noir en Amérique anglophone. L’album du groupe Public Enemy intitulé Fear of the Black Planet, un album phare dans la discographie du rap, est comparable à l’album de Bob Marley intitulé Survival. Ces albums sont semblables dans le sens où leurs auteurs ont tenté
180
« Everywhere the white man goes he brings misery all throughout history, look it up. Everything them baldheads touch they fuck it up. Every government he set up, it be corrupt. » 181 Album: bande originale du film Black and White, Dem Crazy, Dead Prez, Stephen Marley and Ghetto Youth Crew, mars 2000, Sony records. « I've seen two sides, us against them. Police troops ride with four to five men. Prison business is boomin, Senators grin. People searchin for answers, where to begin ? Capitalism born from the backs of blacks. White folks relax, live off the kick backs. Gettin work to the bone we build this country further exploited by class to make money. » 182 Album : Survival, Babylon System, Island Def Jam: 2001. « Babylon system is a vampire sucking the children day by day. Babylon system is a vampire sucking the blood of the sufferers ».
192
de souligner les conditions économiques, raciales et psychologiques du peuple noir. En 1990, dans un entretien, lorsqu’on demande à Chuck D, rappeur du groupe Public Enemy, d’expliquer le titre de l’album, il répond : « La peur de la planète noire, c’est le refus d’accepter le point de vue afrocentrique, c’est l’endoctrinement ininterrompu du point de vue eurocentrique. A mon avis, cela ne bénéficie pas à la majorité des gens sur cette planète. En un mot, la peur de la planète noire, c’est une contreattaque du système culturel de la suprématie blanche, qui est d’ailleurs une conspiration pour détruire la race noire.»183
L’album se focalise sur la vie de la communauté africaine-américaine aux États-Unis, avec comme objectif de relever son estime de soi. C’est une déclaration politique. Ce message est constant tout au long de l’album mais deux titres expriment particulièrement cet état de fait. Brothers gonna work it out (Les frères s’en sortiront) traite du fait que l’homme noir doit prendre ses responsabilités, s’informer et s’unir avec d’autres pour pouvoir trouver des solutions. Ces réussites ne se feront qu’au prix d’un effort collectif car seul, l’homme noir a peu de chances de parvenir à son but : «Viens, il faut que tu t’investisses. Parce que les frères dans la rue veulent s’en sortir. Allons-y…Nous avons la volonté maintenant, on est prêts si vous êtes prêts. Unis on tient, divisés on tombe. Ensemble, on peut résister. »184
La deuxième chanson qui cristallise la pensée sociopolitique de Public Enemy est intitulée 911 is a joke. Elle est interprétée par le deuxième rappeur du groupe, Flavor Flav. Aux États-Unis, le 911, c’est le numéro des urgences. Flavor Flav se plaint du manque de rapidité des interventions de la police ou des ambulances dans les quartiers urbains noirs du pays. Lorsque la communauté noire a besoin d’assistance, les secours n’arrivent presque jamais à temps, contrairement aux autres quartiers plus riches :
« Ça fait longtemps que j’ai composé le 911 Ne vois-tu pas tout le temps qu’ils prennent Ils ne viennent que quand ils veulent
183
http://www.daveyd.com/peterrord.html « Come get it...Get involved 'Cause the brothers in the street are willing to work it out. Let's get it on... we are willin' (…) Now we are ready if you are ready (…) United we stand, yes divided we fall. Together we can stand tall ».
184
193
La morgue vient embaumer le maccabée, ils s’en foutent parce qu’ils sont payés de toutes façons. »185
Le groupe se spécialisera dans la destruction des légendes américaines. Le film Rebel without a cause mettant en scène l’un des plus grands mythes de l’Amérique blanche, James Dean, devenu la fureur de vivre en France, leur inspirera une chanson intitulée Rebel without a pause comme nous l’avons dit. Lorsque les Beastie Boys, un groupe de rappeurs blancs, sortira la chanson Fight for your right to party (Bats-toi pour ton droit de faire la fête), comme pour rappeler l’urgence qui demeure au sein de la communauté noire, Public Enemy sortira le titre Party for your right to fight (Amuse-toi pour ton droit de te battre) (Dufrene, 1991 : 46). Si Public Enemy est le groupe phare du mouvement hip-hop, il ne représente qu’une période du mouvement, en l’occurrence les années 90. En 1988, sur son album Straight outta Compton, le groupe NWA (Niggaz With Attitude), originaire de Los Angeles, s’attaque violemment aux institutions policières à travers la chanson Fuck tha police. En effet, les habitants des quartiers démunis de la ville sont souvent victimes de brutalités policières. Cette chanson sera la prophétie annonçant les émeutes de Los Angeles, après le verdict de l’affaire Rodney King en 1992186. Le rap et le reggae n’ont pas toujours été des moyens de revendication sociopolitique ; ils sont tout deux passés par des étapes différentes, par des phases violentes. Durant les années 60, le reggae donna naissance au Rock Steady, un avatar privilégiant des histoires et des images de gangster ou encore de rude boys (mauvais garçons). La période du Rock Steady fut une période qui décrivait le malaise social, mais du point de vue de criminels rattachés à des gangs urbains. Cette anarchie verbale reflétait l’anarchie politique en Jamaïque (Davis : 1989 : 70, 71). Tout comme la période du
185
« Now I dialed 911 a long time ago. Don't you see how late they're reacting. They only come when they wanna. So get the morgue embalm the gone/They don't care 'cause they stay paid anyway. » 186 Glen « Rodney » King est devenu célèbre malgré lui. Le 3 mars 1991, il est arrêté lors d’un contrôle radar à environ 160 kmh. Parce qu’il refuse de coopérer, King est passé à tabac par quatre policiers blancs. L’interpellation est filmée ; les images font le tour du monde et provoquent l’indignation générale. Lorsqu’en avril 1992 les policiers sont mis hors de cause par un jury exclusivement blanc, la colère éclate et provoque la plus importante émeute raciale du 20e siècle aux Etats-Unis dans la ville de Los Angeles.
194
Rock Steady dans le reggae, durant le milieu des années 90, le rap connut la glorification de la violence à travers la montée d’un genre nouveau baptisé Gangsta rap. Le rap sortit de l’ombre après les émeutes de 1992 à Los Angeles. Les acteurs de la culture hip-hop se mirent à glorifier les activités criminelles et la violence. Ce tournant dégénéra au point d’alimenter une rivalité, quoique nourrie exagérément par les médias, entre la côte Est (New York) et la côte Ouest (Los Angeles). Deux figures clés de chaque camp tombèrent sous les balles à quelques mois d’intervalle : Tupac Shakur (septembre 1996) et Christopher Wallace (mars 1997), surnommé Biggie Smalls. L’activisme social et politique de la culture hip-hop refait surface en 2001. En effet, la communauté hip-hop, représentée par des pionniers tels qu’Afrika Bambaataa, Grandmaster Flash, Chuck D du groupe Public Enemy et des rappeurs tels que KRS-One, remit à l’ONU une déclaration de paix. Cette déclaration, rédigée en 25 paragraphes, contient l’opinion des acteurs de la culture concernant la direction sociopolitique que devrait prendre la musique rap187. Une autre étape importante dans le lien entre politique et reggae fut la campagne électorale de 1972 en Jamaïque. Durant cette campagne, le reggae et le mythe rastafari ont été manipulés par l’opposition, menée par Michael Manley, pour rallier les masses pauvres à sa cause socialiste. Michael Manley et son parti, le People’s National Party (PNP), utilisèrent des artistes reggae lors de leurs conférences. Ils s’allièrent au mouvement en utilisant ses symboles pour des raisons politiques. Manley utilisa adroitement un bâton surnommé « The Rod of correction », qui lui avait été remis par Haïlé Selassié, le messie des rastas, lors d’un de ses voyages en Éthiopie en 1971. Manley qualifiait ce « bâton de correction » d’arme qui lui permettrait de « purger » la Jamaïque de la corruption. L’opposition avait compris le potentiel du mouvement rastafari, des références à l’Afrique au sein de la majorité pauvre de la Jamaïque188. Le 5 décembre 1976, alors qu’il s’apprête à donner un concert intitulé « Smile Jamaica », Bob Marley est victime d’une tentative d’assassinat chez lui. Bien qu’il se garde d’apporter son appui à un parti, le concert apparaît clairement comme un soutien à Michael Manley, Premier ministre du gouvernement de l’époque. Marley reçoit des menaces de mort de la part des hommes de main du parti adverse, le JLP, convaincu que l’événement
187
www.thetempleofhiphop.com Chevannes Barry, Healing the nation: rastafari excorcism of the ideology of racism in Jamaica publié dans Caribbean sociology: introductory readings, Barrow Christine, Reddock Rhoda, p 605-621.
188
195
pourrait jouer en faveur du PNP lors des élections à venir. Quelques jours avant le concert, un homme armé ouvre le feu sur Marley et son entourage, plusieurs personnes sont blessées mais personne n’est tué. Choqué, tout le groupe se réfugie sur les hauteurs de Kingston, ne sachant plus s’il doit participer au concert. Finalement, escorté par la police, Bob Marley et les Wailers redescendent à Kingston pour jouer, ayant été prévenus qu’ils étaient hors de danger. L’une des premières choses que Marley affirme en montant sur scène, c’est sa neutralité politique pour apaiser les conflits latents. Il réaffirme que lorsqu’il a décidé de participer au concert, il ne l’a pas fait pour soutenir un parti politique, mais pour encourager le peuple jamaïcain (Davis, 1991 : 240-251). Cet événement historique atteste de la violence ouverte qui règnait en Jamaïque et qui déterminait le contexte social, politique et culturel dans lequel le reggae s’est développé. Après ce concert, Marley s’exile pendant deux ans aux États-Unis et en Angleterre. Son retour en février 1978 est un moment historique car il marque la réconciliation, au moins symbolique, entre le Premier ministre Michael Manley et Edward Seaga, le leader de l’opposition. Leurs rivalités avaient entraîné l’île au bord de la guerre civile, les deux partis s’affrontant de façon violente dans les rues de Kingston et dans les autres villes. Par son charisme et la puissance de sa musique, Marley est capable de rapprocher les deux camps politiques et leurs ramifications dans le ghetto (Claudie Massop, leader de la faction armée du JLP et Bucky Marshall pour le PNP). Il est approché par des miliciens des deux camps qui lui demandent s’il accepterait de participer à un concert, dont l’objectif serait de mettre fin à la rivalité meurtrière. Le concert eut un succès inespéré. Toutes les stars du reggae y étaient présentes : Jacob Miller, Inner Circle, The Mighty Diamonds, Peter Tosh, Trinity, Dennis Brown, Culture, Dillinger, Big Youth et Ras Michael and The Sons of Negus (Davis, 1991 : 271-280). Pendant le concert, Peter Tosh harangua sévèrement et ouvertement la classe politique présente pour son inefficacité dans la gestion du pays, lui reprochant de persécuter les rastas à cause de l’herbe, un monologue d’environ une demi-heure qui lui valut d’être arrêté en possession d’herbe et passé à tabac par la police un mois après. Quant à Bob Marley, il demanda aux deux leaders politiques de le rejoindre sur scène afin de se serrer la main en signe de réconciliation et de démontrer au peuple leur volonté de travailler ensemble dans l’édification du pays. Tandis que Marley prenait leurs mains et les joignait au-dessus de sa tête en signe de réconciliation, Edward Seaga et Michael Manley avaient l’air distants et pétrifiés. Cette réconciliation mythique fut quand même un moment significatif dans l’histoire politique de la Jamaïque. Encore une fois le reggae était à l’avant- garde. Les deux derniers exemples les plus récents de contestation à travers le rap sont en rapport avec les événements liés à la tempête Katrina en 2005 et aux événements du 11 septembre 2001.
196
La communauté hip-hop s’est mobilisée en organisant des concerts au profit des habitants de la Nouvelle-Orléans. La controverse fut lancée par la déclaration d’un rappeur populaire lors d’un téléthon en faveur des victimes sur la chaîne nationale NBC, le 2 septembre 2005. En pleine crise nationale, alors que les secours avaient de la peine à s’organiser pour porter assistance à la population, le rappeur Kanye West déclara que George Bush ne se souciait pas de la communauté noire. Le monde politique ne resta pas insensible à cette déclaration. Katrina révéla le traitement subi par la population noire. En effet, à travers les plans d’assistance et d’aide, cette dernière avait été oubliée et laissée pour compte. Le gouvernement fédéral n’a pas pris en charge les plus pauvres de la Nouvelle-Orléans, majoritairement noirs. En sa qualité de président, George Bush alimentait le sentiment de négation et d’oubli que vit la communauté noire aux ÉtatsUnis. La déclaration de Kanye West fut un écho de ce sentiment partagé. À la suite de ce commentaire, plusieurs chansons ont été enregistrées par des rappeurs sur l’événement en lui-même, la manière dont la crise a été gérée par le gouvernement et vécue par la population noire de la NouvelleOrléans : « Mother Nature » de Papoose et Razah, « George Bush doesn’t care about black people » de Legendary K.O, « Hell no, we ain’t alright » de Public Enemy, etc. Cependant celle qui retient le plus notre attention c’est la composition du rappeur Mos Def Katrina Klap. C’est une critique en direction du gouvernement Bush qui n’a pas réagi assez rapidement pour porter assistance aux démunis Africains-Américains. Pour ce faire, il compare la tempête à une claque administrée à la population noire, non pas par la nature, mais par le gouvernement américain : « Dieu sauve ces rues/Un dollar par être humain/Ressens la claque de Katrina/Vois la claque de Katrina/Ecoute frère, c’est le jour du dollar à la Nouvelle-Orléans/Il y a de l’eau partout et des gens morts dans la rue et M. le Président, il est près de sa thune/Il a une politique pour gérer les frères et les ordures/Si tu es pauvre, tu es noir/Je me marre, on ne te donne rien quand tu demandes/Pour eux, on est mieux, drogués au crack, morts ou en prison, ou avec un fusil en Iraq. »189
189
Mos Def, True Magic, Geffen Records: 2006. « God save these streets, One dollar per every human being/Feel that Katrina clap/See that Katrina clap/Listen homie, it dollar day in New Orleans/It’s where there is water everywhere and people dead in the street and Mr President he bout’ that cash/He got a policy for handlin’ the bruthas and trash/ If you poor you black/I laugh a laugh, they won’t give you when you ask/You betta off crack, dead or in jail, or with a gun in Iraq. »
197
Immortal Technique, un rappeur américain originaire du Pérou et vivant à Harlem, a été, depuis 2001, l’un des représentants les plus radicaux du courant politique au sein du hip-hop. Dans ses albums, on retrouve des interventions de l’activiste noir Mumia Abu Jamal. Dans ses chansons, il s’est attaqué durement aux dirigeants du gouvernement de manière précise, exposant des faits et une opinion partagée par les opposants à l’invasion de l’Irak. Avec Mos Def, dans une chanson intitulée Bin Laden, il rend compte de sa vision de la guerre et des motivations du président Bush : Mos Def : « Bin Laden didn't blow up the projects/It was you, nigga/Tell the truth, nigga (Bush knocked down the towers) Tell the truth, nigga (Bush knocked down the towers) Tell the truth, nigga (…) »190 Immortal Technique : « Regarde leurs belles maisons et regarde les conditions dans lesquelles tu vis/ Ils ne parlent que de terrorisme à la télévision/ Ils vous demandent d’écouter mais ils ne vous disent pas en quoi consiste leur mission/Ils ont financé Al-Qaida, et maintenant ils blâment la religion musulmane/ De plus Ben Laden était entraîné par la CIA/ Ils lui ont donné des milliards de dollars et ils ont financé son projet/ Fahrenheit 9/11191 n’a fait que gratter la surface/Ils disent que les rebelles en Iraq se battent toujours pour Saddam/ Mais ce sont des conneries et je vais vous montrer pourquoi c’est faux/ Si un autre pays envahissait le quartier ce soir/ Ça serait la guerre civile à Harlem et à Washington Heights/ Je ne me battrais pas pour les rêves de Bush et de l’Amérique blanche/ Je me battrais pour la survie de mon peuple et ma fierté. »192
Les commentaires politiques ne sont pas dirigés uniquement vers le pouvoir institutionnel, mais aussi vers la communauté noire et la communauté hiphop. S’insurgeant contre le néo-colonialisme et le matérialisme, certains
190
« Bin Laden n’a pas fait péter les cités C’est de ta faute, négro Dis la vérité, négro/ Bush a fait exploser les tours/ Dis la vérité négro/ Bush a fait exploser les tours/ Dis la vérité négro. » 191 Documentaire réalisé par Michael Moore en 2004 sur le rôle de l’argent et du pétrole dans les événements du 11 septembre 2001. 192 Single Bin Laden, Viper Records, 2005. « Look at they mansions, then look at the conditions you live in/All they talk about is terrorism on television/They tell you to listen, but they don't really tell you they mission /They funded Al-Qaida, and now they blame the Muslim religion/Even though Bin Laden was a CIA tactician/They gave him billions of dollars, and they funded his purpose/Fahrenheit 9/11, that's just scratchin' the surface (…) They say the rebels in Iraq still fight for Saddam/But that's bullshit, I'll show you why it's totally wrong Cuz if another country invaded the hood tonight/It'd be warfare through Harlem and Washington Heights/ I wouldn't be fightin' for Bush or White America's dream/I'd be fightin' for my people's survival and self-esteem. »
198
artistes rap n’hésitent pas à rappeler à leurs auditeurs, avec une ironie cruelle, les conditions dans lesquelles les Africains ont été débarqués aux États-Unis, en faisant le parallèle avec leur situation actuelle : « Ces gars boivent du champagne et portent des toasts à la mort et à la souffrance comme des esclaves sur des négriers parlant de qui a la plus belle chaîne »193
Le rappeur Cee-Lo montre les disparités entre les Africains-Américains et leurs ancêtres : « Nous ne sommes pas des tueurs nés. Nous sommes un peuple spirituel élu de Dieu/ Repensez à l’esclavage quand ils avaient des bateaux avec des centaines des nôtres à bord Et qu’on louait toujours le Seigneur. Aujourd’hui, t’es prêt à mourir à cause d’un manteau, d’un collier autour de ton cou. Ce sont des conneries! Peuple noir/ Réalise qu’on se perd. »194
Le groupe Public Enemy a également composé une chanson sur les répercussions de la drogue sur la communauté noire, morceau intitulé The nights of the living baseheads, une mise en garde contre la vie menée par les dealers et la destruction engendrée par ce style de vie. Dans sa chanson Murderer Buju Banton, un toaster jamaïcain converti à la foi rastafari, dépeint froidement la réalité des tueurs employés pour exécuter des personnes dans le ghetto : « Meurtrier! Tu as du sang sur les épaules/ Meurtrier aujourd’hui, tu le seras demain/Meurtrier! À l’intérieur tu dois être vide/ Comment ça fait de prendre la vie d’un autre? »195
193
Talib Kweli and Hi-Tek, Reflection Eternal, Africa Dream, Rawkus Records, 2000. « These cats drink champagne and toast to death and pain like slaves on a ship talking about who got the flyest chain. » 194 Goodie Mob, Album: Soulfood, Fighting, Arista Records, 1995. « We ain’t natural born killers/ We are a spiritual people, God’s chosen few/Think about the slave trade when they had boats with thousands of us on board and we still was praising the Lord/ Now you ready to die over a coat/ A necklace around your throat/ That’s bullshit Black people, you better realize that we loosing. » 195 Buju Banton, Album: Til Shiloh, Island Record, 1995. Version originale : « Murderer! Blood is on your shoulders/Killer today you gon be killer tomorrow/ Murderer! Your insides must be hollow. How does it feel to take the life of another?»
199
La culture hip-hop et le mouvement rastafari forment tous deux des perceptions politiques dans la vie de leurs adeptes. Ce sont des manières de prendre conscience de son identité de « ce qu’on est » par rapport à ceux qui nous entourent. Leurs membres ont su réagir par la musique, principalement, aux effets négatifs de la politique économique et sociale des gouvernements en place. Si, par le biais du rap et du reggae, les membres de la communauté hip-hop et de la communauté rasta ont pu se faire entendre, le manque d’activisme sociopolitique demeure un handicap majeur. « C’est toujours facile pour nous d’être prêts à bouger et prêts à parler, prêts à agir mais si nous n’allons pas au cœur du ghetto, si nous ne commençons pas à traiter le problème des emplois, des écoles et des autres questions élémentaires, nous ne serons pas en mesure d’avoir une perspective révolutionnaire ou d’enclencher une révolution à ce propos »196 Malcolm X, le 13 décembre 1964 (Cité dans Stand and Deliver : political activism, leadership and hip-hop culture d’Yvonne Bynoe).
Cette pensée de Malcolm X est toujours actuelle. La musique en elle-même, malgré le contenu des textes, ne peut pas modifier la situation car ce sont les actions concrètes menées au sein de la communauté noire, les votes traduisant un pouvoir politique qui feront la différence. Yvonne Bynoe articule fort bien cette pensée dans son livre Stand and deliver : political activism, leadership and hip-hop culture (2004). Des réserves ont été émises par des critiques tels qu’Adoplh Reed Jr, arguant que les rappeurs ne devraient pas confondre l’expérience politique avec les scènes qu’ils mettent en place dans leurs clips vidéo. Cela vaut aussi pour les artistes issus de la communauté rasta. Le mouvement hip-hop et le mouvement rastafari ne possèdent pas un agenda politique comme les partis politiques traditionnels s’adressant aux problèmes spécifiques de leurs membres. Il existe des adeptes des mouvements qui sont affiliés à des partis politiques traditionnels ou qui ont créé leur propre parti, mais ceux-ci ne représentent pas l’opinion de tous les adeptes. Le succès commercial de certains artistes ou de certains dirigeants de maisons de disques n’a pas profité à l’ensemble des masses noires. Les artistes issus des mouvements hip-hop et rastafari peuvent traduire une orientation politique à travers leurs disques, leurs concerts ou
196
« It’s always easy for us to be ready to move and ready to talk and ready to act, but unless we get down into the heart of the ghetto and begin to deal with the problem of jobs, schools, and the other basic questions, we are going to be unable to deal with any revolutionary perspetcive, or with any revolution for that matter. »
200
encore leurs vidéos, néanmoins, n’ayant pas une formation politique proprement dite, ils ne peuvent pas être aussi des leaders politiques engagés dans l’arène politique. En 1987, consterné par l’attente que sucitait les rappeurs, le musicien et activiste africain-américain, producteur du premier album du groupe Public Enemy, Bill Stephney déclara: « Malheur à une communauté qui doit compter sur les rappeurs pour prendre une direction politique. Parce que ca ne correspond pas à un progrès mais à un manque. (…) Si notre leadership doit être assuré par un gamin de 18 ans qui n’a aucun projet, on est dans la merde. »197
Las d’entendre dire que la génération hip-hop était ignorante des réalités du monde politique, en 2002, deux personnalités africaines-américaines se sont mobilisées. Russell Simmons, l’ancien dirigeant de la plus célèbre maison de disques de rap (Def Jam), et le Dr Benjamin Chavis, un activiste africainaméricain. Ils ont créée un réseau politique nommé « The hip-hop Summit Action Network ». Le but de l’organisation « HSAN » est de rendre la génération hip-hop plus consciente de l’importance du vote et de l’activisme politique. Soutenue par des acteurs du mouvement hip-hop, elle organise régulièrement des séminaires et des conférences en ce sens198. L’engagement politique qui se veut représentatif du peuple nécessite un engagement total et ne peut être mené en parallèle avec une carrière artistique importante. Les artistes ne peuvent pas être à la base des projets politiques ; cependant ils peuvent en être les détonateurs, des mannes financières qui soutiennent les acteurs politiques déjà engagés. 6/ La libération mentale et psychologique Le rap et le reggae ont également été des cris de liberté. Ils ont tour à tour exprimé l’aspiration à la liberté du peuple noir aux États-Unis et dans la région Caraïbe. Le thème de la libération mentale et psychologique demeure un lieu commun des deux musiques. Les rastas ont été les premiers à populariser le concept de « l’esclavage mental », notamment à travers la chanson de Bob Marley, Redemption song :
197
198
Une histoire de la génération hip-hop, Jeff Chang, 2005 : p. 347. The Source Magazine, N°206, janvier 2007.
201
« Libère-toi de l’esclavage mental, nous sommes les seuls à pouvoir délier nos esprits. »199
À l’instar de Marley, le chanteur Capleton affirme : « Personne, à part nous, ne peut libérer nos esprits/Jah vient enlever les chaînes de leurs esprits/Et pourtant beaucoup d’entre eux agissent comme des aveugles/Tous les ans Babylone a un nouveau plan/Je vois les génocides qu’ils ont en tête/ Libère ton cœur, veille sur ton esprit toi-même »200
Aux États-Unis, aux yeux des jeunes qui vivent au sein des quartiers défavorisés des grandes villes, la musique rap est devenue un moyen d’échapper à leurs conditions de vie. Il n’est pas rare d’entendre les rappeurs ou de jeunes Africains-Américains dire que la musique est leur passeport de sortie du ghetto. Dans ce contexte, les rappeurs du duo Dead Prez remettent en question cette vision consumériste, étant donné l’exploitation des maisons de disques dont sont victimes les artistes : « Négro, ne pense pas que ces contrats de production vont nourrir ta famille et payer tes factures parce que c’est pas le cas ! Suffit que les MCs soient un peu adulés et ils se croient bons/Ils parlent de l’argent qu’ils ont, tous vos disques se ressemblent/J’en ai marre des scénarios de faux gangsters, des combinaisons rap et rnb toute la journée à la radio/Les mêmes scènes dans les vidéos, le même matérialisme, vous me comprenez pas/Ces maisons de disques distribuent nos disques comme de la drogue/Tu peux être le prochain à signer et malgré cela écrire des rimes en n’ayant aucune thune/Tu préfères avoir une Lexus201, un peu de justice, un rêve ou un peu de substance? Une BMW, un collier ou ta liberté ?»202
199
«Emancipate yourself from mental slavery, none but ourselves can free our minds » 200 Capleton, I Testament, No man can save no man, Def Jam, 1997. « Well none but ourselves shall free our mind/ Jah come to take the chain off dem mind/ Still nuff a dem a go on like seh dem blind (…) Every year Babylon dem have a new plan design/ Me see dem with dem genocidal mind (…) Free your own heart guard your own mind. » 201 Dans le milieu rap, posséder une voiture de marque Lexus est synonyme de réussite et de luxe. 202 Dead Prez, Let’s get free, Hip-hop, 2000, Loud Records. « (…) Nigga, don’t think these record deals gonna feed your seeds and pay your bills because they’re not. Mcs get a little bit of love and think they hot/Talkin bout how much money they
202
Conserver sa liberté dans l’arène du conformisme artistique et matérialiste imposé par la logique économique capitaliste, c’est la pensée qu’articule le duo Dead Prez à travers ces paroles. La comparaison du duo qui assimile les maisons de disques à des dealers et les disques des artistes rap à de la drogue n’est pas éloignée de la réalité. En effet, les dirigeants de ces compagnies ont une méthode de travail semblable à celle des dealers : trouver le meilleur produit et le distribuer au plus grand nombre afin d’augmenter leurs marges de profits. Si le produit est bon, l’accoutumance fera revenir les acheteurs. Dead Prez invite aussi ses auditeurs à s’émanciper des objectifs matérialistes qui régissent la société et à viser des objectifs plus nobles. Il les exhorte également à se libérer de l’emprise des substances narcotiques et les incite à réfléchir à de véritables projets d’avenir. Dans un autre titre intitulé Freedom, il déclare : « Je ne veux pas être une star du cinéma, je ne veux pas conduire une voiture de marque. Je veux juste être libre, libre de vivre ma vie de vivre ma propre vie »203
Dans leurs paroles, M 1 et Sticman manifestent le désir de prendre leur vie en main. Buju Banton écrit une chanson intitulée Destiny où il exprime des sentiments identiques : « La fortune de l’homme riche est dans la ville/La destruction de l’homme pauvre c’est la pauvreté/ La destruction de ton âme, c’est la vanité/Vous m’entendez ?/ Je veux contrôler ma destinée. »204
Las des souffrances vécues au quotidien, Sizzla, un chanteur rasta, proclame le droit de la communauté noire à se révolter et à se faire entendre :
got, all yall records sound the same/I sick of that fake thug, r & b, rap scenario all day on the radio/ Same scenes in the videos, monotonous material, yall dont hear me though/These record labels slang our tapes like dope/You can be next in line, and signed, and still be writing rhymes and broke/You would rather have a Lexus, some justice, a dream or some substance? A beamer, a necklace or freedom? (…) » 203 Dead Prez, Let’s get free, Hip-hop, 2000, Loud Records. « I don't wanna be no movie star, i don't wanna drive no fancy car. I just wanna be free, to live my life, to live my own life. » 204 Buju Banton, Album: Inner Heights, Destiny, Heartbeat, 1997. « The rich man's wealth is in the city /Destruction of the poor is his poverty/ Destruction of your soul is vanity Do you hear I and I? I wanna rule my destiny I and I, I wanna rule my destiny. »
203
« Sans aucune raison nous avons été emprisonnés, faites-vous entendre/ Souvent, ils prennent le peuple noir pour cible/ Ils ont le culot de tuer des innocents/ Ça suffit avec vos façons de faire ! La liberté pleure/ Peuple noir, sèche tes larmes ! Homme noir lève-toi! Trop longtemps que tu te caches. »205
Dans la même chanson, Sizzla, à travers un interrogatoire sur les réparations dues au peuple noir, s’adresse de manière personnelle, voire impertinente, a la reine d’Angleterre, qui, pendant longtemps, à administré la Jamaïque durant la période coloniale : « Elizabeth, qu’en est-il des réparations ? »206
Cette libération mentale implique de façon explicite la remise en question de l’ordre établi, des grandes institutions, des traditions, et surtout de l’origine de l’information diffusée par les médias. En 1975, lors de l’annonce du décès d’Haïlé Selassié, Bob Marley enregistre une chanson intitulée Jah Live où il contredit la nouvelle de sa mort. Son message est évident le dieu des rastas ne peut pas mourir les affirmations des médias de « Babylone » sont fausses : « Jah vit, les enfants, Jah vit/ Jah vit, les enfants, Jah vit/ Les imbéciles disent : Rasta ton dieu est mort/ Mais nous le savons/Craint, il doit être craint et plus que craint/ Jah vit, les enfants, Jah vit/ Jah vit, les enfants, Jah vit »207
Le groupe Public Enemy s’oppose à l’image que les médias nordaméricains donnent de l’homme noir dans sa chanson Don’t believe the hype. Il critique l’image négative que renvoient les médias à travers les informations et les reportages :
205
Sizzla, Freedon cry, Jammin’ Record, 1998. « (…) for no reason we have been prisonned/ Youth let your voices be heard/Yo and every season dem target black people/To kill the innocent dey have the nerve/ Up with your policies (…) Freedom cry/ Black people wipe the tears from your eye/ Blackman rise! Too long you dere inna your disguise » 206 « Elizabeth, what about the compensation ? » 207 « Jah live! Children yeah! Jah-Jah live! Children yeh/Jah live! Children yeah ! Jah-Jah live! Children yeh, Jah/Fools say in their heart, Rasta your God is dead but I and I know Jah-Jah! Dread it shall be dreader and dread/Jah live! Children yeah! Jah-Jah live! Children yeh/Jah live! Children yeah! Jah-Jah live! Children yeh. »
204
« Ils disent que je suis un criminel/ Dès qu’ils me voient, ils ont peur/Je suis la personnification de l’ennemi public/ Utilisé et abusé sans le moindre indice/ Je refuse de péter un plomb/ Ils l’ont même dit au journal/ Ne crois pas au battage médiatique. »208
Enfin dans sa chanson Propaganda, Dead Prez questionne également l’origine des informations données par les médias : « Je ne crois pas que Bob Marley soit mort du cancer/ Il y a 31 ans, j’aurais été un (black) Panther/ Ils ont tué Huey (cofondateur du Black Panther Party) parce qu’il avait la réponse/Les opinions que tu vois aux nouvelles c’est de la propagande (…) On ne peut pas tromper tout le monde tout le temps mais si tu trompes les bonnes personnes alors les autres les suivront/Dis-moi qui contrôle ton esprit ta vision du monde est-ce que c’est le journal télévisé?»209
Ces paroles se rapprochent clairement de la rhétorique et du mouvement rastafari. Dead Prez remet en cause les raisons de la mort du « prophète rasta » puis il remet en question une affirmation contenue dans la célèbre chanson de Marley et des Wailers Get up Stand up. Dans cette chanson Peter Tosh déclare: « Vous pouvez tromper quelques personnes quelquefois mais vous ne pouvez pas tromper tout le monde tout le temps »210
Dead Prez va plus loin et affirme que si l’on se joue des « bonnes personnes », autrement dit les dirigeants de la communauté, alors le reste du peuple sera lui aussi trompé ; c’est ainsi qu’il met en exergue le rôle capital des médias ainsi que leur capacité à convaincre.
208
« They claim that I'm a criminal/The minute they see me, fear me/I'm the epitome - a public enemy/Used, abused without clues/I refused to blow a fuse/They even had it on the news/Don't believe the hype » 209 « I don’t believe Bob Marley died from cancer/31 years ago I would have been a panther/They killed Huey cause they knew he had the answer/The views that you see in the news is propaganda/ You can’t fool all the people all the time but if you fool the right ones then the rest will fall behind/Tell me who’s got control of your mind, your worldview. Is it the news ? » 210 « You can fool some people sometimes but you can’t fool all the people all the time. »
205
À travers les chansons reggae et rap, il importe d’expliquer et de ne pas laisser le champ libre aux agents de l’information d’une société hostile. Enfin, le fait religieux, qui est embrassé comme un moyen de résistance, est invoqué dans les deux courants musicaux. 7/ Le fait religieux Les musiques noires se sont toujours nourries de religion et ce, depuis l’époque de l’esclavage. La religion, chrétienne ou musulmane, prône la libération des masses et la justice divine. Issus de communautés où règne l’inégalité, le reggae et le rap ne pouvaient pas ignorer le fait religieux. Dans son ouvrage Five Percenter Rap : God’s hop music, Message and Black Muslim Mission (2005), Felicia Miyakawa explique la relation entre la Nation de l’Islam et la culture hip-hop. En 2003, Anthony Pinn a édité un ouvrage plus général traitant de la relation entre la musique rap et le fait religieux intitulé Noise and spirit : the religious and spiritual sensibilities of rap music. La Nation de l’Islam a joué et continue à jouer un rôle important dans la culture hip-hop. Le mouvement rastafari étant un mouvement religieux, il est moins surprenant de retrouver ce discours dans l’expression de ses adeptes. Dans le discours rastafari et le discours hip-hop, le christianisme est souvent remis en question, critiqué pour avoir permis l’asservissement des populations noires. La croyance en un être divin qui mérite d’être révéré et qui soutient la communauté est véhiculée dans les textes des artistes de manière similaire. Le rappeur KRS-One et le chanteur rasta Sizzla émettent des critiques semblables à l’égard du christianisme, souvent identifié à l’oppresseur. L’arrivée des missionnaires catholiques dans l’Amérique anglophone correspond à l’arrivée des colons blancs. A travers la chanson Higher level, KRS-One déclare: Vous voulez savoir comment on s’est fait avoir depuis le début ?/On a accepté la religion de nos oppresseurs/Donc dans le cas de l’esclavage ce n’est pas difficile pour eux parce qu’aux yeux de leur Dieu, c’est juste/ Où est notre Dieu, le Dieu qui nous représente/Le Dieu qui me ressemble, le Dieu à qui je peux faire confiance ?211
211
« You wanna know how we screwed up from the beginning?/We accepted our oppressors’s religion/So in the case of slavery it ain’t hard because it’s right in the
206
C’est ce même désir d’avoir un Dieu à leur image qui motiva les premiers adeptes du mouvement rastafari à reconnaître Haïlé Sélassié, alors empereur d’Éthiopie, comme leur Dieu. De son côté, Sizzla élève la voix contre l’évangélisation : « Je vois Bob Marley se lever et vous avez tué le prophète/Pourquoi vous ne tuez pas ceux qui sont debout sur vos pupitres/Vous les utilisez pour égarer l’esprit des jeunes et quand ils prêchent les jeunes ne découvrent plus la vérité/C’est la vérité qui explique ce que nous vivons/Je vois comment vous continuez à construire des églises mais tant que votre Eglise prône l’immoralité comme d’habitude, les rastas ne se mélangeront pas avec les homos»212
Leur position ne reflète pas une opinion anti-religieuse mais elle constitue plutôt une déclaration en faveur d’une affirmation religieuse afrocentrique. Cette conviction pousse ainsi le rappeur Ice Cube, dans sa chanson When I get to heaven, à déclarer : « Le diable a fait de toi un esclave et t’a donné une Bible/ Est-ce que c’est ça ta religion ? Homme noir, tu dois prendre une décision. »213
Ice Cube s’inspire d’un cantique très connu aux États-Unis, chanté par les chrétiens protestants et intitulé When i get to heaven. Ce faisant, il critique l’aliénation de l’homme noir engendrée par le christianisme. Il est à noter qu’il existe également un courant dans la musique rap qui est en faveur du christianisme avec des rappeurs tels que The Crossmovement, Corey Red and Precise (rattachés aux Eglises protestantes) et Kanye West (dans le milieu séculier).
eyes of their God/Where is our God, the God that represents us/The God that looks like me, the God that I can trust?» 212 « (…) I see Bob Marley rise and unu killed the prophet/Why you don’t kill those standing on your pulpits/you use dem to steer di minds of di yout an as they preach di youth cease from knowin’ di truth/ This is the truth above our circumstances/I see how yuh constantly building churches but while yuh church defend di slackness as usual, rasta no mix up with homo (…) » 213 Album : Lethal Injetcion, EMI Records, 2003. « The devil made you a slave and gave you a bible/ (…) Is that your religion? Black man, you got to make a decision»
207
Dieu (qu’il soit personnifié par Haïlé Sélassié ou Jésus) est aussi un être qui s’intéresse à la situation des communautés noires. Ce sentiment apparaît dans les deux musiques, tandis que Nas, rappeur originaire de New York, chante : « Dieu nous aime les Négros du quartier/Parce qu’à côté de Jésus sur la croix il y avait les Négros escrocs et les tueurs/Dieu nous aime les négros du quartier/Parce que dans la rue il y a les Négros du quartier et je sais qu’il nous comprend/ Dieu nous aime les Négros du quartier parce qu’il est avec nous dans les prisons et il prend le temps d’écouter»214
Sizzla chante dans sa chanson intitulée Guide over us : «Dirige-nous, empereur SélassiéI, leur route est difficile et raide/Je sais que nous devons rentrer chez nous»215
La réhabilitation de l’histoire du peuple noir, l’oppression des forces gouvernementales, la valorisation de la femme noire, la critique sociopolitique et la libération psychologique de la communauté noire et le fait religieux sont des thèmes qui sont tous évoqués à la fois dans les paroles des chansons rap et des chansons reggae. Certes, le répertoire que nous avons ciblé n’est pas exhaustif mais il est assez explicite. Il faut savoir que les chansons rap que nous avons citées ne sont pas les plus médiatisées. Elles représentent tout de même les sentiments d’une partie de la communauté hip-hop qu’il convient de prendre en compte. Le rap et le reggae sont deux musiques nées dans des espaces urbains défavorisés communément appelés des ghettos. Même si elles se sont réparties dans plusieurs communautés ethniques, elles restent ancrées au sein de la communauté noire des Amériques. Grâce à un environnement commun, des communautés et des barrières socio-économiques communes, les paroliers du reggae et du rap ont exprimé au cours des années, des sentiments et des positions idéologiques analogues. La musique est devenue un trait d’union entre l’Afrique, la Caraïbe et les États-Unis. Ces différentes
214
Album: Nastradamus, Sony Records, 1999. «God love us hood niggaz/Cause next to Jesus on the cross was the crook niggaz and the killers/God love us hood niggaz/Cause on the streets is the hood niggaz and I know he feel us/God love us hood niggaz cause he be with us in the prisons and he take time to listen. » 215 Album : Black, Woman and child, Greensleeves Records, 1997. «Guide over us, emperor Selassie I, dem road rugged and steep/I know it is a must for us to make it home (…) »
208
circonstances ont favorisé la collaboration entre des artistes rastafari qui s’expriment à travers le reggae et des artistes rap. «On m’a toujours dit de comporter en fonction de mon âge, pas de ma couleur, je ne savais pas que j’avais la couleur de l’homme originel donc aujourd’hui j’ai un nouveau chant Negro Spiritual/il fait…debout !lèves toi ! Lève-toi pour tes droits ! Debout !lèves toi ! Lève toi!N’abandonnes pas le combat! »216
Dans cette chanson, le rappeur Common Sense reprend les paroles du titre de Bob Marley et des Wailers (Get up, stand up). Cet emprunt est lourd de sens. Les negro-spirituals ont, par le passé, été des structures de résistance émotionnelle, spirituelle et psychologique pour le peuple africain-américain. Avec la reprise des paroles de Marley sur un rythme rap et la déclaration selon laquelle elles sont le nouveau negro-spiritual qu’il a découvert, implicitement, il relie le destin de la diaspora noire dispersée aux États-Unis, en Jamaïque et dans le Tiers-Monde. Ce chant a été un hymne international lors de la vague de décolonisation dans le Tiers-Monde. Common Sense relie également, à travers la musique, l’histoire du mouvement hip-hop et mouvement rastafari. La collaboration musicale entre les courants musicaux des mouvements hip-hop et rastafari se manifeste sous plusieurs formes. Dans le domaine musical, des figures du milieu rap collaborent avec des artistes qui font partie du mouvement rastafari sur des supports reggae : Dead Prez (deux rappeurs) et Stephen Marley (un chanteur rasta) sur les titres Dem crazy217 et It was written218. Dans ces deux chansons, les deux partis adoptent le même positionnement sociopolitique quant à la condition du peuple noir et à la corruption des instances politiques, sans pour autant confesser les principes théologiques du mouvement rasta. Le groupe de rap X-Clan, avec le chanteur rasta Damian Marley, a produit un titre intitulé Culture United (X-Clan, Return from the Mecca, Suburban Noise Records, 2006). Les rappeurs posent leur voix sur du reggae et ensemble les artistes lancent un appel en faveur de l’unification des mouvements hip-hop, rastafari et dancehall à travers la musique. Dans une collaboration avec Jah Orah, un toaster rasta, X-Clan évoque la violence dans les quartiers noirs ainsi que le style de vie positive qu’ils ont
216
Common Sense, Book of life, album : Resurrection, Relativity records, 1994. « I was always told to act my age not my colour not knowing that my colour was that of the original so now i see the new Negro spiritual/it goes…get up! Stand up! Stand up for your rights! Get up! Stand up! Stand up! Don’t give up the fight! » 217 Album: Black and White, Mars 2000, Sony records. 218 Album: Turn off the radio: Mixtape Vol 1, Novembre 2002, Landspeed records.
209
choisi de vivre dans cet univers. Le support musical est un style rap influencé par le courant dancehall. Le chanteur rasta Capleton collabore avec le rappeur Method Man sur un titre intitulé Wings of the morning (Capleton, Prophecy, 1995, Def Jam), tandis que Capleton explique la corruption et la violence qui existent dans les ghettos de Kingston et que Method Man traite de la situation dans les rues de New York. Les deux artistes s’accordent à dire que les responsables ne pourront pas échapper au jugement d’Haïlé Sélassié. Dans d’autres cas, la fusion musicale s’opère à un autre niveau. Les rappeurs choisissent de scander leurs messages sur un support reggae. Le thème n’est pas systématiquement en rapport direct avec le discours rastafari, mais le rappeur s’exprime sur un support reggae : Le rappeur Kardinal Official vit au Canada et est originaire de Trinidad. Il rappe l’histoire d’une jeune femme avec qui il a eu une relation amoureuse sur un rythme reggae (Quest for fire, MCA Records, 2001). Sur des musiques rap, les artistes rasta collaborent avec des rappeurs sur des thèmes divers : Les relations amoureuses sur le titre Hey baby de Stephen Marley et du rappeur Mos Def (Mind control, Tuff Gong Records, 2007), Damian Marley et la rappeuse Eve sur le titre Where is the love ? Damian Marley s'inscrit entre « tradition musicale rastafari » et modernité, puisqu'il n'hésite pas à mélanger son style jamaïcain au rap américain, ce qui révèle les influences américaines en Jamaïque sur le mouvement rastafari lui-même mais également l'attirance des rappeurs américains pour ce dernier. Damian Marley a invité plusieurs artistes rap à collaborer sur des titres de son album Half-way Tree en 2001. Ces collaborations se font toujours sur des rythmes rap. Avec la rappeuse nord-américaine Eve sur le titre Where’s the love ?, il aborde le sujet des relations entre hommes et femmes. Sur le titre Educated fools, avec le rappeur Treach, il critique les décideurs en place qui pillent les ressources naturelles de la planète. Sur son deuxième album, Damian Marley collabore avec le rappeur Black Thought du groupe The Roots et avec le célèbre rappeur New Yorkais Nas. Dans la chanson avec Black Thought, il reprend un titre de Bob Marley sur un support rap intitulé Pimpers paradise. Ils décrivent la vie d’une jeune femme droguée. Le chanteur rasta Sizzla collabore avec le rappeur Styles P sur un titre intitulé Fire and pain (Art of war mixtape, vol. 2) sur un support rap. Leurs paroles décrivent les douleurs intérieures qu’ils ressentent et leur animosité à l’égard des forces sociales et politiques. Selon eux, ce sont ces instances principales conditionnent la pauvreté des communautés noires. Sizzla a collaboré avec de nombreux rappeurs tels que Mobb Deep, Mos Def et Nas.
210
La plus récente fusion musicale entre les deux courants est celle expérimentée dans la chanson Trafic Jam de Stephen et Damian Marley. Sur un support beatbox, une rythmique rap authentique martelée par la voix utilisée comme percussion vocale, les deux chanteurs défendent leur consommation de marijuana. Le beatbox, boîte à rythme humaine, est une discipline qui a été développée au sein du mouvement hip-hop et, dans ce cas, elle fusionne avec le chant rastafari. Enfin, la dernière forme de médiation entre le rap et le reggae rastafari que nous avons observée est tout aussi particulière car, dans ce cas, ce sont des artistes rap qui reprennent des chansons d’artistes rasta. À cet égard, le groupe Fugees réinterprète la chanson No woman, no cry de Bob Marley. Ils ne rappent pas, mais deux membres du groupe (Wyclef Jean et Lauryn Hill) réinterprètent le chant dans leur propre contexte à New York. C’est ainsi que les paroles originales de la chanson : « Je me rappelle quand nous nous asseyions dans le parc à Trenchtown observant les hypocrites » 219
elles sont transformées par le groupe Fugees comme suit : «Je me rappelle quand nous nous asseyions dans le parc à Brooklyn observant les passants de New Jersey »220
Dans la même catégorie, le rappeur Warren G adapte un texte original de Bob Marley I shot the sheriff à son contexte pour évoquer la brutalité policière. La version de Bob Marley s’articulait ainsi : « J'ai tiré sur le shériff, mais je n'ai pas tué son adjoint, oh non!/J'ai tiré sur le shériff, mais je n'ai pas tué son adjoint, oh non!Tout autour de ma ville natale ils essayent de me traquer/Ils disent que je suis coupable de l'assassinat de l’adjoint, d’avoir ôté la vie au shériff adjoint mais j'ai dit : « J'ai tiré sur le shériff toutefois je jure que c'était de l'autodéfense » J'ai tiré sur le shériff O mon Dieu! et ils disent que c'est un crime énorme »221
219
« I remember when we used to sit in the government yard in Trenchtown, observing the hypocrites » 220 « I remember when we used to sit in the government yard in Brooklyn observing the Jersey heads » 221 Album : Burnin’, 1973, Island Record. « I shot the sheriff but I didn't shoot no deputy, oh no! Oh! I shot the sheriff but I didn't shoot no deputy, Yeah! All around in my hometown they're tryin' to track me down ; they say they want to bring me in guilty for the killing of a deputy, for the life of a deputy. But I say: Oh, now, now.
211
Environ 30 ans plus tard, Warren G reprend le concept pour dénoncer la brutalité policière dont les jeunes Noirs sont victimes dans sa ville, Los Angeles : « J’ai tiré sur le sheriff/Je devais le faire/J’avais mes raisons. Il m’a confondu avec quelqu’un qui était recherché (…) La rue garde des âmes/Les jeunes frères perdent le contrôle/J’arrive à m’en sortir dans tout ce qui se passe. Fais attention aux endroits où tu traînes ils peuvent te piéger et il n’y a personne comme mes potes et la police essaie toujours de me coller dessus quelque affaire de merde. Je reste loin des imbéciles ; ils commettent des crimes et ça attire les flics. Les flics ont des fusils et des menottes et des cellules pour t’enfermer.»222
Warren G replace le texte de Marley à son époque et dans son contexte californien. La plainte de ce dernier est encore valable pour lui, donc il n’a pas de mal à s’approprier son discours. Conclusion Les paroliers et les compositeurs du mouvement hip-hop et du mouvement rastafari échangent leurs moyens d’expressions et s’expriment ensemble. Les thèmes qu’ils expriment se ressemblent par plusieurs points. Si, aujourd’hui, ces deux types de musiques s’adressent à l’ensemble de la société et trouvent un écho multiculturel, multiethnique, ils sont nés d’une même expérience d’exclusion et d’identité perdue vécue par les descendants des Africains transplantés. Cela explique la médiation de ces deux courants musicaux fédérateurs, le rap et le reggae.
Oh! (I shot the sheriff.) - the sheriff. (But I swear it was in self-defense.) Oh, no! (Ooh, ooh, oo-oh) Yeah! I say: I shot the sheriff - Oh, Lord! - (And they say it is a capital offence.) » 222 «I shot the sheriff/I had to shoot the sheriff, it was justifiable. He mistaked me for somebody who was liable (…) Streets keep souls/Young brothers lose control/I seem to maintain through this. Watch where ya kick it, they’ll put you in a twist and it ain’t nobody like my down ass homies and the police always tryin’ to pin some bullshit on me. I keep away from fools, they do crime and it attracts cops. Cops got guns and cuffs and cells too stuff you in. »
212
CHAPITRE 3 LE MOUVEMENT « RASTAFARI-HIP-HOP » Dans ce chapitre, nous avons tenu, nous référant à des artistes rasta engagés dans plusieurs disciplines du mouvement hip-hop, à présenter les formes de la nouvelle culture issue de l’hybridation entre le mouvement rastafari et le mouvement hip-hop. Il ne s’agit plus seulement de l’échange entre leurs moyens d’expression mais de participants prenant sciemment part aux deux mouvements. Nous tenterons de mettre en évidence la manière dont s’expriment ces artistes qui participent au mouvement rastafari et s’expriment à travers le mouvement hip-hop. « (…) repose en paix, on donnera tes poumons à un rasta (…) »223 Nas, album: Hip-hop is dead, 2007
Le rappeur Nas, une figure légendaire du rap américain, dans sa chanson intitulée Hip-hop is dead, insinue que si le mouvement hip-hop meurt, ses poumons pourront être affectés au mouvement rastafari. Dans cette rime, il relie les deux mouvements de manière idéologique et socioculturelle. Selon lui, le mouvement rastafari peut devenir la continuité d’un mouvement hiphop en perte d’idéaux nobles. Dans ce chapitre, nous analyserons l’interculturalité du mouvement hip-hop et du mouvement rastafari à travers deux groupes de rap dont les membres sont adeptes du mouvement rastafari. Nous tenterons de comprendre comment ils perçoivent et vivent leur affiliation aux deux mouvements au moyen de l’analyse de leurs idées, de leurs parcours biographiques et de leurs productions musicales. Nous n’avons pas repéré d’échange entre la danse hip-hop et la danse rastafari qui a lieu au cours des cérémonies religieuses « Nyabhingi ». Cela peut s’expliquer par le fait que la pratique de la danse n’est pas aussi intense et aussi compétitive dans le mouvement rastafari que dans le mouvement hiphop. De nombreux groupes ou artistes hip-hop sont influencés par l’idéologie rastafari. Toutefois, nous avons choisi deux groupes, Duo Live et I-n-I Mighty Lockdown, car nous avons pu les rencontrer et, de ce fait, nous pouvons certifier l’authenticité de leur engagement dans le mouvement rastafari.
223
« … R.I.P., we’ll donate your lungs to a rasta… »
213
3.3.1: I-n-I Mighty Lockdown : New Rochelle, New York
Figure 1 Negus et Jolomite , Cliché de Dre Oba
Nous avons découvert ce groupe de rap grâce à son site internet224. Durant nos recherches et lors d’un voyage à New York, en juillet 2004, nous avons pu les rencontrer et nous entretenir avec eux. Nous considérerons leur parcours social, idéologique et artistique, en fonction des informations obtenues en majeure partie durant notre entretien avec eux et par le biais de leur site internet.
224
Nous transmettons ici l’adresse du site internet car il diffuse des informations originales et bien documentées www.trusfund.com.
214
A/ Origines socioculturelles et intégration à la société étasunienne Le groupe I-n-I Mighty Lockdown est composé de deux rappeurs, Negus (30 ans) et Jolomite (32 ans), d’origine caribéenne. Negus est originaire de la Jamaïque et Jolomite d’Haïti. Ils sont arrivés aux États-Unis durant leur enfance et le groupe s’est formé dans les années 90. Il est le résultat de la fusion de deux groupes distincts : I-n-I et Mighty-Lockdown. Le groupe I-n-I s’est fait connaître avec un album et un titre Fakin’ Jakes produit par Pete Rock, un compositeur africain-américain reconnu dans le milieu hip-hop, tandis que Mighty Lockdown s’est fait connaître dans le milieu underground de la scène hip-hop, le cercle le moins médiatisé du mouvement. Les membres originels du groupe I-n-I sont High Love, Jolomite, Grab-Lover et Rabo. Les membres originels du groupe MightyLockdown sont Ras-Gizzy, Hasgod et King Negus. Les groupes se sont dissous pour diverses raisons, propres à chacun des membres. Jolomite et Negus se sont réunis pour devenir I-n-I MightyLockdown. Selon Negus, I-n-I Mighty Lockdown symbolise la situation du peuple noir, le peuple puissant, la race puissante « mighty », qui est sous le joug de l’oppression « lockdown ». Malgré cela, grâce au mouvement rastafari, cette race se dresse. Jolomite est cuisinier et chauffeur de taxi. Pour expliquer le choix de sa profession, il nous confie que c’est une manière pour lui de se mélanger au peuple et de travailler pour celui-ci : « Je me fonds avec le peuple, pas pour les arnaquer (…) je travaille avec le peuple, il me choisit dans les tranchées de la vie (…) »
Jolomite a suivi des cours du soir à l’université. Il a suivi un cursus de sciences humaines mais abandonna les études, car il ne pouvait plus payer ses droits d’inscription. Cependant, il nous avoua que sa motivation première était qu’il ne voulait plus être sur les bancs du système éducatif de Babylone et aspirait à travailler. Negus a fréquenté également une université à Manhattan, pendant un an et demi, dans le domaine de la recherche sociale. Ses idéaux rasta l’ont poussé à quitter la faculté. Il estimait ne pas pouvoir évoluer comme il l’entendait, étant entouré de beaucoup d’homosexuels. Son attitude vis-à-vis de l’homosexualité s’explique par sa perception de la virilité étant originaire de la région Caraïbe. L’homme démontre sa virilité par l’attrait qu’il exerce sur la gent féminine. Tout processus contraire, particulièrement en Jamaïque, est considéré comme une déviance et donc comme un défaut d’affirmation
215
masculine. Selon Negus, il ne fréquentait pas la faculté de son propre chef, mais plutôt pour plaire à sa famille. Sa foi grandissante dans la religion rastafari le poussa à quitter cet environnement. S’il a connu le travail manuel, dans les dépôts de marchandise, aujourd’hui, il travaille en tant que responsable de la formation des employés dans la deuxième plus grande compagnie d’assurance des États-Unis. Par son apparence (ses cheveux), Negus indique qu’il est considéré et regardé autrement à New York. Le fait de vivre dans cette ville cosmopolite est également une chance pour lui, car, compte tenu de la forte présence caribéenne, la nourriture végétarienne, les divertissements et les lieux de culte pour les rastas sont plus faciles d’accès. Au sein de l’entreprise, il a également suivi des programmes de formation continue pour assumer ses fonctions. Paradoxalement, Negus travaille au milieu du système qu’il repousse en tant que rasta. Lorsque nous lui avons demandé s’il aimait sa profession, il nous a clairement affirmé qu’il préférerait pouvoir s’investir pleinement dans sa compagnie de promotion d’art hip-hop/rastafari. Ce qu’il est important de signaler, c’est que sa présence et les implications de sa foi rastafari sont tangibles et prises en compte au sein de la société. Négus fait partie des trois seuls employés noirs de l’entreprise. Lors des réceptions et des réunions, de la nourriture végétarienne est toujours disponible pour lui. Lorsque les autres employés n’ont pas le droit de laisser pousser leur barbe, Negus laisse deviner sa philosophie grace à son apparence physique, avec sa barbe et ses dreadlocks. Lors de son entretien d’embauche, il a clairement précisé à son employeur qu’il ne couperait pas sa barbe ou ses cheveux par principe religieux. Il a aussi réclamé de ne pas travailler le 23 juillet, qui est un jour de célébration pour les rastas car c’est celui de la naissance d’Haïlé Sélassié, ainsi que le 2 novembre, le jour de son couronnement. Negus est conscient de jouer un rôle d’ambassadeur du mouvement rasta dans un milieu où il est peu représenté et souvent méconnu. Il doit souvent reprendre les collègues qui essaient de tourner sa foi en dérision. Malgré les contraintes de son métier, il arrive à vivre sa différence religieuse et culturelle à l’intérieur de son milieu professionnel, car elle n’est pas réprimée. Jolomite et Negus ont pu terminer leurs études secondaires et entamer des études universitaires. Si Negus a pu accéder à un rang social plus élevé, Jolomite exerce une activité professionnelle que beaucoup de Caribéens exercent à New York. Ils ont tous deux réussi à s’intégrer dans la société nord-américaine en ayant une situation et une activité déclarées.
B/ Expérience religieuse au sein du mouvement rastafari Comment Negus et Jolomite considèrent-ils leur profession de foi dans le mouvement rastafari ? Comment vivent-ils cette croyance aux États-
216
Unis ? Ce sont les deux questions auxquelles nous tenterons de répondre dans cette partie de notre analyse. Originaire de la région caraïbe, particulièrement de la Jamaïque, Negus avoue que son affiliation au mouvement rastafari lui a permis de s’affirmer. Dès son arrivée, il était considéré comme un outsider, et c’est ce regard de l’autre qui l’a poussé à se construire à travers ce mouvement originaire de la Jamaïque, son île natale. Comme il n’était pas accepté par son entourage immédiat, en l’occurrence la communauté africaine-américaine, son origine culturelle a été un refuge, un point d’ancrage. Il ajoutera que son origine autant que sa quête spirituelle l’ont conduit vers la foi rastafari. Jolomite et Negus ne sont pas affiliés à une secte ou à une Église particulière, mais ils participent à des rassemblements à l’occasion des grandes dates du mouvement, telles que la naissance d’Haïlé Sélassié. L’intérêt pour le mouvement hip-hop s’est révélé avant le mouvement rastafari car ils étaient constamment entourés par ses manifestations. Leur affiliation au mouvement rastafari était une manière de résister au mode de vie et aux critères identitaires nord-américains. Jolomite et Negus observent un régime végétarien strict. Ils considèrent Haïlé Sélassié comme un modèle divin et le pilier de leur foi. Ils le considèrent comme le roi des rois, le tout-puissant, leur dieu. Il est la représentation de Dieu sur terre qui s’est incarné afin de montrer aux hommes comment vivre en harmonie. Tous deux s’expriment souvent et aisément en utilisant le vocabulaire du langage rasta, le dread-talk. Ils considèrent la Bible comme un livre sacré et l’étudient régulièrement. Contrairement au christianisme, elle n’est pas leur seul livre de référence et n’est pas vitale pour maintenir une relation avec Dieu. Selon eux, le corps est la première Eglise, le premier temple permettant à l’homme d’être en relation avec le créateur. Le mouvement rastafari leur permet de renouer avec leur héritage ancestral, royal, longtemps dénigré par l’homme blanc.
C/ Conception et participation au mouvement hip-hop À la question « Quelle culture avez-vous adoptée en premier ? », Negus répond qu’il a adhéré aux deux mouvements en même temps. Au fur et à mesure qu’il découvrait le hip-hop, sa quête spirituelle à travers le mouvement rastafari s’intensifiait. Cependant, selon leurs dires, nous sommes en mesure d’affirmer que Jolomite et Negus ont découvert d’abord le mouvement hip-hop puis le mouvement rasta. À leur arrivée aux ÉtatsUnis, durant les années 80, le mouvement hip-hop était en pleine effervescence. Il était impulsé par la communauté africaine-américaine, donc
217
ils s’y sont naturellement intéressés. Cette originalité ne leur a pas échappé. Jolomite précise que, originaire d’Haïti, il n’a pas eu de difficulté à s’identifier au hip-hop une culture noire-américaine. Il a rapidement commencé à danser. Negus, pour sa part, a commencé par le graffiti, puis la danse et enfin le rap. La seule discipline qu’il n’ait pas pratiquée est le djing, car il n’avait pas de platines pour s’entraîner chez lui. Le hip-hop est un style de vie pour eux avec des valeurs, des comportements, des repères historiques formant une tradition. Ils conçoivent que le rap, le graffiti, l’argot et le style vestimentaire ont leurs racines en Afrique. Par le biais du hip-hop, ce sont ces racines africaines qui se reforment dans un contexte différent. Lorsque leur tour de se produire arrive lors des concerts de rap, le public s’attend souvent à entendre du reggae. L’assistance est souvent surprise quand ils commencent à rapper. Bien qu’ils soient différents dans la communauté hip-hop, ils ne sont pas marginalisés par les autres rappeurs. Cependant, ils s’estiment différents. Ils ne portent pas systématiquement des vêtements hip-hop (par exemple, pas de casquettes de baseball, ni de jeans larges.) et considèrent leurs locks comme une couronne. Ils présentent à keur auditoire, sans timidité, ce qu’ils appellent, leur « rasta rap ». « C’est de la musique consciente, édifiante indépendamment de la forme sous laquelle elle est présentée. »225
Même s’ils ne font pas de reggae, ils restent attachés aux messages et aux valeurs véhiculés dans cette musique, une musique qui a présenté le mouvement rastafari au monde. Jolomite et Negus ne participent pas exclusivement au mouvement hip-hop. Les messages de leurs textes, leur style vestimentaire et leur apparence reflètent leur adhésion au mouvement rasta. Néanmoins, leur moyen d’expression demeure une discipline du hiphop, le rap. Ils se réclament donc des deux mouvements, car ils se sentent autant rastas que «hip-hoppers». Ils entretiennent des rapports avec les autres groupes de rap dans le mouvement hip-hop, particulièrement avec des groupes composés de rastas, tels que Duo Live. Ils se connaissent bien et ont déjà enregistré des titres ensemble. Jeru Da Damaja et Afu-Ra sont deux autres rappeurs qui incorporent certains éléments du mouvement rastafari sans en partager les croyances religieuses, et avec qui ils ont déjà eu des échanges. S’ils portent
225
« This is roots and culture regardless of the musical form it comes in ». Entretien de l’auteur avec Negus et Jolomite.
218
des dreadlocks et les couleurs du mouvement rastafari, ils n’abordent jamais l’idéologie du mouvement dans leurs paroles : « Nous n’avions pas la même vibe parce qu’on sentait qu’ils nous traitaient différemment (…) Quand ils nous saluaient, on savait pertinemment qu’il y avait des choses qu’on ne partagerait pas avec eux » 226
Selon Negus, leur interaction n’est pas la même qu’avec Duo Live qui, eux, partagent et professent les croyances religieuses rastafari dans leur musique. Il n’évoque pas ces sujets avec Jeru et Afu-Ra dans leurs conversations. Par contre, il dénonce l’utilisation de l’image et des attributs du mouvement rastafari sans pour autant prendre position pour l’idéologie qui est à la base. Il déclare en effet : « L’industrie [du disque] mettra du rouge, du doré, du vert autour de quiconque ayant des locks et une barbe, juste pour vendre et leur donner une expression, même s’ils ne sont pas rastas »227
À des fins commerciales, les symboles du mouvement sont utilisés par des artistes pour mieux se vendre ou simplement agrémenter leur « look ». Le port des locks ou des couleurs du mouvement ne signifie pas une adhésion à ses principes religieux (par exemple le rappeur Lil’Wayne et le chanteur Rn-B, T-Pain, qui ne sont pas rastas mais qui portent des dreadlocks). Certains artistes, comme le groupe Dead Prez, utilisent aussi ces symboles pour affirmer leur attachement aux idées afrocentristes. Dead Prez et I-n-I Mighty Lockdown se connaissent et se côtoient. Jolomite a été leur cuisinier personnel durant l’une de leurs tournées à travers les États-Unis en 2000 (Okay Player Tour). La réaction des autres groupes de rap envers I-n-I Mighty Lockdown n’est pas unanime. Lorsque certains les encouragent dans leur différence, d’autres la rejettent, percevant leur manière de se comporter et de se vêtir comme de l’arrogance.
226
« It wasn’t the same vibe that i-n-i was still dealing with because I could see how one treat us different (…) When they check i-n-i they know well it’s certain things where they ain’t even gonna go with these guys. » 227 « The industry will put a red gold and green aound anybody with locks and a beard just to sell and give an expression even if they’re not rastas. »
219
D/ Production musicale et contenu thématique « (…) même si je vais parler de ce qui se passe dans la rue, des galères, je le ferai mais du point de vue de rastafari (…) »228 Negus
Le mode de vie et les croyances d’I-n-I Mighty Lockdown déteignent constamment sur les thèmes de leurs textes. Sur le plan musical, leurs origines culturelles et leurs croyances les poussent à expérimenter des mélanges avec le reggae et la dancehall. Ce sont ces deux aspects que nous analyserons à ce stade de notre argumentation. Le groupe fait partie d’un collectif d’artistes rasta (poètes, rappeurs, chanteurs, peintres) dénommé « The Eye Tree Society ». Le but de cette association est de faire connaître le style de vie rastafari à travers tous ces groupes. Selon Negus, cette action est menée de manière désintéressée. Leur objectif n’est pas de convertir d’autres personnes à leurs croyances religieuses mais d’exposer une conception de la culture hip-hop différente de celle qui est diffusée en télévision et en radio. « Je ne peux plus continuer à sortir des disques montrant une certaine image de la vie de la communauté noire alors qu’elle ne se limite pas à ça, elle est beaucoup plus richeque ça (…) »229 Negus
Tandis que Negus rappe en anglais, Jolomite rappe en français et parfois en anglais. Ses origines haïtiennes lui permettent de manier la langue correctement. Durant notre entretien, il mentionne la révolution menée par Toussaint Louverture contre les troupes françaises de Napoléon Bonaparte en 1804, en disant « The 1804 regime, we have to keep that alive ! »230. C’est d’ailleurs le titre de l’une de ses chansons231. Il l’articule comme une idéologie, un état d’esprit à défendre et à maintenir dans les consciences. Mélangé aux idées afrocentristes du mouvement rastafari, son héritage culturel transparaît dans la thématique de ses textes.
228
«Even if i’m gonna talk to you about the life of being in the streets and hustling, I have to talk to you from the point of view of Fari. » 229 « I just can’t continue to put out records portraying a certain image of black life (…) when there’s so much more to it than that, it’s much richer than that. » 230 Traduction : « Le régime de 1804, on doit le maintenir en vie! » 231 Nous transmettons ici www.myspace/inimightylockdown.
220
« My song is a way of life that I recite… »232 Negus
Le quotidien de la communauté noire est un premier thème récurrent. Le groupe fait référence à la symbolique rastafari pour décrire ses conditions socio-économiques. De la nourriture « ital » au concept de « babylon » en passant par les idées de Marcus Garvey, ils incorporent les concepts du mouvement dans leur discours. Depuis l’introduction de leur titre Frontline ils annoncent : « Rastafari, Haïlé Sélassiéthe first the emperor comes in to take it out. »233
Puis dans le texte: « Ce que Marcus Garvey a dit doit se réaliser/On vit dans le futur, n’oublie pas ton passé/Malgré ton travail, tu manques d’argent (…)»234 Negus
Les conditions socio-économiques dans le ghetto sont telles que toute activité est « bonne à prendre » pour gagner son pain : « Conduire un type à l’aéroport JFK juste pour faire un peu de cash (…) Comment on survit dans cet endroit : On se débrouille tout le temps. »235 Negus
L’anti-matérialisme transparaît dans les paroles de la chanson The soul is priceless : « Le matérialisme change mes potes/New York est une décharge qui court à la ruine »236
L’aspect religieux où les rappeurs citent leur appartenance au mouvement rastafari et déclament leurs louanges à Haïlé Sélassié est omniprésent. C’est l’un des marqueurs du « rap rasta » :
232
Traduction : « Ma chanson, c’est un style de vie que je déclame… » Traduction : « Rastafari, Haïlé Sélassié Premier, l’empereur arrive pour régler les choses » 234 « Marcus Garvey words come to pass/You living in the future can’t forget your past/When your nine to five got you still looking for cash » 235 Chanson, How you livin’: « Take a cat to JFK just to make some ends (…) how do we live and survive in this place: steady hustling. » 236 « Materialism really got my people flipping/New York is a wasteland heading for desolation. »
233
221
« Sérieusement, qu’est-ce que tu connais du mouvement rastafari/Qu’est-ce que tu connais de sa majesté?/Qu’est-ce que tu connais de la rue, du rythme africain ? (…) Babylone sait que je suis une pierre jetée sur Rome quand les briquets s’allument. »237 Fre du groupe Duo Live avec Negus «Révolutionnaire dans l’intérêt de mon peuple/L’objectif à chaque fois, mettre de la vérité dans les rimes/Pour ma mère qui a eu des coups durs dans cette vie (…) Aujourd’hui, c’est l’œuvre de Sélassié qui se réalise. »238 Negus
Jolomite rappe en français sur le titre The soul is priceless. Ce faisant, il se rattache à plusieurs groupes, en premier lieu aux communautés rasta et hiphop et, en deuxième lieu, aux communautés haïtienne et francophone de New York. Ses rimes sont empreintes de références bibliques : « Je marche dans le chemin de la justice/Ma voix s’adresse au fils de l’homme/Pas le temps de radoter, ici sur terre pour exercer sa volonté/A quoi bon faire ses affaires/Laisser tomber ?/Non pas moi/Je serai comme l’arbre qui pousse près de la rivière sans jamais fléchir/Jour et nuit je représente mes frères. »
L’expression « le fils de l’homme » qu’utilise Jolomite, la Bible l’utilise pour désigner le Christ. L’image de l’arbre planté au bord de la rivière représente l’homme pieux qui s’attache aux commandements du créateur dans le psaume 1. Dans un autre texte, Negus n’hésite pas à « rapper » le discours qu’Haïlé Sélassié a délivré aux Nations Unies en 1963. Ce discours a été rendu célèbre par Bob Marley qui fut le premier à en faire une chanson intitulée War : «Tant que cette philosophie qui détermine une race supérieure et une autre inférieure ne sera pas totalement et définitivement discréditée et abandonnée, partout ce sera la guerre ! Tant qu'il y aura des premières classes et des secondes classes de citoyens dans toutes les nations, tant que
237
Chanson, Really : «Really what you know about Rastafari?/ What you about his majesty I/ What you know about the street, the african beat (…) Babylon know I’m brimstone pun Rome when the lighters show up. » 238 « Revolutionary cause for my people’s interest/The objetcive everytime, put truth inside rhymes/ For my mother who suffered this life with hard times (…) Nowadays it’s Selassie I work on display. »
222
la couleur de peau n’aura pas plus de signification que celle des yeux partout ce sera la guerre. »239
Cette appropriation est hautement symbolique dans le sens où Marley reprend les paroles de celui qui est au coeur de la foi rastafari, puis Negus reprend, non pas seulement les paroles de Sélassié, mais aussi celles de la chanson de Marley, qui en a fait un discours rastafari, pour les transformer en discours hip-hop. Negus et Jolomite abordent également les relations hommes/femmes de manière singulière avec le titre She’s my darling. La femme qu’il décrit partage sa croyance et sa vision afrocentriste. Pour ce faire, il cite le livre biblique Le cantique des cantiques. Il rappe en patois jamaïcain et se rattache ainsi à la communauté jamaïcaine de New York et de la Jamaïque. La version musicale reste toujours le reggae. En ce qui concerne la musique, il se rattache à la communauté rasta par le fait de rapper sur du reggae. Traditionnellement, les rastas ont toujours chanté sur du reggae mais Negus bouleverse la tradition pour « rapper » sa différence et ses convictions rastafari. Les versions musicales reggae ont été ses premiers supports pour apprendre à rapper. C’étaient d’ailleurs les seuls qu’il arrivait à se procurer. Étant donné qu’il était en contact avec un propriétaire de sound system, il allait régulièrement le voir pour l’écouter et par la même occasion s’entraîner à rapper. Negus avoue écouter moins de rap qu’un hip-hopper ordinaire. Il écoute plus de reggae que de rap ; c’est une musique qu’il veut voir transparaître de plus en plus dans ses compositions. Dans le groupe, à l’évidence, Negus domine dans l’écriture des paroles et dans le charisme artistique, mais ils arrivent à trouver un équilibre. Jolomite, originaire d’Haïti, et Negus, originaire de la Jamaïque, ont mis en place un discours et une représentation rastafari à travers leur expression dans la communauté hip-hop de New York. Leurs racines caribéennes ont été essentielles dans leur intérêt pour le mouvement rastafari. Nous allons maintenant nous intéresser au deuxième groupe, Duo Live, et considérer la manière dont il vit son interculturalité.
239
Bob Marley, Rastaman Vibration, 1976, Island Records. « Until the philosophy which holds one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned, everywhere is war me say war! That until there is no longer first class and second class citizens of any nation. Until the colour of a man's skin is of no more significance than the colour of his eyes, me say war! »
223
3.3.2: Duo Live : Brooklyn, New York En effet, le deuxième groupe que nous avons interrogé dans le cadre de nos recherches, Duo Live, est originaire de Brooklyn, New York. Il est composé de deux membres, un rappeur, Justin Cozier alias Fre, et un DJ/Compositeur, Sidda Phillip, alias Sid V. Ce dernier n’était pas disponible ; nous avons donc pu nous entretenir uniquement avec Fre lors de notre voyage de recherche à New York, en février 2007. Par le biais de notre entretien ainsi que des supports musicaux et écrits, nous avons voulu comprendre quelle était la démarche du groupe, ses origines culturelles et sociales, son approche du mouvement hip-hop et du mouvement rastafari, la thématique de ses textes ainsi que ses influences musicales.
A/Origines socioculturelles
Fre et Sid V240
Duo Live s’est formé au milieu des années 80 à New York dans le quartier de Bedford- Stuyvesant, majoritairement habité par la communauté africaine-américaine, au cœur de Brooklyn. De nombreux rappeurs célèbres sont originaires de ce quartier, tels que Busta Rhymes, Talib Kweli, Papoose,
240
Les deux membres du groupe Duo Live vendant leurs cds dans la rue. Avec l’aimable autorisation de Redemption Music Group.
224
Jay Z, Lil’Kim, Mos Def, Memphis Bleek, GZA, etc… Il est intéressant de noter que, par leurs parents, Sid et Fre ont des liens dans la région Caraïbe. La mère de Fre est originaire du Sud des États-Unis, son père, du Guyana, l’ancienne colonie britannique, et une de ses grand-mères de la Jamaïque. La mère de Sid V est originaire du Sud des États-Unis et son père, de Trinidad. Ils sont nés aux États-Unis et y ont été élevés, contrairement à Jolomite et Negus, qui sont issus de l’immigration. Ils ont adhéré au mouvement hip-hop durant leur enfance en 1979. Fre a été enseignant pendant 9 ans et a mis en oeuvre des programmes pour la petite enfance, les sciences, l’environnement et l’entretien d’espaces verts. Il est également nutritionniste et masseur kinéthérapeute. Quant à Sid V, il a été professeur de musique. Depuis environ trois ans, ils vivent tous deux des revenus générés par leurs activités musicales.
Fre, New York, Fevrier 2007, cliché de Steve Gadet
225
B/ Conception et participation au mouvement rastafari C’est en 1993, au lycée, que Sid V et Fre découvrent le mouvement rastafari. Fre admet que leurs liens avec les pays d’origine de leurs parents, la Jamaïque, Trinidad et Guyana, ont beaucoup influencé leur adhésion au mouvement. Les références culturelles au sein de leur foyer étant Caribéennes, pour mieux se comprendre et se définir au sein de la société nord-américaine, ils se sont identifiés plus aisément à ce mouvement afrocaribéen. Les habitudes alimentaires, les cheveux naturels, l’anticonformisme et la valorisation de l’identité noire ont aussi été des éléments persuasifs. « Le mouvement rastafari ne s’arrête pas à l’herbe, aux couleurs (rouge, jaune, vert ndla), aux locks, à la Jamaïque. »241 Fre
Contrairement au groupe I-n-I Mighty Lockdown, Duo Live remet en question les concepts établis. Paradoxalement, peu après le début de notre entretien, Fre nous précise qu’il ne se réclame d’aucun mouvement religieux, y compris le rastafarisme. Sa vision du mouvement est différente. Il le conçoit comme une manière de se rapprocher de Dieu. Depuis l’âge de 13 ans, il s’est largement documenté sur la personne et l’œuvre politique d’Haïlé Selassié. Le mouvement rastafari, qui porte son nom à l’origine, doit être, selon lui, directement relié à sa personne, à ses idées et à son oeuvre. Il est vrai que le mouvement est composé de concepts et de pratiques religieuses très éloignés de cette théorie. Le rastafarisme n’est pas strictement aligné sur les enseignements et les idées laissés par Haïlé Sélassié. Le besoin de fumer de la marijuana pour méditer, la nécessité d’avoir des dreadlocks pour être rasta ne sont pas des pratiques inspirées par la pensée de l'empereur d’Éthiopie. Lorsque nous nous sommes entretenu avec Fre, il venait de couper ses dreadlocks, qu’il portait depuis l’âge de 13 ans. Quand nous avons voulu connaître les raisons de ce changement, il nous a répondu qu’il ne les estimait plus nécessaires à son développement spirituel. Sid V, quant à lui, a gardé les siennes mais adhère aux idées que nous a exprimées Fre. En tant que nutritionniste, il assure que le fait de fumer nuit gravement à la santé et que la consommation de la marijuana serait moins nocive sous forme de thé ou dans la nourriture. Fumer contredit les principes d’alimentation saine et de bonne santé prônés par le rastafarisme. L’aversion
241
Extrait de l’entretien avec Fre réalisé en février 2007. « Rasta is bigger than weed, colors, locks, Jamaica. »
226
des rastas pour le progrès technologique ne coïncide pas avec les efforts d’Haïlé Sélassié pour moderniser l’Éthiopie par tous les moyens. Au contraire, la technologie devrait être utilisée pour soutenir l’idéologie rasta. À travers ces commentaires et ces pistes de réflexion, Fre encourage les participants au mouvement rastafari à dépasser les barrières religieuses qui se sont installées petit à petit et à poursuivre leurs recherches sur la personne et les opinions d’Haïlé Sélassié. Dans sa conception et comme dans le mouvement rastafari, l’Éthiopie tient une place centrale puisque ce sont le pays d’Haïlé Sélassié et la terre promise du peuple noir. Fre et Sid V considèrent Haïlé Sélassié comme l’incarnation de Dieu. Pour refléter la position centrale de l’empereur et redéfinir le mouvement rastafari, Fre a inventé l’appellation « Haile Selassie culture », « la culture Haïlé Sélassié». Ils ne se considèrent pas comme faisant partie de la religion rastafari mais comme étant des disciples intellectuels et religieux d’Haïlé Sélassié. Cette évolution est récente, donc ne transparaît pas encore pleinement dans le contenu de leurs chansons. Au regard des recherches que nous avons menées, leur vision représente un challenge pertinent pour la communauté rastafari. Nous avons souhaité comprendre quels étaient les rapports qu’entretenaient les membres du groupe avec la communauté rasta à New York, à savoir s’ils fréquentaient les lieux de cultes, les rassemblements et s’ils étaient acceptés à part entière. Fre et Sid V participent aux rassemblements Nyahbinghi, où les rastas se retrouvent pour jouer du tambour, chanter, débattre et manger ensemble. Ils se rendent aussi aux cultes religieux célébrés par l’Église orthodoxe éthiopienne. Il est vrai qu’ils n’y assistent pas régulièrement. Sid V a été baptisé dans cette Eglise. Ils se rendent également aux rassemblements organisés par la Fédération Éthiopienne Mondiale (Ethiopian World Federation). Au fil des années, ils ont développé des relations dans la communauté rastafari de New York. Lors d’un voyage en Jamaïque, après une discussion avec un rasta plus âgé, ils décidèrent de changer leur nom. Ils s’appelaient Duo Die, mais, suite aux commentaires du patriarche rasta leur conseillant de promouvoir la vie plutôt que la mort, ils adoptèrent le nom Duo Live. Fre précise qu’ils essaient de nouer des liens avec la communauté musulmane africaine-américaine et qu’ils ne tiennent pas à être exclusivement attachés à la communauté rastafari. Au contraire, ils veulent créer un lien entre la diaspora noire aux États-Unis et dans la région caribéenne à travers la personne d’Haïlé Sélassié. Le sentiment qui persiste est que Fre tente de sortir des dogmes rastafari et ne tient pas à être reconnu comme adepte du mouvement comme il l’est traditionnellement. Cependant, les paroles de ses chansons, certes enregistrées avant notre entretien, proclament le contraire.
227
C/ Production musicale et contenu thématique Il s’agit pour nous, dans cette partie, de cerner l’influence du mouvement rastafari sur la production musicale du groupe et la thématique de ses textes. Dans un entretien accordé en janvier 2004, Fre décrit leur musique de la manière suivante : «Je dirai que c’est de la musique consciente (…) Notre musique, c’est comme si Bob Marley pouvait rapper et Sid V serait les Wailers.»242
Le lien que Fre établit entre leur musique, le rap, et celle de Bob Marley est une matérialisation de notre sujet de recherche et une réponse à notre question de départ. En réalité, c’est un lien établi entre leur mouvement, le hip-hop, et le mouvement rastafari que Bob Marley représente. Les valeurs afrocentriques défendues par le mouvement rastafari sont également défendues à travers le rap de Duo Live. Musicalement, ils s’identifient aux Wailers, les musiciens de Marley. Le compositeur Sid V façonne un support musical, certes moins acoustique et plus rythmé, adapté pour ce message. L’idéologie rastafari est représentée dans le mouvement hip-hop à travers le rap de ces deux artistes. Le message passe d’un mouvement à l’autre, d’une musique à l’autre sans difficulté car les principaux créateurs et dirigeants charismatiques qui stimulent les deux mouvements sont originaires de la communauté noire et des classes pauvres. Ils aspirent légitimement à des destins similaires. Le lieu (New York) et l’époque durant laquelle ils vivent apportent des variations à leur musique et à leurs propos. Les thèmes abordés par Fre dans leurs chansons sont tous relatifs aux conditions sociales du peuple noir aux États-Unis. Sa rhétorique met en exergue les conditions socio-économiques et spirituelles de la communauté noire. Selon lui, la pauvreté dans laquelle vit cette communauté est un danger permanent dans le sens où elle choisit la violence, les activités criminelles pour subvenir à ses besoins. Il s’adresse tout d’abord aux habitants du ghetto, en particulier à la population africaine-américaine. Le plus souvent, ses paroles sont en argot africain-américain, l’ Ebonics, apparu
242
« I say it’s conscious music (…) I feel like our sound is like if Bob Marley could rap and Sid is like the Wailers. »
228
au milieu des années 70 à travers l’ouvrage Ebonics : the true language of black folks (1975) édité par Robert Williams. Leur avantage est qu’ils savent s’adresser aux membres de leur communauté. Elle est le laboratoire où ils testent leur musique, où ils la font écouter en premier lieu. «Mon doigt est sur le pouls du quartier …»243 Fre
Fre ira jusqu’à comparer leur musique à la chanson Trenchtown rock244 de Bob Marley où ce dernier évoque la vie du ghetto qui porte le même nom. Marley y défend et valorise en premier lieu ses habitants. Les thèmes sont parfois propres au mouvement hip-hop. Par exemple Fre, en tant que rappeur, vante son quartier, ses prouesses verbales, son style de rap. Peu de chanteurs de reggae et peu d’adeptes du mouvement rastafari écrivent dans ce sens ; ces thèmes sont propres à la culture hip-hop. Fre aborde la spiritualité rastafari à travers des titres tels que Lord Help Us/Praise Negus Selassie ou November 2nd, 1930, date du couronnement d’Haïlé Sélassié en Éthiopie. Il l’articule de manière claire et directe comme le ferait un artiste reggae de croyance rastafarienne, n’hésitant pas à louer ce dernier et à lui demander son secours. C’est le seul artiste rap à vocaliser cet aspect théologique de manière aussi évidente parmi les groupes que nous avons écoutés au cours de notre recherche : «Ne me laisse jamais/Loué soit le Negus Sélassié/ne me laisse jamais/Ce monde ne peut pas et ne voudra pas m’accueillir mais par toi, je sais trop de choses. Permets-moi de t’adorer/Je te dois trop/Humble j’observe ; on me dit que je parle trop/Ils ne veulent pas que je grandisse trop/Avec toi à mes côtés le diable ne peut pas me tromper/Dans tes bras je me sens protégé et en sécurité/Ma force ne me laissera pas! »245
Haïlé Sélassié est révéré ; il est l’être divin qui accorde sécurité et stabilité. En s’appuyant sur la Bible (Psaume 72, Apocalypse chapitre 5, verset 13, Psaume chapitre 68, verset 31), Fre qualifie son couronnement comme
243
« I got my finger on the pulse of the hood. » Album : Confrontation, Island Record, 1983. 245 « Don’t ever leave me/Praise Negus Selassie/Never leave me/This world can’t and would never receive me but by you I know too much/Permit me to worship/I owe too much/Humble I observe/ They say I flow too much/they don’t want to see me grow too much/With you beside me evil can’t deceive me (…) In your arms I’m safe and secure my strength won’t leave me! » 244
229
l’avènement d’un événement prophétique dans le titre November 2nd, 1930. C’est ainsi que son couronnement a été perçu dans la communauté rastafari de la Jamaïque dès 1930 : « Ce jour-là, ils devaient le couronner (…)/Empereur Haïlé Ier, couronnez-le/Impératrice Menen couronnez-le/Roi des rois couronnez-le Seigneur des seigneurs couronnez-le Roi alpha/ couronnez-le/ Reine oméga »246
L’Éthiopie joue un rôle important, car les rastas la considèrent comme le berceau de l’humanité mais parce que c’est aussi le pays natal d’Haïlé Sélassié: « L’Éthiopie, je ne suis pas chez moi tant que je ne suis pas sur cette terre/Ma terre noire est plus riche que ces cheiks avec leur pétrole noir (…) »247
Il n’hésite pas à expliquer la tradition des longues nattes que les rastas portent. Comme le personnage biblique, Samson, les cheveux sont source de force pour eux : « Je porte mes cheveux partout ils sont longs/ je les porte depuis treize ans beaucoup seront éffarés/Ils sont longs et vraiment comme l’afro l’a fait, ils disent haut et fort que je suis noir et fier de l’être (…)»248
Dans cette comparaison, Fre relie l’expérience socioculturelle de la communauté noire aux États-Unis à celle de la communauté noire en Jamaïque. Implicitement, il relie la communauté hip-hop à la communauté rastafari. À la coiffure afro et aux locks, il assigne le même rôle, celui d’affirmer sa négritude. Néanmoins, il porte une critique sur cette pratique, constatant que, parfois, les dreadlocks sont source de vanité chez les rastas. Au moment où nous nous sommes entretenu avec lui, il ne portait plus ses dreadlocks. Lorsqu’il a enregistré le titre, il laissait entendre dans ses paroles qu’il pourrait les couper. Pour lui, le mouvement rasta ne s’arrête pas au port
246
« On this day they had to crown him(…)/November 2nd, 1930 crown him/Emperor Haile I, crown him/ Emperess Menen crown him/king of kings crown him/Lord of lords crown him/King alpha crown him/Queen omega crown him. » 247 « Ethiopia, i ain’t home ‘till i’m on that soil/My black soil richer than them cheiks with them black oil (…) » 248 « I wear my hair everywhere ; it’s long/13 years ; most will stare/It’s long and much like the afro did it says real loud that I’m black and proud (…) »
230
des locks. De plus, encore pour provoquer la réflexion, Fre insiste sur le fait que l’initiateur du mouvement, Haïlé Selassié, n’en portait pas : «Quand les gens voient des locks, la première chose à laquelle ils pensent “c’est un rasta”/je dois te dire la vérité, te mettre au courant/Haïlé Sélassiéle chef n’a jamais eu de locks/Il a gardé ses cheveux à une certaine longueur/Je porte ma couronne partout en ville,je ne frime pas pour autant. J’ai laissé ma vanité dans le siège/Je ne peux pas dire que je ne vais jamais les couper/Je suis uni aux saisons ; j’ai mes raisons (…) »249
Il affirme encore ici sa différence avec le courant traditionaliste et conservateur du mouvement rastafari. Par ailleurs, dans cette même composition, il décrit son art comme étant du « rap rastafari ». Fre et Sid V parviennent à retranscrire l’atmosphère de leur communauté dans leurs rimes et leurs sonorités. Ils rappellent que la ville de New York peut devenir très dangereuse selon l’endroit où l’on marche : « T’as intérêt à pas aller n’importe où/ T’as intérêt à pas dire n’importe quoi /Je t’assure les rues de New York te surveillent/Je le sais puisque ça marche bien pour moi à New York»250
Leur communauté est une entité, où la violence devient parfois nécessaire pour se faire respecter : « Je ne porte pas de fusil mais certains prennent ma douceur pour de la faiblesse, ma gentillesse pour de la naïveté/Ils oublient d’où je viens, ils oublient les temps où j’en portais/Où je faisais des choses qui noircissaient mes paumes/Tout seul je vais le voir/Il menace ma santé aussi je vais le voir/un fusil sur moi, je vais le voir/Il peut courir mais pas se cacher parce que je vais le voir. »251
249
« See when people see locks, first thing they think it’ rasta/Give you the truth and scoop you i gotta/Haile Selassie I the head he never had no dreads/He kept his hair to a certain length/I wear my crown around town I don’t show off neither, I left my vanity in the chair/can’t say that I ain’t never going to shave my hair/I’m one with season ; I have my reasons (…) ». 250 Fre, Watch where you walk, Ghetto gold, 2005. « You better watch where you walk/You’d better watch where you talk/Trust me the streets watch in New York/I know cause I’m real hot in New York ». 251 Fre, I’m going to see him, Ghetto gold, 2005. « I do not bear gun so some took my meakness for weakness, my kindness for blindness/Forgot where I’m from, forgot about the days where I was packing my arms/Doing dirt that’ll blacken my
231
La pauvreté, le manque de repères et l’oisiveté favorisent le crime : « Je vends de la drogue, j’explose des cartouches avec les voyous (…) parce qu’on ne m’a jamais témoigné d’amour/J’ai été élevé comme ça et c’est comme ça que je gagne de l’argent (…) Quand les gens n’ont pas d’objectifs, ils adorent l’argent. »252 « C’est dur de faire du hip-hop et de gagner sa vie honnêtement/Il manque beaucoup de choses/Des foyers brisés où le père n’est pas là/J’ai une vision honnête (…) »253
Contrairement aux conditions qui les entourent, ils s’efforcent de sortir de cette spirale de violence et de criminalité. Il est évident que le ghetto, leur environnement immédiat, demeure une source d’inspiration à laquelle ils sont attachés en dépit des importunités : « L’or du ghetto/Je sais au fond de moi que le ghetto est vendu/ Je sais au fond de moi que le ghetto est en or/ Je sais au fond de moi que le ghetto est vraiment froid/Je sais au fond de moi-même, je suis mon cœur (…) Je soutiens la famille noire, ma vision est profonde (…) »254
Dans le titre Coming in from the cold, enregistré en 2005, Duo Live fait des commentaires sociaux sur le style de vie des habitants des zones défavorisées. La chanson est inspirée d’une compilation de Bob Marley ayant le même titre et où ce dernier encourage ses auditeurs à ne pas laisser leurs conditions de vie les transformer en destructeurs. Duo Live commence sa version par un refrain repris sur une autre chanson de Marley, intitulée We’ll be forever loving Jah. Il y a une vraie volonté de replacer le message de Marley, apôtre du mouvement rastafari, dans leur propre espace
palms/By myself I’m going to see him/Threatning my health so I’m going to see him/Gun by my side I’m going to see him/Run but he can’t hide cause I’m going to see him ». 252 Duo Live, Get paid like this, Ghetto gold, 2005. « I sell drugs, bust slugs with the thugs (…) all because noboby ever showed me love i was raised like this, I get paid like this (…) When people lack purpose, they worship funds (…) ». 253 Mixtape Cash those checks. « It’s hard to make hip-hop and earn a honest living/A whole lot is missing/Broken homes where the pop is missing/I got a honest vision (…) ». 254 Duo Live, Ghetto gold, Ghetto gold, 2005. « Ghetto gold/I know in my heart the ghetto is all sold/ I know in my heart the ghetto is all gold/ I know in my heart the ghetto is so cold/I know in my heart, following my heart (…) I support the black family, my vision is deep (…) ».
232
socioculturel. Leurs commentaires sociaux s’adressent notamment aux plus jeunes afin de les motiver et de les conseiller sur les choix de vie à faire dans le ghetto. Duo Live tient à leur faire comprendre qu’ils ont le pouvoir de choisir, qu’ils peuvent construire une vie sans avoir à s’engager dans des activités illégales. Ils encouragent l’estime de soi sachant que le respect et la reconnaissance sont des éléments cruciaux dans la construction du jeune. Après avoir conté l’histoire d’un jeune qui s’est laissé entraîner dans des activités illégales, Fre leur explique qu’ils ne doivent jamais faire partie de ce scénario : « La morale de l’histoire, c’est que vous ne devez pas m’aider à écrire la morale de l’histoire, les enfants »255
L’éducation, l’estime de soi, l’esprit d’entreprise, la prise en charge de leur environnement, l’autonomie économique sont les solutions qu’ils préconisent pour améliorer le quotidien de la communauté noire : « Je leur enseigne la connaissance, la santé et l’autonomie. »256 « Prends soin du quartier, aime-toi, la possibilité de gagner de l’argent se trouve dans ton cerveau. »257 «Tous les enfants du ghetto chantez/Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez si vous le voulez vraiment/Vous savez ce que la débrouillardise provoque/Pour faire des sous des imbéciles feraient n’importe quoi/Maintenant c’est à nous de briller. »258 « Des chèques de l’assistance sociale (...) à l’acquisition d’un bâtiment, c’est ça la suite/D’un disque sur une étagère à des milliers en commande, c’est ça la suite/Des dollars et des cents aux euros, aux pounds et aux pens, c’est ça la suite. »259
255
Fre, Get paid like this, Ghetto gold, 2005. « The moral of the story is you don’t wanna help me write the moral of the story, kids ». 256 Mixtape Cash those checks. « I teach them science, health and self reliance ». 257 Mixtape Cash those checks. « Support the hood, love yourself. The potential for financial gain is just sitting in your brain ». 258 Ghetto children, Color money, 2007. « All ghetto children sing/You can have anything you put your minds to/You know what the grind do/To make a dime some fools would do anything/Now it’s our time to shine ». 259 That’s what’s next, Color money, 2007. “From welfare checks to (…) owing a complex, that’s what next/From a record on deck to thousand on request, that’s what’s next/From dollars and cents to euros pounds and pens that’s what’s next ».
233
Duo Live prône un mouvement hip-hop libre des pressions exercées par la logique capitaliste des maisons de disque, une logique qui force les artistes à exploiter certains sujets qui se vendent mieux, qui favorise le rap mettant en scène des stéréotypes de la communauté noire (violence, misogynie, drogue, matérialisme). En 1996, ils ont commencé leur label de production indépendant « Redemption music group ». Depuis, ils s’occupent directement de la production et de la distribution de leurs disques. Depuis la création de ce label, ils ont pu vendre environ 227 000 disques aux ÉtatsUnis. Comparé aux maisons de disques « majors »260, ce n’est pas un chiffre important mais suffisant pour considérer qu’ils ont une base d’auditeurs consistante. Obtenir les moyens financiers pour vivre et mettre en place leurs projets en gardant leur liberté créatrice reste une préoccupation constante : « Aucun dirigeant de label ne m’a donné d’avance/J’ai réussi en me débrouillant, (vendant mes disques, ndla) de la main à la main, mec/Je traînais tellement dans la cité qu’ils ne me supportaient plus/La police était frustrée parce qu’elle ne pouvait pas m’enfermer (…) à dire vrai, j’ai l’argent à l’esprit. »261 « On n’est pas obligé de se vendre pour vendre/C’est Duo Live, Sid V et MC Fre/Quand ils m’ont demandé de vendre du crack, j’ai commencé à enseigner des principes de santé au quartier/Le parie que le ghetto a compris. »262
La relation entre l’homme et la femme noire est un autre thème traité dans leurs textes. Contrairement à la tendance, elle est décrite dans le cadre du mouvement rastafari et en fonction des objectifs de leur communauté. Selon eux, l’homme et la femme doivent avoir les mêmes objectifs quant à la communauté, autrement dit travailler à la rendre prospère. La chanson Hold my hand est un hymne à l’amour, non pas basé sur les apparences, mais sur les qualités intérieures :
260
Les « majors » sont quatre sociétés (Universal Music Group, Sony BMG, EMI Group, Warner Music Group) qui se partagent l’essentiel du marché de l’édition de disques. 261 Fre, Truth be told, Ghetto gold, 2005. « Ain’t no label execs advanced me/I got mines on the grind hand to hand G/Hit the block so hard they could not stand me/Po po mad they could not jam me (…) truth be told money on my mind ». 262 Duo Live, They asked for it, 1st HIMpressions, 2003. « We ain’t got to sell out to sell out/It’s Duo Live Sid V and MC Fre/When they asked me to sell crack/ I start teaching the hood about health/Bet the ghetto felt that ».
234
« Même les aveugles peuvent trouver un compagnon, oublie le visage je te jugerai en fonction de ton coeur, en fonction de ton intelligence, en fonction de ton attachement à moi, jusqu’à ce qu’on devienne vieux, je vais partager mon âme, tiens ma main (…) on vient ensemble aussi pour louer et adorer (Dieu), c’est incroyable! »263 « Je suis un homme occupé/J’ai besoin d’une femme qui a la même passion/Je suis un visionnaire, un travailleur, j’ai besoin d’une femme qui a le même état d’esprit. »264
Musicalement, les créations de Sid V, le compositeur du groupe, reflètent leur héritage caribéen, leur culture nord-américaine ainsi que leur orientation religieuse. Dans un entretien accordé au magazine Billboard en décembre 2003, Sid V déclare : « Notre héritage Caribéen apparaît dans nos rythmes/Nous subissons des influences africaines autant que celles du quartier » 265
Ses compositions sont influencées par la Crunk music (Duo from the side), un style de rap apparu dans les années 90 à Atlanta et popularisé au début des années 2000 par des artistes tels que Tree Six Mafia, Pastor Troy ou encore Lil' Jon’. Le rythme dansant et très énergique convient bien aux discothèques. Les rythmiques et les synthétiseurs sont électroniques. Contrairement au rap de la côte Est qui favorise la profondeur des paroles et l’aspect poétique, celles-ci sont simples et répétitives. Même s’ils résident à New York, cette fusion s’explique par le fait que Sid et Fre ont grandi dans le Sud des États-Unis. Leurs mères respectives en sont originaires. Néanmoins, il est intéressant de noter que Fre conserve un débit, une diction et des paroles inspirés par le style de rap de New York même dans ce type de compositions. L’influence africaine se dénote dans l’utilisation des tambours dans des titres tels que We aware ou encore Jetsetters. Les musiques sont composées à
263
Duo Live, Hold my hand, 1st HIMpressions, 2003. « Even those that are physically blind can find a mate, forget the face I’ma rate you based on your heart, based on whether you’re smart/Based on how much you genuinely care ‘till we old I’ma share my soul, hold my hand (…) we even join together to praise and worship too, it’s amazing ». 264 « I’m a busy man stay hustling/I need a woman with the same drive/I’m a visionary, rue breadwinner I need a woman with the same mind ». 265 « Our west-indian heritage is refletced in our rythms/We have African influences there as well as the hood. »
235
partir de celles des cérémonies rasta nyabhingi auxquelles ils participent avec leur communauté à New York. Le jazz, la soul et le blues apparaissent pleinement dans les compositions de Sid V à travers les échantillons de disques qu’il utilise ou encore à travers les ambiances et les rythmiques qu’il crée sur des titres comme Ducktales ou Hold my hands. Durant notre entretien, Fre nous a clairement révélé la passion du groupe pour le reggae et son désir de composer des chansons avec des artistes rasta impliqués dans cette musique tels que Capleton ou Luciano, des artistes caribéens actifs dans le milieu dancehall également, tels que Bounty Killer. Ils prévoient de composer un album « hip-hop/reggae », un mariage des deux styles musicaux. Sur leur album The Color of Money produit en 2007, Sid V « échantillonne » la voix de Norris Man, un chanteur de reggae rasta, dans le titre Bright days, qui n’est autre qu’une reprise, version rap, de sa chanson. Sa voix revient dans le refrain et, de son côté, Fre rappe en créole jamaïcain. Le rythme reggae se mélange au rythme rap et reflète l’interculturalité de la culture hip-hop et du mouvement rastafari que Fre et Sid V symbolisent. Comme nous l’avons démontré, Duo Live se rattache aux deux mouvements, hip-hop et rastafari, à travers sa position idéologique et sa création artistique. Toutefois, Fre, à maintes reprises, a souhaité se distinguer des dogmes rastafari. Par là, nous comprenons qu’il ne rejette pas les bases de ce mouvement, c’est-à-dire la divinité d’Haïlé Sélassié, mais plutôt les pratiques religieuses qui s’y sont greffées petit à petit. Les deux groupes de rap que nous avons choisis pour vérifier nos hypothèses, en l’occurrence I-n-I Mighty Lockdown et Duo Live, arrivent à allier leurs convictions rastafariennes à leur contexte géographique et à l’expression culturelle qu’ils ont choisie, en l’occurrence le hip-hop. En fonction de ce contexte, l’expression et la perception de leur croyance diffèrent. Nous pouvons néanmoins affirmer que leur patrimoine socioculturel caribéen (Haïti, Jamaïque, Guyana et Trinidad) a servi de « détonateur » dans ce transfert interculturel. En effet, il existe des adeptes du mouvement hip-hop, originaires des États-Unis, qui adoptent des symboles du mouvement rastafari sans pour autant intégrer l’aspect théologique dans leur démarche. Ces symboles (dreadlocks, couleurs) sont portés comme des phénomènes de mode ou comme une manière de revendiquer leur négritude. Aux yeux de ces groupes, l’appropriation du mouvement rastafari et du mouvement hip-hop est une réponse identitaire qui juxtapose bien leur contexte nord-américain et leurs racines caribéennes.
236
CONCLUSION GÉNÉRALE « Chaque culture n’est jamais un achèvement, mais une dynamique constante chercheuse de questions inédites, de possibilités neuves, qui ne domine pas mais qui entre en relation, qui ne pille pas mais qui échange, qui respecte. » Éloge de la Créolité (53), Patrick Chamoiseau, Raphaël Confiant, Jean Bernabé.
Tout au long de notre travail de recherche, nous avons tenté de mettre en évidence les liens existant entre le mouvement rastafari et le mouvement hip-hop, par le biais des peuples créateurs, des espaces de création et des créations elles-mêmes. Le sociologue jamaïcain Stuart Hall, cheville ouvrière des cultural studies, a longtemps insisté sur la notion de cultures hybrides (Macionis, Plumer, 2002 : 117). Cette notion sous-entend qu’avec les effets de la mondialisation les individus n’ont plus de repères culturels, identitaires uniques. Les cultures hybrides n’ont plus un ensemble de valeurs rigides et bien définies. Au contraire, ce mécanisme est de plus en plus complexe et parfois contradictoire. Dans nos sociétés, nombreux sont ceux qui doivent assumer leur avenir au point de rencontre de plusieurs cultures et de plusieurs groupes plus ou moins structurants. Au terme de notre démonstration, il ressort que notre hypothèse de départ est totalement vérifiée. Il existe bel et bien un lien entre le mouvement rastafari et le mouvement hip-hop. Il y a bien échange et fécondations croisées entre les deux diasporas composées « des descendants d’Africains transplantés » aux États-Unis et en Jamaïque. Les mouvements créés par ces groupes sont des efforts de réconciliation entre leur contexte spatio-temporel et leurs aspirations sociales et spirituelles. Ces deux nouveaux mouvements sociaux ont eu deux fonctions principales, que cela soit aux États-Unis ou dans la Caraïbe : ils ont « fait sortir de l'ombre » et provoqué des transformations sociales. Leurs thèmes et leurs motivations essentiels sont les retrouvailles avec des identités perdues. Les mouvements expriment le combat d’individus qui ont dû grandir et vivre sans ancêtres connus. L’attitude non conventionnelle des rastas et des hip-hoppers, leur apparence et leurs revendications eurent un effet similaire sur leur société natale, celui d’être perçus comme des menaces pour l’ordre social. Certes, les deux mouvements ont leurs limites et leurs carences mais tous deux ont cherché à améliorer les conditions de vie de leurs adeptes et à revaloriser leur estime de soi. Leurs racines se trouvent dans les luttes politiques, culturelles et économiques. Ces mouvements sont l’expression populaire d’une misère liée en partie au ségrégationnisme et à l’ostracisme passés mais sous-jacents de nos jours. Ils sont la voix d’une classe politique, la voix d’un combat et ont
237
permis l’éveil d’individus humiliés. Tous deux sont nés dans de grandes années d’oppression et de misère, qui se sont cristallisées dans le rap et le reggae. Comme le souligne James Jasper, dans une réflexion brillante sur les mouvements sociaux en 1997, participer à une revendication sociale ne se réduit pas uniquement à une revendication intéressée ; c'est aussi une manière de s'interroger sur sa propre vie, de faire un travail sur soi-même et d’exprimer une créativité inexploitée (Neveu, 2005 : 107). Les Nouveaux Mouvements Sociaux ont insisté sur la résistance au contrôle social, sur l'autonomie. Leurs revendications ont comporté une forte dimension expressive, d'affirmation d'identités (Idem, 62). En ce sens, les adeptes du hip-hop et du rastafarisme ont élaboré et continuent d'orchestrer deux véritables mouvements sociaux non traditionnels. Malheureusement, tous deux ont été repris, ou se sont laissés reprendre peut-être, par la logique économique capitaliste, ce qui a contribué à affaiblir leurs dimensions politiques et idéologiques respectives. Leurs éléments culturels les plus visibles dans la société contemporaine sont devenus « des objets folkloriques d'une commercialisation économico-politique » (Certeau, 1993 : 126). Comme dans le cadre de la créolité évoquée par Confiant, Bernabé et Chamoiseau, les différents apports se sont juxtaposés sans pour autant disparaître en tant que tels. Selon la pensée de Stuart Hall, la culture populaire est un espace dans lequel s’affrontent consentement et résistance (Bhabha, 2007). De même, dans le cadre des études postcoloniales, Homi Bhabha nous invite à dépasser la conception d'un monde dominé par l'opposition entre soi et l'autre. Chaque individu est de plus en plus la conséquence de métissages variés. La particularité du hip-hop et du rastafarisme, c’est qu’ils sont tous deux des mouvements de résistance et des mouvements multiculturels. Dans la première partie de notre argumentation, nous avons observé l’évolution des phénomènes hors de leur espace géographique « originel ». Nous avons analysé les mutations du mouvement rastafari aux États-Unis, bien qu’il soit originaire de la Jamaïque. Quant au mouvement hip-hop, étant né aux ÉtatsUnis, nous avons relaté son évolution en Jamaïque. Ensuite, dans une deuxième partie, nous avons mis en évidence les causes des transferts culturels entre les deux mouvements, les phénomènes qui ont facilité leur médiation. En l’occurrence, nous avons pu isoler plusieurs facteurs : les mouvements migratoires entre la Caraïbe et les États-Unis facilités par la mondialisation, des expériences similaires vécues par la diaspora noire aux Amériques et, enfin, le développement des médias modernes, principalement Internet et la télévision câblée. Enfin, dans la troisième partie de notre travail, nous nous sommes appliqué à dresser les contours de cette nouvelle culture que nous avons baptisée mouvement « rastafari/hip-hop », une culture qui adopte, qui redéfinit l’idéologie du mouvement rastafari et
238
l’exprime avec des moyens d’expressions tels que le rap, le graffiti et le djing offert par le mouvement hip-hop. Ce qui explique le succès de ces deux cultures, c’est qu’elles n’ont pas rejeté la diversité. Les sujets adeptes du mouvement rastafari et s’exprimant par la culture hip-hop ont tous des origines caribéennes. Cette interculturalité est une réponse idéale à leur contexte étatsunien et à leurs racines Caribéennes. Sous cet angle, l’échange entre les deux mouvements gagne sa légitimité. Nous avons aussi constaté que, dans certaines situations, les symboles et les pratiques qui maintiennent l’unité du mouvement rastafari ne gardent pas systématiquement le même sens dans la culture hip-hop. Cependant cet échange permet aux deux cultures de s’affirmer. Dans notre réflexion, nous avons tenté aussi de souligner l’apport de la culture caribéenne à la « culture du monde » à travers le mouvement rastafari et le mouvement hip-hop dans la Caraïbe et dans la naissance du mouvement hip-hop aux États-Unis. L’esthétique caribéenne favorise la communication entre cultures. Dans une société « mosaïque » qui s’est construite avec l’apport de différents peuples, la recherche de points communs est essentielle pour bâtir un développement harmonieux. C’est ainsi que l’artiste caribéen, étant lui-même un homme « divisé », cherche souvent à faire la synthèse de tous ces mondes qui se croisent dans les sociétés caribéennes. Les populations originaires de cet espace, d’ailleurs, ont changé le visage de beaucoup de grandes villes nordaméricaines comme New York, Chicago et Miami. Des révolutions haïtienne et cubaine au garveyisme en passant par José Marti, de la négritude à Frantz Fanon, du mouvement rastafari à la créolité, la société caribéenne démontre sa capacité à innover sans cesse et à contribuer à l’enrichissement de la culture mondiale malgré sa petite taille et sa relative pauvreté économique. Sa culture a largement contribué à la résistance contre le colonialisme, le néo-colonialisme et le racisme par l’attitude de ses populations, de ses dirigeants et de ses intellectuels. Durant l’été 2006, une rue de Brooklyn, un quartier phare dans l’évolution du mouvement hip-hop, a été rebaptisée « Bob Marley Boulevard »266, le nom du plus célèbre messager du mouvement rastafari. Symboliquement, cette inauguration peut constituer un « clin d’œil » à l’interculturalité entre les deux mouvements sociaux que nous avons étudiés. L’intercultutralité entre le mouvement hip-hop et le mouvement rastafari redessine les contours de l’identité de la jeunesse caribéenne, caribéenne-américaine et africaine-américaine. Ces échanges entre les deux mouvements expriment l’identité transnationale de leurs adeptes et incarnent surtout la fin des identités exclusives. La faculté de s’ouvrir aux autres est une richesse précieuse. Les mouvements nous
266
AfroGlobe, Novembre/Décembre 2006.
239
rappellent, comme le déclare l’intellectuel antillais Patrick Chamoiseau, que « ce dont nous devons témoigner aujourd’hui, c’est des modalités d’un nouveau vivre ensemble à l’échelle du monde ».267
267
Cité dans Le Point Hors-Série N°22, Avril-Mai 2009, p 41.
240
BIBLIOGRAPHIE Outils conceptuels BACK, Len. New Ethnicities and Urban Culture, Racism and Multiculturalism in Young Lives London: UUL press, 1996. BANTON, Michael. Anthropological Approaches to the Study of Religion. London: Tavistock, 1990. BARTHES, Roland. Le Bruissement de la Langue. Paris : Seuil, 1993. BENETT, Andy. Popular Music and Youth Culture: Music, Identity and Place. Grande-Bretagne: Mac Millan press, 2000. BEYER, Peter. Religion and Globalization. London: Sage publications, 1994. BHABHA, Homi. Les Lieux de la Culture: Une Théorie Post-Coloniale, Paris: Payot, 2007 [1994]. BOURDIEU, Pierre. La Distinction : Critique Sociale du Jugement. Paris : Ed. de minuit, 1979. ------------------------. Les Règles de l’Art. Paris: Point Essai, 1998. -----------------------. La Misère du Monde. Paris: Seuil, 1998. BOYSSON-BARIDE, Bénédicte. Le langage, qu’est-ce que c’est ?, Paris : Editions Odile Jacob, 2003. BRAKE, M. The Sociology of Youth Culture and Youth Sub-Cultures. London: Routledge, 1980. BRUNEAU, Michel. Diasporas et espaces transnationaux. Paris : Anthropos Economica, 2004. CAMILLERI, Carmel. COHEN-EMERIQUE, Margalit Dir. Chocs de Cultures: Concepts et Enjeux Pratiques de l’Interculturel. Paris: L’Harmattan, 1989. CAUNE, Jean. Pour une Ethique de la Médiation: Les Sens des Pratiques Culturelles. Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble, 1999. CHIVALLON, Christine. La Diaspora Noire des Amériques. Paris : CNRS Editions, 2004. CLANET, Claude. L’Interculturel. Toulouse: Presses Universitaires du Mirail, 1990. CLOWARD, Richard Andrew. PIVEN, Frances Fox. Poor People's Movements: Why They Succeed, How They Fail. USA: Vintage Books, 1978. CONSTANT, Fred. Le Multiculturalisme. Paris : Flammarion, 2000. CUCHE, Denys. La Notion de Culture dans les Sciences Sociales. Paris: La Découverte, 1996.
241
DELACHE, Denys. LAURIER, Turgeon. OUELLET, Real. Transferts Culturels et Métissages entre l’Amérique et l’Europe du 16e au 20e siècle. France: L’Harmattan, 1996. DARRE, Alain Dir. Musique et Politique : Les Répertoires de l’Identité. Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 1996. DOLLOT, Louis. Culture de Masse et Culture Individuelle Paris: Presses Universitaires de France, 1977. FAURE, Alain. FILLEULE, Olivier. PECHU, Cécile. Lutter ensemble : Les théories de l’action collective. Paris : L’Harmattan, 2000. FISHER, Heinz-Dietrich. MERILL, C. John. Intercultural and International Communication New York: Hasting House publishers, 1976. FERNANDEZ-OLMOS, Margarite. PARAVISINI-GEBERT, Lizabeth. Creole religions of the Caribbean: An introduction from Vodou and santeria to obeah and espiritismo. New York/London: New York University Press, 2003. FRITH, Simon. Sound Effects: Youth Leisure and Politics of Rock. New York: Pantheon Books, 1981. GLAZER, Nathan. We are All Multiculturalists now. London: Harvard University press, 1997. GOODWIN, Jeff. JASPER, James. POLETTA, Francesca. Passionate politics: emotions and social movement, Chicago: University of Chicago Press, 2001. GURR, R. Ted. Why men rebel, Princeton University Press, 1971. HOOKS, Bell. Outlaw Culture: Resisting Representation. London: Routledge, 1994. LONGHURST, Brian. Popular Music and Society, Cambridge: Polity Press, 1995. LOUIS Second (traduit par). La Sainte Bible, Editions Internationales VIE. LABAT, C. VERMES, G. Dir. Cultures Ouvertes, Sociétés Interculturelles : Du Contact à l’Interaction Colloque de l’ARIC « Qu’est-ce que la recherche interculturelle ? » Vol. 2, 1994. LANTERNARI, Vittorio. The Religions of the Oppressed: A Study of Modern Messianic Cults New York: Mentorbooks, 1963. LEVI-STRAUSS, Claude (Dir.), L’Identité. Paris: Presses Universitaires de France, 1977. MACIONNIS, John. PLUMMER, Ken. Sociology: A Global Introduction. England: Prentice Hall, 2002. MANDON, Daniel. Cultures et Changement Social: Approche Anthropologique Lyon: Chronique sociale, 1990. NACHBAR, Jack. LAUSE, Kevin. Popular Culture: An Introductory Text. Bowling Green, OHIO: Bowling Green State University press, 1992. NEVEU, Erik, Sociologie des mouvements sociaux. Paris: Editions La Découverte, 2005.
242
NOTTINGHAM, Elizabeth. Religion and Society. New York: Random House, 1954. SMELSER, Neil. Theory of collective behaviour, Free Press, 1962. STEBE, Jean-Marc. La crise des banlieues. Paris: Presses Universitaires de France, 1999. TANON, Fabienne. VERMES, Geneviève. L’Individu et ses Cultures. Colloque de l’ARIC « Qu’est-ce que la recherche interculturelle? » Vol. I Paris: L’Harmattan, 1993. TAYLOR, Charles. Multiculturalisme: Différences et Unité dans la Diversité. Paris: Flammarion, 1994. TING-TOOMEY, Stella. Communicating Across Cultures. New York: Guilford press, 1993. TOFFLER, Alvin. The Culture Consumers: A Study of Art and Affluence in America. New York: Random House, 1973. WATSON, Conrad Williams. Multiculturalism. Buckingham: Open University press, 2000. WARNIER, Jean-Pierre. La Mondialisation de la Culture. Paris: La Découverte/Syros, 1999. WEBER, Max. L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme.Paris : Poche, 1989. WHITELEY, Sheila. Women and Popular Music: Sexuality, Identity and Subjectivity. London/New York: Routledge, 2000. WILLAIME, Jean-Pierre. Sociologie des Religions. Paris : La découverte et Syros, 1995. WILMORE, Gayraud S. Black Religion and Black Radicalism: An Interpretation of the Religious History of Afro-American People. New York: Orbis books, 1998.
Le mouvement hip-hop, la musique rap BAZIN, Hughes. La Culture Hip-Hop. Paris: Desclée de Brouwer, 1996. BETHUNE, Christian. Le Rap, Une Esthétique Hors La Loi. Paris: Autrement, 1999. BLUM, Bruno. Le rap est né en Jamaïque. Bordeaux : Castor Music, 2009. BYNOE, Yvonne. Stand and Deliver: Political Activism, Leadership and Hip-Hop Culture. Brooklyn: Soft skull Press, 2004. CACHIN, Olivier. L’Offensive Rap. Paris: Découverte Gallimard, 2000. ---------------------. Le Dictionnaire du Rap. Paris: Scali, 2007. --------------------. Les 100 Albums Essentiels du Rap. Paris: Scali, 2006. -------------------. Eminem: Le Prince Blanc du Hip-Hop. Paris: J’ai Lu, 2005. CASHMORE, Ellis. The Black Culture Industry. London: Routledge books, 1997.
243
CHANG, Jeff. Can’t Stop, Won’t Stop. New York: Saint Martin’s Press, 2005. -----------------. Total Chaos: the Arts and Aesthetics of Hip-Hop. New York: BasicCivitas Books, 2006. COSTELLO, Mark. FOSTER, Wallace. Signifying Rappers:Rap and Race in the Urban Present. New York: Ecco press, 1990. CROSS, Brian. It’s Not About a Salary: Rap, Race and Resistance in Los Angeles New York: Verso, 1994. DUFRESNE, David. Yo! Révolution Rap: l’Histoire, Les Groupes, Les Mouvements. Paris: Ramsay, 1991. DYSON, Michael Eric. Between God and Gangsta Rap: Bearing Witness to Black Culture. New York: Oxford University Press, 1996. ---------------------------- Know what I mean: Reflections on hip-hop. New York: Basic Civitas Book, 2007. ELLISON, Mary. Lyrical Protest, Black Music’s Struggle Against Discrimination. New York: Pragers publishers, 1989. FLOYD, Samuel A. Jr. Race music: Black Cultures from Bebop to Hip-Hop. [s.l.]: University of California Press, 2003. FLOYD, Samuel A. (Dir.). Black music Journal. Vol. 18, N° ½, [s.l.] 1998. GEORGE, Nelson. Hip-Hop America. New York: Penguin books, 1998. ----------------------The Death of Rhythm and Blues. New York: Penguin books, 1988. HAGER, Steven. Hip-Hop: The Illustrated History of Break dancing, Rap Music and Graffiti. New York: St.Martin’s, 1984. HAVELOCK, Nelson. GONZALES, Michael A. Bring the Noise: a Rough Guide to Rap Music and Hip-Hop Culture. New York: Harmony books, 1991. HELLER Jerry, Gangsta Rap Attitude. Paris: Scali, 2007. HOYE, Jacob et ALI, Karolyn. Tupac: Resurrection 1971-1996. New York: Atria books, 2003. HANAK, Fred et BLONDEAU, Thomas. Combat Rap. Bordeaux: Castral astar, 2007. JACKSON, Robert Scoop. The Last Black Mecca: Hip-Hop. Chicago: Research Associates, 1994. JAH, Yusaf Chuck D. Fight the Power, Rap, Race and Reality. Edinburgh: Payback press, 1999. JONES, LeRoi. Blues People. Edinburgh: Payback press, 1963; 1995.
KELLEY, Norman. Rhythm and Business: The Political Economy of Black Music. New York: Akashic Books, 2002.
KITWANA, Bakari. The Hip-Hop Generation: Young Blacks and The Crisis in African-American culture. New York: Basic Civitas Books, 2002.
244
------------------------- Why White Kids Love Hip-Hop: Wankstas, Wiggers, Wannabes and the New Reality of Race in America. New York: Basic Civitas Books, 2005. LAPASSADE, Georges. ROUSSELOT, Philippe TALAMAR, Loris. Le Rap ou la Fureur de Dire. Paris: Editions Loris Talmart, 1990. MASSOT, Florent. MILLET, François. Freestyle. Paris: Millet éditeurs, 1993.
MIYAKAWA, Felicia M. Five Percenter Rap: God’s Hop Music, Message, and Black Muslim Mission. Bloomington: Indiana University Press, 2005. MORGAN, Joan. When Chicken Heads Come Home to Roost: My Life as a Hip-Hop Feminist. New York: Schuster, 1999. NELSON, Angela M.S. (Dir.). This is How We Flow: Rhythm in Black Cultures. South Carolina: University of South Carolina press, 1999.
OLIVER, Richard (Dr). LEFFEL, Tim. Hip-Hop Inc: Success Strategies of the Rap Moguls. New York: Thunder’s Mouth Press, 2006. PANICCIOLI, Ernie. Who Shot ya? Three Decades of Hip-Hop Photography. New York: Amistad press, 2002.
PARKER, Kris. Ruminations. USA: Hamilton Printing Compagny, 2003. PARTEL, Stéphane. Les Fonctions Socioculturelles et Politiques du Rap aux États-Unis de 1980 à nos jours, Université des Antilles et de la Guyane, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Décembre 2005. Références au Fichier National des Thèses: 05GUY0127. PERRY, Imani. Prophets of the Hood: Politics and Poetics in Hip-Hop. Durham/London: Duke University Press, 2004. PERKINS, Williams Eric. (ed.). Droppin’ science: Critical essays on rap music and Hip-Hop culture. Philadelphia: Temple University Press, 1996. PINN, Anthony B. (Dir.), Noise and Spirit: The Religious and Spiritual Sensibilities of Rap Music. New York/London: New York University, 2003. ROSE, Tricia. Black Noise: Rap Music and Black Culture in Contemporary America. Hanover NH: University press of England, 1994. SCOTT, Cathy. The Murder of Biggie Smalls. New York: Saint-Martin’s Press, 2000. SEXTON, Adam. Rap on Rap: Straight-up Talk on Hip-Hop Culture. New York: Delta book, 1995. Sister Souljah. No Disrespect, New York: Vintage Books, 1994. SHAPPIRO, Peter. The Rough Guide to Hip-Hop., New York: Rough guides, 2001. SPADY, James Twisted Tales: In the Streets of Philly. Philadelphia: Umum press, 1995. -------------------Street Conscious Rap. Philadelphia: Umum press, 1999. SPRINGER, Robert. Les Fonctions Sociales du Blues. France: Parenthèses, 1999. TOOP, David. The Rap Attack:African Jive to New York Hip-hop. Boston: South End Press, 1984.
245
TATE, Greg (ed.). Everything But the Burden: What White People Are Taking From Black Culture, New York: Broadway Books, 2003. WEST BROOK, Alonzo. Hip-hoptionary: The Dictionary of Hip-Hop Terminology. New York: Harlem Moon, 2002. Le mouvement rastafari et la musique reggae BARROW, Steve. DALTON, Peter. The Rough Guide. New York: Penguin Books, 2001. BARETT, Leonard T. The Rastafarians: Sounds of Cultural Dissonance Boston: Beacon press, 1977-1988. BLUM, Bruno. Le Reggae. Paris: Librio musique, 2000. BONACCI, Giulia. Exodus! L'Histoire du Retour des Rastafariens en Éthiopie. Paris: Scali, 2008. CAMPBELL, Horace. Rasta and Resistance: From Marcus Garvey to Walter Rodney. New Jersey: Africa World press, 1987. CHANG, Kevin O'Brien. CHEN, Wayne. Reggae Routes: The Story of Jamaican Music. Temple University Press, Philadelphie: 1998. CONSTANT, Denis. Aux Sources du Reggae. Marseille: Parenthèse, 1982. DAVIS, Stephen. Bob Marley. Paris : Point Seuil, 1994. DAVIS, Stephen. Reggae Bloodlines: In Search of the Music and the Culture of Jamaica. New York: Capo Press, 1979. DAWES, Kwame. Natural Mysticism: Towards a New Aesthetic in Caribbean Writing. England: Peepal Tree press, 1999. ----------------------. Bob Marley: A Lyrical Genius, London: Sanctuary Publishing, 2002. DOUGLAS, R.A. Mack. From Babylon to Rastafari: Origins and History of the Rastafarian Movement. New York: Paperback, 1999. FORSYTHE, Dennis. Rastafari for the Healing of the Nation. New York: One Drop books, 1999. FOEHR, Stephen. Jamaican Warriors: Reggae, Roots, Culture. London: Sanctuary publishing, 2000. HANNAH BLAKE, Makeda Barbara. Rastafari the New Creation. Kingston: Jamaican Media Productions Ltd, 2002. JAHN, Brian. WEBBER, Tom. Reggae Island: Jamaican Music in the Digital Age. New York: Da Capo press, 1998. KING, Stephen A. Reggae Rastafari Rhetoric Social Control. Mississippi: University Press of Mississipi, 2002. LAVIGE, Laurent. BERNADI, Carine. Tendance Rasta. Paris: 10/18, 2003. LAKE, Obiagele. Rastafari Women: Subordination in the Midst of Liberation Theology. Durham, North Carolina: Carolina Academic Press, 1998.
246
LEE, Hélène. Le Premier Rasta France: Flammarion, 1999. ----------------. Voir Trenchtown et Mourir. France: Flammarion, 2004. LOCKOT, Hans. The Mission: The Life, The Reign and Character of Haile Selassie I. Jamaica: Research Associates Schooltimes Publications, Miguel LORNE Publishers, 1989. MARLEY, Rita avec JONES, Hettie. My Life with Bob Marley: No Woman No Cry. New York: Hyperion, 2004. MURRELL, Nathaniel S. Dir. Chanting Down Babylon: The Rastafari Reader. Kingston: Ian Randle publishers, 1998. NETTLEFORD, Rex. Rastafari: Roots and Ideology. Syracuse/Kingston: Syracuse University press, University of the West Indies press, 1995. NICHOLS, Tracy. Rastafari as a Way of Life. New York: Anchor Press, 1979. O’BRIEN CHANG, Kevin. CHEN, Wayne. Reggae Routes: The Story of Jamaican Music Philadelphia: Temple University Press, 1998. OWENS, Joseph. Dread: The Rastafarians of Jamaica. Kingston: Sangster, 1976-1995. POLLARD, Velma. Dread Talk: The Language of Rastafari. Kingston: Canoe press/ Mc Gill Queen’s University Press, 2000. POTASH, Chris. Reggae Rasta Revolution Jamaican Music. New York: Paperback, 1997. SANDFORD, Christine. The Lion of Judah Hath Prevailed. London: Frontline Books, 1999. STUART, Jane. I am a Rastafarian. USA: Rosen publishing group/Power kids press, 1999. WHITE, Timothy. Catch a Fire: The Life of Bob Marley. New York: Henry Holt and Company, 1998. Musique et communauté Africaine-Américaine ABU-JAMAL, Mumia. En direct du couloir de la mort. Paris : La Découverte et Syros, 1999. ANDERSON, Elijah. MASSEY, Douglas S. Problem of the Century: Racial Stratification in the United States, New York: Russell Sage Foundation Publications, 2004. BARETT, Leonard E. Soul-Force: African Heritage in Afro-American Religion. Garden City/New York: Anchor Books, 1974. BASTIDE, Roger. Les Amériques Noires dans le Nouveau Monde. Paris : Payot, 1967. BAUGH, John. Beyond Ebonics: Linguistic Pride and Racial Prejudice. New York: Oxford University press, 2002.
247
BLAIR, Thomas L. Retreat to the Ghetto: The End of a Dream?. New York: Hill and Wang, 1977. BRICE HEATH, Shirley. Mc LAUGHIN, Milbrey W. Identity and Inner City Youth: Beyond Ethnicity and Gender. New York: Teachers college press, 1993. DAVIDAS, Lionel. Chemins d’identité. Kourou: Ibis rouge, 1997. DU BOIS, William Edward Burghardt, The Souls Of Black Folk. England: Oxford University Press [1903], 2007. DYSON, Michael. Reflecting Black: African-American Criticism. Minnesota: University of Minnesota Press, 1993. ----------------------. Race Rules : Navigating the color line.USA: Vintage Books, 1997. ---------------------. Between God and Gangsta Rap: Bearing Witness to Black Culture. Oxford: Oxford University Press, 1996. FRAZIER, Franklin. The Negro in the United States. New York: Macmillan Co, 1949. FUSFELD, Daniel R. BATES, Timothy. The Political Economy of the Urban Ghetto. [s.l]: Southern Illinois University Press, 1984. GLAZIER, Stephen D. Dir. African and African-American Religions. London/New York: Religion and Society Encyclopedia, 2001. GREEN, Charles. Manufacturing Powerlessness in the Black Diaspora: Inner City Youth and the New Global Frontier. New York: Altamira press, 2000. HALLOWAY, Joseph E. Africanisms in American Culture. Indiana: Indiana University press, 1990. HARRIS, Joseph E. African-American Reactions to War in Ethiopia (19361941., Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1994. HERSKOVITS, Melville. The Myth of the Negro Past. Boston: Beacon Press, 1941. HUGGINS, Nathan I. KILSON, Martin. FOX, Daniel M. (Dir.). Key Issues in The Afro-American Experience. Volume II, [s.l.]: Harcourt Brace Jovanovich Inc., 1971. HOOKS, Bell. Outlaw Culture. New York: Routledge, 1994. KETE ASANTE. Kemet, Afrocentricity and Knowledge. New Jersey: Africa World press, 1990. KENNEDY, Randall. The strange Career of a Troublesome Word. New York: Pantheon Books, 2002. LAWSON, Bill E. (Dir.). The Underclass Question. Philadelphia: Temple University Press, 1992. MASSEY, Douglas. DENTON, Nancy. American Apartheid. Paris: Descartes and Cie,1995. MINTZ, Sidney W. Sweetness and Power: The Place of Sugar in Modern History. New York: Penguin Books, 1986.
248
PAINTER, Nell Irvin. Creating black Americans: African-American History and its Meanings, 1619 to the Present New York. Oxford: Oxford University Press, 2007. RICKFORD, John Russell. Spoken Soul: The Story of Black English. New York/Canada: John Wiley and sons Inc., 2000. RUSSELL, John Rickford. Spoken soul: The story of black English, New York:
Hardcover, 2000. SCOTT, William R. The Sons of Sheba’s Race: African-Americans and the Italo-Ethiopian War (1935-1941). Indianapolis: Indiana Univversity Press, 1993. SUTCLIFFE, David. FIGUEROA, John. System in black language (Multilingual matters), United Kingdom: Longdunn Press, 1992. TATE, Greg (Dir.). Everything But the Burden: What White People Are Taking From Black Culture. New York: Broadway Books, 2003. JAYNES, Gerald Davis. WILLIAMS, Robin Dir. A Common Destiny: Blacks and American Society. [s.l.]: National Academy Press, Washington DC Press, 1989. Nationalisme noir CARR, Robert. Black Nationalism in the New World: Reading the AfricanAmerican Experience and West Indian Experience. Chicago: Duke University press, 2002. GLAUDE, Eddie S. Jr. Dir. Is it Nation Time?: Contemporary Essays on Black Power and Black Nationalism. London: University of Chicago Press, 2002. PINKEY, Alphonso. Red, Black and Green: Black Nationalism in the USA, New York: Cambridge University Press, 1976. Expérience caribéenne aux États-Unis HOLGER, Henke. The West-Indian-Americans. Greenwood Press: New York, 2001. KASINITZ, Philip. Caribbean New York: Black Immigrants and the Politics of Race. New York: Cornell University Press, 1992. PALMER, Ransford W. U.S.-Caribbean Relations: Their Impact on Peoples and Culture. Connecticut: Praeger, 1998. PALMER, Ransford W. Pilgrims From the Sun: West-Indian Migration to America. New York: Twayne Publishers, 1995.
249
REUEL, Rogers, Afro-Caribbean Immigrants and the Politics of Incorporation: Ethnicity, Exception or Exit. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. VICKERMAN, Milton. Crosscurrents: West-Indians and Race. New York/Oxford: Oxford University Press, 1999. WATERS, Mary C. Black Identities: West-Indians Dreams and American Realities. New York: Russell Sage Foudation, 1999. Culture dancehall HOPE, Donna P. Inna di Dancehall: Popular Culture and the Politics of Identity in Jamaica. Kingston: UWI Press, 2006. COOPER, Carolyn. Sound Clash Jamaican Dancehall Culture. New York: Palgrave MacMillan, 2004. STOLZOFF, Norman C. Wake the Town and Tell the People: Dancehall Culture in Jamaica. London Durham: Duke University Press, 2000. Substances narcotiques BOOTH, Martin. Cannabis: A History. New York: Picador Editions, 2005. CHARLES NICOLAS, Aimé. Crack et cannabis dans la Caraïbe. Paris: L’Harmattan, 1997. REINARMAN, Craig. LEVINE, Harry G. Dir. Crack in America: Demon Drugs and Social Justice. Berkeley/Los Angeles: University of California Press, 1997. SHAPIRO, Harry. Waiting For the Man: The Story of Drugs and Popular Music. London: Helter Skelter Publishing, 1999. WILLIAM, James H. Doin’ Drugs: Patterns of African-American Addiction. Texas: University of Texas Press, 1996. Identité et cultures caribéennes ALLEYNE, Mervin. Africa: Roots of Jamaican Culture. London: Pluto
Press 1988.
BARROW, Christine. REDDOCK, Rhoda Dir. Caribbean Sociology: Introductory Readings England: Wiener, Markus publishers, 2001. BENNETT, Hazel. SHERLOCK, Phillip. The Story of the Jamaican People. Kingston: Ian Randle Publishers, New-Jersey: Markus WIENER Publishers, en collaboration avec The Creative Production and Training Centre, 1998. BRATHWAITE, Kamau. The Development of Creole Society in Jamaica: 1770-1820 Creolisation. Ian Randle Publishers, Jamaïque: 1971.
250
BURTON, Richard D.E. Afro-Creole: Power, Opposition, and Play in the Caribbean England: Paperback, 1997. BEHAGUE, Gerard H. Dir. Music and Black Ethnicity: The Caribbean and South-America. Florida: University of Miami-North-South-Center, 1994. BERNABE, Jean. CHAMOISEAU, Patrick. CONFIANT, Raphaël. Eloge de la Créolité. Paris: Gallimard, 1989. BEST, Curwen. Culture at the Cutting Edge: Tracking Caribbean Music. Kingston: University of the West Indies Press, 2004. BOLLAND, Nigel. The birth of Caribbean civilization: A century of ideas about culture and identity, nation and society. Kingston: Ian Randle Publishers, 2004. CHAUDENSON, Robert. La Créolisation : Théorie, Applications, Implications. Paris : L’Harmattan, 2003. DUNN, Hopeton Dir. Globalization, Communications and Caribbean Identity. Jamaica: Ian Randle Publishers, 1995. EDMONDSON, Belinda. Caribbean Romances: The Politics of Regional Representation. USA: University of Virginia Press, 1999. ENTIOPE, Gabriel. Nègres, Danse et Résistance: La Caraïbe du 17e au 19e Siècle. Paris: L’Harmattan, 1996. FERNANDEZ-OLMOS, Margarite. PARAVISINI-GEBERT, Lizabeth. Creole religions of the Caribbean, New York: New York University Press, 2003. GARVEY, Marcus. GARVEY, Amy J. Dir. The Philosophy and Opinions of Marcus Garvey, Or, Africa for the Africans. England : Majority Press, 1986. GILMORE, John. Faces of the Caribbean. [s.l.]: Latin American Bureau, 2000. GLISSANT, Edouard. Le Discours Antillais. Paris: Le Seuil, 1981. GUNST, Laurie. Born Fi’Dead: A Journey Through the Jamaican Posse Underworld. New York: Henry Holt company, 1995. HEBDIGE, Dick. Cut n’ Mix: Culture, Identity and Caribbean Music. New York: Routledge, 1990. HENRIQUES, Fernando. Family and Color in Jamaica. London: Eyre and Spottiswoode, 1953. JNO-BAPTISTE DURIZOT, Paulette. Culture et Stratégie Identitaire dans la Caraïbe. Paris : L’harmattan, 2001. LARA, Oruno Denis. Les Caraïbes. Paris : Presses universitaires de France, 1986. LERUS, Julie. Identité Antillaise : Contribution à la Connaissance
Psychologique et Anthropologique des Guadeloupéens et des Martiniquaiso Paris: 1979, Editions Caribéennes.
MAXIMIN, Colette. La Parole aux Masques: Littérature, Oralité et Culture Populaire dans la Caraïbe Anglophone au 20e Siècle. Paris : Editions Caribéennes, 1991.
251
Martin, Steve. Britain and the slave trade. London: Channel 4 Books, 1999. NETTLEFORD, Rex. Caribbean Cultural Identity: The Case of Jamaica, An Essay in Cultural Dynamics. Kingston: Ian Randle Publishers, New Jersey: Markus WIENER Publishers, 2003. PERRET, Delphine. La Créolité : Espace de Création. Martinique : Ibis Rouge éditions, 2001. RANO, Jonas. Créolitude : Silence et cicatrices pour seuls témoins. Paris : L’Harmattan, 1997. RODNEY, Walter. Grounding With My Brothers. England: Frontline Distribution International, 1996. ----------------------.How Europe underdeveloped Africa, USA: Howard University Press, 1982. RUBIN, Vera. Social and Cultural Pluralism in the Caribbean. Canals of New York academy, 1960. SHEPERD, Verene. RICHARD, Glen Dir. Questioning Creole: Creolisation in Caribbean Discourses: In Honor of Kamau Brathwaite. Kingston: Ian Randle publishers, 2002. TAFARI, Seko. From the Marrons to Marcus: A Historical Development. Trinidad: Research Associated School Times Publications, 1985. VALDMAN, Albert. HIGHFIELD Arnold. Theoretical Orientations in Creole Studies. New York: Academic press, 1980. Les États-Unis ANDERSON, Elijah. MASSEY, Douglas S. Problem of The Century: Racial Stratification in the United States. New York: Russell Suge Foundation, 2001. HEFFER, Jean. Les États-Unis de 1945 à nos jours. Paris: Armand Colin, 1997. LACORNE, Denis. La crise de l’identité Américaine, du Melting-Pot au multiculturalisme. Paris: Fayard, 1997. LEVY, Claude. Les minorités ethniques. Paris: Ellipses, 1997. HENITT, Christopher. Understanding Terrorism in America: From the Klan to Al-Qaeda. New York/London: Routledge, 2003. SCHLESINGER, Arthur. The Disuniting of America. New York et London: W.W. Norton, 1998. SCHLOSSER, Eric. Reefer Madness: Sex, Drugs and Cheap Labor in the American Black Market. New York: Mariner books, 2003. TEAFORD, Jon C. The Twentieth Century American City, Problems, Promise and Reality. Baltimore and London: The Johns Hopkins University press, 1986.
252
WALZER, Michael. What It Means To Be an American: Essays on the American Experience. New York: Marsilio, 1996. La communauté noire en France BILE, Serge. Sur le dos des hippopotames: Une vie de nègre. Paris : Calmann-Lévy, 2006. Articles de revues et périodiques SIMPSON George. "Political Cultism in West Kingston, Jamaica" Social and Economic Studies, 1955, 4(1), pp. 133-149. LENNOX, Raphael. West-Indians and Afro-Americans. Freedomways, 1964: 438—45. PATTERSON, Orlando. "Ras Tafari: The Cult of Outcasts" New Society (1), 1964: pp. 15-17. BRYCE-LAPORTE, Roy, “Black immigrants, the experience of invisibility and inequality”. Journal of Black Studies, 3, 1, 29-56, 1972. RECKFORD, Verena. “Rastafarian Music : An Introduction Study”. Jamaica Journal 11, 1977. SPENCER, William D. “Rastafari : Poverty and Apostasy in Paradise”, Journal of pastoral practices N°4, 1 1980: p 67-68. ----------------------------- “Manchild by the rivers of Babylon : An analysis of Rastafari’s churchly versus sectarian aspects to interpret the present and predict the future of the rastafarian experience in the United States” , Manuscrit non publié et situé à la Bibliothèque Zenas Gerig, Séminaire Théologique de la Jamaïque à Kingston, 1983. YAWNEY, Carole. “Rastafarian Sistren by The Rivers of Babylon”. Canadian Woman Studies/Les Cahiers de la Femme 5(2) : 73-75 ROWE, Maureen. “The Woman in Rastafari”. Caribbean Quarterly 26 (4): 13-21. 1985. SEMAJ, Leahcim Tufani. “Inside Rasta: The future of a religious movement”, Caribbean Review 14, 1 (1985): 8-11, 37-38. BLAIR, Elizabeth. “Commercialization of the rap music subculture” Journal of Popular Culture Vol. 27 n°3, 1993. SAVISHINSKY, Neil. “Transnational popular culture and the global spread of the jamaican rastafarian movement”, New West Indian Guide, 63(3/4), 1994. -----------------------------. “Transnational Popular Culture and the Global spread of the Jamaican Rastafarian Movement”, New West Indian Guide 68, 3-4 (1994): 261-279.
253
MICHEL, Christian. « Faut-il interdire les drogues? », D’après un conférence donnée à Toulouse, Septembre 1996. L’Affiche Magazine, Dossier Rap féminin, N°43, Mars 1997. The Source Magazine, Numéro spécial, N°100, Janvier 1998. LELAND, John. “When Rap Meets Reggae”. Newsweek, 7 septembre 1992. HAVELOCK, Nelson. “Reggae and hip-hop come together”. Billboard, Vol. 108 N°27, Juillet 1996. HENDERSON, Errol A. “Black Nationalism and Rap Music” Journal of black studies 26 (3): 308-339, 1996. PRYCE, Jean T. “Debates on Ebonics and Jamaican Creole”. Journal of Black Psychology, n° 23, Août 1997. Journal of Popular Culture, Volume 21.3, 1999. BERNIER, Yvan. ATKINSON, Dave. « Mondialisation de l’économie et diversité culturelle : Les arguments en faveur de la préservation de la diversité culturelle ». 2e concertation intergouvernementale sur la promotion de la diversité culturelle, Paris : Agence intergouvernementale de la francophonie, Octobre 2000. OUMANO, Elena. “Natty Dread Learns to Rap”. Miami News Times, février 2000. OTCHET, Amy. « Musiques: Génération fusion » Courrier de l’UNESCO, n°8, juillet-août, pp.21-56, 2000. CUCHE, Denys. «Diaspora », Pluriel Recherches. Vocabulaire Historique et Critique des Relations Inter-Ethniques, cahier n°8, Paris : L'Harmattan, 2001. p. 14-23. CONDRY, Ian. “Japanese Hip-Hop and Globalization of Popular Culture”. Urban Life: Reading in the Anthropology of the City, George Gmelch and Walter P. Zenner Dir. Illinois: Waveland press, p.357-387, 2001. JONES, Steve. “Teen idols with an urban edge”. USA Today, 06 Juin 2002. KITWANA, Bakari. « Tribal-ism ». The Source Magazine, N°139, Avril 2001. FROSH, Dan. “Dead Prez : Rites of Passage”. The Source Magazine, N°136, Janvier 2001. BYNOE, Yvonne. “Getting real about global hip-hop”. Georgetown journal of internal affairs, culture section, Mars 2002. DUFOIX, Stéphane. « Généalogie d’un lieu commun « Diaspora » et sciences sociales », Actes de l’histoire de l’immigration, Volume 2, 2002. CHANG, Jeff. “Stakes is high: Conscious Rap, Neosoul and the Hip-Hop Generation”, The Nation, 13/20, Janvier 2003. WITTER, Michael. Dr. “Challenges facing the Jamaican music business”, Directeur du Département d’Economie de UWI, Mona, Février 2003.
FORD, Ryan. “The Bogyguard: Streets is watching”. The Source Magazine, N°169, Octobre 2003.
254
CONFIANT, Raphaël. « Créolité et francophonie : Eloge de la diversalité » Agence intergouvernementale de la francophonie, Madrid : Autrement, 2004. GARDNER, Laura. “Slackorality in dancehall culture: Oral sex gets a licking”. Beat Magazine, Août et Septembre 2004, vol. 23, N°4. RATCLIFFE, Fahiym. CLARK, Antoine. “Eminem: La Face Cachée”. The Source Magazine France, N°006, Février 2004. MESCHINO, Patricia. “Roots Renaissance”. The Source Magazine,N°180, September 2004. MARSHALL, Wayne. “Hearing hip-hop’s Jamaican accent”, Institute for Studies in American Music, Conservatory of Music, Brooklyn College of the City University of New York, Newsletter, Volume 34, N°2, 2005. ALLAH, Dasun. “Minister Farrakhan: Vision Quest”. The Source Magazine, N°193, November 2005. TURNER, Khari Kimani. “Violence in hip-hop: Self-Destruction”. The Source Magazine, N°201, July 2006. HEINZELMAN, Bill. CODISH, Cybelle. SKOUTAKIS, George. LUCAS, Demetria. “Hip-hop Behind Bars”, The Source Magazine, N°208, Mars 2007. HALE, Andreas. “Funny Money”. The Source Magazine, N°213, Août 2007.
255
SITES INTERNET Méthodologie : www.gate.cnrs.fr/perso/neveu/documents/TEMS_Seance_2.pdf, Mathieu Neveu Mouvement hip-hop et communautés africaine-américaine, caribéenne : www.amadoudiallofoundation.org www.149st.com : site consacré a l’art graffiti. www.daveyd.com www.motherjones.com/arts/qa/2004/09/09_100.html www.haiticulture.ch http://www.geocities.com/Athens/Ithaca/3638/blacktalk.html http://www.atoutgospel.com/historique/historique.htm www.reynier.com/ANTHRO/Amerique/Index_Amerique.html http://www.reynier.com/Anthro/Amerique/Index_Amerique.html www.africamaat.com/article.php3?id_article=129 www.zulunation.com http://www.youtube.com/watch?v=LYOVQezWaCY http://www.allhiphop.com/features/?ID=1521. www.rastaexperience.com/demusic.htm www.thetempleofhiphop.com Cannabis : http://agora.qc.ca/encyclopedie.nsf: http://fr.wikipedia.org/wiki/Cannabis www.oas.org/juridico/spanish/gapeca_fr_docs_can4.doc http://www.unodc.org/unodc/fr/press_release_2004-06-25_1.html?print=yes http://agora.qc.ca/mot.nsf/Dossiers/Drogue http://fr.wikipedia.org/wikiCannabis/#Pharmacologie http://www.dossiersdunet.com/spip.php?article546 www.narconon.org/druginfo/marijuanna_hist.html cannabisculture.com/articles/3582.html http://cannabisculture.com/articles/1846.html Mouvement rastafari : http://www.rastaites.com/news/archives/2004/archive1104.htm www.thedreadlibrary.com lu-k.skyrock.com/article_141284961.html
257
Reggae : www.reggae.fr/lire-interview/ 1_interview-Anthony-B-.html) www.jahmusik.net http://www.ireggae.com/record.htm http://en.wikipedia.org/wiki/Island_Records www.vprecords.com http:/oldies.jahmusic.net/marleymumia.htm Jamaïque : www.visitjamaica.com http://www.boston.com/travel/getaways/caribbean/articles/2005/04/03/a_troub led_jamaicas_call_for_one_love_rings_hollow/ www.jamaicatravel.com societies.ex.ac.uk www.salonmario.de www.wallpaperbase.com www.naani.com www.rastadread.com Citation de Christine Taubira Delanon : http://www.secourspopulaire.fr/dossiersarticle.0.html?&cHash=df2b5aa78e&id_article=170&id_dossier=24 Graffiti Rastafari : www.myspace.com/rasterms www.miamigraffiti.com/writer.php?id=Terms www.tagpage.com/tag_page/6-16-01_memory.html http://www.protestplaat.nl/foto/rasta001.jpg www.kcm.hr/ktgraffiti/rasta.asp
258
DISCOGRAPHIE REGGAE The Wailers, Burnin’, Island Records: 1973 Bob Marley and The Wailers, Catch a fire, Island Records: 1973 Bob Marley and The Wailers, Natty Dread, Island Records: 1974 Bob Marley and The Wailers, Rastaman Vibrations, Island Records: 1976 Bob Marley and The Wailers, Exodus, Island Records: 1977 Peter TOSH, Equal Rights, Virgin: 1977 Bob Marley and The Wailers, Kaya, Island Records: 1978 Bob Marley and The Wailers, Uprising, Island Records: 1980 Bob Marley and The Wailers, Confrontation, Island Records: 1983 Peter TOSH, Mama Africa, EMI: 1983 Capleton, Prophecy, Def Jam/African Star: 1995 Buju Banton, ‘Til Shiloh, Loos Canon: 1995 Capleton, I Testament, Def Jam: 1997 Sizzla, Praise Ye Jah, X Terminator/Jet Star: 1997 Buju Banton, Inner Heights, Heartbeat: 1997 Sizzla, Freedom cry, VP Records: 1998 Sizzla, Black woman and child, Brickwalls/Greensleeves: 1998 Sizzla, Good Ways, Jet Star: 1999 Sizzla, Be I strong, VP Records: 1999 Morgan heritage, Don’t haffi Dread, VP Records: 1999 Capleton, More Fire, VP Records: 2000 Bob Marley and The Wailers, Survival, Island Def Jam: 2001 Bob Marley and The Wailers, Catch a fire, Island Def Jam: 2001 Damian Marley, Halfway Tree, Motown Records, 2001 Bob Marley and The Wailers, Talking Blues, Island Def Jam: 2002 Buju Banton, Friends for Life, VP records: 2003 Damian Marley, Welcome to Jamrock, Universal Records: 2005 Nasio Fontaine, Universal Cry, Greensleeves: 2006 RAP NORD-AMÉRICAIN Grandmaster Flash and The Furious Five, The Message, Sugarhill: 1982 Public Enemy, It Takes A Nation Of Millions To Hold Us Back, Def Jam, 1988 Boogie Down Production, By all means necessary, Jive: 1988 Krs-One, Ghetto music: The blueprint of Hip-Hop, Jive records: 1989 Jungle Brothers, Done by forces of nature, Warner Bros Records: 1989
259
NWA, Straight outta Compton, Priority records, 1989 Public Enemy, Fear of the black planet, Def Jam Records: 1990 X-Clan, To the East, 4th and B’way, Island, Polygram Records: 1990 Brand Nubian, In God we trust, Elektra Entertainment: 1992 X-Clan, Xodus, Island Records: 1992 Krs-One, Return of the Boom Bap, Jive Records: 1993. Dr Dre, The Chronic, Death Row: 1993 Jeru da Damaja, The Sun rises in the East, Payday: 1994 Wu-Tang Clan, Enter The Wu-Tang Clan (36 Chambers), Loud Records: 1994 Nas, Illmatic, Columbia: 1994 Arrested Development, Zingalamaduni, Chrisalys Records: 1994 Common, Resurrection, Relativity Records: 1994 Notorious BIG, Ready to die, Bad boy: 1995 Goodie Mob, Soul food, Laface Records: 1995 Tupac Shakur, All Eyes on me, Death Row: 1996 Busta Rhymes, The Coming, Elektra: 1996 Tupac Shakur, The Don Killuminati, Death Row: 1996 Jay Z, In my Lifetime Vol. 1, Roc-a-fella Records: 1997 Notorious BIG, You’re nobody till’ somebody kills you, Bad boy: 1997 Lauryn Hill, The miseducation of Lauryn Hill, Ruffhouse Records: 1998 Gangstarr, Moment of Truth, Noo Trybe Records: 1998 DMX, It’s dark and hell is hot, Def Jam: 1998 Cocoa Brovas, The rude awakening, Priority Records: 1998 Bob Marley, Chant Down Babylon, Tuff Gong/Island Records: 1999 Mos Def, Black on Both Side, Rawkus Records: 1999 Nas, I am…The autobiography, Sony Music: 1999 Mos Def et Talib Kweli, Blackstar, Rawkus Records: 1999 Dead Prez, Let’s get Free, Loud Records: 2000 Common, Like Water for chocolate, MCA Records: 2000 Talib Kweli and Hi-Tek, Reflection Eternal-Train of thought, Rawkus Records: 2000 Kardinal Official, Quest for fire, MCA Records: 2001 Lauryn Hill, MTV Unplugged 2.0, Columbia Records: 2002 Jurassic Five, Power in Numbers, Interscope Records: 2002 Krs-One and The Temple of hip-hop, Spiritual Minded, Koch Records: 2002 Dead Prez/RBG/People Army, Turn off the radio, the mixtape Vol. 2, Get free or dye tryin’, Boss Inc.: 2003 Jeru Da Damaja, Divine Design, Ashenafi Entertainment Inc: 2003 Krs-One, Kristyle, Koch Records: 2003 The Hip-hop Project Vol. I “Are you feeling me?”, Art Start Inc: 2003 Immortal Technique, Revolutionnary Vol. II, Viper Records: 2003 Duo Live, 1st H.I.M. Pressions, Redemption recordings: 2003
260
Duo Live, Ghetto Gold, Redemption Recordings: 2005 P-Cutta, Mixtape The Art of War Vol. II, UNI can make it happen Entertainement: 2006 Krs-One, Life, Antagonist Records: 2006 Scienz of life, The blaxploitation sessions, Shaman Work Recordings: 2006 Duo Live, Mixtape Cash Those Checks hosted by DJ Khaled, Redemption Music Group: 2006 Duo Live, Mixtape That’s What’s Next hosted by DJ Kay Slay, Redemption Music Group: 2006 M1, Confidential, Koch Records: 2006 X-Clan, Return from the Mecca, Suburban Noize Records: 2006 Hi-Tek, Hi-Teknology: The Chip, Babygrande Records: 2006 Nas, Hip-hop is dead, Def Jam Recordings: 2006 Mos Def, True Magic, Geffen Records: 2006 Dead Prez and The Outlawz, Can’t sell dope forever, Affluent Records: 2006 Krs-One and Marley Marl, Hip-Hop Lives, Koch Records: 2007 Duo Live, The Color of Money, Redemption Recordings: 2007 Stephen Marley, Mind Control, Universal Records: 2007 Ras G, Beats of Mind, P-Vine: 2008 Ras G and The Afrikan Space Program, Ghetto Sci-Fi, Poo-Bah Records, 2008 Ras G, Beats and the abstract truth: More blues than mathematics, Mochilla records, 2008 RAP FRANÇAIS Dany Dan, Poétiquement correct, Disques Durs : 2006 DANCEHALL Beenie Man, Maestro, VP records/Universal: 1995 Beenie Man, Slam, Island Records: 1995 Bounty Killer, My Xperience, VP Records/ TVT Records: 1996 Lady saw, Give me the reason, VP Records: 1996 Beenie Man, Many Modds of Moses, Melodie: 1997 Sean Paul, Dutty Rock, VP Records/Atlantic: 2002 Sean Paul, The Trinity, VP Records/Atlantic: 2005 The biggest ragga dancehall anthems, Greensleeves Records: 2006 Buju Banton, Too Bad, Gargamel Music Inc.: 2006 Beenie Man, Undisputed, Virgin2006
261
NEO SOUL D’angelo, Brown Sugar, EMI Records: 1995 Erykah Badu, Baduism, Kedar/Universal Records: 1997 Erykah Badu, Mama’s gun, Motown Records: 2000 Jill Scott, Who’s Jill Scott : Words and Sounds Vol. I, Hidden Beach Recordings : 2000 India Arie, Acoustic Soul, Motown Records: 2001 India Arie, Voyage to India, Motown: 2002 RAP JAMAICAIN268 Ginsu, The Struggle, Per Ankh Amen Publishing: 2003 The Sickest Drama, Wildcard Mixtape Skeng Digital, Fully Digital Mixtape High Stakes Mixtape Vol. II High Stakes Mixtape Vol. III Killah Child, Killah Tapes K-John, Kingstown Mixtape Julio Sluggs, Street Corner Mixtape Frank Grizzy, Bad man 9/11 Mixtape
268
Le plus souvent, les mixtapes n’ont pas de date de sortie ni de maison de disques, ces données n’ayant pas été accessibles pour nous.
262
FILMOGRAPHIE Mouvement hip-hop, communauté Africaine-Américaine Wattstax, réalisé par Larry SHAW et Mel STUART, Fantasy Inc.: 1972 Wildstyle, réalisé Charlie AHEARN, 1982 Beatstreet, réalisé par Harry BELAFONTE et David V. PICKER, Orion Pictures : 1984 Boyz in the hood, réalisé par John SINGLETON, Columbia Pictures: 1991 Rhyme and reason, réalisé par Peter SPIRER, Miramax Films: 1997 Black and White, réalisé par James TOBACK, Bigel/Mailer Films: 2000 Street Life: La dure loi de la rue, réalisé par Dionciel ARMSTRONG, Xenon Pictures: 2001 Brooklyn Babylon, Marc Levin, 2001. U-God : Rise of a fallen soldier, réalisé par JAGWAR, 5 Star Entertainement: 2003
Beef, réalisé par Peter SPIRER, QD3 Entertainement : 2003
F.E.D.S. : The Streets are talking, réalisé par Rob KIRK et Rob LIHANI, Simmons Lathan Media Group: 2003 Inside hip-hop, réalisé par Marcos Antonio MIRANDA, Live Music Channel: 2003 Colorz of Rage, Réalisé par Dale RESTEGHINI, Artisan Home Ent. : 2003 8 Miles, réalisé par Curtis HANDSON, Universal Studios and Dreamworks: 2003. Street is watching, réalisé par Damon DASH et Schavaria REEVES, Roc-afella Records: 2004 Beef II, réalisé par Peter SPIRER, QD3 Entertainment : 2004 Hip-Hop Peace and Unity Fest, Inebriated Rhythm: 2004 Rap Files, Volume I, Game Time, réalisé par Frak Vision, SonyMusic Department: 2004 The MC: Why we do it, réalisé par Peter SPIRER, QD3 Entertainment: 2004 Scarface, réalisé par Oliver STONE, Universal Studio : 2004 The Original 50 Cent: The true story of the legend who inspired the biggest name in rap, réalisé par Froi CUESTA, CZAR Entertainment: 2005 King of Kings, réalisé par Kevin CLOVER, P.O.C. Films: 2005 Mandekalou: The art and soul of the Mande griots, Syllart Productions: 2005 Fight Klub Volume 1, Magazine DVD The Raw Report : hip-hop in its rawest form, Volume 3, Magazine DVD
263
Mouvement rastafari, reggae, société caribéenne Marcus Garvey: Look for me in the whirlwind, réalisé par Stanley NELSON, WGBH: 2001 Life and debt, réalisé par Stephanie BLACK, New Yorker film Artwork: 2003 Rude Boy, réalisé par Desmond GUMBS, Bent outta Shape Productions/A mstell Entertainment Inc. : 2003 One Love, réalisé par Rick ELGOOD et Don LETTS, VRP Music Group: 2005 Africa Unite: In celebration of Bob Marley, 60th Birthday (Febuary 6, 2005), Ethiopia. Shottas, Réalisé par Cess SILVERA, Sony Pictures Entertainment: 2007 Champion in action, Volume 3, Magazine DVD
264
GLOSSAIRE RASTAFARI Akete : Désigne une forme de tambour ou un style de battement utilisé dans les cérémonies religieuses rastafari nyahbinghi. Babylon Shitstem : Cette locution désigne les forces ou institutions sociales, politiques, sociales, économiques, culturelles que les rastas perçoivent comme étant menaçantes pour leur équilibre. Badman : Peut désigner un rasta courageux et, dans d’autres cas, une personne ayant un comportement dangereux. Balhead : Personne n’appartenant pas au mouvement rastafari Bongo Natty : autre nom désignant le rastaman Bredren : Terme désignant un frère dans la foi ou un sympathisant Chalice : Terme désignant les deux pipes utilisées dans le rituel rastafari consistant à fumer de la marijuana durant les cérémonies religieuses. Dawta : De l’anglais daughter signifiant fille. Terme affectif désignant les femmes rasta. Dread talk : Langage propre aux adeptes du mouvement rastafari. Dub : Rythme reggae utilisé pour chanter ou réciter des poésies. Idren : Désigne les enfants d’un adepte rasta. I-n-I : Expression qui capture l’harmonie entre le rasta et Dieu. Ital : Désigne la nourriture végétarienne consommée par les rastas. Itations : Méditations, réflexions. Jah : Terme utilisé pour désigner Dieu. Il réfère aussi à Haïlé Sélassié. Kingman : Terme utilisé par les femmes rasta pour désigner leur compagnon. Nyahbinghi ou Binghi: Désigne le rassemblement et la célébration religieuse rastafari. Sistren : terme désignant une sœur dans la foi ou une sympathisante. Zion : Désigne le paradis, l’Éthiopie ou encore la nature où le rasta peut se réfugier et fuir l’activité du monde moderne.
265
GLOSSAIRE HIP-HOP Battle : Compétition entre deux danseurs ou deux groupes de danseurs. Désigne aussi la confrontation verbale entre deux MCs ou deux groupes d’artistes. B-Boy : désignait dans les années 70 les danseurs et danseuses (B-Girls). Aujourd’hui, le terme désigne tout membre actif du mouvement hip-hop. Beatboxing : Discipline de la culture hip-hop consistant à produire des rythmiques et des sonorités diverses avec la bouche. Beef : Dispute verbale entre deux MCs ou deux groupes d’MCs. A l’origine ces confrontations sont verbales mais ces dernières années elles ont dégénéré de manière dramatique. Durant les années 90, le beef est devenu un outil puissant pour lancer un artiste. Le terme désigne aussi une embrouille, un accrochage entre deux personnes. Bling-bling : Bijoux, accoutrement des rappeurs mais aussi se réfère au style de vie ostentatoire et excessif. Beat : rythme. Breakdance : Danse hip-hop. Boom-Bap : rythme classique à quatre temps du rap des années 1990. Crew : Un groupe de personnes (DJs, MCs, danseurs et autres) faisant partie de la même fraternité. En général, les membres du crew se déplacent ensemble, font des concerts, des albums ensemble. DJ : abréviation de la locution disc-jockey. Il manipule les disques sur ses platines et travaille souvent en harmonie avec les rappeurs et les danseurs. Disc jockey (DJ) : Le musicien de la musique rap. Il manipule les disques vinyles à partir de ses deux ou trois platines. Il accompagne le MC et produit également des musiques à partir de boîtes à rythmes. Il est aussi appelé Turntablist mot dérivé de l’anglais « turntable » signifiant platine disque. Ego-Trip : Style d’écriture ou de morceau dans lequel le rappeur se met en valeur (au plan financier, sexuel, musical…) et cherche à se différencier des autres rappeurs. Flow : La qualité et le style du débit du MC lorsqu’il rappe. Ce débit est la signature du MC, ce qui le différencie des autres. Freestyle : Littéralement « style libre ». Cet exercice de style consiste à improviser des paroles, non écrites et non coupées, avec ou sans musique. C’est une qualité impressionnante et très plébiscitée dans la culture hip-hop, et tous les MCs sont censés la maîtriser. Elle s’applique aussi aux danseurs, au DJs et aux graffeurs. Graffiti : inscription calligraphiée d’un dessin tracé, peint ou gravé sur un support qui n’est normalement pas prévu à cet effet (murs, camions, trains, etc…) Hip-hopper : Adepte du mouvement hip-hop.
266
MC : Originellement l’abréviation signifiant « maître de cérémonie » et elle a été inventée par la franc-maçonnerie. Dans la culture hip-hop, elle désigne celui qui par ses rimes, son style et son charisme arrive à capter l’attention de l’auditoire. L’abréviation a été redéfinie au fil des années Mic Controller ou Move the Crowd. Elle désigne le rappeur même si certains font une distinction entre le rappeur et le MC, le rappeur étant un mot pour désigner l’artiste commercial et le MC celui qui représente la culture hip-hop. L’art d’être un MC se dit emceeing. Mixtape : Généralement produite par un DJ, cette compilation invite des dizaines de MCs sur des productions inédites. Elle propose de nouvelles versions de morceaux connus ou les meilleures chansons d’un artiste ou d’un courant dans le rap. Elle est, en général, vendue dans la rue c’est un outil de promotion important pour un artiste et qui sert de lien entre les membres de la communauté hip-hop. New School : deuxième génération de rappeurs (à partir des années 90). Old School : première génération de rappeurs (fin des années 70 jusqu’à la fin des années 80). O.G : le sigle signifie Original Gangster. Les O.G ont une crédibilité dans la rue et dans le quartier car ils ont déjà commis plusieurs crimes graves. Ils servent de médiateurs dans les conflits entre les plus jeunes et, en général, ils participent financièrement à des actions sociales dans le quartier. Sampling : De l’anglais sample qui signifie « échantillon ou extrait ». Cette pratique est à la base de la musique rap. Elle consiste à sortir un extrait d’instrument ou de voix d’un disque et à en faire la base d’un morceau rap en le répétant. Cet extrait est parfois lui-même mélangé à d’autre extraits. Scratch : Désigne les sonorités effectuées par un DJ en manipulant un disque vinyle et sa table de mixage. Underground : Ce mot signifie souterrain en anglais et fait référence à la scène rap non médiatisée. En général, c’est aussi un état d’esprit revendiquant la production indépendante et la liberté artistique des artistes. Weed, chronic : Marijuana. Word : Cette expression est propre à la culture hip-hop et s’emploie quand l’orateur ou l’interlocuteur veut souligner ce qui vient d’être dit. Ce vocable fait partie des nombreux termes du hip-hop empruntés à la Five Percent Nation.
267
L'HARMATTAN, ITALIA Via Degli Artisti 15 ; 10124 Torino L'HARMATTAN HONGRIE Könyvesbolt ; Kossuth L. u. 14-16 1053 Budapest L'HARMATTAN BURKINA FASO Rue 15.167 Route du Pô Patte d’oie 12 BP 226 Ouagadougou 12 (00226) 76 59 79 86 ESPACE L'HARMATTAN KINSHASA Faculté des Sciences Sociales, Politiques et Administratives BP243, KIN XI ; Université de Kinshasa L’HARMATTAN GUINEE Almamya Rue KA 028 en face du restaurant le cèdre OKB agency BP 3470 Conakry (00224) 60 20 85 08 [email protected] L’HARMATTAN COTE D’IVOIRE M. Etien N’dah Ahmon Résidence Karl / cité des arts Abidjan-Cocody 03 BP 1588 Abidjan 03 (00225) 05 77 87 31 L’HARMATTAN MAURITANIE Espace El Kettab du livre francophone N° 472 avenue Palais des Congrès BP 316 Nouakchott (00222) 63 25 980 L’HARMATTAN CAMEROUN Immeuble Olympia face à la Camair BP 11486 Yaoundé (00=Ht8 ++ ti i2 ii [email protected] L’HARMATTAN SENEGAL « Villa Rose », rue de Diourbel X G, Point E BP 45034 Dakar FANN (00221) 33 825 98 58 / 77 242 25 08 [email protected]


![Theorie du mouvement de la lune [Tome 1]](https://vdoc.tips/img/200x200/theorie-du-mouvement-de-la-lune-tome-1.jpg)
![Theorie du mouvement de la lune [Tome 2]](https://vdoc.tips/img/200x200/theorie-du-mouvement-de-la-lune-tome-2.jpg)