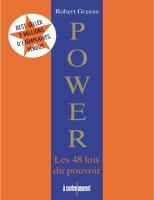Ecriture Du Pouvoir Et Pouvoir de La Littérature [PDF]
Écritures du pouvoir et pouvoirs de la littérature Sylvie Triaire et Alain Vaillant (dir.) DOI : 10.4000/books.pulm.193
55 2 3MB
Papiere empfehlen
![Ecriture Du Pouvoir Et Pouvoir de La Littérature [PDF]](https://vdoc.tips/img/200x200/ecriture-du-pouvoir-et-pouvoir-de-la-litterature.jpg)
- Author / Uploaded
- Mohamed Lehdahda
Datei wird geladen, bitte warten...
Zitiervorschau
Écritures du pouvoir et pouvoirs de la littérature Sylvie Triaire et Alain Vaillant (dir.)
DOI : 10.4000/books.pulm.193 Éditeur : Presses universitaires de la Méditerranée Année d'édition : 2001 Date de mise en ligne : 21 octobre 2014 Collection : Collection des littératures ISBN électronique : 9782367810492
http://books.openedition.org Édition imprimée ISBN : 9782842695002 Nombre de pages : 389 Référence électronique TRIAIRE, Sylvie (dir.) ; VAILLANT, Alain (dir.). Écritures du pouvoir et pouvoirs de la littérature. Nouvelle édition [en ligne]. Montpellier : Presses universitaires de la Méditerranée, 2001 (généré le 03 mai 2019). Disponible sur Internet : . ISBN : 9782367810492. DOI : 10.4000/books.pulm.193.
Ce document a été généré automatiquement le 3 mai 2019. Il est issu d'une numérisation par reconnaissance optique de caractères. © Presses universitaires de la Méditerranée, 2001 Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540
1
SOMMAIRE Avant-propos Alain Vaillant
La littérature et l'Histoire Quand Sade récrit l’histoire de France : pouvoir de la représentation romanesque et (contre-) écriture politique dans Histoire secrète d’Isabelle de Bavière Reine de France (1813) Éric Bordas
En haine de la politique Gisèle Seginger
De la lumière bénie de Dieu aux feux brûlants de l'homme : la représentation du pouvoir dans les derniers romans de Victor Hugo Patricia Mines
La réaction politique de Barbey d'Aurevilly à Léon Bloy : imagerie ou rhétorique du pouvoir ? Marie-Françoise Melmoux-Montaubin
Les émotions du pouvoir Ramón Camats I Guardia
Les pouvoirs de l'écrivain Du détachement à la révolte : philosophie et politique dans l’Essai sur les règnes de Claude et de Néron Stéphane Lojkine
I. Le sage, la doctrine, le texte : figures du détachement II. De l’attachement à la révolte : dialogisme et dialectique de l’Essai III. Poétique de la révolte et imaginaire du pouvoir
Joseph de Maistre, nouveau mentor du prince : le dévoilement des mystères de la science politique Jean-Louis Darcel
Les œuvres de la période 1793-1803 Les œuvres de la période russe : 1808-1815 Du Pape comme utopie politique
L’écrivain comme pouvoir (1778-1864) José-Luis Diaz
Honoré de Balzac : prince, propriétaire, maréchal, intelligentiel Stéphane Vachon
Monde Idées Prince Propriétaire Sujet Maréchal Intelligentiel
2
Pouvoir - impouvoir ou fiction et réalités juridiques Sandra Travers de Faultrier
L’œuvre objet d’un droit de reproduction Le livre, objet contractuel ou domaine public
Le roi est nu ou la tragique impuissance de l’écrivain face à l’éditeur au XIX e siècle Jean-Yves Mollier
Le système éditorial français en 1857 Le magistère perdu ou la souffrance de l’homme de lettres Pour une histoire culturelle de la littérature
Les pouvoirs de l'écriture Le pouvoir des Lumières : le tableau du citoyen Dupuis (1806) Claude Rétat
« Rois inconnus ». De l’usage du secret dans le roman de Balzac Chantal Massol-Bedoin
Ultima verba : pouvoir du condamné et du proscrit David Charles
Écriture et fantasme du pouvoir chez Barbey d'Aurevilly : la violence et l'harmonie Pascale Auraix-Jonchière
De la néantisation à la célébration du pouvoir dans l'Histoire La souveraineté de l'écriture Fiction, mythologie et fantasmatique du pouvoir
Rhétorique et pouvoir au miroir du récit Corinne Saminadayar-Perrin
Confrontations Sémiotique du pouvoir Dissections, disjonctions L'invention d'un autre discours
La génétique littéraire Présentation Sylvie Triaire
Une culture fragmentaire Peter Michaël Wetherill
Un exemple d'étude microgénétique : le début du second chapitre de Bouvard et Pécuchet de Gustave Flaubert Florence Pellegrini
Qu'est-ce que la critique génétique ? État des lieux Spécificité du manuscrit moderne Constitution et analyse d'un dossier génétique Un exemple d'étude microgénétique : le début du chapitre II de Bouvard et Pécuchet de Gustave Flaubert. Établissement du dossier génétique Ouvrages et articles génétiques consacrés à Gustave Flaubert
3
Génétique, musicologie, comparatisme : quelques réflexions Marjorie Berthomier
Critique génétique et poétique du sujet la leçon des variantes Christian Chelebourg
1. PERSPECTIVES SUR LA VARIANTE 2. LES LEÇONS D’« EL DESDICHADO »
Critique génétique : orientation bibliographique Florence Pellegrini
4
Avant-propos Alain Vaillant
1
Si l'on néglige, un instant, les arguties conceptuelles et les débats méthodologiques, il est clair que toute la théorie littéraire est une longue réflexion – ou rêverie – sur le pouvoir de la littérature, sur ce pouvoir mystérieux des mots dont l'écrivain, par vocation artistique, aurait découvert le moyen de décupler l'efficacité. De cette vertu intemporelle du langage, le discours critique sur le Romantisme – disons sur le XIXe siècle – a en outre inventé la version historienne, qui est à l'origine de l'extraordinaire renouveau des recherches littéraires sur le XIXe siècle français, depuis près d'un demi-siècle. L'homme d'après 1789 aurait découvert l'Histoire : que l'Histoire a un pouvoir sur le réel et un sens, et qu'il lui revient de se saisir du premier pour influer sur le second. Là encore, l'auteur, parce qu'il est, plus que tout autre, libre et responsable de ses mots, aurait la mission de penser le modèle de cette historicité-là, ou, du moins, d'en élaborer l'image textuelle ; si bien que, désormais, toute poétique est, ipso facto, une politique.
2
Tout cela est bien connu. Mais, justement, il ne sera pas question, dans cette troisième livraison de Lieux littéraires/La Revue, de ces deux images, triomphales et aveuglantes, de la Littérature et de l'Histoire, mais, au contraire, de ce qu'elles ont laissé dans l'ombre – ou à contre-jour. S'il est vrai, en effet, que le XIXe siècle est sans doute destiné à réaliser, dans le long terme, les promesses de la Révolution, jamais pourtant l'Histoire n'a paru autant piétiner, revenir sur ses pas ou divaguer hors du sillon glorieux que les romantiques du début de siècle lui avaient par avance tracé. Alors que se met en place, lentement mais sûrement, l'économie du capitalisme industriel – nouveau type de pouvoir, autrement redoutable que le politique –, la France voit ainsi se succéder, à un rythme que ponctuent les violences collectives, civiles ou militaires, deux monarchies, deux empires, deux républiques, trois révolutions et un coup d'État (ou deux, si l'on compte comme tel le retour de Napoléon Ier, en 1815). Le pouvoir au XIXe siècle est ainsi polymorphe, anamorphique et tétracéphale, sans cesse partagé ou disputé par le Prince, le peuple, la foule, le financier.
3
L'idée qui a présidé au présent numéro1 est que cette instabilité, ces soubresauts de l'histoire événementielle, ont joué un rôle déterminant dans les représentations que les écrivains se font d'une part du pouvoir politique, d'autre part de leur statut, de leur
5
fonction et de leur propre pouvoir en regard du politique. À cette idée est aussi liée la conviction que, outre le problème des sources du pouvoir, des fondements de sa légitimité et de sa forme idéale, qui intéresse la théorie politique et l'utopie sociale, si fécondes au XIXe siècle, l'écrivain, parce qu'il est un spécialiste de la parole performative et donc, à sa manière discursive, un homme d'action, est d'abord fasciné par la réalité du pouvoir, par les modalités concrètes de sa conquête comme de son exercice. Au cœur de la conception énergétique de la littérature qui est celle du romantisme, se love un obscur désir de violence, qui se nourrit des coups de force de l'Histoire. * 4
Un premier ensemble d'articles s'intéresse au regard que portent les auteurs – certains auteurs, qui ont tous problématisé la violence et son rapport avec le cours des choses humaines – sur l'Histoire réelle. Éric Bordas analyse ainsi comment le marquis de Sade, avec autant de subtile malignité que de cohérence, récrit l'histoire d'Isabelle de Bavière, reine de France. Gisèle Seginger, revenant sur la question, complexe et controversée, de l'idéologie de Flaubert, montre que son apolitisme, déclaré et nourri d'une profonde méfiance à l'égard de l'Histoire, doit être sensiblement nuancé si l'on envisage la pratique de l'écrivain. Patricia Mines suggère, contre une bonne partie de la critique hugolienne, que Victor Hugo, des Misérables à Quatrevingt-treize, a teinté de couleurs beaucoup plus sombres et pessimistes son image de la violence révolutionnaire, peut-être jusqu'à la palinodie. Chez Barbey d'Aurevilly, la dénonciation de l'apocalypse révolutionnaire ne fait, elle, aucun doute ; mais, pour Marie-Françoise Melmoux-Montaubin, l'essentiel est bien moins le discours réactionnaire du lecteur admiratif de Joseph de Maistre que la tentative littéraire de concevoir un nouveau lyrisme, qui tourne résolument le dos à la rhétorique terroriste des révolutionnaires. Enfin, d'un point de vue apparemment extérieur à la littérature, Ramón Camats i Guàrdia nous invite, en philosophe, à nous interroger au préalable sur les « émotions » du pouvoir, sur sa nature affective et infraconsciente qui explique, selon lui, les étonnantes affinités entre le littéraire et le politique.
5
Un deuxième volet est consacré au pouvoir de l'écrivain, à ses réalités ou à ses représentations. Par l'intermédiaire de la littérature des Lumières et de Diderot, Stéphane Lojkine revient à la figure héroïque de Sénèque, philosophe et pourtant conseiller du sanguinaire Néron : pour l'auteur de L'Essai de Claude et de Néron, il n'y aurait d'engagement possible qu'au prix d'un « détachement » préalable, qui conditionne la poétique de l'œuvre. A l'inverse, Jean-Louis Darcel entreprend de démontrer que Joseph de Maistre, bien avant et malgré le succès public de ses écrits, s'est rêvé conseiller du Prince – mentor d'un tsar auquel il ambitionnait de communiquer, notamment sous la forme qu'il leur donne dans les Soirées de Saint-Pétersbourg, des leçons de philosophie politique. Mais, à mesure qu'on avance dans le siècle, le pouvoir de l'écrivain procède bien moins de l'autorité politique que de son image auprès du public, de la représentation de lui-même qu'il élabore au travers de sa personne ou de son œuvre. Dans une perspective large, José-Luis Diaz propose une esquisse historique de l'écrivain comme pouvoir ; Stéphane Vachon, pour sa part, décline les conceptions balzaciennes, du prince des lettres au parti des « intelligentiels ». Mais la question du statut de l'écrivain est indissociable de l'examen des doctrines juridiques ou des réalités économiques : dans ces deux domaines, il apparaît que le pouvoir prétendu ou revendiqué de l'homme de lettres
6
repose sur des bases extraordinairement fragiles, voire illusoires : selon Sandra Travers de Faultrier, ce pouvoir fonctionne comme une fiction inévitable ; et Jean-Yves Mollier, en historien de l'édition, montre que l'écrivain, s'il est un roi d'un nouveau genre et sacré comme tel, est décidément un roi nu. 6
Il est alors tentant, dans ces conditions, de loger le pouvoir de l'écrivain dans les secrets d'une écriture par nature singulière, dans l'ambition démesurée – ou plutôt incommensurable – qui anime tout auteur. Ambition utopique d'illuminer le monde et de communiquer un savoir encyclopédique, sous la forme à la fois érudite et totalisatrice qu'imagine le citoyen Dupuis et que retrace Claude Rétat. Ce désir d'explication s'accompagne souvent de la conviction fantasmatique de détenir un mystère, et d'en contrôler la divulgation : Chantai Massol-Bédoin rappelle à quel point cette obsession du secret est une des clés de La Comédie humaine. Victor Hugo, selon l'évolution qu'en retrace David Charles, résoud la contradiction en faisant naître le sujet de l'écriture grâce à l'exil – proscription ou mort – du personnage anecdotique de l'écrivain : processus de désindividuation où lecteur et auteur doivent idéalement se rejoindre. Mais comment l'autorité légitime que ce dernier rêve pour lui-même pourrait-elle se prémunir de la violence originelle qui gît dans toute rhétorique – dans la rhétorique de l'écriture aussi bien que dans celle de la politique, qu'il est si facile et si gratifiant de condamner ? C'est à surmonter cette aporie que la littérature du XIXe siècle s'est épuisée, en même temps qu'elle se constitue et se renouvelle grâce à elle. Ainsi, pour Pascale Auraix-Jonchière, la doctrine réactionnaire de Barbey d'Aurevilly, partagée entre l'exacerbation de la violence et le désir d'harmonie, semble-t-elle née de ce questionnement de la rhétorique, et d'avance fissurée par lui. Si bien que, suivant la suggestion vertigineuse de Corinne Saminadayar-Perrin, l'écriture, en représentant et en désignant le pouvoir politique, s'acharnerait à vouloir expulser d'elle-même cette rhétorique maléfique qui, pourtant, est le pouvoir même, et avec laquelle elle devrait enfin se résigner à vivre – en y réfléchissant poétiquement. *
7
À la suite de ce premier ensemble, on trouvera, comme pour les deux numéros précédents, un dossier scientifique, cette fois consacré à la dernière-née des méthodes critiques, la génétique littéraire, et constitué sous la responsabilité de Sylvie Triaire : je renvoie donc à la présentation qui figure en ouverture. Mais il reste, pour terminer, à justifier deux anomalies de ce numéro.
8
Anomalie chronologique : ce troisième numéro paraît en automne au lieu du printemps, après deux livraisons de l'année 2000 elles-mêmes tardives. Que le lecteur se rassure. Ces retards sont ceux des débuts : les deux numéros de l'année 2001 – dont celui-ci – auront paru à peu près simultanément, d'octobre à décembre 2001, et le calendrier, ainsi remis en ordre, sera désormais respecté à l'avenir.
9
Anomalie rédactionnelle : compte tenu de la masse exceptionnelle d'articles publiés dans les deux livraisons 2001, nous avons choisi de répartir entre elles les deux sections qui figurent habituellement dans chaque numéro, à savoir le dossier scientifique et les « chantiers en cours », consacrés à des recherches en voie d'achèvement. Pour le 2001-1 (ce numéro), le dossier sur la génétique ; les comptes rendus de recherches figureront, eux, dans le 2001-2 (n° 4). Mais les numéros retrouveront leur physionomie normale en 2002, et durant toutes les années à venir.
7
NOTES 1. Avant d'être un numéro de revue, cette idée a fourni le thème d'un colloque qu'a organisé le Centre d'études romantiques et dix-neuviémistes de Montpellier III, en collaboration avec l'équipe XIXe siècle de l'université Denis Diderot/Paris VII, sous la responsabilité scientifique de Jean-Claude Fizaine et d'Alain Vaillant. Une partie des communications a été publiée dans le numéro précédent de Lieux littéraires/La Revue (n° 2, 2000-2), consacré à « Rythmes. Histoire, littérature, culture ».
8
La littérature et l'Histoire
9
Quand Sade récrit l’histoire de France : pouvoir de la représentation romanesque et (contre-) écriture politique dans Histoire secrète d’Isabelle de Bavière Reine de France (1813) Éric Bordas
1
La pratique sadienne de l’écriture est indissociablement liée à l’expérience carcérale qui fut la condition de l’auteur : privée de variété et de renouvellement dynamique, elle s’épanouit, de ce fait, dans le ressassement des discours, des images et des usages. La poétique de Sade est faite de reprises et de détournements des contextes d’énonciation — ou scénographies. L’objet de la reprise peut être de nature métatextuelle, quand Sade reprend l’histoire de son héroïne exemplaire, Justine, en trois récits toujours plus développés, ou hypertextuelle, quand l’auteur s’approprie des « fictions » qui sont tombées dans le domaine public depuis longtemps, sans référence livresque précise ou avec une référence plus culturelle que littéraire — on pense à la réinvention de la Bible proposée par l’un des criminels de La Nouvelle Justine, ou à la figure de Catherine II de Russie telle qu’elle apparaît dans l’Histoire de Juliette1. La récriture est de toute façon un phénomène courant au XVIIIe siècle qui n’a pas encore un sentiment exclusif de la propriété artistique, et notoirement présent dans la démarche sadienne que tout phénomène de rapt ou de perversion ne peut qu’enchanter2.
2
En effet, la récriture réalise chez Sade la ruse suprême de la destruction, qui a toujours été son obsession. En investissant un texte premier d’une intention qui lui est radicalement étrangère, en développant celle-ci dans une perspective précise contre laquelle ce texte pouvait même avoir été pensé, Sade obtient des effets de subversion qui sont une des images du pouvoir de l’écrivain, le seul pouvoir qui lui reste dans sa cellule ou dans sa vie si étroitement surveillée. La démonstration est évidente dans le cas d’une
10
vérité biblique totalement diabolisée3 ; elle s’avère tout aussi exemplaire quand Sade récrit une page de l’Histoire de France en racontant, dans ce qui est son dernier texte (1813), la vie d’Isabeau de Bavière, reine de France de 1385 à 14224. Le genre de la chronique historique, inspirée de Froissart, et qui relate des faits bien connus de tous, oblige l’écrivain au respect d’une certaine vérité factuelle prétendue qui va lui servir de garant pour énoncer des contre-vérités interprétatives — à charge pour celles-ci d’avoir la couleur stylistique de la conviction : conviction historique ou romanesque ? tel sera l’enjeu du combat de l’hypertexte et de l’hypotexte que Sade agence avec une évidente délectation. Toute l’énonciation de l’Histoire secrète d’Isabelle de Bavière reine de France repose sur l’opposition d’une construction argumentative logique (narrative et historique) et d’une destruction des références (narratives et historiques elles aussi, mais porteuses de romanesque). C’est pourquoi, pour artificieuse que soit la distinction, dans la production de Sade, entre une tendance ésotérique scandaleuse et une tendance exotérique plus sage, semblable clivage a le mérite de suggérer les phénomènes de récriture, de tromperie, d’énallage, par lesquels une énonciation, avouée et avouable, ne feint de se plier au pouvoir de l’ordre attendu que pour mieux investir de ses troubles pervers les énoncés de la représentation. 3
Le résultat est une fiction alla Umberto Eco, qui joue d’une intertextualité pervertie par les réinventions scénographiques pour démontrer que le pouvoir poétique de l’imaginaire est supérieur à la vérité des faits admis. On commencera par décrire le fonctionnement, diversement subtil mais nettement codifié, d’une récriture qui est d’abord une désécriture puis une invention (I) ; on s’interrogera ensuite sur les effets stylistiques d’un tel renversement des valeurs, du point de vue de la représentation du sujet, qui est tout l’enjeu de l’écriture sadienne, autant que sur les images emblématiques d’un imaginaire collectif qui soutiennent ces effets (II). Ceci permettra de comprendre que l’idée stylistique formelle est ici au service d’une thématique très large — et non l’inverse — qui joue des images du pouvoir comme de principes d’une énonciation du fantasme (III). Mais il ne s’agit pas de ramener cette démarche sadienne à un cas particulier, plus ou moins inquiétant : comme l’a souligné Jean-Claude Bonnet, « on a trop longtemps pathologisé l’œuvre de Sade en la rabattant uniquement sur des obsessions et des fantasmes, alors qu’elle s’inscrit méthodiquement dans le contexte de son temps »5. C’est vrai de l’Histoire secrète d’Isabelle de Bavière, plus encore que de tous les autres textes du marquis, en ce que cette récriture qui fait du neuf avec un ancien qui, fondamentalement, n’existe plus endehors du surgissement de l’archaïque qu’il vient rappeler, est la matérialisation même de cette transition des pouvoirs et surtout des pratiques de discours possibles qui marque le romantisme français.
4
Voulant raconter le destin d’une femme d’exception, Sade part du principe que les historiens qui l’ont précédé ont tous été insuffisants, soit par « ignorance », soit par « pusillanimité » (p. 19)6. Monstrelet, Mézerai, l’abbé de Choisy, Le Laboureur, Mlle de Lussan, Villaret, sont tous des « compilateurs » (p. 26) qui « ont commis la même faute » (p. 326) : ne pas avoir osé comprendre le caractère de la femme de Charles VI, analyse qui, seule, peut permettre d’expliquer les horreurs qui ont accompagné son règne. Le point de vue de Sade ne doit pas être perçu aujourd’hui comme une originalité prétentieuse : ses contemporains avaient le même mépris pour ce genre de fausses références. « Jusqu’ici », écrit Stendhal dans le New Monthly Magazine de mai 1824, « les Français n’ont pas eu d’historien qu’ils puissent comparer à Hume et à Rapin-Thoyars. L’Histoire de France de Velly, Villaret et Garnier est une compilation ridicule, exécutée pour des libraires et
11
mutilée par la censure »7. « Le temps est venu d’écrire l’histoire avec la même sérénité philosophique qu’un traité de chimie », ajoute le futur auteur de La Chartreuse de Parme un mois plus tard8. Ce n’est pas exactement le choix stylistique et scientifique de Sade quand il décide de jeter un nouvel éclairage sur une des périodes les plus sombres de notre passé. Un premier exemple illustrera la dialectique de réfutation et d’invention imaginaire dont Sade décide de faire son principal outil rhétorique. Peu après le début de la folie du roi de France, en 1392 environ, la reine régente, Isabeau de Bavière — appelée « Isabelle » par Sade qui préfère cette version féminine plus proche de l’onomastique de ses romans personnels —, décide de ne plus vivre avec le monarque et isole celui-ci afin de mieux se livrer à ses intrigues de détournement du pouvoir. Sade, comme ses prédécesseurs, rapporte le fait et propose une interprétation qui est d’abord une réfutation : C’est ici qu’on observe avec plaisir la bonhomie de nos historiens. Isabelle, disentils, attendu les fréquentes rechutes de son époux, demeurait à l’hôtel Saint-Paul, pendant que le roi se tenait au Louvre : comme si la gravité des maux de son époux n’eût pas plutôt exigé sa présence près de lui ? À quel point ces grands spéculateurs s’écartent du motif de cet éloignement ! et pourquoi donc ne pas voir que si la reine avait son habitation loin de celle de son époux, c’était dans le dessein de négocier plus à l’aise avec ceux qu’elle cherchait à séduire et à s’attacher par les moyens même les plus illicites ? Voilà cependant comme les bonnes gens écrivent l’histoire, et comme les sots croient tout ce qu’écrivent les bonnes gens (p. 102). 5
La citation reste anonyme et approximative : demeure l’intention malveillante de désigner comme insuffisant, voire ridicule, le discours historien dans son ensemble. Face à une question suggérée par les faits (pourquoi Isabelle a-t-elle abandonné son mari au moment où il avait besoin d’elle ?) et non résolue par les spécialistes, Sade risque la proposition historique de la tentative de trahison effective, autorisée par une vraisemblance psychologique incontestable mais tout de même inventée par ce narrateur-historien d’un nouveau genre. C’est dire que sa récriture de l’Histoire de France est d’abord une réfutation des références admises, qui prend la forme stylistique d’une désécriture radicale du discours historien et historique pour mettre à sa place un nouvel usage énonciatif. Le discours de l’Histoire passera par la production d’une histoire narrée et commentée selon les lois d’une logique romanesque originale : « Le plan de cet ouvrage ne nous permettant pas de suivre tous les fils de cette sanglante époque de l’histoire de France, nous prions nos lecteurs de permettre qu’entièrement circonscrits dans notre sujet, nous ne tracions ces faits horribles, qu’autant que notre héroïne s’y trouvera liée » (p. 178). Ce choix n’est pas arbitraire, il s’impose, quasiment, du fait de l’insuffisance de tout ce qui a précédé et qui ne permet pas, par exemple, de rendre compte des manœuvres d’Isabelle de Bavière. On ne sera pas surpris de lire fréquemment des énoncés d’une intransigeance absolue, qui sont d’abord des réprimandes devant le laisser-aller intellectuel, et donc moral. Il y a un devoir d’imagination : « [...] le devoir d’un historien ne consiste pas seulement à débiter des faits que tout le monde sait, il consiste encore davantage à suivre le fil des événements et, s’il se rompt, à le rattacher aux vraisemblances, quand il ne peut pas l’unir à des vérités connues. Il vaudrait autant sans cela, lire des dates et des chronologies » (p. 84)9. Ainsi, Villaret ayant rapporté l’anecdote célèbre selon laquelle Charles VI avait inventé un petit jeu qui consistait à se déguiser en sauvage avec quelques courtisans, puis à mettre le feu à leurs costumes enduits de poix, le narrateur sadien réagit en refusant la non-culpabilité du monarque dans cette plaisanterie qui finit très mal, ironisant sur ce « hasard, qu’il n’est permis de nommer tel qu’à ceux ou qui ne veulent rien approfondir, ou qui jugent encore moins » (p. 93) :
12
Nous ignorons ici par quelle raison, et contre tous les récits des contemporains, il a plu a Villaret d’avancer deux mensonges aussi absurdes que ceux qu’il se permet, en disant que le roi n’était pas avec les sauvages, pendant qu’il est certain qu’il les conduisait ; ensuite que la reine s évanouit au récit du malheur qui venait de menacer les jours d’un époux qu’elle aimait, tandis qu’elle vivait avec d’Orléans depuis plusieurs années, et que ce prince n’avait projeté que chez elle, et avec elle, le perfide événement des sauvages, qui d’après les nouvelles réflexions qu’ils avaient faites, leur faisaient plus que toute autre chose désirer maintenant la mort d’un roi, dont l’existence contraignait infiniment l’étendue de leur pouvoir. Et d’ailleurs, si Charles n était pas avec les sauvages, d’après le récit de Villaret, comment peut-il dire, à la page suivante, que la reine frémit du danger que son époux avait couru ? pouvait-il en courir aucun, puisqu’il n y était pas ? quelle contradiction ! et comment un grave historien peut-il altérer la vérité de faits aussi capables de jeter du jour sur les plus importants personnages de ce siècle : est-ce donc avec cette basse adulation qu’on écrit l’histoire ? N’en doutons pas, Isabelle conçut l’affreux projet de cet incendie, et le duc d’Orléans l’exécuta (p. 93-94 ; je souligne). 6
Entre la raillerie et la leçon de morale, on voit se dessiner la « méthode » sadienne qui repose tout entière sur l’autorité de ton de l’énonciation, fonctionnant par intimidation du discours fortement axiologisé (exclamatives, vocabulaire, questions rhétoriques, antiphrases) et par une radicalisation des enchaînements logiques matérialisée par quelques connecteurs syntaxiques et surtout par la cohérence isotopique du propos dans le dictum. Imprécation et harangue se rejoignent dans l’impératif collectif final (« N’en doutons pas »), qui impose un mode d’énonciation réunissant écriture et lecture en une commune activité de production d’un imaginaire qui est aussi un mode d’intellection. Semblable poétique de l’Histoire, qui est d’abord une stylistique du récit, trouve son aboutissement dans la prosopopée, dont le narrateur-historien renverse la nature de prétérition pour en faire une charge critique : [...] comment ne pas voir qu’Isabelle instruite de cette affaire aura nécessairement dit au jeune homme : Profite de ce qui se présente ; venge-toi, venge ton maître et moi, le hasard t’en offre les moyens, et je me charge de ton bonheur. Si elle a dû dire cela, Isabelle l’a dit, et si elle l’a dit, tout le reste coule de source, tout le reste est démontré (p. 251).
7
Logique de l’intuition et supériorité du sensible sur le factuel, et surtout du discursif sur le narratif. L’énonciation de l’historien fait entendre un CQFD enchérissant ou contrariant : sa désécriture d’un discours historique insatisfaisant propose en contrepartie une récriture critique, qui subvertit les repères attendus, aussi bien thématiquement que poétiquement. Qui veut la fin veut les moyens : « Il fallait connaître Isabelle », prévient « l’auteur » dans sa « préface », « et certes, elle est bien mieux connue quand on la fait parler que quand on écrit froidement ce qu’elle a dit » (p. 27). C’est ainsi que le discours de l’historien a pour devoir d’inventer le discours des héros de l’Histoire pour rendre cette Histoire intelligible.
8
Le factuel s’éclaire par le virtuel, et non l’inverse : « Pour démêler ce qu’elle faisait, partons toujours de ce qu’elle avait fait, ou de ce qu’elle était capable de faire. Isabelle est maintenant assez connue pour qu’on soit persuadé qu’elle ne résista jamais à rien de tout ce qui pouvait [...] consolider des crimes nécessaires » (p. 170-171). Les témoignages pourront, ensuite, éventuellement servir d’appoint : « Choisissons maintenant, dans les différents rapports que les historiens nous offrent sur le célèbre événement de Montereau, celui qui s’accorde le mieux avec la vérité que cette conversation nous dévoile » (p. 270). Faute d’avoir maîtrisé cette rhétorique épistémologique, Villaret et ses confrères ont écrit une histoire — et une Histoire — qui est lettre morte. Ils ont faussé
13
l’acte de lecture en condamnant celui-ci à une réfutation qui inscrit la violence dans la production du sens énoncé : « Qu’il est pénible d’être toujours obligé de contredire quand on ne voudrait que narrer. Mais le pourrions-nous avec fruit, si nous ne réfutions à chaque ligne toutes les inepties que les historiens nous transmettent sur un règne si intéressant et si mal connu d’eux » (p. 185). La dynamique de l’agressivité est dans l’acte d’énonciation lui-même, qui thématise la violence en la retournant contre un hypotexteprétexte. 9
Pourtant, Sade sait bien que tout historien crédible doit s’appuyer sur des sources précises. C’est là que son entreprise découvre toute son originalité, son audace aussi. Dans la même « préface », « l’auteur » admet que ses prédécesseurs, contrairement à lui, n’ont tout simplement pas eu les « moyens » de comprendre l’énigmatique figure de la mauvaise reine : Le hasard et quelques voyages littéraires nous avaient fourni ces moyens, dont 1 un des principaux se trouvait dans l’interrogatoire de Bois-Bourdon, favori d Isabelle et qui, condamné à mort par Charles VI, révéla dans les tourments de la question toute la part qu’avait Isabelle aux crimes de ce règne. Cette pièce essentielle, ainsi que le testament du duc de Bourgogne tué à Montereau, fut déposée aux Chartreux de Dijon dans 1 église desquels la maison de Bourgogne avait sa sépulture ; c’est là que nous avons recueilli tout ce dont nous avions besoin dans l’une et l’autre de ces pièces importantes, que l’imbécile barbarie des Vandales du XVIIIe siècle lacéra comme les marbres de ces anciens tombeaux dont les fragments du moins se conservent encore au musée de Dijon ; mais les parchemins sont brûlés. À l’égard des autres pièces authentiques qui viennent à l’appui des récits de ce règne, puisées dans des sources aussi pures, nous avons soin de les indiquer à mesure que nous les employons (p. 24).
10
Effectivement, le texte de l’Histoire secrète est ponctué d’appels de notes, qui donnent, en fin d’ouvrage, les références exactes aux volumes de Villaret concernés, précisent quelques allusions authentiques, et surtout indiquent le numéro de liasse et de feuillet de cet apocryphe de Bois-Bourdon — précisions qui fonctionnent quasi iconiquement comme garanties de rigueur, d’objectivité et de respectabilité. Étant donné que la Révolution de 1789 a rendu tout ce précieux témoignage inaccessible, le lecteur est prié de croire sur parole ce qu’en rapporte « l’auteur ». La récriture, par l’usage de l’apocryphe — qui rappelle fortement le topos très sollicité au XVIIIe siècle du manuscrit transcrit, égaré et trouvé —, parvient ainsi, après la désécriture-réfutation des historiens reconnus, à sa seconde réalisation. Celle-ci est plus performante, car elle joue de l’hésitation du lecteur à créditer ou non « l’auteur » de cette précieuse connaissance ; de plus, elle permet une délégation de la parole, dans la mesure où le discours de l’historien reprend, sans pour autant le reproduire mais en le citant, le discours du contemporain. La récriture n’est qu’une écriture déguisée, mais qui impose un pacte de lecture reposant sur ce leurre énonciatif et identitaire admis. La récriture de l’Histoire de France par Sade est donc d’abord une franche écriture romanesque (niveau 1, macro-structural : histoire de BoisBourdon ; niveau 2, méta-diégétique : histoire d’Isabelle) qui substitue à son déploiement dans la fiction l’espace scénographique du discours historique pour contraindre le lecteur à accepter deux vérités a priori inconciliables (la fiction et l’Histoire), mais dont Sade entend faire un modèle et une leçon. Il n’échappera d’ailleurs à personne que cette nouvelle façon d’écrire l’Histoire du passé lointain permet aussi de souligner les erreurs du passé proche. La « note » finale « sur plusieurs des pièces justificatives énoncées dans cet ouvrage » est franchement polémique :
14
Il est donc devenu impossible à l’auteur de cet ouvrage de fournir d’autres renseignements que ceux annoncés dans sa préface. Ces papiers existaient dans leur entier en 1764 et 1765, tems où il les compulsa, pour en retirer ce qu’on trouve dans ce qu’on vient de lire. Il est bien d’autres anecdotes, aussi précieuses à l’histoire, dont on ne retrouvera jamais les titres originaux, grâces aux malheurs de la fin du XVIIIe siècle : c’est donc à ceux qui occasionnèrent ces malheurs qu’il faut s’en prendre, et non pas aux auteurs qui, pour dédommager de ces pertes, ont bien voulu nous fournir sur ces faits tout ce qu’il était en leur pouvoir d’offrir (p. 324-325). 11
En 1813 — la date est donnée dans le texte —, certaines critiques sont devenues possibles et la fiction textuelle inventée par Sade permet de mesurer les torts d’une époque par l’impossibilité de parler d’une autre époque. À chacun de se désoler devant cet obscurantisme imposé qui ne fait que renforcer le travail obligatoire de l’imaginaire. Écrire et inventer sont devenus des devoirs moraux quand l’Histoire — la vraie — abdique toute morale pour laisser s’installer la barbarie qui rend impossible l’accès au discours de la vérité.
12
Quoi qu’il en soit, Sade va utiliser toutes les virtualités de son procédé d’énonciation qui lui accorde la garantie dont il a besoin. Référence matérielle et expérience empirique qui fonctionnent comme un bluff : « nous avons sous nos yeux les preuves que les charges de la condamnation de ce prince sont absolument semblables à tout ce qu’elle avait dit » (p. 119) ; écriture à l’irréel du passé, affirmation de sa supériorité et condamnation de ceux qui n’ont pas eu les mêmes lectures : « C’est de ces dépositions importantes que nous avons tiré une partie des faits que nous citons, et que d’autres eussent également mis au jour s’ils se fussent donné la peine d’en prendre connaissance » (p. 239). Le témoignage de Bois-Bourdon connaissant, lui aussi, ses limites historiques, face à certaines situations qu’il ne sait commenter le narrateur étend même l’idée du document apocryphe à d’autres supports toujours afin de pouvoir s’appuyer sur un discours extérieur au sien : « nous ne pouvons nous empêcher de rapporter l’entretien curieux qu’il eut la veille avec la reine, et qui ne se trouve que dans un testament manuscrit apporté à Londres par Jacquelin, secrétaire du duc qui, dès le lendemain de la scène que nous allons décrire, y passa avec d’autres pièces analogues au même fait » (p. 268) ; suit un appel de note qui fournit l’indication suivante : « C’est là, et dans la bibliothèque même du roi d’Angleterre, que nous avons en 1770 recueilli ces notes sur les pièces originales qui constituent ce passage ; elles étaient écrites en vieux français » (p. 330). Érudition et perspicacité de l’analyse se réunissent pour écrire une Histoire cohérente, et surtout crédible du point de vue privilégié : celui de la charge romanesque des énoncés avancés10.
13
Le procédé de la récriture plus ou moins fantaisiste et ouvertement fantasmatique culmine à la fin du texte avec la mort de Jeanne d’Arc, que le narrateur sadien impute directement à Isabelle — ce qui est une nouveauté absolue dans l’Histoire de cet épisode célèbre, et que même Michelet n’a pas osé quelques années plus tard. La légende a toujours insisté sur la flèche qui atteignit la pucelle en plein combat, et qui la fit tomber, blessée, aux mains des Anglais. « Mais qui lança cette flèche ? », se demande la narrateur sadien : « Voilà ce que n’approfondirent jamais ceux qui ont parlé de cet événement, et voilà ce qu’il aurait découvert comme nous, s’ils eussent pris la peine de compulser les pièces authentiques et originales qui éclaircissent ce fait, et particulièrement celles du procès de Jeanne, déposées à la Bibliothèque royale de Londres » (p. 304). Suit une série de citations commentées par l’avertissement suivant : « Examinons le fait sans partialité comme sans prétention » (p. 307) — l’historien reste fidèle à son discours et à son style
15
obligé ; tout aboutit à un document explicite : « Jeanne fut faite prisonnière le 24 mai 1431 11 ; la reine le sut aussitôt. Le 26 elle écrivit au duc de Bedford ce qu’on va lire et ce que nos recherches nous ont fait trouver » (p. 309). L’historien recopie la lettre, qui réclame impérieusement la mort de Jeanne ; elle est signée « Isabeau de Bavière, reine de France » (p. 310), le narrateur rendant à l’héroïne à ce seul endroit du texte son nom historique pour mieux garantir la crédibilité du document inventé. Enfin, vient le moment de la péroraison victorieuse : Terminons une discussion déjà trop longue, mais nécessaire pour jeter du jour sur un des principaux traits de nos annales et qui est absolument défiguré par des historiens qui, n’ayant fait aucune perquisition, n’avaient pas la plus légère idée de la part énorme qu’Isabelle avait à la condamnation de Jeanne d’Arc. La mort de cette malheureuse est, poursuivent ces mêmes écrivains, l’ouvrage de ses ennemis ; mais où en avait-elle de plus puissants que dans la reine et dans Bedford ? Après avoir suffisamment démontré ces faits, nous abandonnons sur un sujet aussi grave le sage lecteur à ses réflexions, en osant croire que nous les avons dirigés vers la vérité la plus pure. [...] Quelle surabondance de preuves à toutes celles que nous venons d’établir ! Qui persuade Bedford ? C’est la reine. Qui persuade le duc de Bourgogne 7 C’est Bedford. Cessons donc de nous aveugler sur ce fait (p. 310-311). 14
Et voilà comment on est passé de la récriture de l’Histoire de France à l’écriture effective du roman sadien, basé sur l’opposition de la victime vertueuse et de la criminelle triomphante. Le rappel des pièces justificatrices et la condamnation des mauvais historiens viennent encore souligner un des cadres scénographiques du texte, mais il est évident que la fiction court maintenant en liberté ; nous sommes d’ailleurs à la fin du récit et le procédé qui vient de culminer sur cette proposition inouïe va s’en tenir là. Le narrateur sadien laisse s’évanouir dans les limbes d’une judicieuse ellipse la description de la rencontre historique d’Isabelle et de Henri VI d’Angleterre, désormais héritier légitime du roi de France : « Le manuscrit cité dans nos dernières notes, et dont nous nous appuyons dans tout ce qui vient d’être dit, ne nous donne aucun détail sur cette seconde entrevue » (p. 316). Cette nouvelle écriture doit se garder de toute saturation, et cette concession, qui n’est pas dans le style de Sade12, atteste de la nécessité, pour l’énonciation de la subversion, de savoir ruser avec elle-même afin de conserver encore un avenir, et, presque, un rendement.
15
La pratique de la récriture de l’Histoire de France est menée avec le plus grand sérieux par Sade qui convoque sources et références pour les critiquer et les rejeter et mettre à leur place une nouvelle vérité, totalement inventée. De ce fait, celle-ci a le mérite de s’appuyer sur une entière disponibilité référentielle et sur la logique de son énonciation dans le cadre d’une écriture de la destruction des repères attendus. Les procédés allient audace et naïveté, arrogance et invention : l’effet reste toujours la suggestion d’une confusion des valeurs. L’Histoire n’a pas su reconnaître à Isabelle sa place : la première, dans la monstruosité d’ailleurs. C’est à la récriture de la fiction historique de rétablir la vérité poétique quand les pouvoirs admis échouent à parler d’eux-mêmes et de ce qui les conditionnent.
16
Confondant volontairement les repères, la récriture a pour conséquence de renverser les valeurs admises et reconnues. Ainsi, Isabelle peut être présentée comme le principal agent dans la série des catastrophes politiques qui frappèrent la France entre le XIVe et le XVe siècles : elle devient héroïne de l’Histoire et son biographe resserre l’action autour d’elle. Pourquoi Isabelle, d’ailleurs ? On sait que l’imaginaire sadien a toujours été plus nettement sollicité par les détours d’une énonciation féminisée, tout comme il a trouvé
16
dans les emblèmes du corps féminin les repères les plus nets d’une sémiotique de l’agression : la femme, sujet ou objet, reste l’aboutissement actantiel des pulsions de mort. Mais, en 1813, l’écriture d’un roman historique, qui est d’abord une récriture de l’Histoire de France, centré autour de la figure d’Isabeau de Bavière, s’explique par des raisons moins anecdotiques. 17
La démarche se rattache à une tendance pamphlétaire qui s’épanouit sous la Révolution de 1789. On vit alors se multiplier les ouvrages de propagande, visant à démontrer de façon plus ou moins sérieuse les vices des hommes et des femmes au pouvoir autocratique. Il y eut, en particulier, un livre qui jouit d’un certain succès : Les crimes des Reines de France depuis le début de la monarchie jusques y compris Marie-Antoinette de Louise Robert (1791)13. Sade connaît manifestement bien cet ouvrage, qui consacre plusieurs pages à Isabeau ; il ne fait lui-même que développer, par un style plus hardi parce que plus construit, l’idée directrice de l’écrivain et journaliste révolutionnaire d’une reine « élevée par les furies pour consommer la ruine de l’État, et le vendre aux ennemis », une reine dotée du « pouvoir absolu de désoler la France » — « certains passages même donnent l’impression d’un simple démarquage du pamphlet de Louise Robert », remarque Chantai Thomas14. Toujours dans la veine pamphlétaire, il est vraisemblable que Sade pensa à un ouvrage qu’il cite fréquemment : l’Histoire secrète du règne de Justinien et de Théodora de l’historien du VIe siècle, Procope de Césarée, qui décrit les vices de ces deux monstres15 ; le texte connut un regain de popularité à la fin du XVIIIe siècle, pour des raisons bien évidentes. C’est dire que l’imaginaire sadien est d’abord de nature intertextuelle : l’inspiration de Sade qui fonctionne le plus souvent par la copie et le ressassement reprend des figures qu’un style pamphlétaire a portées au rang d’archétypes, et sa pratique d’écrivain les enferme, les resserre dans un réseau de citations et d’allusions, plus ou moins explicitées, qui sont autant de ré-appropriations et d’inventions. Le choix d’Isabeau de Bavière comme support privilégié s’inscrit dans le contexte historique des pamphlets anti-royalistes, mais on se doute bien que le ci-devant marquis ne se livre à cette harangue pléonastique que pour la subvertir à ses propres idées, lesquelles ne sont pas exactement de nature démocratique16.
18
Car la valorisation d’Isabeau — devenue « Isabelle », et donc radicalement autre par ce déplacement désignatif — dépasse le simple renouvellement du statut actantiel — de la figure réelle à l’héroïne d’une fiction historique qui est présentée comme un roman authentique — pour proposer une quasi réhabilitation de la femme criminelle : À l’envie que nous avions de démêler la vérité partout où elle se dérobait, s’est joint, nous l’avouons, un désir bien plus délicat encore, celui de disculper, s’il était possible une femme aussi intéressante qu’Isabelle, tant par les grâces de sa personne, que par la force de son esprit et la majesté de ses titres ; de la disculper, disons-nous, si cela se pouvait, des reproches honteux dont on la chargeait, et de ne trouver de crimes que dans ses délateurs. Cette pénible tâche était glorieuse sans doute, et surtout si le succès eût couronné nos peines ; mais beaucoup trop éclairés par les preuves sans nombre que nous acquérions tous les jours, nous n’avons pu que plaindre Isabelle et dire la vérité ; or, cette vérité est telle qu’on peut raisonnablement affirmer qu’il ne coula pas une goutte de sang, sous ce terrible règne, qui n’ait été répandu par elle ; qu’il ne se commit pas un seul crime dont elle n’ait été la cause ou l’objet (p. 24-25).
19
C’est là une qualité de force qui n’est pas reconnue au commun des mortels. La sympathie du narrateur à l’égard d’Isabelle ne se cache guère, même dans les accusations, et ce d’autant plus qu’il n’hésite pas, pour valoriser la harangue, à apostropher son héroïne, suggérant un dialogue complice :
17
Ô toi que le sort appelait au soutien d’un trône déjà chancelant, devais-tu donc en précipiter la chute ? Mais séduite, ou plutôt corrompue par les exemples qu on mettait sous tes yeux, n’eus-tu pas quelques droits à l’indulgence de la postérité ? Ah ! sans doute, si tu nous avais du moins offert quelques vertus ! mais c’est en vain qu’on les désire (p. 44). C’est avec peine que nous chargeons Isabelle de ce nouveau crime ; mais est-il possible de le révoquer en doute ? (p. 171). 20
Et l’image finale d’une reine déchue en proie à de tardifs remords, appelant les furies pour venir la torturer dans l’éternité de l’enfer, puis disparaissant « sans que le tombeau même pût lui servir d’asile » (p. 322), est chargée d’un prestige culturel immense qui valorise le sujet en le faisant accéder au statut romanesquement enviable de monstre. C’est là un autre aspect de la récriture de l’Histoire, du factuel vers le symbolique, qui fait vaciller les certitudes morales trop tranchées. C’est pourquoi l’appui intertextuel sur les pamphlets anti-royalistes qui traînaient les reines de France dans la boue ne peut servir que de contrepoint ironique puisque la finalité du discours est ici, presque, une exaltation pour ne pas dire une glorification. Les parallèles avec le XVIIIe siècle n’hésitent pas à charger la cour de France des torts qu’on ne peut plus ignorer — « Ce n’est que dans les cours corrompues que de telles singularités se remarquent ; celles du XVIIIe siècle pourraient en fournir quelques exemples » (p. 58) —, mais ils travaillent, précisément, à distinguer les figures monarchiques des courtisans parasites qui ont fait tout le mal : De semblables turpitudes eurent lieu sous un règne plus rapproché de nous, on le sait ; mais ces criminelles complaisances furent l’ouvrage de la maîtresse d’un souverain, jamais de son épouse. L’histoire n’offre aucun exemple d’une aussi horrible prostitution exercée par des reines ; fières de leur dignité, aucune ne l’avilit d’une aussi indigne manière (p. 110).
21
La figure royale doit rester intacte de tout soupçon. Tel était le but de l’ouvrage : « établir dans nos cœurs l’attachement et le respect inviolables que nous devons sans cesse à celles de nos souveraines véritablement dignes de notre encens et de nos hommages » (p. 44). Voilà comment on récrit l’Histoire : un contrepoint monstrueux doit faire figure de repoussoir — non sans complaisance ambiguë donc — pour attester des qualités de tout ce qui s’oppose à lui. La démarche vaut pour les individualités, elle vaut aussi bien pour les idéologies. Et Sade profite de son discours pamphlétaire détourné pour prendre la défense du catholicisme, ce qui, replacé dans le cadre scénographique général de son œuvre, ne peut apparaître que comme une suprême ironie narquoise : Et voilà comme, dans ces temps obscurs, la plus sainte des religions servait d’abri et même d’excuse, aux actions qui lui font le plus d’horreur. Cessons donc de lui attribuer tous les crimes auxquels elle a servi de prétexte : c’est aux abus de ses principes et non pas à ses principes aussi purs que sacrés que doit s en prendre l’homme assez sage pour ne jamais raisonner que d’après son esprit et son cœur (p. 215).
22
La récriture est ici d’abord récriture de l’œuvre de Sade lui-même, quand celui-ci entend accéder à la parole publique en déguisant son discours authentique sous des discours d’emprunt qui fonctionnent comme des marqueurs d’ironie à l’usage de celui-là seul qui en détient le code : l’auteur. Le piège réussit d’ailleurs, puisque la Biographie Michaud, commentant Isabelle de Bavière, présente le sujet de ce texte comme « noir et terrible », « mais », y est-il ajouté, « on n’y trouve rien de répréhensible sous le rapport des mœurs et de la religion »17. C’est vrai quant à la lettre, c’est moins vrai quant à l’esprit qui invente cette énonciation truquée.
18
23
La valorisation de quelques figures actantielles repose d’abord sur l’antiphrase de l’implicite. Charger Isabelle est un moyen pour innocenter Marie-Antoinette ; prendre la défense de la religion est une voie pour condamner ceux qui ont voulu détruire cette référence : mais sans pour autant jamais prétendre à la vérité exacte de ce qui n’est énoncé que comme une contre-vérité rhétorique à but purement démonstratif. Les images du pouvoir politique actif, incarnées en quelques figures majeures, sont les principes d’une écriture du fantasme qui tire cette stylistique de la récriture du côté de la thématique générale du pouvoir de l’imaginaire, qui est LE pouvoir propre de l’écrivain, et le seul pouvoir dont on ne saura jamais priver aucun prisonnier.
24
Procédant par renvois culturels codés, plus ou moins pervertis par les effets de contrediscours de certaine valorisation, le texte de l’Histoire secrète d’Isabelle de Bavière s’appuie sur les ressources de l’image pour assurer l’efficacité de sa pragmatique. C’est cet usage de l’image qui réalise l’élargissement de la stylistique singulière sur une thématique générale. L’image peut être de nature allusive : c’est le cas quand la mention d’un nom propre par exemple, doit venir saturer le texte de sèmes connotatifs pour orienter sa réception et son intellection. Ainsi, quand Isabelle, sur le point d’assassiner son fils, est comparée à Néron — et au-delà à Médicis : Elle avait tant de fois fait usage de poison qu’elle craignait d’être soupçonnée en faisant une nouvelle tentative de ce genre : elle imagina donc pour faire périr son fils un moyen aussi épouvantable sans doute, mais dont on devait moins se défier. Sachant que le dauphin devait tenir un grand conseil à La Rochelle et que l’on construisait à cet effet une salle dans les vastes greniers de la plus grande maison de la ville, elle se rappela le trait exécrable de l’amphithéâtre de Sidènes que Néron avait fait élever de manière à ce qu’il s’écroulât dès qu’il serait chargé ; et dès l’instant, frappée de cette horreur, elle se résolut à l’imiter (p. 296).
25
La page joue de l’intertexte culturel de convention. Isabelle tuant son fils évoque Agrippine, et la comparaison avec Néron met en perspective la filiation pour suggérer le renversement attendu ; parallèlement, l’usage du poison renvoie directement aux crimes italiens de la Renaissance. Cette série d’images non visuelles mais suggestives se ramène à ce que l’on peut appeler « le paradigme de Machiavel », comme pseudo-théorisation de la justification criminelle au service de la puissance — mais non du pouvoir, on y reviendra. La figure de Machiavel parcourt l’œuvre de Sade, de citations effectives en allusions implicites. Dans le contexte de cet écrit historique que prétend être l’Histoire secrète d’Isabelle de Bavière, les références à Néron18 ou à Machiavel fonctionnent comme des matrices pour un imaginaire sollicité dans des images fertiles. Le texte dépasse ainsi l’anecdote étroite pour devenir rêve de puissance par l’imaginaire, et rêverie sur le pouvoir concret. Au-delà des figures, nous avons affaire à des principes. Comme l’explique Catherine Cusset, « le néronisme mythologise le mal politique, la cruauté sanguinaire et arbitraire ; les écrits de Machiavel, en donnant naissance au machiavélisme, ont créé un mythe qui n’est pas seulement celui de la politique à la florentine, mais celui d’un comportement moral qui privilégie la duplicité »19. Les trois dimensions de l’instance générale du pouvoir représentable, telles que les études de l’imaginaire nous ont appris à les lire, se rejoignent en un principe d’énonciation commun : la potentia est la puissance, la force spontanée qui s’impose à autrui ; la potestas est la volonté qui se rapporte à un objet déterminé, généralement réglée par un droit ; l’ auctoritas est l’éminence qui favorise l’exercice de la potestas en lui conférant une légitimité20. Dans l’Histoire secrète d’Isabelle de Bavière, récit d’une potestas déréglée, qui inverse potentia et auctoritas, le pouvoir s’impose comme un principe conducteur qui
19
permet des représentations pour piéger l’idéologie du texte. Ce principe d’un imaginaire perverti conditionne la poétique historique de Sade : les mentions prestigieuses servent à illustrer le triomphe de la fiction énoncée par l’imaginaire, tout en contextualisant celuici dans une perspective historique critique. Il y a une logique, et presque une direction, du fantasme. 26
Une direction qui trouve son achèvement stylistique dans la figure rhétorique de l’hypotypose, que l’on doit lire dans ce cas comme le lieu d’expérimentation du principe de l’imaginaire conducteur. Dans des énoncés soumis à la recherche de l’effet visuel remarquable et dominé par la morbidité, les figures exemplaires d’une puissance meurtrière réfléchissent toutes les capacités illustratives et créatrices du pouvoir de l’imaginaire. « En général, peignons pour intéresser, et ne racontons pas, ou si nous sommes obligés de raconter, que ce soit toujours en peignant » : tel est l’art poétique de « l’auteur » tel qu’il le résume dans sa « préface » (p. 27). Narration vs description ? Intellection vs visualisation ? Il y a réalisation, et même accomplissement, des pistes stylistiques jusque-là dispersées, en une représentation de ce qui devient une thématique organisatrice. Le principe fonctionne par illustration de ses figures fantasmatiques, en une autre figure, rhétorique, qui justifie l’énonciation privilégiée : [...] les mêmes armes dont les bouchers immolaient leurs taureaux s’enfonçaient à l’instant dans le sein de leurs proies au milieu des rues, dont les ruisseaux encombrées d’entrailles palpitantes et de sang encore tout fumant assimilaient tous les quartiers de la ville à des arènes d’abattoirs (p. 182). Les corps du connétable et du chancelier furent attachés à des câbles et traînés dans la boue ; on découpa leur chair pour en décomposer des écharpes, puis les cannibales, ornés de ces bandelettes sanglantes, couraient les rues, armés de couteaux dont ils entrouvraient le flanc des femmes enceintes, osant dire en voyant leurs fruits : Regardez donc ces petits chiens qui vivent encore. Les chefs bourguignons, témoins de ces horreurs, les excitaient du geste et de la voix (p. 253-254). Les rues étaient jonchées d’infortunés à demi-nus, cherchant dans les ordures ou parmi les animaux les plus vils de tristes aliments au besoin qui les consumait. On fut obligé de fermer les boutiques, parce que le pauvre dérobait en passant ce qui pouvait le garantir du froid ou de la faim. La mère voyant son lait glacé dans un sein flétri et ne pouvant substanter le fruit de son hymen, le déposait au coin des rues, où des êtres que la disette transformait en tigres le saisissaient pour le dévorer (p. 287-288).
27
Autant d’images fortes qui superposent différents registres notionnels dans une commune isotopie de l’horreur macabre ; autant d’images qui suspendent le temps en un arrêt remarquable, pendant lequel se mettent en place une accélération radicale de la représentation, en raccourci, et une valorisation du détail littéral qui prend valeur d’emblème synecdochique. Le procédé, et sa légitimité historique et stylistique — voir Agrippa d’Aubigné, bien sûr —, autorise même les uniques introductions de la cruauté sexuelle dans ce récit, sans lesquelles Sade n’est jamais vraiment Sade21 : Les chemins, les villages, les champs, tout était couvert de cadavres, qu’on ne prenait seulement pas la peine de couvrir. Ce qu’épargnait le fer du soldat devenait à l’instant la pâture de son avarice sordide, ou de sa brutale obscénité. Une jeune fille du village de Stein, près Saint-Denis, ayant refusé de dire où étaient cachés son père et sa mère, fut à l’instant déshonorée par ces monstres qui l’égorgèrent après, sur le corps même de ses parents, dès qu’il en eurent découvert la retraite (p. 193).
28
Puissance de l’agent et pouvoir de l’écrivain se rejoignent dans ces images fortes animées du même principe de destruction d’une énergie qu’ils ne reconduisent que pour la consommer, dans un infini mouvement de scandale révolté. L’hypotypose contraint le
20
lecteur, non à voir mais à imaginer la représentation brutalisante d’un réel réduit à des détails sanglants et hypertrophiés. En discours romanesque avoué, le procédé peut basculer dans l’arbitraire et la complaisance, mais intégré à une étude qui se veut objective et dont un passé notoire est l’objet, il oblige à ré-interroger la responsabilité du discours qui fait surgir de telles images, en tant que porteur de sens et d’exemplarité. « Un choix synthétique du détail contribue à une sémantisation littéraire du discours historique, dont le tissu devient ainsi plus rugueux », précise Jean-Claude Bonnet en commentant ces pages ; « chez Sade comme chez Michelet, les indices et les métaphores s’organisent en thèmes », ajoute-t-il22. Cette organisation suggère une intellection de l’objet porté par le discours, qui est pourtant ce que Sade rejette dans toute l’anarchie du non-sens historique et moral qu’il prétend paradoxalement démontrer23. La stylistique énonciatrice est une thématique au service d’une contre-représentation critique. La puissance du roman vient écrire par les images du fantasme ce que le pouvoir de l’Histoire n’a pas su rendre lisible. 29
Quand Sade récrit une certaine page de l’Histoire du Moyen-Âge français, c’est d’abord pour reconduire les figures actantielles et stylistiques de son imaginaire dans une perspective de vérité dont la respectabilité du propos ne rendra que plus sulfureuses les hypotyposes par lesquelles elles assurent leur pragmatique propre. Par exemple, le couple historique Isabelle/Jeanne d’Arc s’impose comme une subversion de l’imaginaire du couple romanesque Juliette/Justine — et non l’inverse. En ce sens, tout le plan exotérique de cette écriture « historique », sinon « historicisée » apparaît comme le palimpseste sur lequel se laisse lire l’écriture de la destruction ésotérique. Loin de toute « transposition » individuelle ou factuelle, l’Histoire secrète d’Isabelle de Bavière reine de France se propose ainsi comme un exemple de déconstruction d’une Histoire inique et injuste — qui refuse à Isabelle son statut d’héroïne — par la valorisation de la production historique romanesque. Le pouvoir du roman peut tout et est toute la vérité, puisque son énonciation coïncide avec son énoncé, contrairement au discours historique, parfois coupable de retard ou de décalage. Caricaturé jusqu’à la grimace de l’inacceptable, il est la réponse à l’impuissance de l’Histoire quand le discours de celle-ci abdique son droit (et son devoir ?) de subjectivité.
NOTES 1. La Nouvelle Justine (1797), in Sade, Œuvres, édition de M. Delon, Paris, Gallimard, « La Pléiade » (trois tomes), 1990-1998, t. 2, p. 479-492 ; Histoire de Juliette (1801), ibid., t. 3, p. 969-988. 2. Voir J. Deprun, « Quand Sade récrit Fréret, Voltaire et d’Holbach », in Roman et lumières au XVIIIe siècle, Paris, Éditions Sociales, 1970, p. 331-340 ; M. Delon, « La copie sadienne », Littérature, Paris, 1988, n° 69, p. 87-99. 3. Cf. supra. 4. Pour une connaissance plus objective, et surtout plus fiable, du règne d’Isabeau, on consultera les synthèses suivantes : G. Duby, Histoire de France : le Moyen Âge (987-1460), Paris, Larousse, 1988 ; A. Demurger, Temps de crises, temps d’espoirs ( XIVe-XVe siècles), in Nouvelle Histoire de la France médiévale, t. 5, Paris, Seuil (Points-Histoire), 1990. L’ouvrage d’I. Nollier, Isabeau de Bavière, reine de
21
France, Paris, Éditions du Rocher, 1996, ridicule invention de dialogues et de sentiments extravagants, semble à peine plus crédible, sur le plan historique, que celui de Sade. 5. J.-Cl. Bonnet, « La harangue sadienne », Poétique, Paris, 1982, n° 49, p. 39. 6. Premiers mots de la « préface essentielle à lire pour l’intelligence de l’ouvrage » ; toutes les références renvoient à l’édition Gallimard (Paris, 1953) parce qu’elle est largement diffusée, ce qui ne peut faire oublier qu’elle propose un texte rempli de coquilles et de fautes plus ou moins graves : pour ne pas lasser par des sic répétés, ces erreurs ont ici été corrigées. 7. In Stendhal, Paris-Londres. Chroniques, édition de R. Dénier, Paris, Stock, 1997, p. 165. 8. Ibid., p. 173-174. 9. Ce qui n’empêche pas le narrateur sadien de déclarer plus loin que l’exactitude factuelle suffit à suggérer la vérité d’intellection : « Ici les ramifications se perdent, le labyrinthe devient inextricable, et nous ne pouvons nous rallier qu’aux événements connus, qui, racontés avec la plus sévère exactitude, nous fourniront néanmoins une masse de lumières suffisante pour nous guider sans cesse vers la plus extrême vérité » (p. 97). 10. La vérité biographique ne change rien à ce fonctionnement original. Il est certain que Sade travailla sur des parchemins au couvent des Chartreux de Dijon en 1764, en vue de recherches historiques. « Le 4 mai 1764, le ministre de la Maison du roi informe M. de Montreuil que Sa Majesté accorde [...] à M. de Sade, l’autorisation de se rendre à Dijon afin de s’y faire recevoir au parlement dans sa charge de lieutenant général pour le roi, du gouvernement de Bresse, Bugey, Valromey et Gex. [...] Profitant de son séjour a Dijon, [Sade] se rend à la bibliothèque du couvent des Chartreux, afin d’effectuer des recherches dans les archives, ce qui laisse supposer qu’il songeait, dès cette époque, à quelque ouvrage historique », M. Lever, Donatien Alphonse François, marquis de Sade, Paris, Fayard, 1991, p. 133. Cette matrice scénographique extra-textuelle suggère la mise en place du dispositif qui s’épanouit plus de quarante ans plus tard. 11. L’Histoire moderne a d’autres dates — Michelet lui aussi commet quelques erreurs que ses descendants ont corrigées. Jeanne d’Arc aurait été arrêtée le 23 ou le 24 mai 1430 devant Compiègne — Sade se trompe donc d’un an exactement ; son procès s’ouvrit le 9 janvier 1431, et elle fut brûlée vive le 30 mai de la même année : voir G. & A. Duby, Les Procès de Jeanne d’Arc, Paris, Gallimard & Julliard, 1973 ; L. Fabre, Jeanne d’Arc, Paris, Tallandier, 1977. Mais il est de toute façon évident que nous ne sommes plus là dans l’écriture de l’Histoire de France mais dans celle du roman sadien qui réinvente toute une chronologie. 12. Sur l’écriture « détaillée » et la saturation de l’imaginaire que semblable pratique stylistique entraîne, voir É. Bordas, « Obscènes détails. Contre-écriture de la scène sadienne », EighteenthCentury Fiction, Hamilton, 1999, vol. 11 (n° 3), p. 271-284. 13. Publié par L. Prudhomme, À Paris, Au bureau des Révolutions de Paris, 460 pages ; Louise Robert est le nom d’auteur de mademoiselle de Keralio. 14. Ch. Thomas, Sade, Paris, Seuil, 1994, p. 195 ; pour les citations du texte de Louise Robert, cf. ibid. 15. Cf. Ch. Thomas, ibid. 16. Voir les nombreuses notes de bas de page dans La Nouvelle Justine et dans Juliette, qui sont souvent politiquement très engagées, et qui font de l’ambiguïté d’intention leur principale force pragmatique ; voir surtout le fameux discours de Dolmancé, « Français, encore un effort si vous voulez être républicains », inséré dans La Philosophie dans le boudoir (1795). Dans tous les cas, le sens de ces énoncés est systématiquement perverti et détourné par le contexte scénographique de leur énonciation — par l’ironie des décalages presque toujours. C’est pourquoi une anthologie des textes politiques de Sade, telle que l’a réalisée M. Lever par exemple (Sade et la Révolution. « Que suis-je à présent... ? », Paris, Bartillat, 1998), est un quasi contresens : isolant le « texte » du « contexte » énonciatif, le procédé court le risque de suggérer une lecture de l’acceptation, quand Sade politique ne procède jamais que par contre-énonciation.
22
17. L.-G. Michaud, Biographie universelle ancienne et moderne, Paris-Leipzig, Desplaces & Brockhaus [1825], seconde édition 1843, t. 39, p. 223. 18. Voir également p. 22. 19. C. Cusset, « Sade, Machiavel, Néron. De la théorie politique à l’imaginaire libertin », Dixhuitième siècle, Paris, 1990, n° 22, p. 410-411. 20. Voir l’ouvrage fondateur de G. Durand, Les Structures anthropologiques de l’imaginaire : introduction à l’archétypologie générale, Paris, PUF, 1960 ; sur le mythe de l’autorité royale, fondement symbolique de la politique du pouvoir, voir J.-J. Wunenburger, « Le fondement mythique de la souveraineté. Dieu, père et roi », in Images européennes du Pouvoir, Toulouse, Éditions niversitaires du Sud, 1995, p. 461-477. 21. Voir également p. 109, mais la précision est plus dans le style drolatique que frénétique : « Isabelle se dérobait avec soin aux devoirs que lui prescrivait 1 hymen, et, pour en dédommager le roi, elle avait introduit, dans le lit du monarque, la fille d’un marchand de chevaux. [...] elle recommandait fortement à sa suppléante d’épuiser son mari, afin de s’en débarrasser plus tôt, lui ayant enseigné [...] toutes manières de besoigner ; pour ce qu’il y print un tel gaudissement qu’il s’en saoulât et vînt plus vite à fins ». 22. J.-Cl. Bonnet, « Sade historien », in M. Camus & Ph. Roger éds., Sade : écrire la crise, Paris, Belfond, 1983, p. 141. 23. « Dans Isabelle de Bavière, Sade dit chercher une ’vérité extrême’ — vérité qu’il ose qualifier de ’géométrique’. Une telle formule peut sembler gratuite, ou provocatrice, si l’on songe à fa désinvolture de Sade par rapport à la vérité objective. Pourtant elle s’approche au plus près d’une idée de la littérature identifiée aux intensités négatives qu’elle est susceptible de capter — pour la beauté du risque et la rigueur de la logique, pour la pure monstruosité du projet », Ch. Thomas, op. cit., p. 200.
23
En haine de la politique Gisèle Seginger
1
Flaubert a souvent affirmé que la littérature ne doit pas être probante, qu'elle ne doit rien démontrer ni dans le domaine religieux et moral ni dans le domaine politique. Les formules de l'« art pour l'art » et surtout de l'« art pur » reviennent souvent sous sa plume. Il s'est toujours opposé à ce que nous appellerions maintenant l'engagement de l'écrivain. Il réprouve l'attitude de Hugo lorsqu'il s'en prend à Napoléon le Petit. L'art ne doit pas énoncer d'idées politiques1 et défendre jalousement sa spécificité par rapport aux pratiques discursives. Aux prises de position, à la lutte politique l'artiste préfèrera « l'acceptation ironique de l'existence, et sa refonte plastique et complète dans l'art 2. » Il ne faut pas confondre cette acceptation avec une adhésion au monde tel qu'il est. En effet l'œuvre est tout à la fois synthétique et critique, et d'autant plus critique qu'elle est synthétique et évite d'adopter une position déterminée. L'ironie est là aussi pour rappeler que Flaubert ne cède jamais à une soumission facile. Il est d'ailleurs formel : il ne fait au mieux que des « concessions de silence, mais aucune de discours 3. » Néanmoins malgré le silence de l'œuvre4 l'art peut avoir une dimension politique d'une autre façon. En effet, le refus flaubertien de la politique n'est pas une dénégation de l'importance du politique. Il ne pense pas que l'on puisse écrire hors du temps et de manière indépendante par rapport à la société et à une situation politique. L'impersonnalité est davantage un effet de texte, élaboré grâce à une poétique particulière du récit, qu'une indifférence. Ses déclarations contre la littérature probante et la mission sociale de l'écrivain tiennent à la nécessité de défendre la spécificité de la littérature pour faire reconnaître son mode d'action particulier. En effet contre les figures du pouvoir politique, contre la tyrannie de la parole politique, la littérature peut avoir le rôle d'un contre-pouvoir. *
2
Très tôt Flaubert manifeste à la fois son intérêt pour la politique et sa déception. En 1848, il assiste en spectateur avec Maxime du Camp aux journées révolutionnaires5. Il ne partage pas les rêves républicains qu'il représentera de manière critique dans L'Éducation sentimentale de 1869. Mais les moments troubles l'intéressent par la force de négation qui s'y manifeste. Ainsi en mars 1848 il écrit : « Je me délecte profondément dans la
24
contemplation de toutes les ambitions aplaties6 ». Sous l'Empire il sera reçu aux Tuileries et acceptera la légion d'honneur mais sans jamais s'enthousiasmer pour l'Empereur, à une exception près, en 1852 lorsqu'il voit dans l'établissement de ce régime fort un écrasement de tous les partis, une négation des débats politiques du XIXe siècle : « Oui, je deviens vieux, je ne suis pas du siècle, je me sens étranger [...] et je commence sérieusement à admirer le Prince-Président qui ravale sous la semelle de ses bottes cette noble France7. » 3
Deux raisons différentes expliquent ce mépris de la politique. Tout d'abord le constat d'une dégradation du politique. L'action est sans but puisque, écrit-il, « 89 a démoli la royauté et la noblesse, 48 la bourgeoisie et 51 le peuple. Il n'y a plus rien, qu'une tourbe canaille et imbécile8. » Que des inégalités sociales subsistent ne change rien au constat : la société se nivelle et triomphe donc une égalité bien différente de celle que défendent les républicains et les partisans du Peuple. Flaubert perçoit en effet dans son époque le triomphe progressif du nombre, de l'Opinion, de la Foule9, c'est-à-dire d'un esprit démocratique qui lui semble dangereux car il le rend responsable de la perte des valeurs, des différences par l'arasement de toute distinction : « Nous sommes tous enfoncés au même niveau dans une médiocrité commune. L'égalité sociale a passé dans l'Esprit. 10 » La médiocrité manifeste dans le domaine de la pensée et de l'art le triomphe de l'égalité et de la démocratie avant même qu'ils ne s'imposent ouvertement dans les institutions et la forme du gouvernement. Quand il « n'y a plus rien », le pouvoir de l'exécrable « on », qui tourne au vent de toutes les idées, peut l'emporter. La politique n'est plus alors qu'une affaire de parti pris absurde, ou pire d'opportunisme et d'ambition. Les positions sont réversibles : un socialiste peut devenir un défenseur de l'ordre, comme Sénécal dans L'Éducation sentimentale. Même le personnage le mieux intentionné, Dussardier, finit par ne plus s'y retrouver. La politique n'a plus de but au-delà d'elle-même, au-delà des turbulences qui agitent la masse sociale. La Correspondance le dit. Les romans le montrent. L'Éducation sentimentale est un roman sur l'illégitimité de toute politique.
4
La deuxième raison qui explique la haine de Flaubert pour la politique tient à sa pensée de l'histoire et du temps. Sur ce point il se sent bien de son époque : « Le sens historique, écrit-il, date d'hier. Et c'est peut-être ce que le XIXe siècle a de meilleur 11. » Mais le sens historique est pourtant souvent ce que ses contemporains tentent d'oublier en ressaisissant le temps dans une pensée téléologique de l'Histoire. Flaubert refuse les pensées qui rationalisent l'histoire et assignent à l'humanité un devenir. Il conçoit le sens historique comme une force critique qui s'exerce contre toutes les représentations et les discours. A l'Histoire il oppose le temps. Celui-ci défait les certitudes. Néanmoins le scepticisme « n'a rien d'amer12 », affirme Flaubert, car le sens historique implique une conscience de l'infini : « L'horizon perçu par les yeux humains n'est jamais le rivage, parce qu'au-delà de cet horizon, il y en a un autre, et toujours13 ! ». La critique doit l'emporter sur la politique car toute pensée est historique et donc mortelle. Les idées politiques et les gouvernements sont pris dans un mouvement infini, aucune idéologie n'est capable de mettre fin à l'histoire et d'assurer le bonheur de l'humanité : C'est parce que je crois à l'évolution perpétuelle de l'humanité et à ses formes incessantes, que je hais tous les cadres où on veut la fourrer de vive force, toutes les formalités dont on la définit, tous les plans que l'on rêve pour elle. La démocratie n'est pas plus son dernier mot que l'esclavage ne l'a été. L'horizon perçu par les yeux humains n est jamais le rivage, parce qu'au-delà de cet horizon, il y en a un autre, et toujours ! Ainsi chercher la meilleure des religions, ou le meilleur des
25
gouvernements, me semble une folie niaise. Le meilleur, pour moi, c'est celui qui agonise, parce qu'il va faire place à un autre14. 5
Contre la politique, Flaubert retourne une pensée du temps, une pensée de la négation anti-dialectique dans une temporalité qui n'est pas orientée. Il se représente l'homme en mouvement vers un ailleurs incertain auquel aucune société ne pourra donner forme car son aspiration l'entraîne toujours au-delà. Aussi ne peut-il guère adhérer aux idéaux médiocres de la bourgeoisie louis-philipparde qui n'aspire qu'au bonheur matériel, à l'enrichissement. Il n'éprouve pas davantage de sympathie pour les socialistes car en lui assignant des fins ils veulent tarir l'aspiration15 qui fait le dynamisme de l'histoire. Le socialisme a, selon Flaubert, les effets pernicieux d'une croyance. Aussi confond-il dans la même réprobation le néo-catholicisme et le socialisme qui ont tous deux « abêti la France » : « Tout se meurt entre l'Immaculée Conception et les gamelles ouvrières16 ». Tandis qu'il prépare L'Éducation sentimentale, il rapproche les socialistes des théoriciens catholiques qu'ils soient progressistes comme Lamennais ou réactionnaires comme Joseph de Maistre : Je viens d'avaler Lamennais, Saint Simon, Fourier et je reprends Proudhon d'un bout à l'autre... Il y a une chose saillante et qui les lie tous : c'est la haine de la liberté, la haine de la Révolution française et de la philosophie. Ce sont tous des bonshommes du Moyen Âge, esprits enfoncés dans le passé. Et quels cuistres ! quels pions ! Des séminaristes en goguette ou des caissiers en délire. – S'ils n'ont pas réussi en 1848, c'est qu'ils étaient en dehors du grand courant traditionnel. – Le socialisme est une face du passé, comme le jésuitisme de l'autre. Le grand maître de Saint-Simon était M. de Maistre et l'on n'a pas dit tout ce que Proudhon et Louis Blanc ont pris à Lamennais17.
6
La politique est dépassée puisque le sens historique est la conscience du changement qui emporte un jour ou l'autre toutes les opinions. Il ne peut plus y avoir de figures du pouvoir crédibles. L'Éducation sentimentale en montre la déchéance. Le roman ne débute qu'en 1844 à un moment où Louis-Philippe commence à être contesté. Puis, en 1848, la Liberté et la République sont incarnées par une prostituée tandis que le peuple s'amuse. Enfin, après le Coup d'état du 2 décembre, une ellipse de plusieurs années fait du régime napoléonien le règne inénarrable du rien. Dans Bouvard et Pécuchet, ni le Comte ni le curé ne peuvent arrêter le nomadisme encyclopédique des deux personnages lorsqu'ils examinent le fondement des croyances sociales. A l'opposé, dans le peuple n'émerge pas de nouvelle légitimité. Gorgu qui est la figure allégorique du peuple de 1848 s'est fait un nom « à force de bavarder » et fascine « par son bagout ». Dans le chapitre VI, l'effet subversif de ses discours qui réclament le droit au travail est de tourner la cervelle du père Gouy qui s'empare d'une charrette de fumier et tient à bêcher le jardin de Mme Bordin contre son gré. L'action politique sombre dans la dérision. Une telle vacance des figures du pouvoir laisse le champ libre à Bouvard et Pécuchet qui profèrent « d'abominables paradoxes », mêlant discours moralisateurs et lieux communs politiques : « Ils mettaient en doute, la probité des hommes, la chasteté des femmes, l'intelligence du gouvernement, le bon sens du peuple, enfin sapaient les bases [...] une faculté pitoyable se développa dans leur esprit, celle de voir la bêtise et de ne plus la tolérer18. » Bouvard et Pécuchet est le roman de l'égalité des paroles, en un temps démocratique où il n'y a plus d'instances supérieures de légitimation et où il appartient à chaque discours d'élaborer les conditions de sa créance et de la conquérir. Sous le regard de personnages qui n'acceptent pas ce passage du règne de la vérité à celui du discours, les paroles politiques (mais aussi scientifiques) perdent leur crédibilité et versent de ce fait dans la bêtise. L'égalisation des jugements, l'arasement de toute hiérarchie discursive
26
montre que rien n'échappe à la crise de légitimité, pas même la position hors-jeu de la critique qui sous le règne de la parole errante bascule elle-même dans la bêtise lorsque Flaubert la tourne en dérision en la faisant pratiquer par les personnages les plus incapables de refonder une autorité et de redonner une légitimité à la parole, fût-elle critique. 7
Néanmoins, même si ce dernier roman suggère que la critique est aussi critiquable, dans la Correspondance Flaubert s'efforce de penser la légitimité de la critique en la fondant sur la science, en opposant donc aux opinions et croyances l'observation des faits. Il reconstitue alors une opposition stable entre le vrai et le faux duquel relève désormais la politique : tous les partis sont « bornés, faux, puérils19 ». Contre la politique Flaubert défend une autre conception du politique : une gestion scientifique des choses de la cité. La critique fonde sa propre légitimité en s'autorisant du prestige de la science en un temps où l'esprit positiviste gagne un large public. Mais en fait le déplacement métaphorique révèle bien la crise : sous le règne de la parole errante, quand il n'y a plus rien comme le dit Flaubert, aucun idéal crédible – ni la monarchie ni le peuple, seule l'analogie peut encore donner l'illusion d'une légitimité.
8
Ennemi de l'esprit d'égalité, Flaubert se rallie pourtant en 1871 à l'idée d'une République. Elle ne prétend suivre aucune belle maxime : Je crois, comme vous, que la République bourgeoise peut s'établir. Son manque d'élévation est peut-être une garantie de solidité ? C'est la première fois que nous vivons sous un gouvernement qui n'a pas de principes. L'ère du positivisme en politique va peut-être commencer20 ?
9
D'une part, cette République lui semble bien loin de la politique et de ses croyances et, d'autre part, contre l'esprit démocratique elle pourrait permettre l'avènement d'une nouvelle élite et d'une nouvelle légitimité de parole. Il espère la fin de la politique au profit d'une gestion compétente des choses fondée sur l'observation : « Il était temps de se défaire « des principes » et d'entrer dans la Science, dans l'Examen21 ». Il se dit favorable à une aristocratie du savoir, constituée d'experts capables de gérer scientifiquement les affaires de l'État, sans idéal politique. La guerre de 1870 contre un pays plus efficace, puis la Commune lui ont montré l'urgence de renoncer aux rêves et aux querelles politiques : « Pour que la France se relève il faut qu'elle passe de l'inspiration à la Science, qu'elle abandonne toute métaphysique, qu'elle rentre dans la Critique, c'est-à-dire dans l'examen des choses.22 » Au nom de la Science, il justifie son élitisme en des termes assez proches de ceux de Renan. Seuls comptent vraiment les Mandarins : « Il n'y a d'important qu'un petit groupe d'esprits, toujours les mêmes, et qui se repassent le flambeau. Tant qu'on ne s'inclinera pas devant les Mandarins, tant que l'Académie des Sciences ne sera pas le remplaçant du Pape, la Politique tout entière, et la Société jusque dans ses racines, ne sera [sic] qu'un ramassis de blagues écœurantes 23. » La politique pour Flaubert ne peut survivre qu'à condition de se convertir à la science, de renoncer aux idées et aux sentiments.
10
L'Éducation sentimentale est un roman contre une certaine conception de la politique, trop romantique. Au début de son travail il définit ainsi son projet : « Montrer que le Sentimentalisme (son développement depuis 1830) suit la Politique et en reproduit les phases24 ». Dès les années 1850 Flaubert avait associé le romantisme lamartinien au sentimentalisme politique qu'il voit triompher en 1848, et il tenait Lamartine pour responsable de l'inefficacité politique de ces événements : « C'est à lui que nous devons tous les embêtements bleuâtres du lyrisme poitrinaire, et lui que nous devons remercier
27
de l'Empire25. » Après la Commune, il défend le droit contre le sentiment qui trouble le jugement. Il voit le triomphe de la sensibilité et de l'idée de grâce dans les mouvements révolutionnaires qui lui semblent rétrogrades car ils ramènent le religieux dans la politique : « Nous pataugeons dans l'arrière-faix de la Révolution, qui a été un avortement, une chose ratée, un four « quoi qu'on die », et cela parce qu'elle procédait du Moyen Âge et du christianisme, religion anti-sociale. L'idée d'égalité (qui est la démocratie moderne) est une idée essentiellement chrétienne, et qui s'oppose à celle de Justice. Regardez comme la Grâce, maintenant, prédomine. Le Sentiment est tout, le droit rien ! on ne s'indigne même plus contre les assassins26. » Il hait l'esprit démocratique qui n'est qu'une manifestation du vieux christianisme27. Dans L'Education sentimentale, l'acteur Delmar obtient un grand succès dans le rôle du Christ, dont l'esprit quarante-huitard avait fait un sans-culotte28. A l'inverse les nouvelles figures du pouvoir que Flaubert imagine ne seront donc pas des figures religieuses. Les Mandarins ne sont pas des phares de l'humanité, des prophètes ou des prêtres, ni des Messie. Flaubert refuse la représentation romantique des figures idéales du pouvoir. La seule politique qui lui semble légitime se dissocie de la croyance pour fonder sa légitimité de manière immanente sur l'exercice efficace du pouvoir, sur les compétences effectives des Mandarins. Ce serait une politique qui n'imposerait pas aux individus des idées, des manières de penser. Les Mandarins doivent gérer la cité et non faire triompher une philosophie politique. Contre les vieilles figures du pouvoir, contre le danger des idéaux, la littérature agit par une mise en cause générale de la tyrannie des discours et des idées. Le roman flaubertien représente moins le monde que les discours qui font violence au monde. Il représente de manière critique la collusion de la parole et du pouvoir. Dans Madame Bovary, lorsque la parole d'Homais est devenue suffisamment forte à Yonville, le pouvoir la fait sienne et pour se concilier cet homme au verbe dominant, le reconnaît comme son porte-parole. Homais fait un coup d'état à son échelle. La violence politique est d'abord une violence du discours. 11
L'œuvre flaubertienne représente le pouvoir de la parole et s'oppose à ce pouvoir. Elle représente des points de vue et n'en adopte aucun. Par la virtuosité de son ironie et d'une poétique de l'inachèvement, l'œuvre résiste à l'interprétation et laisse à penser et à rêver au lieu d'imposer une pensée. A la parole et au pouvoir l'écrivain préfère l'écriture et l'art pur, le livre qui ne dit rien et qui se tient par la seule force de son style. L'écriture donne une liberté à l'égard de la tyrannie des discours politiques qu'il refuse même lorsqu'ils défendent des idées philanthropiques29. Avec ses croyances, ses mots d'ordre la politique est l'ennemi de la liberté. La philanthropie démocratique ne lui paraît donc pas moins tyrannique que les vieux despotismes : Qui êtes-vous donc, ô société, pour me forcer à quoi que ce soit ? Quel Dieu vous a fait mon maître ? [...] Ce ne sera plus un despote qui primera l'individu, mais la foule, le salut public, l'éternelle raison d'Etat, le mot de tous les peuples, la maxime de Robespierre. J'aime mieux le désert, je retourne chez les Bédoins qui sont libres 30 .
12
L'écrivain déserte chez les bédouins, choisit la liberté de l'écriture contre la limitation de tout discours. Le désert est souvent chez Flaubert la métaphore de l'écriture et de l'art pur, la métaphore de l'indépendance de l'art. La lutte de l'écrivain contre la tyrannie de la politique, des pouvoirs et des idéologies qui veulent imposer des manières de penser passe moins par des discours – Flaubert se refuse d'en tenir dans ses romans – que par une pratique de l'écriture qui est un véritable défi. L'écrivain est une figure de contrepouvoir qui met en cause indirectement les figures du pouvoir par la seule existence de
28
son style, parce qu'il déjoue les pièges du discours, parce qu'il oblige le lecteur à penser. C'est dans ce style résistant au discours que Flaubert voit la force politique de l'écrivain : « je crois, écrit-il en 1880, à la haine inconsciente du style. Quand on écrit bien, on a contre soi deux ennemis : 1° le public, parce que le style le contraint à penser, l'oblige à un travail ; et 2° le gouvernement, parce qu'il sent en vous une force, et que le pouvoir n'aime pas un autre pouvoir31. » 13
Le style tel que l'entend Flaubert est un acte d'insoumission d'une part grâce à sa force anti-discursive qui s'oppose à la parole politique et d'autre part grâce à la transmutation de la banalité en poésie grâce au travail du style. Contrairement à ce que croit Emma Bovary, la poésie ne préexiste pas au travail artistique et la virtuosité de l'écrivain peut la créer à partir de réalités prosaïques. Pour Flaubert, le travail du style est un acte de résistance politique contre le triomphe de l'esprit démocratique. L'égalité a passé dans les esprits mais l'écrivain, virtuose du style, doit se montrer capable de se libérer par la plume de ce conditionnement aliénant. La littérature est un espace non pas à part mais à côté, où Flaubert espère encore que l'esprit démocratique puisse être mis en échec. Lorsqu'il prépare Madame Bovary, il imagine faire de son œuvre un coup de force, un roman sur la médiocrité de la vie bourgeoise qui affirme contre le triomphe de l'égalité qui y est représentée la supériorité aristocratique de l'écrivain, vainqueur par la plume. Flaubert pense le pouvoir de la littérature et le fonde sur la force d'une écriture qui défie tout discours, toute volonté de pouvoir.
14
L'écrivain est encore vainqueur d'une autre façon. Il réussit à contourner l'interdit qu'il a lui-même énoncé en discréditant pouvoir et discours politiques. A l'époque où il rédige L'Éducation sentimentale, Flaubert reconnaît d'ailleurs que l'impersonnalité est moins un bel idéal éthique qu'une stratégie de pouvoir et paradoxalement de parole. Il avoue à George Sand que son écriture puise son énergie dans la violence d'une pensée sur la politique, qu'il énonce d'ailleurs dans plusieurs lettres de cette époque. L'écrivain ne doit pas dire son opinion, explique-t-il, mais il peut la « communiquer32 ». Le plus important est de réussir à exprimer cette opinion sans qu'elle tombe sous le coup de la critique, sans qu'elle puisse donc passer pour un discours qui relèverait comme les autres de la bêtise : « Quelle forme faut-il prendre pour exprimer parfois son opinion sur les choses de ce monde, sans risquer de passer, plus tard, pour un imbécile ?33 ». Il refuse de tenir des discours pour dire sa position politique mais la structuration du roman peut la suggérer par d'autres moyens. L'organisation textuelle est sous-tendue par un infra-discours qui ne s'énonce pas mais qui régit efficacement le récit. Ainsi, dans L'Éducation sentimentale, le récit des événements historiques est discontinu. Certains faits importants demeurent incompréhensibles car ils sont souvent présentés sans leurs causes, comme la fusillade du boulevard des Capucines. La Révolution débute d'ailleurs dans une ellipse de quelques heures, entre la fin de la première partie et le début de la deuxième pendant que Frédéric dort en compagnie de Rosanette. Les temps forts sont escamotés et Flaubert choisit de raconter les violences absurdes comme le sac des Tuileries plutôt que les moments héroïques. Le roman représente par ailleurs la cacophonie des discours dans les deux camps qui sont égaux en férocité et en bêtise. Des conservateurs aux républicains, l'opportunisme de Dambreuse et celui de Deslauriers se répondent. L'organisation narrative sert donc d'interface à une pensée politique qui s'inscrit dans le texte. Elle ne s'écrit pas mais elle permet d'écrire le récit. L'Éducation sentimentale communique au lecteur cette idée que la Correspondance développe de plus en plus après 1870 : la nécessaire fin de la politique pour que le politique échappe aux tournoiements absurdes
29
des idéologies. Cet infra-discours qui ne s'énonce pas mais organise le récit se fait ainsi passer pour une conclusion toute naturelle, dont l'auteur n'assume pas la responsabilité pour mieux la laisser au lecteur. Malgré les apparences éthiques que prend parfois le principe d'impersonnalité dans la Correspondance, surtout dans les années 1850, il y a bien chez Flaubert une politique machiavélique de l'écriture, une stratégie de pouvoir qui fait du silence apparent de l'œuvre un moyen efficace d'action. * 15
L'œuvre flaubertienne est donc doublement politique par ce qui s'y inscrit malgré tout et aussi par la finalité qu'elle se donne : l'œuvre cherche à atteindre le beau à partir de la médiocrité et en même temps contre elle. C'est là pour Flaubert l'acte de résistance le plus radical que puisse accomplir la littérature contre le triomphe de l'égalité. Si Flaubert défend « l'art pur » et refuse d'inféoder la littérature à la politique cela ne signifie donc pas qu'elle soit un jeu inutile et gratuit qui n'aurait plus rien à voir ni à faire avec le politique. Certes, comme Gautier il affirme que l'art ne saurait être utile. L'œuvre n'aura donc pas d'effet politique direct et immédiat. Néanmoins elle agit. La Correspondance montre bien que Flaubert pense ce qu'il appelle l'art pur comme une action, comme une riposte contre une société dégradée. Il ne voit pas du tout l'artiste comme un esthète qui s'enferme dans sa tour d'ivoire pour se livrer en solitaire aux plaisirs gratuits de la littérature. Il le voit plutôt comme une taupe qui mine insidieusement mais efficacement ce qui existe : Il faut se renfermer, et continuer tête baissée dans son œuvre, comme une taupe. Si rien ne change, d'ici à quelques années, il se formera entre les intelligences libérales un compagnonnage plus étroit que celui de toutes les sociétés clandestines 34 .
16
L'artiste est pour Flaubert un résistant clandestin.
NOTES 1. Ce serait la fin de l'art et Flaubert en montre les dangers dans L'Éducation sentimentale avec le personnage de Sénécal qui est un défenseur de l'art social, au service de la politique. 2. Lettre à Louise Colet, 23/1/54 ; Corr., II, p. 514 3. Lettre à L. Colet, 19 mars 1854, ; Corr., II, p. 537. 4. Sur ce point voir Gisèle Séginger, Flaubert, Une éthique de l'art pur, à paraître aux éditions SEDES, 1999. 5. « J'ai assisté en spectateur à presque toutes les émeutes de mon temps », écrira-t-il plus tard à Mlle Leroyer de Chantepie (30/3/57 ; Correspondance (désormais : Corr.), éd. de Jean Bruneau, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », Gallimard, 1973-1991, II, p. 698). 6. Lettre à L. Colet, ; Corr., I, p. 492. 7. Lettre à L. Colet, 29/5/52 ; Corr., II, p. 100. 8. Lettre à Louise Colet, 22 septembre 1853 ; Corr., II, p. 437.
30
9. « Je crois, écrit-il en 1871 à G. Sand qui ne partageait guère ses idées anti-démocratiques, que la foule, le nombre, le troupeau sera toujours haïssable. »(8/9/71 ; Corr., IV, p. 376). 10. Lettre à Louise Colet, 22 septembre 1853 ; Corr., II, p. 437. 11. Lettre à E. et J. de Goncourt, 3/7/60 ; Corr., III, p. 94. 12. Lettre à Mlle Leroyer de Chantepie, 18/5/57 ; Corr., II, p. 718. 13. Ibid., p. 719. 14. Lettre à Mlle Leroyer de Chantepie, 18/5/57 ; Corr., II, pp. 718-719) 15. « Ils ont nié la Douleur, ils ont blasphémé les trois quarts de la poésie moderne, le sang du Christ qui se remue en nous. [...] Si le sentiment de l'insuffisance humaine, du néant de la vie venait à périr (ce qui serait la conséquence de leur hypothèse), nous serions plus bêtes que les oiseaux, qui au moins perchent sur les arbres. » (à L. Colet, 4/9/52 ; Corr., II, p. 151) 16. Lettre à G. Sand, 19/9/68 ; Corr., III, p. 805. 17. Lettre à E. Roger des Genettes, été 1864 ; Corr., III, p. 402. 18. Bouvard et Pécuchet, éd. établie par Claudine Gothot-Mersch, Gallimard, coll. « Folio », p. 319. 19. Lettre à Mlle Leroyer de Chantepie, 30/3/57 ; Corr., II, p. 698. 20. Lettre à G. Sand, 25/7/71 ; Corr., IV, p. 352. 21. Lettre à G. Sand, 30/4/71 ; Corr., IV, p. 314. 22. Lettre à G. Sand, 8/9/71 ; Corr., III, p. 376. 23. Ibid. 24. Carnet 19, f° 38 v°, Carnets de travail, éd. de P.-M. de Biasi, Balland, 1988, p. 296. 25. Lettre à L. Colet, 6/4/53 ; Corr., II, p. 298. 26. Lettre à G. Sand, 8/9/71 ; Corr., IV, p. 376. 27. « Je hais la démocratie (telle du moins qu'on l'entend en France), parce qu'elle s'appuie sur « la morale de l'évangile », qui est l'immoralité même, quoi qu'on dise, c'est-à-dire l'exaltation de la grâce au détriment de la justice, la négation du Droit, en un mot l'anti-sociabilité » (à George Sand, 30/4/71 ; Corr., IV, p. 314. 28. C'est ainsi que Jésus est représenté dans Spiridion, roman de son amie G. Sand dont il ne partage pas les sympathies socialistes. 29. A Mlle Leroyer de Chantepie qui défend l'instruction obligatoire, Flaubert rétorque : « Moi, j'exècre tout ce qui est obligatoire, toute loi, tout gouvernement, toute règle » ; et il refuse le primat de la société sur l'individu, (à Mlle Leroyer de Chantepie, 18/5/57 ; Corr., II, p. 719) 30. Ibid. 31. Lettre à Maupassant, 19/2/80 ; Correspondance Gustave Flaubert - Guy de Maupassant, éd. établie par Y. Leclerc, Flammarion, 1993, p. 226. 32. Lettre à G. Sand, 10/8/68 ; Corr., III, p. 786. 33. Lettre à G. Sand 18/12/67 ; Corr., III, p. 711. 34. Lettre à L. Colet, 22/9/53 ; Corr., II, p. 437.
31
De la lumière bénie de Dieu aux feux brûlants de l'homme : la représentation du pouvoir dans les derniers romans de Victor Hugo Patricia Mines
1
L'association chez Hugo entre le pouvoir et la révolution populaire est bien connue. Les commentateurs qui se sont occupés de son œuvre ont souvent constaté que la révolution populaire, selon Hugo, est « la voix de Dieu » qui s'exprime, et qui exige que le vrai pouvoir légitime soit établi sur terre1. Tel est le tableau de la révolution dans Les Misérables, où le chef des révolutionnaires, Enjolras, parle de l'avenir brillant de l'humanité, et où Marius survit au carnage des barricades pour épouser sa Cosette bienaimée. Dans sa préface à l'édition des derniers romans, Les Travailleurs de la mer, L'Homme qui rit et Quatrevingt-Treize, publiée chez Robert Laffont, Yves Gohin nous a donné à croire que le tableau de la révolution dans Quatrevingt-Treize est pareil à celui des Misérables : sous la voix sévère de Cimourdain, sous la rêverie déchirée de Gauvain, le vieux Hugo a fait jaser l'Eros qui sera vainqueur.2
2
On va voir si « l'Eros » est vraiment vainqueur dans Quatrevingt-Treize. Le tableau de la révolution dans le tout dernier roman de Hugo a pris des teintes lugubres. Le conflit politique, les hommes qui y sont impliqués, les paroles proférées par leur chef, et les observations faites par Hugo diffèrent de tous ceux qui sont exposés dans Les Misérables.
3
Henri Meschonnic a fait remarquer que « toute la philosophie de Ce que dit la Bouche d'Ombre se retrouve dans Les Misérables, cette opposition entre des clartés et du noir, de l'âme et de la matière, le bien et le mal »3. Ainsi, la lumière est centrale à la représentation hugolienne de la révolution, la lutte même pour assurer le bien universel. L'association entre « les clartés, l'âme et le bien » que Meschonnic a identifiée remonte à la Préface de Cromwell. Dans cette œuvre majeure, Hugo maintient que « le Christ, c'est le jour »4, et la lumière devient donc la présence visible de Dieu. Dans cette métaphore, Hugo rassemble plusieurs pouvoirs, des sphères divine, humaine et cosmique. Hugo nous fait comprendre que l'aurore de la Genèse, c'était déjà le saint ministère, l'amour du
32
Christ et son triomphe sur la mort, et son agonie est presque masquée par l'intensité de ces premiers rayons. Le pouvoir le plus important, ici, c'est peut-être le pouvoir transcendant de la foi parfaite, dont le Christ est l'incarnation. L'amour suprême du sacrifice, dont le Christ est l'exemple absolu, est lui aussi une force significative que symbolise la lumière. Dans cette vision, le Christ fut le premier révolutionnaire à lutter contre les forces de la réaction et à exiger qu'une nouvelle société soit établie. Dans Les Misérables, où on fait la révolution afin de répandre « lumière, lumière 5 », Hugo ressuscite la relation entre le fils de Dieu et la lumière naturelle, premier don de Dieu qui permet la vie sur terre. On peut voir que Hugo cherchait à justifier la révolution, décrite comme la bonne création de Dieu et la source naturelle de la vie, puisqu'elle est associée avec la lumière. Dans les barricades des Misérables, il n'y a aucun doute qu'un avenir brillant découlera d'une révolution. La douleur et la mort sont secondaires, face à l'intensité et à la perpétuité de la bonté de Dieu. 4
L'importance attachée par Hugo à la force bienfaisante de la lumière dans Les Misérables se manifeste dans le chapitre 'Les Mines et les mineurs', intercalé dans le roman en 1861-1862. Dans cette partie du roman, où on rencontre les criminels de Patron-Minette, Hugo prononce son traité qui résoudrait le problème des « larves », c'est-à-dire tous les maux sociaux : « que faut-il pour faire évanouir ces larves ? De la lumière. De la lumière à flots. Eclairez la société en dessous » (vol. XI, p. 536). On a constaté que ce remède est réitéré de nouveau en 1861-62 dans L'Âme, où Hugo insiste sur la nécessité de « cet immense lavage de l'humanité par la lumière »6. Dans ces œuvres du début des années 1860, la société habitée par des récidivistes tels que Claquesous est très nettement « la nuit », à laquelle la lumière du monde gouverné par Dieu, c'est-à-dire le monde désiré par les révolutionnaires, est opposée. Tandis que Claquesous et ses collègues font le mal sous l'ombre du troisième dessous social, les révolutionnaires sur les barricades sont obsédés par « le rayonnement de l'avenir » (vol. XI, p. 835). La lumière les incite à lutter pour une nouvelle société et ils acceptent la mort comme le prix à payer.
5
La révolution évoquée dans Les Misérables est tout à fait baignée de lumière. Au moment même où l'heure suprême approche, aucune ombre n'est jetée sur Enjolras, chef des révolutionnaires, qui personnifie les idéaux de 89, ni sur ses fidèles. Dans le dernier discours d'Enjolras, il lui faut informer ses hommes qu'ils sont sans espoir, mais il ne cesse pas de parler de la lumière : Citoyens, vous représentez-vous l'avenir ? Les rues des villes inondées de lumière... les nations soeurs, les hommes justes... De l'école identique sort la société égale. Oui, enseignement ! Lumière, lumière... (vol. XI, p. 833)
6
Enjolras est la personnification de l'amour de Dieu, « ce millionnaire d'étoiles » 7, et il meurt en tant que son fils dévoué. On voit son corps en pietà : « adossé au mur comme si les balles l'y eussent cloué. Seulement il pencha la tête » (vol. XI, p. 871). Comme le Christ qui s'attendait à se retrouver au Paradis après son martyre, Enjolras ne perçoit qu'un futur brillant avant d'être tué : « Lumière, lumière, tout vient de la lumière et tout y retourne » (vol. XI, p. 834). La confiance en Dieu ici est telle que la vue biblique de la condition mortelle, (« tu es né poussière et tu redeviendras poussière ») est intervertie, mais dans Quatrevingt-Treize, c'est la vue biblique qui prédomine, et le lecteur a l'impression que la révolution ne fait que réduire et détruire. Navires, villages, chaumières, êtres humains se transforment tous en cendres et fumées.
33
7
Hugo chérit la lumière de Dieu parce qu'il y voit une capacité sublime de changer tout pour le mieux. La vie de saint Paul est bien entendu la meilleure illustration de la métamorphose réalisée par la lumière. Cet apôtre est un des génies qui figurent dans William Shakespeare : « Paul, saint pour l'église, pour l'humanité grand, représente ce prodige à la fois divin et humain : la conversion. Il est celui auquel l'avenir est apparu... rien n'est superbe comme cette face à jamais étonnée du vaincu de la lumière » (vol. XII, p. 182). Selon Hugo, Paul est le personnage qui représente la conversion totale, puisqu'« il aspirait... à devenir bourreau », et c'est la lumière qui a recréé de manière radicale et décisive sa personne : « tout à coup un flot d'aurore sort de l'ombre... et désormais il y aura dans l'histoire du genre humain cette chose admirable, le chemin de Damas » (vol. XII, p. 182). La conversion de saint Paul, c'est le moment où le jour, autrement dit le Christ, le capture. Après son éblouissement Paul ne voit que Dieu et les saints, « Paul parle des célestes comme s'il les apercevait distinctement », et il se voue à l'assainissement des moeurs : « Paul, après sa chute auguste, s'est redressé armé, contre les vieilles erreurs » (vol. XII, p. 183). « La grâce », « le droit » et « le grandissement d'un esprit par l'irruption de la clarté » sont les résultats de la transfiguration de saint Paul8. Le chemin de Damas annonce une nouvelle force intellectuelle qui a été accordée à cet homme, comme l'indique le dessin de saint Paul qu'a fait Hugo en 1860, car Hugo a esquissé la tête du saint auréolée de lumière, tandis que le reste de l'image est assez obscur 9. La lumière symbolise à la fois la présence de Dieu et sa détermination à obliger les hommes à améliorer leur société. Au début des années 1860, Hugo croit que le désir divin de voir l'accomplissement du progrès sur terre est inextinguible, comme la lumière est impossible à éteindre. Puisque la transfiguration de saint Paul l'a poussé à convertir ses semblables, le chemin de Damas représente la transformation de la foule par la transformation de l'individu, et Hugo considère que l'Histoire a été ponctuée par beaucoup de ces instants catalyseurs : « Voltaire est comme saint Paul sur le chemin de Damas. Le chemin de Damas sera à jamais le passage des grands esprits. Il sera aussi le passage des peuples » (vol. XII, p. 183). Les personnages Enjolras, Grantaire et Jean Valjean sont les descendants fictifs de Voltaire et de saint Paul, lui-même descendant du Christ. Sur les barricades, « on a eu la tête dans de la lumière d'avenir », 10 et même « l'ivrogne » Grantaire est « transfiguré » après qu'il s'est décidé à se battre pour la république (vol. XII, p. 871). Hugo est si convaincu qu'une révolution va arriver et qu'une meilleure société va en surgir, qu'il prévoit que le chemin de Damas de la nation française se situe dans un avenir proche : « 2000 ans après [Paul], la France, terrassée de lumière, se relèvera, elle aussi, tenant à la main cette flamme épée la Révolution » (vol. XII, p. 183).
8
Si Hugo s'attache tant au chemin de Damas, c'est qu'il représente à ses yeux la défaite du mal. Paul, qui voulait être « bourreau », est devenu « homme juste » (vol. XII, p. 182). Pourtant, il semble que le chemin de Damas n'ait plus réussi à rassurer le vieil Hugo des années 1870. Dans Quatrevingt-Treize, la victoire est remportée par le mal.
9
Les lumières évoquées dans Quatrevingt-Treize ne sont pas celles du paradis mais celles de l'enfer. Le feu, la fumée et les cendres sont les leitmotivs prédominants de ce roman. Nombreux sont les critiques qui diraient que les barricades des Misérables émettent les mêmes lumières infernales, et il faut admettre que Hugo s'attarde sur « ces choses terribles » pendant « la guerre entre quatre murs »11. Dans la barricade de la Chanvrerie, l'arène de la bataille, « il y avait des cadavres couchés et des fantômes debout... On a vécu dans la mort » (vol. XI, p. 856). Cependant, les images évoquant l'horreur de la révolution sont plus fréquentes et plus approfondies dans le texte de Quatrevingt-Treize. Une des
34
premières lumières qui nous est donnée à voir, c'est « l'éclair » du canon détaché qui dévaste le vaisseau royaliste la Claymore12, et la douleur qu'il inflige à l'équipage est si intense que ses victimes ont l'air de souffrir même après la mort : « les quatre roues passaient et repassaient sur les hommes tués, les coupaient, les dépeçaient, et les déchiquetaient... les têtes mortes semblaient crier, des ruisseaux de sang se tordaient sur le plancher » (vol. XV, p. 303). Ces voix d'outre-tombe condamnent le massacre, et exigent qu'on y mette fin. Pourtant, ceux qui survivent à « la caronade »13 (la destruction du navire par le canon détaché), n'écoutent pas leurs camarades morts, et ils se préparent à tuer de nouveau. Après la caronade, l'horizon « s'incendie », « la mer se couvre de fumée et de feu » et les marins royalistes perdent la vie dans une bataille navale contre un navire révolutionnaire (vol. XV, p. 313). Et ce qui est plus, l'incendie en mer s'étend à la terre française en raison des ordres lancés par le commandant royaliste Lantenac, qui fait raser le village d'Herbe-en-Pail14. S'il est vrai que le destin se trouve dans le nom, on peut voir Lantenac comme celui par qui le malheur arrive à cette communauté rurale. Après le passage de Lantenac, les prés fertiles d'Herbe-en-Pail ne sont plus qu'un désert aride : Pas un cri ne s'élevait, pas un soupir humain ne se mêlait à cette fumée ; cette fournaise travaillait et achevait de dévorer ce village... Au milieu de la cour il y avait un monceau noir... ce monceau était un tas d'hommes ; ces hommes étaient morts... Il y avait autour de ce tas une grande mare qui fumait un peu... c'était du sang (vol. XV, p. 335). 10
Cette révolution présente toutes les couleurs du sang et du feu. Alors que la capitale française est rouge du travail de la guillotine, la mer et la campagne autour exposent les teintes de l'incendie criminel et de la tuerie.
11
Tout comme la dernière bataille livrée dans Les Misérables, le paroxysme du conflit armé dans Quatrevingt-Treize est atteint dans un espace clos. L'arène de gladiateurs de Quatrevingt-Treize s'appelle la Tourgue, la tour Gauvain, forteresse royaliste 15, qui réussira à renforcer le pouvoir de l'Ancien Régime, car l'aïeul réactionnaire Lantenac s'en échappera tandis que le jeune fils éclairé Gauvain mourra devant elle.
12
La Tourgue, c'est un grossissement du café Corinthe, lieu fatal où sont tués Enjolras et ses camarades. Hugo y recrée les mêmes sentiments de claustrophobie et d'asphyxie : il est affreux de s'entretuer avec un plafond sur la tête... toute la retirade se couvrit d'éclairs... et ce fut quelque chose comme la foudre éclatant sur terre... Impossible de rien distinguer. On était dans une noirceur rougeâtre... un ruisseau de sang sortait de la tour par la brèche, et se répandait dans l'ombre (vol. XV, p. 459).
13
Néanmoins, Hugo nous donne l'impression que la Tourgue est un lieu où il est encore plus affreux de mourir. Son entrée même avertit ceux qui y pénètrent qu'ils vont être démembrés : « les assaillants avaient devant eux ce porche noir, bouche de gouffre... une gueule de requin n'a plus de dents que cet arrachement effroyable » (vol. XV, p. 458-459). Bref, la Tourgue, « c'était l'enfer » (vol. XV, p. 459). La révolution telle qu'elle est dépeinte dans ces pages suggère la puissance du Diable et l'idée de damnation. L'espoir du salut et de la vie éternelle qu'avaient les révolutionnaires des barricades n'est pas de mise ici : « dedans c'était l'enfer, dehors c'était le sépulcre » (vol. XV, p. 459). Les révolutionnaires de Quatrevingt-Treize, contrairement à leurs frères idéologiques morts au café Corinthe, ne donnent pas l'impression d'« entrer dans une tombe toute pénétrée d'aurore » (vol. XI, p. 835).
14
La Tourgue est bel et bien une fournaise, une tour qui vomit de la fumée, un cylindre où les hommes brûlent. Dans la partie de Quatrevingt-Treize intitulée « A Paris », Hugo définit
35
la Convention comme une « fournaise » et « une forge » (vol. XV, p. 377). La Tourgue est la transposition concrète et sinistre de cette métaphore industrielle. Non seulement rien de neuf n'est produit par la fournaise de la Tourgue, mais de nombreux hommes sont massacrés entre ses murs. Si on réfléchit un moment à la pensée technique dans Quatrevingt-Treize, l'aspect le plus effrayant de cette métaphore « Convention-fournaiseforge », ce sont les inventions mécaniques qui y sont associées. « Des menottes coupantes, forgées exprès » étaient attachées aux révolutionnaires arrêtés (vol. XV, p. 393). Il n'est pas difficile d'imaginer quelles devaient être les autres inventions de cette révolution, outre ces menottes coupantes et la guillotine. Hugo fait remarquer que « la terreur répliquait à la terreur16 », nous donnant à croire que les deux parties entraînées dans ce conflit étaient coupables d'atrocités comparables. La ferronnerie produite par une forge évoque l'idée de solidité, de résistance et elle représente métaphoriquement les bienfaits durables de la révolution. Mais il ne faut pas oublier que des hommes éclairés tels que Gauvain servent de combustible à cette fournaise. Dans Les Misérables, Hugo a évoqué la beauté que les hommes pourraient créer après avoir participé à une révolution : ce vil sable que vous foulez aux pieds, qu'on le jette dans la fournaise, qu'il y fonde et qu'il y bouillonne, il deviendra cristal splendide (vol. XI, p. 443). 15
En revanche, dans Quatrevingt-Treize, l'accent est plutôt mis sur l'enfer dans lequel les hommes sont obligés de souffrir uniquement pour faire vivre le faible espoir d'un progrès lointain. De ce qu'on apprend dans Les Misérables, la révolution embellit les hommes, les transformant en « cristal splendide », mais au cours de la révolution de Quatrevingt-Treize, les hommes se battent pour le plaisir.
16
Pourtant, il ne faut pas nier que la lumière dorée et bénie des Misérables n'est pas tout à fait absente de Quatrevingt-Treize. Elle imprègne les songeries philosophes de Gauvain, un des « hommes de la délivrance et de l'affranchissement » (vol. XV, p. 485). Maints critiques de Quatrevingt-Treize déclarent que le sauvetage de trois petits enfants par le commandement royaliste est gage de l'optimisme du roman, et de la confiance en l'avenir qu'avait Hugo à l'âge de 72 ans. Le jeune héros Gauvain salue cet exploit courageux en le nommant « un coup de lumière » (vol. XV, p. 485), et cet événement sera son propre chemin de Damas, car il en est inspiré et rembourse cette compassion en permettant à Lantenac d'échapper à la guillotine. Cependant, ce geste de bonté trahit les autres révolutionnaires et la république, et le prix de sa générosité, c'est la mort. Le « contrecoup » de ce « coup de lumière » est le lugubre lever de soleil lorsque Gauvain est guillotiné (vol. XV, p. 485). « Cependant le soleil se lève » est le titre du dernier chapitre écrit par Hugo. En examinant les poèmes de « Juin » dans L'Année terrible, Sandy Petrey a constaté que « le soleil se lève en attendant et tout de même »,17 et cette vision d'un cosmos indifférent aux actions humaines s'applique tout à fait à la fin de QuatrevingtTreize. Le paradis et la nature, bonnes créations de Dieu, n'ont nulle relation à la société des hommes, qui ne s'abstiennent pas de faire le mal.
17
La notion de « transfiguration » est beaucoup moins incertaine dans Quatrevingt-Treize qu'elle ne l'était dans Les Misérables. L'acte courageux de Lantenac est traditionnellement vu comme sa « transfiguration »18, mais le sauvetage des enfants de la Tourgue incendiée ne l'éclaire ni ne le transforme en homme juste. N'oublions pas qu'il est coupable de massacres19. C'est lui qui a enlevé les enfants Fléchard, et qui les a emprisonnés. En outre, il a laissé leur mère gravement blessée à Herbe-en-Pail. De telles atrocités censurent ce personnage, mais le pire, c'est que sa libération lui permet de commettre encore plus de crimes. Lantenac se condamne dans son cachot :
36
Ah ! nous étions des justiciers, nous autres. On peut voir ici sur le mur la marque des roues d'écartèlement. Nous ne plaisantions pas. Non, non, point d'écrivassiers ! moi, j'eusse supprimé tous les gratteurs de papier (vol. XV, p. 492). 18
C'est la voix de l'Ancien Régime qui parle, et qui peut toujours se faire entendre à la fin du roman, tandis que celle de la clémence a été étouffée. Et la bonté que lui montre Gauvain, ce n'est pas la première fois qu'il en bénéficie. On ne parle pas d'une conversion telle qu'a subie Jean Valjean. Le paysan Tellmarch a déjà sauvé la vie à Lantenac, et il suffit de penser à la façon dont Lantenac l'a remercié pour se rendre compte que sa libération par Gauvain ne présage rien de bon pour le futur. Gauvain reconnaît lui-même qu'il est coupable, car il libère « le meurtrier de la patrie »,20 et que « sauver Lantenac, c'est sacrifier la France ; la vie à Lantenac, c'est la mort d'une foule d'êtres innocents » (vol. XV, p. 497).
19
Le récit de Quatrevingt-Treize est circulaire, car à son début celui qui cherchait à tuer les révolutionnaires le cherche encore à sa fin. C'est dans la structure du texte que Hugo met ainsi l'accent sur le manque de progrès qu'a fait la France. « L'avenir » qui « rayonnait » dans Les Misérables n'est qu'une malheureuse répétition de l'Histoire sanglante dans Quatrevingt-Treize. D'où la désillusion des dernières paroles énoncées par Gauvain dans son cachot. A la différence d'Enjolras, il ne mentionne ni la lumière ni un avenir brillant. Dans un monde qui n'arrive pas à se dégager de la barbarie du passé, Gauvain décrit le progrès comme si c'était un rêve, ou de la magie : Je veux la transfiguration de la larve en lépidoptère ; je veux que le ver de terre se change en une fleur vivante, et s'envole. Je veux... (vol. XV, p. 504)
20
La répétition du mot « je veux » fait penser à un enfant qui réclame sans cesse des choses impossibles. Les méditations de Gauvain sont coupées par les bruits de la réalité, les pas des soldats qui viennent l'escorter à la guillotine. Les Misérables nous avait donné à croire que « les larves » allaient disparaître de la terre, mais elles y sont toujours à la fin de Quatrevingt-Treize.
21
Il y a cependant une similarité frappante qui réunit les révolutions des Misérables et de Quatrevingt-Treize. Dans les deux romans, c'est une jeune femme qui nous communique l'ampleur de la cruauté et l'importance du succès de la révolution. Dans Les Misérables, le dernier lever du jour vu par Enjolras, c'est le réveil de Cosette. Le lecteur a pitié d'elle, car elle n'a aucune idée que ses deux hommes bien-aimés se trouvent piégés dans la pire des batailles. Dans ce chapitre intitulé 'Aurore', on voit le parallèle que fait Hugo entre l'amour chaste de Cosette, future femme de Marius et mère de ses enfants, et « le rayonnement de l'avenir » de la révolution. Dans Quatrevingt-Treize, une jeune femme se voit contrainte à contempler la destruction de son identité même21. Michelle Fléchard assiste en spectatrice impuissante alors que les flammes de la révolution brûlent autour de ses enfants. Elle les regagne, mais son avenir est beaucoup moins assuré que celui de Cosette, car elle et sa famille sont toujours menacées par l'existence de Lantenac. La révolution est un produit masculin, provoqué par les hommes, et les femmes y sont assujetties.
22
Dans Les Misérables, c'est un inconnu qui pousse Enjolras et ses fidèles à se battre à la mort : « un oublié... qui s'évanouit dans les ténèbres après avoir représenté une minute, dans la lumière d'un éclair, le peuple et Dieu » (vol. XI, p. 829). Dans Quatrevingt-Treize, pourtant, aucun des plus célèbres des révolutionnaires ne semble rayonner, même brièvement. Danton, Marat, Robespierre et tous les autres membres de la Convention ne sont qu'un « tas de fumées, poussées dans tous les sens » (vol. XV, p. 379). Bien loin d'être
37
des hommes puissants et autonomes, ils sont faibles et anonymes : « esprits en proie au vent » (vol. XV, p. 379). Le Dieu qui règne en Quatrevingt-Treize n'est pas aussi compatissant que celui des Misérables : « les événements dictent, les hommes signent... Le rédacteur énorme et sinistre de ces grandes pages a un nom, Dieu, et un masque, Destin » (vol. XV, p. 379-380).22 23
Dans Les Misérables, Hugo rêve donc toujours de la révolution populaire, mais à l'âge de 70 ans, après la guerre franco-prussienne et la Commune, ce rêve est éteint. QuatrevingtTreize semble un avertissement aux hommes, les informant qu'ils préfèrent le mal au bien. Les images de flammes et de fumée dans Quatrevingt-Treize traduisent cette conviction profonde que le pouvoir légitime ne pourra jamais régner sur la terre. Au cours de son énumération des actes brutaux commis pendant la révolution, Hugo fait cette remarque suivante : « nous avons revu ces moeurs » (vol. XV, p. 393). Dans cette interpolation, le pronom « nous » implique tous les lecteurs présents et futurs : Hugo nous oblige à reconnaître la vérité de son testament de la honte humaine. Le roman Les Misérables est vraiment celui qui est à « la marche du mal au bien... de la nuit au jour », 23 mais Quatrevingt-Treize en est l'antithèse : c'est le roman qui s'enfonce dans les ténèbres du pouvoir.
NOTES 1. Dans le chapitre « La Charybde du Faubourg Saint-Antoine et La Scylla du Faubourg du Temple » des Misérables, Hugo confirme : « L′esprit de révolution couvrait de son nuage ce sommet où grondait cette voix du peuple qui ressemble à la voix de Dieu. » (Œuvres complètes de Victor Hugo, éd. Jean Massin, 18 vol. [Paris : Club français du livre, 1967-69], vol. XI, p. 823. Toutes les références aux œuvres de Hugo et toutes les citations sont tirées de cette édition). Pour en savoir plus de l′association entre Dieu et la révolution populaire, le lecteur pourrait consulter « Poétique et politique de la paternité » de J. Seebacher : « Sans doute le raisonnement tend à démontrer que la démocratie prouve Dieu : [...] l′homme sera refait et l′humanité accomplie, à condition qu′il soit éclairé, illuminé par l′aspiration au divin. » (Œuvres complètes de Victor Hugo, vol. XII, pp. XXV-XXVI). En plus, Guy Rosa déclare Les Misérables un « livre de prière » (« Jean Valjean [I, 2, 6] ; Réalisme et irréalisme des Misérables dans Lire Les Misérables, Paris : José Corti, 1985, p. 238). Il ajoute encore : « Il nous signale : Dieu demeure parfaitement inconnaissable parce qu′il est non pas l′objet mais le produit de l′effort spirituel - mais aussi bien moral, historique, amoureux, social - des hommes » (p. 237, note 35). 2. Œuvres complètes de Victor Hugo, 15 vol. (Paris : Robert Laffont, 1985), Roman III, p. v. 3. « La Poésie dans Les Misérables », Œuvres complètes de Victor Hugo, vol. XI, p. XXXVII. 4. O.c., vol. III, p. 48. 5. O.c., vol. XI, p. 834. 6. O.c., vol. XII, p. 94. Dans l′édition des Misérables publiée chez Laffont, Guy et Annette Rosa nous indiquent que « le thème recevra tout son développement dans William Shakespeare » (Roman II, p. 1201). 7. 0.c., vol. XI, p. 853. 8. O.c., vol. XII, p. 182-183.
38
9. Voir le dessin de Saint Paul dans O.c, vol. XVIII. « Encre de Chine, lavis et aquarelle », « Non Liber Monet, Non Gladius Servat », p. 492 bis. Le commentaire se trouve à la page 492. 10. O.c., vol. XI, p. 856. 11. O.c., vol.XI, p. 824. 12. O.c., vol.XV, p. 302. 13. O.c., vol.XV, p. 302. 14. Voir le chapitre « Les Péripéties de la guerre civile » dans Quatrevingt-treize. 15. Voir le chapitre « Une Bastille de province » dans Quatrevingt-treize. 16. O.c., vol. XV, p. 393. 17. Sandy Petrey, History in the Text: Quatrevingt-treize and the French Revolution, (Purdue University Monographs in Modern Languages), Amsterdam: John Benjamins, 1980, p. 114: « the sun is rising meanwhile and nevertheless ». 18. Voir, par exemple, le chapitre sur Quatrevingt-treize dans Victor Brombert, Victor Hugo and the Visionary Novel, Princeton: Princeton University Press, 1984: « When Lantenac saves the children [...] His conversion to the truth of love no longer belongs to the realm of political action: it is a transfiguration » (p. 222-223). Se pourrait-il qu′on ait tort d′accepter une telle interprétation ? 19. A Herbe-en-Pail, Lantenac donne l′ordre impitoyable : « dis-leur de tuer, de tuer, de tuer » ( O.c., vol. XV, p. 321). 20. O.c., vol. XV, p. 497. 21. « Cette figure, ce n′était plus Michelle Fléchard, c′était Gorgone ... je veux mes enfants ... tuezmoi ! ... qu′on les ôte, ou qu′on m′y jette ! » (O.c., vol. XV, p. 474-476). 22. Ce passage fait penser au décret de la Convention que Gauvain a signé, « édictant la peine capitale contre quiconque favoriserait l′évasion d′un rebelle prisonnier », (O.c., vol. XV, p. 497). Ainsi, le jeune héros se condamne, et Hugo nous fait goûter le fiel d′un sort qui se moque de lui. 23. Les Misérables, O.c., vol. XI, p. 861.
39
La réaction politique de Barbey d'Aurevilly à Léon Bloy : imagerie ou rhétorique du pouvoir ? Marie-Françoise Melmoux-Montaubin
1
« Torrent du sang des innocences égorgées », la guillotine, « ignoble couperet », change le cours du siècle. De Chateaubriand à Maistre, de Bonald à Maurras en passant par Daudet, toute la réaction naît dans ces images et se nourrit d'elles. Autour de ces auteurs s'élabore certes un discours historique et philosophique, qui interroge l'histoire et contre l'émergence d'une société républicaine et démocratique tente de penser la survie d'une France monarchiste et catholique. La réaction a ses philosophes du pouvoir, dont l'œuvre demeure pourtant largement ignorée. Sans doute est-ce la rançon de choix politiques malheureux, que l'événement ne couronna pas... À moins que ce ne soit au contraire celle d'un succès équivoque, qui détourna leur pensée en système d'images.
2
Car parallèlement à leurs textes théoriques, s'impose une approche qui récuse la philosophie et l'histoire contemporaines, au profit de l'image. L'œuvre aurevillienne en témoigne entre toutes. Elle est fondatrice. Si en effet Barbey d'Aurevilly se nourrit de Maistre, il n'écrit pas pour autant les Soirées de Saint-Pétersbourg sans cesse promises 1. On formulera une hypothèse : comme la carrière politique est impossible, de même l'œuvre politique, celle qui ferait de Barbey un Machiavel à défaut d'un prince, reste dans les limbes. À l'absence d'action politique réelle – car les quelques expériences de Barbey en la matière sont largement insuffisantes pour permettre de parler seulement d'une carrière politique – répond ainsi l'abandon du traité. Les articles, relativement nombreux bien que leur nombre demeure proportionnellement négligeable en regard de l'ensemble de l'œuvre, ne manifestent pas une cohérence suffisante pour qu'on en retire une pensée du pouvoir. Ces défaillances expliquent d'ailleurs la pauvreté des ouvrages consacrés à la politique chez Barbey d'Aurevilly, tels, par exemple, celui de Yarrow, qui ne réussit guère à conclure, au bout de trois cents pages, qu'au caractère changeant et fondamentalement peu sérieux de la représentation du pouvoir chez Barbey.
3
Or Barbey a fait école et une partie non négligeable de la réaction politique procède de son œuvre dont elle se réclame de manière explicite. Si comme lui elle lit Joseph de
40
Maistre, elle avoue parfois s'y ennuyer et se garde bien de vouloir le réécrire ; c'est l'œuvre aurevillienne, singulièrement l'œuvre romanesque, qui éclaire sa route. De ces réactionnaires, plusieurs pourraient retenir l'attention : Villiers de L'Isle-Adam, qui, dans des Professions de foi retrouvées se pose en « Héritier du passé » 2 et proclame dans L'Amour suprême « Le Droit du passé »3, Joséphin Péladan, dont toute l'œuvre affirme un même credo antidémocratique et aristocratique, ou encore Léon Bloy, les deux derniers « lancés » par une préface du maître et revendiquant haut et fort, leur carrière durant, cette filiation. Dans l'œuvre de Bloy, la plus proche sans doute des positions aurevilliennes, je retiendrai deux textes relativement méconnus, par lesquels Bloy prend position dans le camp réactionnaire tout en se prononçant sur l'impossibilité d'une restauration des Bourbons : La Chevalière de la mort, essai de 1877, publié pour la première fois en 1891, sa première tentative littéraire si l'on en croit la préface qui précède l'édition définitive4, et Le Fils de Louis XVI, essai commencé en 1898 et achevé en 1900 5. Les deux textes appartiennent avec Byzance et Constantinople et L'âme de Napoléon à la série des œuvres que l'on dit « historiques ». Bloy y trouve l'occasion d'exprimer à la fois son dégoût pour la démocratie, largement divulgué par tous ses autres textes, du Journal à l'étonnant Léon Bloy devant les cochons et la nature de la réaction qu'il appelle de ses vœux. 4
Dans cette œuvre, je chercherai une définition de cette réaction que j'appelle rapidement « littéraire », pour l'opposer d'un mot aux œuvres théoriques ou spéculatives des Maistre et Bonald. En renonçant, explicitement le plus souvent, à donner leur « traité du prince », les réactionnaires entendent se libérer pleinement des exigences de l'histoire et de la science contemporaines. A une réaction qui se croit un avenir et veut mobiliser pour l'assurer les ressources de la modernité, se juxtapose, pour finalement l'emporter, une réaction qui se dit sans avenir et s'inscrit dans la ligne des « Prophètes du passé » que désignait Barbey. La profusion et la luxuriance des images qui désignent, au premier regard, un fonds commun réactionnaire semblent n'avoir d'égales que la pauvreté argumentative. Faut-il pourtant s'en tenir à cette imagerie, si belle soit-elle, et limiter ces formes politiques de la réaction à la constitution d'une série de vignettes, de chromos plus ou moins attendus, « éternel cliché de la niaiserie sentimentale, [...] Famille royale au Temple [...], dans ce goût marécageux de pleurnichage faux et exécrable dont l'imagerie dévote paraît avoir le secret »6 ? Il me semble qu'on peut encore les créditer de l'existence d'une rhétorique ou d'une poétique spécifiques, qui détourne de l'expression politique les topoi de l'épopée pour les remplacer par un travail lyrique.
Les hors-pouvoir et la représentation du pouvoir 5
Après même la Révolution, un espoir ténu pouvait persister pour ceux qui se définirent bientôt comme réactionnaires. Certes la dynastie des Bourbons semble avoir été éradiquée en la personne de Louis XVI – encore que demeure l'incertitude savamment ménagée sur le sort du Dauphin, qui engendrera bientôt la thèse de la Survivance. Mais nombreux sont ceux qui pourraient écrire, comme Barbey à Trebutien : « Nous avons toujours été plus monarchiques que royalistes et plus royalistes que bourbonistes. [...] Une quatrième Dynastie ne nous a donc jamais fait trembler. »7 II n'en reste pas moins qu'au fil du temps et des « épopées » plus ou moins audacieuses, celles de la duchesse de Berry, qui nourrit une imagerie équivoque comme celle du misérable Naundorff, fils de Louis XVI, –sans parler de la geste napoléonienne, suivie avec intérêt – les chances de revoir un roi sur le trône s'amenuisent. Elles disparaissent bientôt dans la débâcle du
41
drapeau blanc et du refus de Henri V. Le pouvoir, désormais, n'a plus de « nom propre » 8 ; la « souveraineté de l'ignoble »9 s'est imposée. 6
Les réactionnaires apparaissent alors comme des exilés du pouvoir. La puissance politique leur a échappé, mais ils sont tout aussi étrangers aux nouveaux pouvoirs qui se constituent et pourraient offrir une compensation. Parmi eux, singulièrement, le pouvoir de la presse. Le cheminement de Barbey, tel que le dessinent ses Memoranda, est significatif : après avoir rêvé de politique, il s'intéresse à la presse pour la puissance qu'elle confère ; la littérature n'est qu'un troisième choix. Pourtant l'expérience s'avère décevante et Barbey, si connu soit-il, n'en a pas moins des difficultés à se maintenir au sein d'un journal, ne parvient pas à faire carrière. On sait ce qu'il en fut de Bloy, victime toute désignée d'une « conspiration du silence ». Exilés du pouvoir et de cette compensation qu'offrirait la presse, ils le sont aussi du pouvoir littéraire, de l'institution 10 . Hôtes d'un autre monde, strictement parlant. Comme Barbey est mérovingien11, de même Bloy, qui avec Marchenoir « avait cette impression d'être beaucoup plus le contemporain des Croisades ou de l'Exode que de la racaille démocratique »12. Inutile pourtant de chercher chez l'un ou l'autre une représentation détaillée de la société mérovingienne ou du temps des croisades qui fonde la référence. Ces règnes n'ont guère d'autre réalité que de n'être plus. N'importe où, hors du monde.
L'impossible traité du Prince 7
Dans ce contexte, nul ne prétendrait avoir encore la vanité de tenter un Traité du Prince. Si Barbey critique à l'occasion Machiavel et plus encore les naïfs qui se mêlent de l'interpréter, s'il trouve chez Joseph de Maistre ou Bonald des systèmes à admirer, la réaction aurevillienne s'en distingue par une méfiance sensible face à l'élaboration d'un système, le privilège accordé à « la flèche qui vole. [...] Elle vibre, elle traverse, elle va frapper. »13. Aussi le raisonnement tourne-t-il très vite court, et ce n'est pas sans raison que la critique retient le plus souvent des extraits des Pensées détachées pour authentifier les prises de position politiques aurevilliennes. C'est bien en effet sous cette forme que se présente dans son œuvre la politique. Pensées détachées, à moins pourtant que la fiction ne vienne leur offrir un écrin dans lequel elles se développent. Alors l'argumentation peut s'imposer comme dans les premières pages de L'Ensorcelée, credo politique d'un Barbey qui se proclame catholique, réactionnaire et régionaliste, au nom de la Poésie. Il faudra se garder d'oublier cette détermination.
8
Bloy ne développe pas davantage de réflexion explicite sur le pouvoir et semble même se situer tout à fait en dehors de la problématique politique. Certes, La Chevalière de la mort, par exemple, repose sur les théories maistriennes de la réversibilité et de l'expiation, que Bloy explique et illustre dans la vie et la mort de Marie-Antoinette, « Reine émissaire de tous les péchés de la race de Saint-Louis »14 et dans l'errance de Naundorff, le fils « certain »15 de Louis XVI, « désigné pour l'expiation de tant de crimes anciens dont il était innocent »16. Mais il ne reprend nulle part la lettre des théories de Maistre, qu'il ne cite jamais précisément, et s'il les illustre, il ne prétend pas proposer à son tour de traité de philosophie politique. Impuissante à conquérir le pouvoir, la réaction bloyenne s'est aussi détournée, en toute conscience, d'un certain nombre de formes traditionnelles de sa représentation. Mieux encore, elle l'abandonne dans une large mesure. Exilé social plus encore que Barbey, Bloy se pose de fait contre tous les pouvoirs. Son hostilité à la démocratie et à la République n'est pas à tout prendre plus violente que le mépris que lui
42
impose la dynastie des Bourbons, dont il dénonce page après page les crimes, pour conclure au soulagement de la voir enfin dépouillée de ses prérogatives. Fondamentalement assez proche de celle de Barbey, qui n'a de cesse de souligner l'ingratitude des Bourbons17, cette position le place en marge dans la réaction même. Bloy, d'ailleurs, ne s'y trompe pas et la conclusion de La Chevalière de la mort est assez provocante en ce sens : « Ce qui est tout de même confondant, c'est l'impossibilité absolue de rencontrer dans le compartiment catholique, Naundorffiste ou Philippiste, un seul être capable de respecter assez son Dieu pour lui supposer le pouvoir d'agir à sa volonté, d'en finir avec une Race qui paraît avoir indigné la terre et les cieux, de se passer, une bonne fois, des traditions qui tombent sous le laminoir de l'entendement humain et de créer des choses NOUVELLES, s'il lui plaît ainsi. » 18 Dénonçant d'un même mouvement la république et la monarchie bourgeoise qu'il date de Louis XIV, Bloy se situe en opposant systématique plus qu'en réactionnaire à proprement parler, ce qui, ajouté à l'absence de complaisance du portrait du prétendant dans Le Fils de Louis XVI, suffit à expliquer que le texte ait pu déplaire à ses commenditaires naundorffistes. 9
Mais c'est pourtant dans la réaction et comme réactionnaire qu'il fonde sa parole politique. C'est donc comme le symptôme particulier d'une réaction si complète qu'elle récuse tout pouvoir en place qu'il convient de lire son texte. On remarquera de fait que, comme Barbey encore, poète des aristocraties mortes et des soleils couchants, Bloy s'intéresse à la conquête du pouvoir ou à sa perte, beaucoup plus qu'à son exercice. Chez Barbey comme chez Bloy, le pouvoir se ne dit jamais au présent. Il se comprend nécessairement au passé, éventuellement au futur. Cela suffit à expliquer l'absence d'une philosophie du pouvoir, en tout état de cause inutile, puisque l'exercice en est toujours dégradé et vraisemblablement dégradant. Mais Bloy refuse de la même manière les formes conventionnelles d'écriture de la conquête ou de la perte de pouvoir que sont l'épopée, parole accordée au vainqueur, chant de la victoire et l'histoire. La réaction a cessé de vouloir convaincre, et se contente de prétendre toucher. Elle se situe par pétition de principe en dehors du champ de la raison.
La crise du sentiment épique 10
Ce n'est pas que l'épopée ne tente pas la plume. Barbey d'Aurevilly a bien écrit une forme d'épopée chouanne, dont on a remarqué pourtant combien elle se détournait souvent de son objet. On sait aussi que la vaste série prévue sous le titre d'« Ouest » s'est réduite à deux titres. Page après page, dans Le Chevalier des Touches, mais aussi dans L'Ensorcelée, parfois dans Une Vieille Maîtresse, le lecteur sent la tentation épique. Elle peut investir le texte, mais toujours de manière dégradée ou éphémère, dans le combat des blattiers du Chevalier, dans la représentation de Jéhoël de la Croix-Jugan. Si Barbey appelle pour chanter la geste des chouans un nouvel « Homère »19, il n'en reconnaît pas moins que l'époque le repousse.
11
Bloy se garde de même d'un genre qui ne convient pas aux rois bourgeois qu'ont été Louis XIV, « homme médiocre » ou Louis XVI, et qui s'avère plus incongru encore pour parler de Louis XVII « qui a des aspects de petit bourgeois qui me paralysent le cœur [...]. Le nom de Bourbon seul ne pourrait donc pas être, pour un catholique et un vieux français de mon bord [...] une occasion d'enthousiasme »20. La geste du « roi martyr » non plus que l'équipée de Naundorff ne trouvent grâce à ses yeux, toutes deux marquées du sceau du « ridicule »21. Or qui, mieux que le ridicule, tue les rois et l'épopée qui les chante ?
43
« Quelque bizarre et paradoxal que cela puisse paraître, il est bien certain que le trait caractéristique des Bourbons, c'est le manque le plus complet d'héroïsme. Quand on en aura fini avec les clichés d'oraison funèbre qui faussent l'histoire depuis deux cents ans, il y a lieu de croire que la majesté triomphale de Louis XIV, par exemple, sera pour tout le monde ce qu'elle fut en réalité, un décor. »22 Encore l'épopée était-elle de fait un genre vieilli, dont on peut admettre que l'écriture se détache. Mais la réaction aurevillienne, si elle repousse cette écriture peut-être désuète de l'histoire, ne le fait pas, tant s'en faut, au profit de la forme moderne qu'est la documentation historique.
Le refus de l'histoire 12
La représentation du pouvoir, depuis la Révolution, est solidaire de l'histoire et la réaction a bien compris cette mutation. Mais si elle connaît le poids de l'histoire, elle se refuse pourtant à l'écrire. C'est aussi que l'histoire méconnaît ses héros, « ces individualités exceptionnelles qui peuvent ne pas trouver leur cadre dans l'histoire écrite, mais qui le retrouvent dans l'histoire qui ne s'écrit pas »23. Bloy ne manifeste guère de complaisance pour le genre. Malgré le caractère explicitement historique de son propos, il n'en récuse pas moins les formes attendues de l'histoire. Ici ou là, pourtant, se glissent quelques documents : les lettres de Marie-Antoinette à Madame de Polignac ou encore à l'Empereur. Mais à côté de cela, le texte prend des libertés certaines avec l'histoire. Les dates sont rares, la chronologie quasiment oubliée ; l'évocation de la naissance du Fils de Louis XVI n'intervient ainsi qu'au chapitre VI de l'essai, après l'évocation de son errance et la mise en évidence de son destin. Point non plus de rappel systématique des faits. Bloy qui ne dit rien de la détention de Marie-Antoinette, élude de même le récit de sa mort : « tout le monde connaît ses derniers moments. Il serait puéril de les raconter »24 L'écrivain s'en dispense donc et renvoie au travail des historiens qui l'ont précédé, les Goncourt, Otto Friedrichs et Henri Provins25. Mais il cite sur le même plan un conte de Villiers de l'Isle-Adam, « Le Droit du passé », retenu au titre de preuve de l'existence authentique d'un fils de Louis XVI26. Le texte se refuse ainsi sciemment à distinguer entre fiction historique – même très documentée – et histoire de type scientifique. C'est une forme de déni de la pratique historique contemporaine, désignée comme fille de la Révolution, qui est en cause. Bloy se prononce contre « le chiendent de l'histoire exclusivement documentaire [...], les idolâtres du document [...], cette sciure d'histoire apportée, chaque jour, par les médiocres ébénistes de l'École des Chartes, au panier de la guillotine historique où sont décapités les grands concepts de la Tradition »27. Le document tient à la guillotine ; cela suffit à le condamner : l'histoire est ainsi volontairement repoussée. Il n'est que de regarder pour s'en convaincre les titres des chapitres de La Chevalière par exemple : Dies irae, Les Bucoliques de Moloch, Le Rien des Lys, La lionne au peuple !, Un dernier spectre, Dies natalis, Le fumier des lys, Le Prince noir.
Un discours apocalyptique 13
Méprisant la théorie, déniant les droits de l'épopée, se refusant à céder à la pratique documentaire, Barbey et Bloy plus encore se condamnent à marginaliser leur politique. A l'exil social fait écho une écriture que son étrangeté voue à le redoubler. Seuls quelques rares passages ressortissent du genre argumentatif et s'attachent à prouver quelque
44
chose ou à défendre une idée à l'aide d'un raisonnement. Avouons que cette singularité contribue à les rendre remarquables. La Chevalière de la mort offre l'un des exemples les plus réussis de cette pratique dans le très beau plaidoyer pour Marie-Antoinette. Se substituant aux défenseurs absents, « tout à coup un spectre se lève et dit »28. La défense s'organise en deux temps, le premier dominé par l'ironie et l'antiphrase amère, reprenant les clichés de la Révolution et de la République pour les vider de leur substance et en montrer le revers, riant par exemple de cette fraternité qui ne connut « ni la bestiale horreur du sang versé, ni l'attendrissement criminel d'une servile pitié, et dont nulle lamentation d'aristocrate ne fut capable d'arrêter le bras vengeur », tandis que le second mouvement opère un retour plein de respect vers la Reine condamnée : « Madame et ma Souveraine, lorsque j'ai sollicité l'honneur de défendre Votre Majesté, il n'entra pas dans ma pensée qu'une parole humaine, si grande qu'elle fût, aurait le pouvoir de sauver une Reine condamnée d'avance »29. Une parole vaine, tel le discours sur le pouvoir. 14
Car les Bourbons ne sont pas seuls condamnés. Leur chute entraîne la France. Si la représentation du pouvoir est inutile ou impossible, la plaidoirie en faveur des vaincus n'est pas moins vaine. C'est dans cette période, nourrie de ces expériences, que s'affirme une écriture de la réaction immédiatement et explicitement apocalyptique. « FINIS GALLIAE ! C'en était fait pour toujours de la grandeur française : le Gesta Dei per Francos s'effaçait par cette mort »30, proclame Péladan dans un roman de 95 intitulé précisément Le dernier Bourbon, tandis que Bloy martèle sans relâche : « Maintenant, le siècle va finir. Tout présage qu'il finira dans une apothéose de massacres et d'incendies. C'est à peine s'il aura le temps de pousser un cri et de tomber mort. Lorsqu'il ne sera plus et que les Nouveaux Temps auront commencé, – quels Temps ? ô Seigneur ! – à qui pourrait-on parler encore de cet effrayant malheureux ? »31. Les deux essais sont l'un comme l'autre marqués par cette forme d'expression, destinée moins à convaincre qu'à toucher, moins à persuader qu'à susciter l'effroi et le retour sur soi. « La France n'a jamais été si près de mourir »32. Plutôt que de tenter une réflexion sur la contemporanéité ou une analyse des circonstances politiques, le texte mobilise un réseau d'images, ressassées jusqu'à l'obsession et destinées à entretenir le climat d'angoisse qu'elles révèlent. Dans cette réitération, il n'est pas rare qu'il perde son objet, au point de développer une puissance hallucinatoire, à la limite parfois de la folie historique ou mystique. L'image envahit le texte, se développe pour elle-même et gouverne la progression de l'essai. « Qu'on se représente »33, tel est le mot d'ordre de l'écriture réactionnaire, particulièrement chez Barbey d'Aurevilly et Bloy. Il s'agit bien en effet de « représenter » un pouvoir, plus souvent un fantôme de pouvoir.
Une imagerie convenue. Le travail du lieu commun 15
Les deux essais de Bloy mobilisent à cet effet une imagerie monarchique et catholique, parfois convenue, qui sert à désigner au premier regard le texte réactionnaire. Il faudrait faire un jour le répertoire de ces images et montrer comment les abstractions philosophiques ou les vérités historiques se laissent illustrer. L'imagerie fonctionne d'abord comme un signe de reconnaissance. À ce titre, elle apparaît comme une forme de résistance à la marginalisation programmée du discours réactionnaire et doit rester relativement simple. Pour cette raison aussi elle tient nécessairement, en quelque façon, au lieu commun. Cette propension peut être regardée comme l'un des écueils majeurs que rencontrerait l'écriture et Bloy ne se fait pas faute de rappeler l'horreur de l'imagerie
45
« sulpicienne », dévote de la monarchie : « L'éternel cliché de la niaiserie sentimentale [...] ce goût marécageux de pleurnichage faux et exécrable dont l'imagerie dévote paraît avoir le secret ». La remarque vaut pour les vignettes naïves qui diffusent le regret des Bourbon, mais elle concerne aussi bien l'imagerie convenue et bien-pensante d'une « toute-petite littérature de fœtus avorté sur lequel une sage-femme éperdue se serait assise »34. Si le sens littéral laisse rêveur, l'image n'en est pas moins parlante et marque bien les prestiges de la métaphore. 16
Nécessairement empruntée à l'imagerie monarchique et catholique, si elle veut remplir son rôle de désignation, l'image doit pourtant s'écarter dans le même temps de la banalité du chromo, sous peine de trahir l'art. Aussi est-elle souvent outrée par-delà les limites de la vraisemblance et montée en séries métaphoriques presque hallucinatoires. La série de la guillotine, dans La Chevalière de la mort, illustre bien cette démarche. La guillotine tient dans le discours réactionnaire une place de choix et toute une imagerie dévote et antirépublicaine s'est composée autour de la fuite à Varennes, la décapitation du roi, la détention au Temple... Signalée dès Chateaubriand comme une rupture ontologique, la guillotine habite le texte aurevillien jusqu'à Une Page d'histoire, ultime variation sur le motif, qui offre en une vision bien maistrienne la représentation d'une aristocratie condamnée par ses crimes et expiant sous le couperet. C'était en 1603. Mais c'est sans doute Bloy qui travaille le plus l'image pour montrer, en une vision exorbitée, le siècle condamné par ce « maillet sanglant des mutilations révolutionnaires »35, cet « ignoble couperet »36, réincarnation d'un mythique « Moloch »37, élevé à l'état de « signe »38, de « labarum »39. Avant même la guillotine, la monarchie est tachée de sang par la faute de Louis XVI qui signa, « d'une plume tremblante, l'épée de saint Louis pendue à son flanc, la Constitution civile du clergé. [...] Il s'en est repenti, assure-t-on. C'est Dieu qui le sait. Mais les victimes sans nombre qu'il n'essaya même pas de défendre ; mais les têtes coupées qui roulèrent en avalanche du pied de son trône dans les abîmes ; mais les bouches mortes des prêtres, des petits enfants, des femmes, de tous ceux qui pouvaient crier utilement vers Dieu »40. Le sang de Louis XVI, celui de Marie-Antoinette, grossissent en « ruisseaux [...] qui s'échapperaient de tout le corps d'un vaillant homme accablé qui se serait laissé hacher en pièces jusqu'à la mort »41, creusent l'histoire du siècle « à son centre, ainsi qu'un ravin »42. Le motif de la tête coupée est prétexte à variations surréalistes. MarieAntoinette « a fait comme saint Denys. Elle a ramassé sa tête coupée et elle s'est mise à marcher et à régner toute seule, sa tête à la main. »43. Encore cette promenade funèbre est-elle métaphorique, promenade de spectres, qui n'est pas sans rappeler, en plus tragique encore, car la Reine est seule, telle Page d'histoire à laquelle se consacrait Barbey : « Les spectres qui m'avaient fait venir, je les ai retrouvés partout dans ce château, entrelacés après leur mort comme ils l'étaient pendant leur vie. Je les ai retrouvés, errant tous deux sous ces lambris [...]. Je les ai retrouvés dans le boudoir de la tour octogone [...] »44. Mais que dire de celle-ci ? « Charles-Louis de Bourbon, duc de Normandie, dernier rejeton de trente-deux rois de France et de vingt-trois rois de Navarre, porta toute sa vie, à travers l'Europe homicide, la tête coupée de son père, comme l'Apôtre des Gaules avait porté son propre chef »45. La représentation du pouvoir français – car il jouit bien, cet exilé, d'un authentique pouvoir – ? Un « roi fantôme »46 portant une tête de mort.
46
L'élaboration d'une rhétorique 17
Le sens du travail de la métaphore et de la primauté accordée à l'expression imagée est clairement désigné à l'occasion du plaidoyer pour Marie-Antoinette. Il est à la fois politique et rhétorique, les deux intimement liés : « Rien n'était possible. Le sublime est sans force sur la meute révolutionnaire, il n'a pas le ragoût du sang [...]. Je me trompe. Quelque chose était possible encore. Un homme pour qui la vie n'eût été rien, qui eût eu le sentiment profond de la fantasmagorie républicaine et l'horreur glacée de la rhétorique du temps [...] ; celui-là eût pu, non pas sauver la tête dévouée de la Reine, mais au moins venger sur place la conscience humaine et casser les reins au pédantisme sanguinaire de la Révolution. »47 Sublime, rhétorique du temps, pédantisme : c'est un traité du style qui s'ébauche ici, dans la critique du style révolutionnaire. Un peu plus tôt la Déclaration des Droits de l'Homme était créditée du statut de monstrueuse somme de clichés : « Une rhétorique telle qu'on n'en avait encore jamais vu chez aucun peuple, apparut en ces temps, comme un météore prodigieux, annonciateur désorbité de la débâcle universelle. / Pour concourir à l'enfantement de cette rhétorique féconde en stupéfactions, toutes les rhétoriques connues de tous les âges avaient apporté leur pollen le plus efficace à travers la nuit du passé, malgré les tempêtes et les ouragans d'un ridicule exterminateur. / Le feu des bûchers de l'Inquisition, les ténèbres du Moyen Âge, le poison des Borgia, le couteau de la Saint-Barthélémy, le glaive d'Harmodius et d'Aristogiton, la chute des Trente Tyrans et la draperie stoïque des deux Brutus, l'hiératisme franc-maçonnique de Weishaupt et le vicariat savoyard de l'évangéliste JeanJacques, la fédération des peuples par-dessus les océans étonnés et l'apostolat transatlantique des générations trois fois saintes ! etc. Le génie déclamatoire de toutes les races sublunaires concourut à l'agrégat surhumain de cette rhétorique miraculeuse qui inscrivit dans l'Histoire la déclaration des Droits de l'Homme. »48
18
Il ne faudrait pas croire le propos isolé. La rhétorique révolutionnaire est sans relâche poursuivie. Car ce monstre enfanté par la Révolution désigne une politique. Lorsque Bloy s'interroge sur le prodige le plus inouï de l'histoire de Naundorff, l'absence de soutien des souverains étrangers au fils de Louis XVI, sa plume trouve tout naturellement une rhétorique du lieu commun. Seuls en effet ces lieux communs, issus du même tonneau que la Déclaration, peuvent rendre compte de la monstruosité politique que présente le spectacle de monarchies, toutes liées plus ou moins étroitement à la famille royale française, faisant volontairement le jeu de la République : « Pourquoi le petit roi n'irait-il pas tout bonnement chez le pétulant François, neveu de maman, personnage qualifié de roi de Bohême et de Hongrie et vulgairement dénommé empereur d'Allemagne ? [...] Seulement, ah ! seulement, où il y a de la gêne il n'y a pas de plaisir ; tous les chemins mènent à Rome ; Paris n'a pas été bâti en un jour ; les grandes douleurs sont muettes et il n'y a pas de fumée sans feu. Mais il y a le "sourire mystérieux de la Joconde" » 49. Si le texte se déploie ici dans le sens d'une « exégèse des lieux communs », ce détour invite clairement à regarder le recueil portant ce titre comme un type particulier de texte politique. La rhétorique est pour Bloy une manifestation politique parmi d'autres, l'une des plus considérables si l'on se place du point de vue de l'écrivain. Aussi la réaction peutelle se passer de toutes les argumentations, de toutes les théories sur lesquelles beaucoup voudraient à tort la fonder. Le privilège accordé à une expression qui s'oppose aux tendances fondamentales de la rhétorique révolutionnaire suffit à désigner l'œuvre de
47
réaction. C'est en ce sens que Bloy travaille : moins pour casser les reins à la Révolution, gageure bien impossible, que pour « casser les reins au pédantisme sanguinaire de la Révolution »50. Contre le pédantisme, la documentation, la science, dresser l'image, voire l'illustration. Faire œuvre de faux naïf et de poète.
L'écrit et l'image 19
L'illustration s'inscrit jusque dans la lettre du texte, ponctué de point d'exclamations, mais aussi de décrochages typographiques. Les italiques et les majuscules, les capitales, parfois les capitales en italique, rythment la page, que l'on regarde comme on pourrait regarder une image : « C'est l'inauguration d'une société et la fin d'un monde, dit-on. Moi, j'y découvre la Fin de la LOI SALIQUE et c'est ce que n'a pas vu la grandiose imbécillité révolutionnaire. »51 ou encore : « A quel que prix que ce fût, on ne voulait pas de ce prince, parce qu'il était le PRINCE DES LYS et toutes les canailles furent bonnes pour le supplanter. »52. Le dessin de la page, la disposition du texte invitent à des lectures transversales, rejoignent, par-delà l'inévitable linéarité du propos, un mot à un autre, une image à une autre, superposent à l'expression logique un autre texte, fait de la rencontre de toutes les italiques, de toutes les capitales, texte troué que tout désigne comme porteur du sens définitif de l'essai.
Une écriture poétique 20
La représentation du pouvoir s'efface ainsi derrière un travail que Bloy dit poétique. Barbey le suggérait déjà : là où l'historien échoue, le poète comprend ; seul qui plus est il détient le mot de la fin et fixe la Légende53. Seule la poésie subjugue. Bloy n'en pense pas moins et entend frapper l'imagination : « L'histoire de cette agonie de la Race Capétienne est à coup sûr le poème le plus inouï et le plus troublant que l'imagination puisse concevoir »54, tandis que l'errance de Louis XVII est « à faire chavirer l'imagination »55.
21
La typographie, comme la répétition et la variation, imposent un certain nombre d'images. À celle de la guillotine déjà citée, on peut ajouter celle des fleurs de lys, dont les épithètes suivent les variations de la fortune des Bourbons : « lys d'or »56 parmi des « fleurs de lys de boue »57, « fleur mystique »58 ou « fumier de fleurs » 59, « grande porphyrogénète fleurdelysée »60 ou encore « rien des Lys » 61, « fumier des lys »62. Le travail des couleurs compose l'œuvre en tableaux. Autour de la dégradation du « délicieux arc-en-ciel du matin »63 que fut Marie-Antoinette, s'imposent trois couleurs primaires, le blanc de la monarchie et de l'innocence, « albâtre » de la « pureté de Marie-Antoinette » 64 , le rouge équivoque, « pourpre tragique des enfants de roi »65 ou « main pleine de sang de la Révolution »66, le noir enfin de la mort et du deuil. L'écriture de l'histoire se fait petit poème en prose, « poésie du sang et des larmes »67.
Le nom 22
Cette poésie est aussi, intimement, travail sur le nom, – ne surtout pas dire le « Verbe » : on sait combien Bloy trouvait cette expression détestable et sacrilège. Mais le « nom » est au cœur de la composition des deux essais. Politiquement, il est fondamental. Au régime de la masse « ignoble » s'opposent les noms : les Capétiens, les Bourbon, Napoléon. Perdre
48
le pouvoir, c'est perdre son nom. Tel Louis XVII, dont la perte de patronyme constitue la marque la plus sûre de la déchéance : « c'est un pauvre [...], un pauvre même de son NOM, lequel faisait, autrefois, trembler la terre »68. Mais ne pas avoir de nom apparaît aussi bien comme l'indice d'un destin. « Quel que soit le nom propre du Pouvoir qui s'est élevé de l'abîme pour nous empêcher d'y tomber, il y a Dieu derrière ce Pouvoir. [...] Mais quand [...] cet homme s'appelle Napoléon [...], les légitimistes sont-ils dans le droit, dans la raison, dans la convenance, de s'opposer, de quelque manière que ce soit, au gouvernement de cet homme [...] ? »69, s'interrogeait Barbey d'Aurevilly au lendemain du coup d'état du 2 décembre. Napoléon, avant d'être nommé, apparaît dans un anonymat où s'inscrit le nom de Dieu. Bloy reprend cette topique et la prolonge. Napoléon a cela de particulier que « personne n'a jamais pu savoir son nom. Il faut qu'il soit bien caché, ce Nom redoutable !... »70. Dépouillé de son nom, mais aussi de sa naissance71, Napoléon peut devenir ce « Protecteur [...] anonyme, incompréhensiblement anonyme »72, en qui Dieu donne « son Image »73. L'anonymat, de Louis XVI comme de Napoléon, vaut fondamentalement comme trace, dans laquelle se donne l'Image divine, ce qui conforte, par analogie, le rôle des images dans le texte. Le pouvoir n'est en effet qu'un jeu d'images, dans lequel il convient de tenir pour l'envoyé de Dieu désigné comme « l'image de l'Image »74. La poétique bloyenne reproduit, à sa manière, ces imbrications et ces dédoublements de l'image, à travers lesquels se donne le sens. Mais l'anonymat recèle d'autres charmes. S'il permet de convoquer le nom de Dieu, d'appeler le Paraclet, et apparaît par là comme un élément central de l'écriture apocalyptique que j'évoquais plus haut, il suggère aussi, plus particulièrement, un autre Nom, dont le décryptage suffit à expliquer la charge lyrique de l'essai. 23
Dans l'anonyme – et dans l'image –, se glisse en effet le nom du Pauvre par excellence, du dépouillé par excellence qu'est Bloy à ses propres yeux. Cet innommable – un Louis XVII, un Napoléon – est aussi bien ainsi, sur un mode compensatoire à peine dissimulé, l'exclu Léon Bloy. De fait, celui-ci s'implique sans détour dans son texte, rapportant l'anecdote de sa rencontre avec le fils de Naundorff, lors d'un « pélerinage au sinistre café de Courbevoie »75 ou revenant brutalement à des circonstances de sa vie privée, qui viennent interrompre la critique du livre de Friedriechs : « Toutes les phrases, ici, seraient idiotes, et, d'ailleurs, j'ai divulgué suffisamment de mes catastrophes personnelles, au cours de mon effrayante vie littéraire. Mais comment ne pas rappeler cette circonstance ? Comment n'être pas obsédé encore, après quinze ans, du souvenir de cette lecture d'un livre si amer, entreprise dans un battement de cœur horrible, dans la plus infernale angoisse, et soudain, coupée en deux par les mâchoires contracturées du tétanos ?... » 76. Si la « poésie du sang et des larmes » a tant d'attrait pour Bloy, au point que seule il l'écrit, ce n'est que parce qu'il s'y projette et se reconnaît, en quelque façon, dans ces expériences. Il l'avoue à la fin du Fils de Louis XVI : « Pourquoi ai-je entrepris d'écrire sur le fils de Louis XVI ? [...] Tenez ! Voulez-vous savoir comment j'ai pu m'en tirer ? Écartant toute autre pensée que celle des souffrances de cet homme qu'il avait plu à Dieu de piler dans un mortier en expiation des crimes de sa Race, j'ai posé devant mon âme les petits cercueils de mes enfants morts de misère et j'ai songé à mon exil, – à moi – à mon abandon, à la haine diabolique dont les contemporains rétribuent, en ma personne, depuis tant d'années, le seul écrivain qui ose dire quelque chose... Alors je me suis trouvé au diapason. »77 En un saut prodigieux, le texte dépouille son sujet historique, pour plonger au plus intime de la vie d'un homme. « Voulez-vous, chère amie, que je vous dise un secret ? Eh bien, le fils de Louis XVI, c'est moi-même, c'est-à-dire que ce personnage
49
historique, mystérieux et si douloureux, je l'ai vu en moi, dans la grande glace noire qui est au fond de mon cœur »78. 24
L'épopée des princes de France n'a de sens que dans la parole lyrique du poète Bloy, abandonné de tous. La politique est loin, la représentation du pouvoir oubliée. D'ailleurs, seules les formes d'exil du pouvoir ont eu l'honneur de la représentation, sans doute parce que l'exilé suprême se reconnaît dans tous les exils. Aussi la réaction bloyenne n'attend-elle aucune restauration politique. Elle se place tout entière sous l'œil du Juge suprême, nécessairement anonyme, « l'AUTRE ? [...] QUELQU'UN [...] qu'il faut avoir peur de méconnaître, quand on LE rencontrera »79, dans l'attente d'une apocalypse, qui peut être aussi celle d'un « Orphée du ciel »80.
Conclusion 25
Si l'essai de Bloy, comme la plupart des textes politiques de Barbey d'Aurevilly, se place en dehors de toute spéculation philosophique ou de toute écriture strictement historique, si, en quelque manière, il semble trahir sa destination réactionnaire en se situant en dehors de toute représentation du pouvoir, il ne faut pas voir là faiblesse ou défaillance seules. Certes ces exilés sociaux peuvent avoir du mal à penser le pouvoir qui les exclut. Mais dans le privilège accordé par eux à l'image, on peut lire, me semble-t-il, l'effort de dresser contre les formes contemporaines de la rhétorique révolutionnaire, dont relèvent précisément l'histoire et la philosophie politiques, une écriture différente, qui en appelle au sentiment et à la réaction affective. Il s'agit moins de convaincre, que de « jeter hors de oi cette clameur ! »81 – et le pamphlet, que j'ai étudié ailleurs 82, en est aussi une expression –, que de dire, fondamentalement, une souffrance, un « exil », un « abandon », la « haine diabolique » dont on est poursuivi83, et d'appeler, pour les compenser, la venue d'un « Orphée du ciel ».
NOTES 1. « "Mais un jour ce livre sortira de ma tête avec effraction. Je veux condenser dans un ou deux volumes, mon cher Trebutien, sous un titre quelconque, peut-être Le
XIXe
siècle, mes opinions sur
toutes les choses de mon temps, depuis la science et les idées générales jusqu'aux derniers détails de l'histoire, et faire de ces opinions un jugement suprême de la vigueur de mon cerveau et qui devra en prouver la force." Cet ouvrage, malheureusement, il ne l'a pas écrit. » (P. J. Yarrow, La Pensée politique et religieuse de Barbey d'Aurevilly, Droz-Minard, 1961, p. 7-8). 2. Villiers de L Isle-Adam, Professions de foi, in Œuvres complètes, II, édition établie par Alan Raitt et Pierre-Georges Castex, avec la collaboration de Jean-Marie Bellefroid, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1986, p. 984. 3. Ibid., t. II, p. 79-85. 4. La Chevalière de la mort, Paris, Savine, 1891. Le texte sera cité dans l'édition Joseph Bollery, Œuvres de Léon Bloy, Mercure de France, t. V, 1966.
50
5. Le Fils de Louis XVI, cité dans l'édition Joseph Bollery, Œuvres de Léon Bloy, Mercure de France, t. V, 1966. 6. La Chevalièrè de la mort, p.27. 7. Lettres à Trebutien, Genève, Slatkine, 1979, t. II, p. 253-254. 8. Barbey d'Aurevilly, « Du Devoir des Légitimistes », Le Public, 14 avril 1852. 9. Barbey d'Auyrevilly, Premier Memorandum, Œuvres romanesques complètes, t. II, textes présentés, établis et annotés par Jacques Petit, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1966, p. 753. 10. Peut-être est-ce d'ailleurs la raison pour laquelle Huysmans, proche pourtant de Bloy ou de Villiers et qui participa avec eux à l'aventure naundorffiste, n'entre pas dans ce corpus. L'institution l'a tôt reconnu. 11. Troisième Mémorandum, op. cit., p.1067 : « Sous des voûtes romanes, je deviens Mérovingien ; j'appartiens au temps que mon imagination hante le plus dans l'histoire. » 12. Le Désespéré, texte présenté par Hubert Juin, 10/18 « Fins de siècles « , 1983, p. 168. 13. Pensées détachées, in Œuvres romanesques complètes, t. II, p. 1229. 14. La Chevalière de la mort, p.48. 15. Ibid., p.68. 16. Le Fils de Louis XVI, p. 87. 17. Le Chevalier des Touches, in Œuvres romanesques complètes, t. I, par exemple p. 760. 18. La Chevalière de la mort, p.72. 19. L'Ensorcelée, in Œuvres romanesques complètes, t.1, p. 735. 20. Le Fils de Louis XVI, p.154-155 21. Ibid., p.88 : « Le Roi-Martyr ! Il faudrait un ange pour dire ce que ce lieu commun a coûté. Après la guillotine, il n'y avait plus d'autre expédient pour renouveler indéfiniment le régicide. Les têtes de roi peuvent repousser sous le couperet, elles ne repoussent pas sous le ridicule « et p. 106 : « Eh ! bien, essayez de prononcer seulement ces mots : Charles XI, fils de Louis XVII, roi de France, essayez un peu et dites si le sentiment du RIDICULE ne vous étrangle pas, à la quatrième syllabe. » 22. Ibid., p.155. 23. L'Ensorcelée, op. cit., p.735. 24. La Chevalière de la mort, p.66. 25. Ibid., p.26-27 : « Je n'ai certes pas le dessein de raconter une fois de plus cette histoire mélancolique [...]. Le livre de MM. de Goncourt me paraît incontestablement définitif ». On lit de même dans Le Fils de Louis XVI, p.109 : « On n'attend pas que j'écrive la Vie de Louis XVII. Ce n'est plus une besogne à faire. Historiquement, MM. Otto Friedriechs et Henri Provins n'ont rien laissé à personne. » 26. La Chevalière de la mort, p.68-69 : « Il existe réellement un homme qui est le petit-fils de Louis XVI d'une manière tellement probable que cela revient à l'authenticité absolue [...]. Voici, en peu de mots, ce qui s'est passé. On me permettra d'emprunter quelques lignes à mon très cher ami le comte Villiers de L'Isle-Adam ». 27. Le Désespéré, op. cit., p.163. 28. La Chevalière de la mort, p.56. 29. Ibid., p.62. 30. Le dernier Bourbon, p.236-237. 31. Le Fils de Louis XVI, p.86. 32. lbid., p.160. 33. La Chevalière de la mort, p.55 : « qu'on se représente cette vaste salle du Palais ». 34. Ibid., p.72. 35. Ibid. p.24. 36. lbid., loc. cit. 37. Ibid., p.26, 27, 28.
51
38. Ibid., p.24. 39. Ibid., loc. cit. 40. Le Fils de Louis XVI, p.87. 41. La Chevalière de la mort, p.25 42. Ibid., p.24. 43. Ibid., p.25. 44. Une Page d'histoire, op. cit., t. II, p. 374. 45. Le Fils de Louis XVI, p.88. 46. Ibid., p.85 et sq. 47. La Chevalière de la mort, p.55. 48. Ibid., p.32. 49. Le Fils de Louis XVI, p.119. 50. La Chevalière de la mort, p.55. 51. Ibid., p.25. 52. Le Fils de Louis XVI, p.89. 53. L'Ensorcelée, op. cit., p.735. 54. La Chevalière de la mort, p.69. 55. Le Fils de Louis XVI, p.90 56. La Chevalière de la mort, p.26, encore p. 47. 57. Ibid., loc. cit. 58. Ibid., p.26 59. Ibid., p.30. 60. Ibid., p.33. 61. Ibid., p.47 62. Ibid., p. 67. 63. Ibid., p.33. 64. Ibid., p. 24 et 26. 65. Ibid., p. 23. 66. Ibid., p.47. 67. Ibid., p.65. 68. Le Fils de Louis XVI, p.106. On lit de même p. 91 : « jusqu'à l'heure irrévélable où cet étranger fera palpiter le cœur des morts en criant son NOM. » 69. Barbey d'Aurevilly, « Du Devoir des Légitimistes », Le Public, 14 avril 1852. 70. Le Fils de Louis XVI, op. cit., p.101. 71. Ibid., loc. cit. : « on assure qu'il est né d'un accouplement humain dans une encognure de la Méditerranée. Je le veux bien, moi ». 72. Ibid., loc. cit. 73. Ibid., loc. cit. 74. Ibid., loc. cit. : « il me semble que Napoléon a été une ressemblance du Cœur impérial, que disje ? la plus claire et la plus unique image du Cœur infiniment fort de Notre Seigneur Jésus Christ. [...] aussi longtemps que cette image de l'Image y (en France) fut honorée, rien ne prévalut contre elle, pas même sa propre infamie » 75. La Chevalière de la mort, p.70. 76. Le Fils de Louis XVI, p.111. 77. Ibid., p.154-156. 78. Le Vieux de la Montagne, Journal, le 29 décembre 1909, édition Joseph Bollery, Mercure de France, 1963, t. III, p. 126. 79. Le Fils de Louis XVI, p.160 : « Et maintenant, quand donc viendra l'AUTRE ? [...] Je songe qu'il y a nécessairement QUELQ'UN de très-pauvre, de très-inconnu et de très-grand, qui souffre de la même manière, en ce moment, et qu'il faut avoir peur de méconnaître, quand on LE rencontrera. »
52
80. La Chevalière de la mort, p.80. 81. Le Fils de Louis XVI, p.155. 82. Marie-Françoise Melmoux-Montaubin, « Pamphlets masqués », communication au colloque international de Grenoble, « Pamphlet, Utopie, Manifeste », 26-29 novembre 1997. A paraître aux éditions de l'Harmattan, collection « Utopies ». 83. Ibid., p.155-156.
53
Les émotions du pouvoir Ramón Camats I Guardia
1
Le problème que posent les relations entre l’écrivain et l’imaginaire du pouvoir est aussi bien philosophique et psychologique que strictement littéraire. Le plus connu des écrivains-philosophes, Platon, s’était déjà intéressé à l’imaginaire du pouvoir par son traitement du mythe, dont le caractère politique est indiscutable. Ainsi du mythe d’Er, dans la République, où nous voyons, comme une Divina Comedia avant la lettre, l’image d’un jugement dernier décidant de la vie ou de la mort éternelle, des récompenses et des châtiments et, en outre, une description de l’enfer, du purgatoire et du paradis, aussi bien qu’une idée des degrés dans les châtiments corporels. Platon n’écrit pas pour amuser le public ; il fut, au contraire, le premier à reconnaître l’immense puissance, strictement politique, inhérente aux croyances ; et il nous apprend comment les croyances, encouragées par la littérature, peuvent être utilisées comme des menaces dans le monde et devenir d’excellents instruments de domination. Platon, en proposant son propre imaginaire du pouvoir, voulait écarter les citoyens grecs d’une façon d’agir, dans la politique et dans la vie privée, qui avait subi l’influence de l’ancienne littérature mythique d’Homère. Car il estimait qu’on méconnaissait l’empire insaisissable de la littérature sur les croyances et, surtout, sur les actions des hommes.
2
L’objet de cet article n’est donc pas le pouvoir en tant que tel et reposant sur ses propres forces, mais les fondements émotionnels du pouvoir, dont participe l’autorité. Car le pouvoir, s’il n’a d’autre soutien que la force, est peu puissant, puisqu’il est obligé de s’exercer sans délai et sans repos ; l’autorité, définie comme la capacité à se faire obéir sans avoir recours à la persuasion ou à la violence, permet que le pouvoir dure, elle est le vrai pouvoir du pouvoir. Ces émotions du pouvoir ne sont pas non plus les émotions qui font ambitionner le pouvoir ou les émotions qu’on éprouve quand on l’a. Mon propos, peut-être plus abstrait, naît d’une constatation et d’une surprise : en général, les écrivains politiques et les philosophes qui ont réfléchi sur le pouvoir, sur les façons de l’obtenir, de le conserver, de le perdre, n’ont pas essayé de l’analyser spéculativement, comme le veut la deuxième règle de la méthode cartésienne, car ils ont considéré que le « pouvoir » était un concept (et une réalité) ayant de solides bases et constituant une catégorie définitive. Bien sûr, on a déjà beaucoup écrit à propos des émotions du pouvoir. Machiavel, dans Le Prince, s’interroge sur les usages du pouvoir, s’il faut être aimé ou être haï. Mais les
54
émotions dont il parle sont très simples, extrêmes si l’on veut, mais totalement insuffisantes pour analyser les débuts de la soumission des enfants aux parents, puis des adultes aux pouvoirs sociaux (économiques, politiques, par exemple) et, en dernier lieu, les origines de la servitude volontaire et du consentement. 3
L’autorité est une émotion qui permet l’acceptation et l’existence même du pouvoir de certaines personnes sur d’autres et qui crée un lien affectif entre des êtres égaux de par leur condition humaine et inégaux de par les liens qui les unissent ; elle est donc, dans cette mesure, constitutive de la sociabilité. Cependant, il faut prêter attention aux formes perverses qu’elle peut prendre, car le pouvoir, les pouvoirs, l’utilisent souvent pour se légitimer, pour se perpétuer ou pour devenir absolus. D’où la nécessité de faire la distinction entre le pouvoir et l’autorité, entre le pouvoir et la hiérarchie et entre la hiérarchie et l’autorité, parce que le langage fait un amalgame de tous ces mots et parce que les mots ne reflètent pas toujours très bien les réalités auxquelles ils se réfèrent.
4
Comme je l’ai déjà dit, le lien de l’autorité est formé d’images de force et de faiblesse, et il s’établit sur un rapport émotionnel entre des êtres inégaux. Pascal l’avait exprimé dans ses Pensées : « Les cordes qui attachent donc le respect à tel et à tel en particulier, sont des cordes d’imagination. [...] Les cordes qui attachent le respect des uns sur des autres, en général, sont cordes de nécessité » [Pensées, 304]. Le lien de l’autorité est un amalgame des cordes de nécessité et d’imagination. Ainsi les enfants, par exemple, ont besoin de l’autorité ; celleci leur est nécessaire ; les enfants ont besoin de personnes qui les guident et qui leur procurent la sécurité ; sans cette aide, sans ce point de référence, leur développement est incomplet et fragmentaire. L’homme - enfant dans le domaine de la politique - a besoin aussi d’être guidé, il ressent l’envie d’expérimenter l’autorité. Néanmoins, il existe aussi une émotion opposée et d’une égale intensité : une crainte rationnelle de l’autorité qui naît de la menace que celle-ci représente pour les libertés de l’individu. *
5
Il paraît bien étonnant que la terminologie du discours politique n’ait pas clairement établi ce à quoi se réfèrent quelques mots clefs comme : autorité, pouvoir, puissance, force... Il faut donc, en suivant les traces d’Hannah Arendt1, préciser les usages qu’on en fera si l’on veut dire quelque chose de la face cachée et émotionnelle du pouvoir visible, fondation et, comme le dirait Kant, « condition de possibilité » de l’utilité des moyens que quelques hommes mettent en pratique pour exercer leur domination sur les autres.
6
Ce travail avait été commencé par les Romains, qui distinguait « potestas » et « auctoritas ». Le premier mot se référait au pouvoir, à la force, à la propriété ou à la capacité d’agir, et même on l’appelait « virtus », toujours dans le sens de « potentialité » (ce n’est pas pour rien que « potestas » dérive du verbe « potior » ; le verbe, en fait, signifie : « s’approprier », « être en possession de quelque chose », « être maître de quelque chose ou de quelqu’un »). Le deuxième mot « auctoritas », désignait le prestige ou l’autorité qui garantit, et faisait allusion au prestige et à l’influence. Cette distinction, très significative, traduit les différences entre le pur pouvoir et sa légitimité ou son autorité. Les romains savaient déjà que le pouvoir ne consiste pas en « savoir pouvoir », que le pouvoir est peu de chose sans l’autorité fondée sur la reconnaissance.
7
« Pouvoir » est un concept problématique, et néanmoins il s’agit d’une catégorie philosophique. Malgré son omniprésence dans toutes les dimensions de la vie quotidienne qui le dissimulent sous divers masques, les philosophes maintiennent qu’il y a une unité
55
qui transcende les formes empiriques par lesquelles il devient visible et sensible. Pouvoir, le pouvoir : le verbe substantivé désigne-t-il une entité substantielle ? S’agit-t-il d’un acte ou de la conséquence d’un acte ? Le mot « pouvoir » a au moins deux sens différents : « pouvoir de », dans le sens de capacité ou puissance, et « pouvoir sur », dans le sens de pouvoir sur quelqu’un, capacité de dominer. Le premier sens, « pouvoir de », mérite souvent d’autres noms : puissance, capacité de faire et il se réfère aux capacités qu’ont les personnes de faire quelque chose, il s’agit d’être capable de, d’être puissant. Dans le sens philosophique ce pouvoir de est attribuable à l’individu puissant, capable de réaliser ses potentialités humaines. La puissance est une force, mais enveloppée d’une essence personnelle qu’on ne peut transférer ni mesurer. Le deuxième sens, « pouvoir sur », est évident ; le mot qu’on utilise habituellement implique la dimension sociale ; il s’agit de la domination, de la capacité à rassembler les autres pour qu’ils réalisent une action. 8
La peur est le sentiment le plus primitif, le plus élémentaire, le plus animal du pouvoir. La peur est la conséquence de la force qu’on impose à un individu en lui montrant que l’obéissance est le seul moyen de survivre. Évidemment, la menace de violence est ici le levier de la soumission. Historiquement, la relation sociale qui a été construite presque intégralement sur la force est l’esclavage. Cette forme de domination, privée de reconnaissance, génère une émotion sans nuances, la haine ; et la haine qui naît de la crainte est une émotion élémentaire, limitée et aliénée, qui mobilise seulement une partie des énergies des individus. Lorsque le maître est seulement capable d’utiliser la force comme instrument du pouvoir, il devient lui-même esclave de ses esclaves, obligé de travailler pour faire travailler. C’est pour cela qu’il existe une autre forme de pouvoir : l’autorité.
9
L’autorité, contrairement à la force, a très peu de fondement ontologique. Il ne s’agit pas d’une substance tangible ni d’une énergie potentielle qui éventuellement peut se réaliser. En fait, seuls ses effets nous sont perceptibles. Pourtant, l’autorité est le vrai pouvoir du pouvoir. Elle est un lien de reconnaissance et celui-ci, bien plus proche des émotions que de la raison, permet au pouvoir de s’exercer sans résistance et de mobiliser la volonté et les énergies physiques et intellectuelles de ceux qui obéissent volontairement. Elle s’appuie uniquement sur la reconnaissance par les individus de l’existence d’une inégalité et de son acceptation.
10
Les liens de rejet sont des formes de rapport avec l’autorité qui mettent en évidence la nature dynamique du rapport émotionnel. On a vu que l’autorité était basée sur la reconnaissance et que s’y soumettre était un geste volontaire : la reconnaissance n’est pas celle d’un forcené, mais elle peut être, comme le disait Pascal, un lien de nécessité. Malgré tout, personne ne reconnaît franchement l’existence des liens émotionnels de nécessité, n’admet une servitude volontaire irrationnelle et difficile à justifier devant le tribunal de la raison. C’est pourquoi il existe des liens de rejet, liens sentimentaux même inconscients. Sentiments de rejet que personne ne veut -sans même le savoir- admettre consciemment. Pourtant, très paradoxalement, le rejet explicite de l’autorité, dans ces formes diverses, consiste souvent aussi en une acceptation de l’autorité : le rejet est une sorte de lien, qui permet d’une manière occulte de se soumettre aux autorités qu’on ne désire pas accepter franchement.
11
Les liens émotionnels de rejet sont la dépendance désobéissante, qui consiste à s’affranchir extérieurement de l’autorité mais à s’y soumettre intérieurement, avec un assujettissement psychologique. Le cas typique est celui de l’enfant qui désobéit à ses parents pour attirer leur attention. Une deuxième forme de rejet émotionnel est la
56
critique constante de l’autorité. Cette attitude critique s’appuie sur une image idéale qu’on a de l’autorité, qui permet de critiquer l’impuissance, l’inopérance, l’incapacité ou l’absence de crédibilité de ceux qui commandent ; en fait, celui qui vit ce lien particulier de rejet demande que l’autorité soit plus forte, plus impérieuse et authentique. Le troisième lien de rejet consiste dans la résistance passive face à l’autorité, résistance alimentée par la conviction que, si l’on résiste suffisamment, l’autorité disparaîtra. Souvent confondue avec l’entêtement récalcitrant, cette forme de rejet, dans le cas des enfants, se manifeste par une attitude de repli sur soi ou par une résistance limitée à la compréhension ou à l’obéissance. L’enfant paraît incapable de comprendre quoi que ce soit, il ne veut rien comprendre, ne rien faire, et parce qu’il croit que s’il résiste suffisamment, on le laissera en paix. * 12
C’est ainsi que les images religieuses ou morales, que les images émotionnelles et spirituelles provenant de la famille traditionnelle sont encore des éléments essentiels de notre culture et véhiculés par la littérature. Les pouvoirs réels, politiques, religieux et économiques tentent de revêtir la pourpre du paternalisme afin de représenter les attributs de l’autorité familiale et d’inspirer de semblables émotions. L’émotion de l’autorité s’acquiert tout au long de l’enfance, et nous permet d’obéir aux parents quand ils exercent l’autorité grâce à leur seule présence. Lorsqu’elle est remplacée par l’obéissance aux parents absents, l’autorité devient intérieure. Ce processus consiste en l’incorporation de l’autorité paternelle, et finit lorsque le prestige des parents est transféré à tous ceux qui se rappellent leur rôle ou qui ont un semblant de fonction : le maître, le chef, le dirigeant politique ou spirituel.
13
Ce phénomène de transfert, normal et universel, contient néanmoins divers dangers : le premier est intérieur et concerne le cœur de la personnalité ; il consiste en une hypertrophie de la sensibilité émotionnelle qui se concentre sur les rôles de domination et de soumission, et qui peut devenir une tumeur émotionnelle. Il s’agit de la personnalité autoritaire. Le deuxième danger est extérieur, les pouvoirs politiques et économiques peuvent tenter de revêtir métaphoriquement les attributs de l’autorité paternelle dans l’objectif d’obtenir une soumission semblable. L’unique protection contre les dégénérescences (dégénérescences, abâtardissements) de l’émotion de l’autorité consiste d’un côté en la reconnaissance du rôle que nous jouons dans leur dynamique, la reconnaissance de la propre complicité dans tout rapport de pouvoir, et la reconnaissance, en un mot, qu’à l’intérieur de chacun de nous cohabitent un maître et un esclave. Mais l’unique contre-pouvoir valable, qui ne peut pas être institutionnalisé dans la société ni dans les lois s’il veut exister et être efficace, consiste dans la maîtrise de nous-mêmes, de nos propres passions, émotions et besoins, qui nous appartient complètement et que manifeste, à sa manière particulière, la littérature.
57
NOTES 1. Cf. HANNAH ARENDT, Du mensonge à la violence, Agora-Pocket, Paris, 1972 ; p. 143 et suivantes.
58
Les pouvoirs de l'écrivain
59
Du détachement à la révolte : philosophie et politique dans l’Essai sur les règnes de Claude et de Néron Stéphane Lojkine
1
Description
2
L’Essai sur les règnes de Claude et de Néron1, l’une des dernières œuvres de Diderot, n’est pas non plus l’une des moins déconcertantes.
3
Au premier abord, on ne voit rien de très original à cette œuvre très inscrite dans la tradition de l’érudition humaniste2, avec ses deux parties, la première consacrée à la vie de Sénèque, d’après le récit des Annales de Tacite, complété par Suétone et par Dion Cassius, la seconde résumant successivement les œuvres du philosophe, des Lettres à Lucilius aux traités philosophiques, aux Consolations et aux Questions naturelles. Diderot prend pour trame de son Essai le travail éditorial de Juste Lipse, qui faisait précéder ses Senecae philosophi opera, à Anvers chez Plantin en 1605, d’une série de pièces liminaires constituant un véritable dossier-Sénèque articulé autour d’un De vita et scriptis L. A. Senecae.
4
Pourtant, rien n’est plus éloigné de la sérénité d’une érudition de cabinet que cet Essai polémique chargé d’exclamations et d’invectives, Essai engagé qui ne se veut pas Judicium super Seneca3, mais apologie convaincue et combattante. Car l’œuvre est d’abord motivée par les circonstances et s’inscrit dans le combat idéologique de la « coterie holbachique » des philosophes contre les tenants d’une certaine culture lettrée, réactionnaire, résolument hostile à l’engagement politique. C’est le baron d’Holbach qui avait engagé Lagrange à traduire en français les œuvres de Sénèque. A la mort de Lagrange, en 1775, Naigeon lui succède, achève la traduction et l’annote. L’Essai de Diderot est adressé « à Monsieur Naigeon » ; sa première version paraît en décembre 1778 et est présentée comme le septième et dernier tome des Œuvres de Sénèque traduites par Lagrange et éditées par Naigeon.
5
Mais ce premier Essai, quoique publié avec approbation et privilège du roi, suscite dans les journaux, massivement hostiles aux philosophes, une vive réaction. Diderot publie donc
60
une deuxième version de l’Essai, où il intègre les critiques de ses adversaires et y réplique. Le second essai paraît en 1782, avec une permission tacite, c’est-à-dire un statut intermédiaire entre l’édition officielle, avec privilège, et l’édition clandestine. Londres est mentionné comme lieu fictif de l’édition. 6
Le texte glisse vers la polémique et la subversion. Le titre change également : l’Essai sur la vie de Sénèque, sur ses écrits, et sur les règnes de Claude et de Néron devient l’Essai sur les règnes de Claude et de Néron et sur les mœurs et les écrits de Sénèque pour servir d’introduction à la lecture de ce philosophe.
7
À la vita héroïsante du philosophe persécuté, encore marquée par l’héritage néo-latin du genre des vies d’hommes illustres, succède un tableau des mœurs d’une époque (première partie de l’Essai), sur le fond duquel viennent se détacher les écrits du philosophe (deuxième partie).
8
Problématique
9
Nous voudrions montrer comment dans ce texte habité par les poétiques désuètes de la glose et de l’exemplarité se constitue de façon inattendue et inaugurale un imaginaire du pouvoir qui détourne la littérature de la représentation détachée, stoïcienne, du monde vers une communion sensible avec le monde, se définissant dans un même mouvement corporel et intellectuel par la convulsion et par la révolte4. Cet espace nouveau de la communion sensible, où le pouvoir ne se déploie plus comme représentation, mais comme imaginaire, met en question la position du philosophe face au politique et, par les transformations radicales qu’il engage, ouvre à la posture5 moderne de l’intellectuel engagé. Tel est l’enjeu majeur de l’Essai.
10
Comment cette transformation s’opère-t-elle ?
11
Le détournement que Diderot opère de la figure classique, détachée, du sage, qui constitue la base du stoïcisme, est assez subtil. En apparence, sous la forme clairement annoncée et constamment rappelée dans l’Essai d’une apologie de Sénèque, il s’agit de sauver, de défendre cette figure contre les critiques réactionnaires dont elle a fait l’objet dès l’antiquité (Quintilien, Suilius), chez les compilateurs médiévaux (Xiphilin), puis dans la littérature morale (La Rochefoucauld) et celle des libertins érudits (Saint-Evremond, La Mettrie). En réalité, Diderot détache progressivement Sénèque du support stoïcien qui, dans ses écrits, l’oriente vers le dédain du politique, pour théâtraliser la figure historique et politique décrite par Tacite de l’instituteur du Prince et du ministre du tyran. C’est par et dans cette théâtralisation que s’effectue le travail philosophique : L’Essai construit la légitimation théorique de l’engagement du philosophe dans la résistance contre le despote, légitimation non seulement absente des écrits de Sénèque, mais qui contredit violemment les fondements dogmatiques du stoïcisme, ce dont Diderot prend d’ailleurs acte explicitement et sans ambiguïté. Cette résistance politique est représentée dans un imaginaire abject des mœurs corrompues, et construite comme une posture de la révolte. Du détachement à l’abjection puis à la révolte, le glissement est insensible.
12
Ce glissement du détachement vers la révolte n’engage pas seulement le discours sur le politique. Il est global, et avant tout sémiologique : c’est l’écriture même de l’Essai qui glisse d’une sémiotique du détachement vers une sémiologie6 de la révolte. Cette révolte n’est pas d’emblée, a priori, l’engagement révolutionnaire ou pré-révolutionnaire du philosophe dans la transformation de la société. Elle est d’abord révolte intime, retournement sur soi et sur son écriture. C’est dans ce repli, dans cette convulsion, dans ce spasme libérateur que se constitue l’imaginaire du pouvoir, c’est-à-dire non plus sa
61
représentation (la littérature classique représente le pouvoir), mais sa corporisation abjecte, dans laquelle s’immisce et se retourne le travail de l’écriture.
I. Le sage, la doctrine, le texte : figures du détachement « Un instituteur qui est devenu ministre » : le rapport au monde 13
L’enjeu initial de l’Essai tourne autour de la question de la compromission de l’intellectuel avec le pouvoir. Le philosophe apparaît ici dans son opposition radicale avec le tyran ; il est le principe symbolique, il détient le discours de la vertu, il porte le jugement sur le monde ; le tyran est l’immanence immonde du monde ; la réalité abjecte de son pouvoir désigne la perversion radicale du principe symbolique figuré par le philosophe7.
14
Dans ce système antithétique, le philosophe peut-il être le ministre du tyran ? Faire l’apologie de Sénèque, c’est répondre positivement et, accessoirement, légitimer la position de Diderot auprès de Catherine II, de Voltaire chez Frédéric.
15
Pourtant, servir le tyran, c’est déjà quitter l’antithèse classique, c’est dialectiser la relation entre le principe symbolique et la réalité immonde du monde. Le philosophe se met à l’épreuve du réel et, par là, de la dimension symbolique du réel même : l’expérience du pouvoir libère un imaginaire travaillé par la torsion, la violence du jeu du monde et de l’immonde, c’est-à-dire de l’expérience des mœurs comme corruption des mœurs (c’est la cour de Néron8) et en même temps comme principe de la vertu (Sénèque a des mœurs). Quoi donc, après l’assassinat d’Agrippine, n’y avait-il plus de bien à faire pour un homme éclairé, ferme, juste, chargé d’un détail immense d’affaires, et capable par son autorité, ses lumières, son courage, sa bienfaisance, de porter des secours, d’accorder des grâces, de réparer des malheurs, d’arrêter ou de prévenir des vexations, d’empêcher des déprédations, d’éloigner des ineptes, d’élever aux places les hommes distingués par leurs connaissances et leurs vertus ? L’enceinte du palais ne circonscrivait pas le district du philosophe ; ce n’est point un précepteur qui a pris son élève au sortir des mains des femmes, et qu’on garde par reconnaissance ; c’est un instituteur qui est devenu ministre. (1, 74, 140.)
16
Le philosophe apparaît d’abord comme une puissance de modération : il tempère, limite les méfaits du tyran ; il s’interpose entre le maître et le monde. Les verbes arrêter, prévenir, empêcher, éloigner marquent bien cette fonction d’écran.
17
Mais très vite pour Diderot il s’agit de bien autre chose. Le philosophe devient lui-même puissance politique qui s’étend sur le monde et l’habite. A la figure classique du « précepteur », de l’« instituteur », succède celle du ministre sortant du champ clos : de l’« enceinte du palais », on passe au « district du philosophe », et ce district c’est le monde. Le Sénèque de Diderot n’est pas en représentation ; il est l’âme politique du monde.
18
De la figure détachée du sage stoïcien, au prix d’ailleurs de quelques entorses aux textes antiques, Diderot passe à la figure révoltée de l’homme engagé dans un face à face qui n’est pas tant celui traditionnel de deux hommes que celui, constitutif de notre modernité, de l’homme avec la barbarie. C’est le moment de la rupture, lorsque, après le meurtre d’Agrippine, la mort de Burrhus et l’incendie de Rome, Sénèque demande enfin à Néron qu’il lui permette de se retirer du pouvoir.
19
Ce début du §88 de l’Essai a été réécrit pour la seconde édition :
62
I. : Sénèque craignant que tant de forfaits, de crimes, de sacrilèges, ne lui fussent imputés, demande sa retraite. II. : Sénèque enfin, révolté de tant de crimes et de sacrilèges, demanda sa retraite. (1, 88, 161.) 20
La révolte ne vient que dans le dernier état du texte, lorsque la question de l’intégrité morale de l’intellectuel au contact du pouvoir est passée au second plan. Il ne s’agit plus tant de détacher la figure intacte du sage que de suivre le mouvement d’intériorisation de la réalité révoltante du monde vers la révolte du « moi », du spectacle de la barbarie vers le retournement d’entrailles qui précipite le philosophe dans le martyre9. Sénèque ne craint plus qu’on lui impute telle ou telle action ou compromission ; il réagit immédiatement au monde.
Le détachement stoïcien 21
La position stoïcienne, détachée, méfiante, distante vis-à-vis du politique, constitue donc, dans l’Essai, une position de départ qu’il s’agit de retourner. Ce détachement, d’ailleurs, n’est pas directement, immédiatement politique : il s’inscrit d’abord dans une morale tout entière tendue vers l’épiphanie d’un sujet forclos : L’ataraxie, l’apatheia, l’autonomie philosophique du sujet, le détachement absolu du sage vis-à-vis de la douleur, de la menace, de la séduction, constitue l’idéal de l’ascèse philosophique, idéal qui contraste violemment avec la participation aux affaires politiques, laquelle suppose de s’insérer dans un réseau de relations, d’offrir sans cesse la prise à la séduction du pouvoir, à la menace du prince, à la douleur de ses rétorsions. C’est donc l’autonomie morale du stoïcien qui conditionne sa méfiance vis-à-vis du politique.
22
Et pourtant cette méfiance ne déclenche pas, comme chez les épicuriens, une absolue condamnation. Il y a plus : Sénèque, l’une des figures les plus éminentes du stoïcisme romain, a joué un rôle majeur dans l’histoire de l’empire. C’est sur cette contradiction implicite que Diderot bâtit son Essai, car elle entre en résonance avec une des contradictions majeures de la philosophie des Lumières, dont le discours évite et dans le même temps vise sans cesse la question interdite du politique.
23
Certes, Diderot restreint légèrement la portée du détachement stoïcien dans le cas de Sénèque : « Des principes de la secte, il n’embrassa que ceux qui détachent de la vie, de la fortune, de la gloire, de tous ces biens au milieu desquels on peut être malheureux » (I, 13, 54)10. C’est encore sur le plan moral et non politique qu’il décrit le détachement de Sénèque à l’approche de sa condamnation : « La disgrâce confirmée trouva le philosophe détaché de toutes ces importantes frivolités » (I, 90, 165). Et la réserve de Sénèque vis-à-vis de la chose politique est une réserve relative : « Séneque ne permet au sage de se mêler de l’administration publique ni dans toutes les contrées, ni en tout temps, ni pour toujours » (II, 22, 276). Mais le point de départ de l’Essai demeure bien sans ambiguïté cette position détachée du stoïcisme vis-à-vis du politique, prônant la « fuite du monde » (II, 1, 233), le « dessouci de l’avenir » (II, 2, 237), « la retraite qui nous rapproche de nous-mêmes, en nous séparant de la foule qui nous heurte » (II, 73, 353) : « Lorsque le philosophe désespère de faire le bien, il se renferme et s’éloigne des affaires publiques ; il renonce à la fonction inutile et périlleuse ou de défendre les intérêts de ses concitoyens, ou de discuter leurs prétentions réciproques, pour s’occuper, dans le silence et l’obscurité de la retraite, des dissensions intestines de sa raison avec ses penchants ; il s’exhorte à la vertu, et apprend à se roidir contre le
63
torrent des mauvaises mœurs qui entraîne autour de lui la masse générale de la nation. » (1, 13, 55) 24
Repli, désespérance politique, retraite : la coupure vis-à-vis du monde11 se traduit dans la méditation du sage par la coupure intime entre le sujet, instance de « la vertu », et le réel, traversé par « le torrent des mauvaises mœurs », puis s’intériorise comme « dissension intestine » de la raison et des penchants. Cette retraite doit être mise en relation avec la retraite méditative de Diderot écrivant l’Essai « presque seul, libre de soins et d’inquiétudes », ayant « perdu le goût de ces frivolités12 auxquelles l’espoir d’en jouir longtemps donne tant d’importance » (p. 35).
Le détachement comme symptôme stylistique 25
Mais l’intériorisation de la coupure, qui passe par l’identification au modèle, va plus loin encore, car la notion de détachement, comme évitée, ou rapidement évacuée s’agissant de la doctrine, réapparaît plus loin à propos de l’écriture : « Lisez le reste de mon ouvrage, comme vous liriez les Pensées détachées de La Rochefoucauld » (II, 1, 230).
26
Certes l’écriture de l’Essai n’est pas une écriture fragmentaire comme celle des moralistes classiques, même si Diderot revendique à plusieurs reprises dans l’Essai une filiation avec La Bruyère et avec La Rochefoucauld (p. 36). Les Maximes participent d’ailleurs directement de la controverse sur l’hypocrisie de Sénèque que ravivent les journaux entre les deux éditions de l’Essai. Sur le frontispice des premières éditions des Maximes un putto désigné comme « L’Amour de la vérité » montrait moqueusement du doigt le buste d’un Sénèque grimaçant, dont il venait d’ôter le masque souriant. Si l’Essai s’oppose radicalement au message porté par le frontispice des Maximes13, il en récupère ouvertement l’efficacité stylistique (II, 5, 245 ; II, 8, 251 ; II, 10, 257). Non seulement la pratique des paragraphes numérotés, le genre de l’essai, mais, dans le déroulement de la phrase diderotienne elle-même, le recours à la parataxe installe dans l’écriture un nouveau détachement qui constitue l’expérience minimale et première du détachement philosophique14.
27
Le détachement stylistique constituait déjà une caractéristique de l’écriture chez Sénèque, admiré et critiqué15 pour son maniement de la pointe et du concetto. La maxime relève du genre de la littérature morale et appelle l’ancienne posture du sage, détaché du politique. Une étrange concordance se dessine alors entre l’écriture de Sénèque, réputé pour son art du trait, la forme brève des moralistes classiques, et une certaine pratique d’écriture dont Diderot rendait compte à Catherine II dans les termes suivants : « J’ai sur mon bureau un grand papier, sur lequel je jette un mot de réclame de mes pensées ; sans ordre, en tumulte, comme elles me viennent. Lorsque ma tête est épuisée, je me repose. Je donne le temps aux idées de repousser ; c’est ce que j’ai appelé quelquefois ma recoupe, métaphore empruntée d’un des travaux de la campagne. Cela fait, je reprends ces réclames d’idées tumultueuses et décousues, et je les ordonne, quelquefois en les chiffrant. Quand j’en suis venu là, je dis que mon ouvrage est achevé. » (Mélanges philosophiques, historiques etc..., chap. 54, « Sur ma manière de travailler ».)
28
Jacques Proust a remarqué que cette forme de la maxime (Diderot utilise le mot réclame, qu’il avait déjà employé dans La Religieuse pour désigner la fin fragmentaire du récit de Suzanne16) se généralisait dans les écrits politiques de la vieillesse de Diderot 17. Diderot, selon lui, exploiterait « le caractère intemporel et abstrait » de la formule détachée, pour
64
marquer « à quel point le locuteur prend au sérieux son rôle d’instituteur des rois et des peuples »18. 29
Cette fonction que Diderot assigne à la maxime a deux effets en apparence contradictoires : d’un côté elle efface la figure de l’auteur19 (Diderot s’efface derrière Sénèque, mais aussi derrière ses apologistes, au point qu’il est difficile parfois de déterminer la paternité de certains énoncés20) ; de l’autre, elle renforce « les éléments indiciels et symboliques de l’énonciation »21, Diderot insistant longuement à la fois sur le contexte dans lequel on doit toujours replacer les propos de Sénèque et sur la nature de sa propre énonciation22.
30
La pratique du fragment, de la citation et de la condensation du discours de Sénèque en maximes détachées relève de cette mise en espace du propos philosophique, de cette traduction du discours en posture. La maxime habite désormais, et théâtralise une scène politique que les anciens protagonistes, le prince et son conseiller, ont laissée vacante. Le détachement stylistique n’engage plus ici une réserve, un retrait par rapport au monde, comme chez les moralistes classiques ; il devient parole qui se détache sur la scène politique, et s’autonomise indépendamment des figures qui traditionnellement étaient chargées de la porter. La formule que Diderot détache est prise dans la théâtralité véhémente23 d’un espace qui en transforme profondément les effets. L’effacement de l’auteur, loin d’effacer le sujet de l’énonciation dans l’atemporalité gnomique d’un énoncé objectivé, le collectivise24 et autorise une parole révoltée qui prolonge la maxime ou même parfois, contre la logique apologétique, se retourne contre elle. Cette parole révoltée n’est plus celle du sage, mais du réseau de sociabilité où est pris le philosophe sensible, l’intellectuel engagé.
31
La théâtralité véhémente de la parole détachée, dans l’Essai, fait donc émerger une troisième instance qui trouble le face à face du sage et du roi : il s’agit du peuple, instance chargée de violence et porteuse de révolte25. Jacques Proust suit l’émergence de cette instance révoltée des Mémoires pour Catherine II aux Observations sur le Nakaz, de l’Essai à l’Histoire des deux Indes.
32
La concordance du détachement politique et stylistique est ainsi retournée par Diderot, dans sa pratique même d’écriture. La maxime est l’instrument poétique d’un pivotement dans la posture du philosophe, qui glisse de « la remontrance au Prince » à « l’exhortation au Peuple »26, du détachement de, du regard surplombant sur le monde, au détachement sur, à la mise en avant d’un impersonnel révolté. Ce pivotement demeure inaccompli. Il est en travail dans l’œuvre.
Détaché de / Détaché sur : l’écriture révoltée 33
D’emblée ce nouveau détachement glisse à la révolte : loin de détacher l’écriture du monde, de figurer le retrait du sage, ce détachement pointe l’objet véhément de l’immixtion dans le monde, et étend le « district du philosophe »27 au monde même. La pratique du morceau détaché relève de cette véhémence révoltée : du récit de Tacite, Diderot détache et invente le discours direct de ses protagonistes dans la première partie de l’Essai. Dans la seconde, les citations exactes, ou le plus souvent condensées, voire détournées, de Sénèque détachent la figure vertueuse du philosophe sur l’océan barbare des mœurs corrompues, détachent la sentence forte sur l’immensité de la matière écrite.
34
Il s’agit de faire sortir la vérité :
65
« Les réflexion suivantes me répugnent : plusieurs fois j’ai pris la plume pour les effacer : mais elles font sortir d’une maniere si forte la partialité des détracteurs de Sénèque... » (I, 86, 159). 35
Le détachement stylistique est ainsi retourné de sa fonction distanciatrice première vers une fonction apologétique qui est une fonction de révolte28. Il s’agit dès lors d’affirmer une position singulière détachée de l’opinion commune : « "On objecte Io à l’auteur de l’Essai sur la vie et les écrits de Sénèque qu’il en est moins l’historien que l’apologiste" »... [...]. « "Que plus de sang-froid aurait peut-être trouvé plus d’impartialité" »... Et moins d’intérêt pour la vérité, moins d’indignation contre la calomnie, moins de mépris pour les modernes échos des calomniateurs anciens, pour des écrivains obscurs qui prononceraient magistralement sur les écrits d’un auteur célèbre, et qui attaqueraient sans ménagement et sans pudeur les mœurs d’un malheureux illustre qu’il sera toujours honnête29 de défendre. » (II, 109, 406.)
36
Diderot détache les accusations du Journal de Paris (25 janvier 1779) pour y répondre à la faveur d’un décrochement syntaxique qui retourne la phrase contre elle-même, par la seule force révoltante du ton véhément. Cette révolte portée par l’énonciation après la formule détachée est un procédé récurrent dans l’Essai. L’indignation et le mépris transforment le détachement stylistique en révolte apologétique, et font glisser la question historique de la vita (il faudrait être « historien ») vers la question idéologique, révoltée, des mœurs (« les mœurs d’un malheureux illustre »).
37
L’insertion envahissante des critiques des journaux dans l’Essai transforme le texte en un immense collage. Le procédé relève bien du détachement : il s’agit de détacher de l’écriture de l’autre les matériaux à incorporer à son propre texte, puis de se démarquer, de se détacher sur le fond de cette écriture corrompue comme Sénèque se détache sur le fond des mœurs corrompues de son temps. Ce détachement retourne la phrase contre elle-même, la dialogise. La sémiotique du détachement initie alors la sémiologie de la révolte.
II. De l’attachement à la révolte : dialogisme et dialectique de l’Essai 38
L’opposition théorique de Diderot à ce point essentiel de la doctrine stoïcienne que constitue le détachement ne se manifeste d’abord pas frontalement. Dans un premier temps, elle s’exprime sourdement dans ce que l’on pourrait désigner comme une contreoffensive lexicale : le vocabulaire de l’attachement, de la liaison envahit le texte. Il s’agit dans un premier temps de la relation de Sénèque à Néron. L’attachement est d’abord indirect : « on sait que le philosophe s’était proposé d’attacher son élève à ses devoirs » (I, 36, 82) ; « c’est en vain qu’il se propose de lier son élève » (I, 41, 86) ; « Serait-ce donc un reproche à faire à Sénèque et à Burrhus que d’avoir enchaîné [la langue du tigre] pendant cinq ans ? » (I, 46, 95). Mais la relation de l’instituteur au prince crée un autre attachement : « Qui est-ce qui ignore que le véritable attachement a sa source dans les soins qu’on a pris et dans les services qu’on a rendus ? [...] Le cœur d’un instituteur vertueux pour son élève est le même que celui d’un père pour son enfant » (I, 46, 90). Attachement pervers, auquel répond la politique du prince vis-à-vis de ses courtisans, « qui détournait de sa personne les regards publics, en attachant les yeux de l’envie sur ceux qu’il lui exposait décorés des dépouilles odieuses dont il les forçait de se couvrir » (I, 53, 110). Tout un réseau se dessine alors, qui lie le prince aux courtisans30, le ministre
66
Sénèque à sa famille et à ses obligés31, interdisant son départ, empêchant pratiquement l’application de la doctrine.
Le continuum sensible 39
Il s’agit dans un premier temps pour Diderot de justifier l’attitude de Sénèque contre ses détracteurs qui l’accusent de compromission avec le pouvoir ; mais plus profondément quelque chose se retourne dans la posture vis-à-vis du politique, qui sera analysée non plus en termes de coupure, de séparation des rôles, mais comme continuum sensible, comme polarisation travaillée par l’affect32, relation de filiva d’un côté, révolte et indignation de l’autre.
40
La mise en avant de l’attachement à la fois comme donnée du réel et comme principe philosophique débouche, dans la deuxième partie de l’Essai, sur une critique violente de toute une partie de l’œuvre de Sénèque. Diderot, à propos de la sixième lettre à Lucilius, fait l’éloge de l’amitié : « l’amitié est la passion de la jeunesse : c’est alors que j’étais lui, qu’il était moi. Ce n’était point un choix réfléchi ; je m’étais attaché je ne sais par quel instinct secret de la conformité. [...] J’éprouvais ses plaisirs, ses peines, ses goûts, ses aversions ; nous courions les mêmes hasards33 » (II, 1, 232).
41
On est bien loin ici de l’attitude philosophique prônée par le sage stoïcien. A Sénèque qui « prétend qu’on refait aussi aisément un ami perdu que Phidias une statue brisée » (II, 1, 235), Diderot oppose la philia philosophique, qui abolit la coupure entre les êtres et fait circuler la sensibilité du Moi à l’Autre : « Quel est l’objet de la philosophie ? C’est de lier les hommes par un commerce d’idées » (II, 2, 240). La philosophie tout entière est attachement. C’est « cet arbre immense dont la tête touche aux cieux et les racines pénètrent jusqu’aux enfers, où tout est lié, où la pudeur, la décence, la politesse, les vertus les plus légères s’il en est de telles, sont attachées comme la feuille au rameau qu’on déshonore en la dépouillant. » (II, 6, 247)
42
La description est étrange, qui rejoint celle de la Discorde homérique évoquée dans le Salon de 176734 : le continuum sensible est à la fois principe rationnel d’organisation du monde et principe de révolte.
Politisation du lien sensible : le devoir social du philosophe 43
C’est au cours du compte rendu des Lettres à Lucilius que l’opposition diderotienne au stoïcisme commence à se formuler plus nettement. « Il dit à Lucilius, lettre 36 : "On blâme votre ami d’avoir embrassé le repos, abandonné ses places, et préféré l’obscurité de la retraite aux nouveaux honneurs qui l’attendaient. Exhortez-le à se mettre au-dessus de l’opinion ; chaque jour il fera sentir à ses censeurs qu’il a choisi le parti le plus avantageux." Pour lui peut-être ; mais pour la société 7 Il y a dans le stoïcisme un esprit monacal qui me déplaît ; c’est cependant une philosophie à porter à la cour, près des Grands, dans l’exercice des fonctions publiques, ou c’est une voix perdue qui crie dans le désert 35. J’aime le sage en évidence comme l’athlète sur l’arène : l’homme fort ne se reconnaît que dans les occasions où il y a de la force à montrer. Ce célèbre danseur qui déployait ses membres sur la scène avec tant de légèreté, de noblesse et de grâces, n’était dans la rue qu’un homme dont vous n’eussiez jamais deviné le rare talent. » (II, 8, 251.)
67
44
La citation détachée de Sénèque est aussitôt contrée et dialogisée. Au dialogue de Sénèque avec Lucilius se superpose celui de Diderot avec Sénèque : « Pour lui peut-être ; mais pour la société ? ». Diderot vise clairement la question du détachement, de la « retraite » du sage, identifiée à la retraite monastique. Il y reviendra plus loin, parlant de « vues monastiques et antisociales » (II, 21, 275). La philosophie n’a de sens que théâtralement installée dans l’espace de la sociabilité publique. Il ne s’agit pas seulement de la position du ministre-philosophe à la cour du tyran, de cette figure traditionnelle du conseiller du prince. Le philosophe n’est pas l’inspirateur discret, caché, de telle ou telle politique. Comparé à « l’athlète sur l’arène », puis plus radicalement au « danseur [...] sur la scène » (autant dire le prostitué, l’excommunié), il exhibe publiquement, théâtralement36, une certaine posture ; ce n’est pas immédiatement son discours, c’est d’abord son gestus social qui fait sens.
Le retournement théorique et dialogique de l’Essai 45
Diderot entreprend donc de retourner Sénèque contre lui-même pour construire la figure imaginaire de l’intellectuel confronté au pouvoir. Le retournement est saisissant, car il embrasse en un seul mouvement la représentation désuète du sage confronté au prince, inscrite dans une tradition multiséculaire de notre culture, et l’ébauche inédite du citoyen révolté, faisant basculer la culture savante dans la posture populaire de la révolte 37 .
46
Pour comprendre comment s’opère ce retournement, il convient de ne négliger aucun des fils conducteurs, en apparence hétérogènes, qui parcourent l’Essai. La dichotomie essentielle n’est pas celle qui, de façon simple et immédiatement visible, sépare le texte en deux parties consacrées successivement à la vie du précepteur de Néron puis aux œuvres du philosophe disciple de Zénon, soit, pour une figure, deux personnages que les détracteurs de Sénèque et de son apologiste ont eu beau jeu d’opposer.
47
L’élément différentiel n’est pas non plus le double référent que manie Diderot, d’une part la réalité stoïcienne du despotisme néronien, de l’autre la réalité contemporaine du despotisme éclairé qu’affronte le philosophe des Lumières, c’est-à-dire plus concrètement pour l’auteur de l’Essai, sa relation, sa position vis-à-vis de Catherine II38.
48
Il s’agit bien plutôt de deux postures face au politique, diamétralement opposées et pourtant difficilement dissociables, l’une de détachement, l’autre de révolte, toutes deux guettées et reliées par la compromission. Tout le travail poétique et, dans le même temps, philosophique de l’Essai consiste à représenter et à articuler ces deux postures, d’abord par la mise en scène de figures, puis, plus subtilement, par le travail même, dialogique, de l’écriture diderotienne : les pages consacrées à Rousseau39 (I, 61-67, 119-131), qui constituent une digression par rapport à la structure rhétorique annoncée de l’Essai, apparaissent alors comme un maillon essentiel dans la construction de ce face à face. Rousseau est la figure moderne et honnie du détachement, qui permet à Diderot de dissocier Sénèque du détachement stoïcien.
49
Peu à peu dans l’Essai, cette opposition de Diderot vis-à-vis du détachement stoïcien s’affirme et se radicalise. Dès le début de la deuxième partie, Diderot nous avait prévenus : « usant avec lui40 d’un privilège dont il ne se départit avec aucun autre philosophe, j’oserai quelquefois le contredire » (p. 229)41. Ainsi, le mépris de Sénèque pour la douleur est insupportable : « Quoi ! l’on se moque d’un époux, d’un amant, d’un fils inconsolable
68
de la mort de sa femme, de sa maîtresse, de son père, de son ami ! Il n’en est rien ; et pour répondre à Séneque dans sa manière, je lui dirai : [...] pour celui qui a les regards attachés sur l’urne de sa femme ou de sa fille, est-il rien de plus importun que la présence de celui qui rit ? » (II, 19, 271.) L’apologie de Sénèque devient dialogue contradictoire avec Sénèque, même si la contradiction est nourrie de la « manière » même du philosophe. L’entreprise est bien de détournement, voire de retournement de l’œuvre de Sénèque contre elle-même. 50
La lecture des Lettres à Lucilius avançant, Diderot passe de la contradiction prudente à la condamnation, voire à l’indignation : « La lettre 66, sur l’égalité des biens et des maux, n’est qu’un tissu de sophismes » (II, 21, 275). Mais surtout l’objet du conflit est la question, à la fois brûlante et interdite depuis Hobbes, des fondements de l’autorité politique. Diderot commence par affirmer, sans rapport direct avec le texte de Sénèque que « le philosophe apprend au souverain quelle est l’origine et la limite de son autorité » (II, 25, 281). Le conflit se noue à l’occasion de la lettre 94 : « C’est avec une espèce d’indignation que je l’entends avancer dans la même lettre, qu’il ne trouve rien de plus froid, de plus déplacé à la tête d’un edit ou d’une loi qu’un préambule qui les motive."Prescrivez-moi, ajoute-t-il, ce que vous voulez que je fasse ; je ne veux pas m’instruire, mais obéir." J’en demande pardon à Séneque, mais ce propos est celui d’un vil esclave qui n’a besoin que d’un tyran. (II, 36, 297) »
51
L’indignation de Diderot contre les effets pervers de l’ataraxie contamine à son tour l’énoncé. De même que le détachement faisait travailler la coupure à la fois dans la pratique stylistique et dans la posture politique, de même la révolte qui se manifeste d’abord dans l’énonciation et dans le retournement indigné des sentences de Sénèque, devient peu à peu l’objet central de l’énoncé. Il faut se révolter. Diderot prend ici radicalement le contrepied du De ira : « Quoi, Séneque ! "le sage n’entrera pas en colère, si l’on égorge son père, si l’on enlève sa femme, si l’on viole sa fille sous ses yeux ?"... "Non..." Vous me demandez l’impossible, le nuisible peut-être. (II, 45, 316) »
52
On voit bien, dans cet exemple pris parmi d’autres42, comment la révolte du philosophe contre l’injustice se superpose à la pratique dialogique qui retourne la phrase de Sénèque contre elle-même.
III. Poétique de la révolte et imaginaire du pouvoir La posture infigurable de la révolte : de l’énoncé au dispositif 53
La posture de l’indignation et de la révolte ne trouve pas véritablement de figure où s’incarner dans l’Essai : elle prolonge la réflexion sur Sénèque mais ne peut s’identifier à lui ; elle rencontre la sympathie et même l’adhésion de Diderot, mais ne se superpose pas à la réalité de sa relation avec Catherine. Cette posture imaginaire, qui traverse et oriente tout l’Essai, demeure donc en quelque sorte inaccomplie. On touche, dans cet inaccomplissement qui désigne la visée de l’œuvre, à un élément majeur de la poétique diderotienne, que Diderot a exprimé un peu partout dans son œuvre, à travers les genres et les thèmes les plus variés : cette posture révoltée qui, du spasme aux larmes, du geste théâtral aux marques de l’indignation la moins mesurée, place l’énonciation au cœur du travail du sens, établit une articulation inédite entre l’élaboration théorique du philosophe et la pratique littéraire et stylistique de l’écrivain.
69
54
La dialectique des postures du détachement et de la révolte, qui guide et oriente la réflexion dans l’Essai, ne se manifeste donc pas comme discours dialectique mais comme effet dialogique de l’énonciation. Soyons plus nets encore : il n’y a pas dans l’Essai un discours philosophique de Diderot, mais un dispositif proprement diderotien, c’est-à-dire une installation d’espaces imaginaires où théâtraliser les enjeux théoriques. La cour de Néron, le cabinet du philosophe, la solitude de Rousseau, l’arène du combat contre les journalistes antiphilosophes sont les espaces, non le discours de l’Essai. On songe ici à l’emploi que Diderot fait du mot scène pour désigner le contexte historique dans lequel il installe son propos : « La scène va changer » (I, 32, 77) ; « la scène va changer encore » (I, 34, 79) ; « cette scène scandaleuse » (I, 70, 134) ; « ajustez cette scène au théâtre et soyez sûr d’un grand effet » (I, 76, 143).
55
Autrement dit, on ne peut pas rendre compte de l’entreprise diderotienne de l’Essai en termes d’énoncé : presque tous les énoncés de l’Essai sont empruntés. Diderot compile les compilateurs et, si l’on ôtait du texte ce qui est pris à Tacite, à Suétone, à Sénèque luimême, à Juste Lipse, ce qui est cité également de ses détracteurs anciens et contemporains, des journaux, jusqu’aux dernières pages où la défense de Diderot est ouvertement recopiée de Marmontel, il ne resterait que bien peu de choses de ce livre volumineux. Le travail essentiel de Diderot n’a donc pas porté sur les énoncés, mais sur leur mise en scène, leur agencement, ou plus exactement sur l’installation de discours inconciliables dans un dispositif susceptible d’ouvrir à la dialectisation.
56
Le montage complexe de l’Essai ne se propose pas d’orner de citations colorées une thèse discursivement préétablie ; le jeu, la succession des postures dans l’espace de la représentation construit un imaginaire du pouvoir qui, lui-même, force, pousse la mise en œuvre théorique.
57
La généralisation d’une sémiologie de la révolte engageant à la fois le retournement dialogique de l’œuvre de Sénèque et la condamnation de son discours sur le rapport du sage au politique, c’est toute l’entreprise apologétique de l’Essai qui est mise en péril. Diderot sauve l’apologie en dissociant Sénèque du stoïcisme, et même, plus subtilement, en dissociant la figure, la posture de Sénèque de ses « principes ». Il a beau jeu ainsi de surprendre Sénèque s’indignant contre la bassesse du courtisan dont le prince vient d’exécuter les enfants : « Et cette bassesse, mon philosophe, remplit votre âme de colère, votre bouche d’imprécations ! Je vous en loue, mais vous avez oublié vos principes sur la colère. Lorsque vous vous écriez : "Un père laisser le meurtre de son fils sans une vengeance proportionnée à l’atrocité du crime43 !"... vous sentez juste ; mais de stoïcien que vous étiez, vous vous êtes fait homme. » (II, 48, 320-321.)
58
Là encore le mouvement d’indignation du philosophe l’emporte sur le travail de définition, de catégorisation qui ouvrait le traité sur la colère. C’est bien une posture, non un discours qui fait sens ici. Il ne s’agit pas de s’accorder scolastiquement à une étiquette dogmatique, mais de se faire homme, de participer de façon immédiate, théâtrale et sensible, de l’humanité héroïque et révoltée.
59
L’enseignement politique de la posture incarnée par Sénèque, la vérité sensible contenue dans cette posture s’oppose donc à la facticité des « principes » : « Dans cet ouvrage, les conséquences des principes de l’auteur le mènent à des assertions difficiles à digérer » (II, 52, 325)44. Par principes, Diderot entend en fait ce qui organise rhétoriquement le corps de la doctrine stoïcienne, la mécanique sophistique du texte. L’œuvre de Sénèque apparaît alors tendue entre cette mécanique textuelle du détachement et le continuum
70
sensible d’une posture qui relie les œuvres à l’engagement politique du précepteur et du ministre de Néron. A propos du De ira dont il vient de réfuter violemment les thèses, Diderot écrit : « On est convaincu, entraîné en lisant le traité de la Colère ; on est attendri, touché, en lisant celui des Bienfaits. L’un est plein de force, l’autre de finesse ; là c’est la raison qui commande ; ici c’est la délicatesse du sentiment qui charme » (II, 58, 332). A l’efficacité persuasive de la rhétorique qui fait tourner à vide les principes du De ira s’oppose l’impression sensible que cherche à produire le De Beneficiis. Mais le passage à cette nouvelle sémiologie qui « parle au cœur » (ibid.) déclenche aussitôt la révolte. Incorporant la scission qu’il a introduite dans son Sénèque, pris entre une rhétorique et une posture, Diderot se met ici en scène pris entre l’efficacité persuasive du détachement et l’indignation que suscitent les énoncés stoïciens : « La justesse et la force des arguments de Séneque [...] subjuguent ma raison, mais mon cœur se révolte contre cette ingrate dialectique » (II, 61, 336-337).
Condamnation du stoïcisme et retournement des citations : écritures de la révolte 60
Diderot se déchaîne alors contre le stoïcisme : « "Quand on est inaccessible à la volupté, on l’est à la douleur"... Voilà un de ces corollaires de la doctrine stoïcienne auquel on n’arrive que par une longue chaîne de sophismes » (II, 68, 347). Le retournement dialogique par rapport à la citation se marque bien comme écart par rapport à la mécanique du texte, comme glissement de l’énoncé vers la posture. « La philosophie stoïcienne est une espèce de théologie pleine de subtilités ; et je ne connais pas de doctrine plus éloignée de la nature que celle de Zénon » (II, 69, 348).
61
Cette dissociation de Séneque et du stoïcisme constitue une avancée majeure dans le travail théorique qui s’opère progressivement tout au long de l’Essai. De la position défensive qui réfutait les accusations de compromission avec le tyran, on est passé à une position offensive, prônant pour le philosophe l’action politique : « je ne mettrai pas sur la même ligne celui qui médite et celui qui agit. Sans doute la vie retirée est plus douce, mais la vie occupée est plus utile et plus honorable ; il ne faut passer de l’une à l’autre qu’avec circonspection ; c’est même l’avis de Séneque. Et qu’importe, ajoute-t-il, par quels motifs le sage embrasse la retraite, si c’est lui qui manque45 à l’Etat, ou si c’est l’Etat qui lui manque ?"... Il importe beaucoup : s’il manque à l’Etat, c’est un mauvais citoyen ; si l’Etat lui manque, 1 Etat est insensé. » (II, 73, 354.)
62
Une fois de plus, sous couvert de « l’avis de Sénèque », Diderot prend le contrepied de sa doctrine, dans la droite ligne de l’article PHILOSOPHE de l’Encyclopédie rédigé par Dumarsais. La critique est de plus en plus nette et vive, sans les précautions initiales. Au terme de son analyse du De Brevitale vitæ, Diderot conclut que « Le stoïcisme a dénaturé tous les mots » (II, 84, 371) ; l’apologie que Sénèque fait du suicide dans le De Constantia révolte son apologiste : « Cette morale est-elle inspirée à un Séneque par un Caligula ? » (II, 85, 372). Curieusement la proximité perverse du philosophe et du despote se retrouve ici, non sur le terrain politique, mais dans le domaine de la morale. Toujours à propos du De Constantia, Diderot éclate devant l’histoire édifiante de Stilpon défiant Démétrius Poliorcète après la prise et le pillage de sa ville. Tous mes biens sont avec moi, avait dit Stilpon : « Je ne le dissimulerai pas, je suis révolté du mot de Stilpon et du commentaire de Séneque. [...] Si tu n’as rien perdu, il faut que tu te sois étrangement isole de tout ce
71
qui nous est cher, de toutes les choses sacrées pour les autres hommes. Si ces objets ne tiennent au stoïcien que comme son vêtement, je ne suis point stoïcien, et je m’en fais gloire ; elles tiennent à ma peau, on ne saurait me séparer d’elles sans me déchirer, sans me faire pousser des cris. Si le sage tel que toi ne se trouve qu’une fois, tant mieux ; s’il faut lui ressembler, je jure de n’être jamais sage. » (II, 87, 374) 63
Le détachement du sage devient isolement étrange, la gloire du stoïcien bascule dans l’incompréhensible. C’est par ce à quoi il est attaché et non par ce dont il se détache que le philosophe diderotien acquiert sa valeur. Le rapport au monde est le rapport de ce qui tient à la peau, entre communication corporelle et déchirement convulsif.
64
Citons enfin cette remarque à propos d’une scène prétendument morale des Questions naturelles : « Je ne m’en dédis pas : Sénèque et Lucilius me sont l’un et l’autre odieux » (II, 100, 393). Non que l’apologiste soit devenu le détracteur de Sénèque : mais le rapport même à l’œuvre est devenu un rapport d’intimité révoltée.
65
Nous avons commencé par opposer les deux postures du détachement et de la révolte. La posture du détachement associe le corps de la doctrine stoïcienne à une certaine pratique stylistique de la forme brève, de la pointe, de la maxime, dans un va-et-vient, une superposition de la coupure symbolique et de la coupure sémiotique ; à l’opposé, la posture de la révolte associe le travail d’émancipation politique entrepris par les philosophes des Lumières depuis l’Encyclopédie à une poétique diderotienne théâtralisant, spatialisant, dialogisant l’énoncé, selon une sémiologie fondée non plus sur la coupure, mais sur le continuum sensible. Le philosophe s’indigne et la phrase se retourne contre elle-même : la révolte est politique et stylistique46.
66
C’est donc l’écriture même de Sénèque qui, dans l’Essai, glisse du détachement vers la révolte. A propos de la 33e lettre à Lucilius, Diderot commente ainsi les réflexions de Sénèque sur le style : « J’ouvre cette lettre et j’y lis : "Des pensées remarquables et saillantes annoncent une composition inégale. Le plus grand arbre n’excitera aucune admiration, si tous ceux de la forêt lui ressemblent." [...] Le génie est souvent inégal. Avec un peu de justesse et de réflexion on n’aurait pas fait dire à Sénèque ce qu’il ne dit pas ; et en méditant un peu sur la comparaison de la pensée saillante avec l’arbre qui se distingue dans la forêt par sa hauteur, on aurait entendu ce qu’il dit. [...] La plupart des ouvrages du philosophe sont des impromptus faits au courant de la plume au milieu du tumulte et des intrigues de la cour, dans les intervalles dérobés aux fonctions de l’instituteur [...] ; il ne compose pas, il verse sur le papier son esprit et son âme, il ne s’épuise point à donner de la cadence à sa phrase, il m’exhorte, il s’exhorte lui-même à la pratique de la vertu. » (II, 10, 257.)
67
De l’image traditionnelle du style de Sénèque comme style saillant, irrégulier, précisément détaché à la manière des moralistes (Diderot répète la comparaison avec La Bruyère et avec La Rochefoucauld), on passe à celle d’une âme déversée sur le papier, écriture sans médiation, pur mouvement de la révolte intime s’objectivant, s’universalisant sur le papier du texte.
De la représentation à l’imaginaire du pouvoir : la chose politique 68
C’est alors que peut naître l’imaginaire du pouvoir. Le pouvoir n’est plus l’objet abstrait, théorique, d’une représentation philosophique. Il est la chose politique, à la fois instance abjecte du réel, barbarie du monde et principe de symbolisation, que l’écrivain incorpore,
72
corporise dans la pratique de son écriture, pour la restituer, la « verser » dans son écrit. C’est alors un imaginaire et non plus une représentation du pouvoir qui s’écrit, imaginaire révolté, subversif. L’Essai sur les mœurs n’est-il pas célèbre pour ses méditations sur les révolutions et, surtout, son apologie de la révolution américaine47 ? 69
L’imaginaire du pouvoir est l’avènement dans l’écriture de la chose politique, qui se manifeste non comme le thème d’un discours philosophique, mais, on l’a vu, comme le dispositif d’un certain face à face engageant un conflit symbolique : le face à face de Sénèque et de Néron, et plus généralement le face à face de la conscience morale, porteuse de l’exigence éthique, et de l’horreur du monde, de ce donné du réel qui saisit le philosophe à la gorge, qui le défie et l’étreint, qui l’accule à choisir entre la mort et la compromission.
70
La chose politique se manifeste donc à la fois comme exigence morale et comme donnée du réel. Elle est pour cette raison toujours figurée par la mise en scène d’un choix impossible : Sénèque doit-il justifier le meurtre d’Agrippine pour continuer à faire le bien ou se retirer, lui qui est le dernier rempart contre la barbarie du tyran (I, 79, 148-150) ? Cneius Pison doit-il exécuter les deux soldats coupables et le centurion désobéissant au nom de la discipline militaire, ou pardonner par humanité contre la loi (II, 46, 317) ?
71
Chaque fois, il s’agit d’appliquer une maxime de morale (ne pas mentir, ne pas cautionner le crime, respecter et faire respecter la loi) à une réalité politique dans laquelle cette maxime est pour ainsi dire retournée contre elle-même : ses effets, barbares et inhumains, révoltent la morale qui l’a dictée.
72
La chose politique est l’articulation révoltée de la maxime et du réel. Elle engage l’écriture de l’Essai, écriture du détachement, de la maxime donc, mais du détachement sur le réel, de la maxime qui se retourne et se révolte, mettant en échec le dispositif stoïcien du face à face entre le sage, que le suicide libère du tyran, et le tyran, dont la barbarie détache la liberté du sage.
Kant avec Diderot ? 73
L’Essai travaille à l’effondrement de ce dispositif. Diderot rejoint, dans cette construction négative d’un imaginaire du pouvoir, l’entreprise contemporaine de Kant. La Critique de la raison pratique (1788) est bien tout entière ordonnée autour de l’articulation des principes idéaux de la morale (l’exigence de vertu) et des satisfactions pratiques qu’offre le monde (la poursuite du bonheur). La loi morale est l’objectivation universelle d’une maxime qui détache l’énoncé de son auteur48 : « Agis de telle sorte que la maxime de ta volonté puisse en même temps toujours valoir comme principe d’une législation universelle. » (I, 1. 1, ch. 1, §7, p. 64349.)
74
Mais cette maxime, nécessairement orientée vers la recherche du « souverain Bien » (le summum bonum stoïcien), échoue à faire coïncider « la vertu et le bonheur », dont la liaison ne peut être ni analytique, ni synthétique : c’est l’antinomie de la raison pratique (I, 1. 2, ch. 2, I, p. 746-747), que Kant résout en dissociant le sujet moral comme phénomène (un individu pris dans les événements du monde sensible) et comme noumène (« pure intelligence dotée d’une existence qui échappe aux déterminations du temps »). Kant concède que l’intention vertueuse ne produit pas nécessairement le bonheur dans le monde sensible, mais, de façon médiate, « dans la connexion avec un monde intelligible ». Il évoque alors longuement Épicure et les stoïciens, pour qui « la possibilité du souverain
73
Bien » était intégralement située dans le monde sensible. Mais dans le monde sensible la poursuite du souverain Bien ne produit le plus souvent qu’une satisfaction négative, le « contentement de soi même » (p. 751) que l’on doit distinguer du bonheur et de la béatitude (p. 753). La recherche du souverain Bien doit être en conséquence considérée comme possible par la conscience morale, même si l’accomplissement total, positif, de ce souverain Bien demeure incompréhensible pour la raison pratique. 75
D’une certaine façon, Kant comme Diderot partent de ce dispositif stoïcien du face à face de l’exigence éthique et du réel pour le déconstruire. Kant lui assigne les limites idéalisantes de sa critique, qui sépare le monde sensible où s’engage le combat de la vertu du monde intelligible où est promise la jouissance. La représentation du pouvoir est ainsi séparée de l’imaginaire de la jouissance, rejeté hors des compétences de la raison pratique. La critique du dispositif moral stoïcien qui déconstruit la dynamique symbolique du Souverain Bien, fondée sur l’unicité du bonheur et de la vertu, ne débouche pas sur l’avènement de la chose politique comme articulation symbolique centrale. La chose politique demeure toujours à l’horizon de la critique, comme en témoigne la conclusion de la Critique de la raison pratique, illustrée par un double face à face : celui de l’honnête homme et des calomniateurs d’Anne Boleyn, puis de l’honnête homme et du taureau brûlant de Phalaris.
76
La « pure moralité » exige bien sûr que l’honnête homme refuse de porter un faux témoignage en échange de profits, mais aussi qu’il ne cède ni aux menaces, fussent-elles de mort, ni aux supplications de « sa famille menacée de la dernière misère ». La « loi des mœurs » doit donc être représentée absolument « dégagée de toute visée de bien-être, car c’est dans la souffrance qu’elle se montre avec le plus d’éclat » (p. 795). Rien n’est moins stoïcien.
77
Kant radicalise la dissociation de la vertu et du bonheur entamée pour résoudre l’antinomie de la raison pratique. Cette dissociation, qui relève toujours d’une sémiotique de la coupure, engage également celle de la raison et des sentiments. Le face à face théâtral du sage et de la réalité immonde du monde est perçu comme un face à face indécent, qu’on ne doit pas donner pour modèle aux enfants : « il faut ici attirer l’attention moins sur l’élévation de l’âme [...] que sur la soumission du cœur au devoir », car la première ne produit que des « transports » passagers quand la seconde engage des « principes » durables (p. 794, note).
78
Comment ne pas reconnaître Diderot dans ce que vise la critique kantienne du dispositif de face à face50 ?
79
Diderot, au lieu de répudier le dispositif stoïcien, l’exacerbe et le retourne contre luimême. Le face à face n’est pas critiqué comme image vaine d’une moralité plus romanesque que philosophique, mais comme postulant une soumission insupportable au pouvoir : la résistance de l’honnête homme au tyran ne remet pas en question le pouvoir du tyran, et même évacue la question du pouvoir au profit de celle de la moralité. Cette soumission est d’abord justifiée, dans la première partie de l’Essai, par l’action politique du philosophe : ce n’est pas pour obéir aux principes de la moralité pure, mais parce que lui-même, comme ministre de Néron, détient un pouvoir qu’il peut mettre en œuvre utilement que Sénèque (le Sénèque de Diderot, sinon le Sénèque historique) se soumet à son prince. La réalité immédiate, les effets tangibles de l’action politique justifient ce que Kant stigmatiserait comme une compromission morale, voire comme le sacrifice de la moralité subjective51. Exigence éthique et causalité pratique des événements dans le monde sensible ne sont pas, ne peuvent pas être séparées pour Diderot.
74
80
L’antinomie de la raison pratique qui se manifeste dans le face à face de l’honnête homme et du tyran n’étant pas résolue par la critique et par la séparation du sujet comme phénomène vertueux et comme noumène accessible à la jouissance, Diderot ouvre une autre voie qui de « l’élévation de l’âme » au « transport » conduit le sujet vers la révolte.
La révolte scénique comme dépassement du face à face 81
Tout commence avec l’anecdote de Cneius Pison et des trois soldats : « Pison condamne à mort un soldat, pour être retourné du fourrage sans son camarade. Ce soldat présentait sa gorge au glaive, lorsque son camarade reparut. Ces deux hommes se tenant embrassés, sont reconduits, aux acclamations du camp, dans la tente de Pison, qui dit à l’un : Toi, tu mourras, parce que tu as occasionné la condamnation de celui-là ; et au centurion : Toi, pour n’avoir pas obéi... » (II, 46, 317)
82
Quid hoc indignius ? Sénèque, dans le De ira, avait réprouvé la colère de Cneius Pison, vir a multis vitiis integer, sed pravus et cui placebat pro constantia rigor, « un homme que bien des vices laissaient insensible, mais mauvais, aimant la rigueur qu’il prenait pour de la fermeté » (I, XVIII, 3). Mais cette réprobation morale visait l’iracundia en tant que passion pernicieuse de l’âme ; elle n’engageait pas la chose politique, ne sollicitait pas un imaginaire du pouvoir mettant en jeu la légitimité politique de Pison.
83
Diderot se révolte contre cette passivité du rapport purement moral à la chose politique : « A ce récit, dites-moi que se passe-t-il en votre âme ? Est-ce que vous ne sentez pas la fureur s’en emparer ? Est-ce que vous ne criez pas à ces trois malheureux : Lâches, que faites-vous ? Quoi ! vous vous laissez égorger sans résistance ? Suivezmoi : élançons-nous tous les quatre sur cette bête féroce, poignardons-la, et qu’après il soit fait de nous tout ce que l’on voudra ; nous ne mourrons pas du moins sans être vengés. Je le sens au bouillon de mon sang, j’en conviens, c’est la passion qui me transporte et qui m’associe dans ce moment aux trois soldats exécutés il y a deux mille ans ; mais si je suis fou, qui est-ce qui osera blâmer ma folie ? » (Suite du précédent)
84
La « résistance » de l’honnête homme dépasse ici de loin le travail de la négativité à l’œuvre face aux calomniateurs d’Anne Boleyn ou aux exigences de Phalaris : il ne s’agit pas de résister à la tentation des biens terrestres, à la menace physique et morale, à la prière des proches, c’est-à-dire de se raidir contre les sollicitations du monde sensible ; il s’agit tout au contraire de s’engager totalement dans le monde, d’exercer ce que la Déclaration des droits de l’homme désignera comme le droit politique fondamental de résistance à l’oppression.
85
Diderot retourne le face à face du tyran et des trois condamnés. La scène engage un imaginaire du pouvoir précisément parce qu’elle est ainsi dédoublée, travaillée par la révolte : l’antinomie se résout non par la critique, mais dans la révolte qui met la passion au service de la justice.
86
Ici s’ouvre une nécessaire vacance de la raison : « je le sens au bouillon de mon sang, j’en conviens, c’est la passion qui me transporte ». Le transport de la révolte met en œuvre une dynamique impure, engageant des forces que ne gouvernent ni la morale, ni la raison. Cette « folie » révolutionnaire, absolument extérieure à la sphère kantienne de la raison pratique, radicalement détachée de l’efficace poétique et philosophique de la maxime, n’est pas pour autant anti-philosophique.
75
87
L’Iroquois qui sauve les Européens du naufrage obéit-il à un principe d’humanité naturelle (II, 67, 344) ? Ce face à face là, que Diderot emprunte à l’Histoire des deux Indes (XV, 4, addition de 1774), elle-même inspirée des Voyages dans le Canada de Louis Crespel (1742) est également retourné, révolté dans l’Essai : « tout à l’heure vous étiez des hommes malheureux, et nous vous avons secourus ; demain vous serez nos ennemis, et nous vous égorgerons »52.
88
C’est le même transport sensible qui précipite l’Iroquois dans la compassion héroïque et dans le massacre sanglant. L’action n’est motivée par aucune maxime. C’est par rapport au dispositif de la scène, c’est-à-dire par rapport à la Chose même du réel, et non au principe de la morale, à la maxime, que se détermine l’action.
89
Le rapport du sage, du philosophe, de l’honnête homme, de l’intellectuel avec le pouvoir cesse donc ici d’être conditionné par l’objectivité universelle de la maxime morale. Une certaine puissance révoltante du réel fait image pour le sujet qui s’engage. C’est à partir de cette image que se déclenche à la fois l’action politique et l’écriture, écriture qui dialectise le détachement pour communier avec le monde.
90
L’imaginaire du pouvoir se nourrit de cette communion révoltée. Le héros diderotien en dernier ressort n’est pas le sage retranché mais l’esclave noir qui a préféré se trancher le poignet plutôt que d’exécuter ses compagnons rattrapés dans leur fuite : « Voilà donc un homme sans éducation, sans principes, réduit par son état à la condition de la brute, qui s’abat un poignet plutôt que de s’avilir. N’oublions jamais que le serviteur peut valoir mieux que son maître. » (II, 67, 345.)
91
Sénèque avait préféré faire l’éloge de Mucius Scaevola (II, 55, 328 ; De providentia, 3, 5). La mutilation de Scaevola représentait la grandeur du pouvoir romain, soutenue dans le sacrifice par la pure exigence morale du devoir ; la mutilation de l’esclave fait travailler un imaginaire du pouvoir pris entre l’horrification et la révolte : un imaginaire qui n’engage pas le retrait de (ou le détachement dans) la sphère symbolique, mais tout au contraire qui l’investit de sa posture subversive.
NOTES 1. Les références seront données dans l’édition de Jean Deprun, Œuvres complètes (édition dite DPV), tome XXV, Hermann, 1986. Le chiffre romain désigne la première ou la seconde partie de l’ Essai, le second chiffre indique le numéro de paragraphe dans l’édition de 1782, le troisième chiffre renvoie à la page dans DPV. 2. C est dans cette tradition que la critique philologique lit encore l’Essai. Voir J. Robert
LOY,
«
L’Essai sur la vie de Sénèque et les règnes de Claude et de Néron, de Diderot », Cahiers de l’association internationale des Etudes françaises, Juin, 1961 ; William T. CONROY Jr., « Diderot’s Essai sur Sénèque », Studies on Voltaire and the eighteenth century, 131 (1975) ; « Three neglected sources of Diderot’s Essai sur Sénèque : Ponçol, Peyrilhe, L’Estoile », Studies on Voltaire, 176 (1979), p. 259-271 ; Herbert JOSEPHS,
« Essai sur les règnes de Claude et de Néron : a final borrowing », in Diderot : digression and
dispersion, a bicentennial tribute, ed. Jack Undank and Herbert Josephs, Lexington, Kentucky; French Forum Publishers, 1984, p. 138-149.
76
3. C’est le titre de l’une des pièces liminaires de l’édition proposée par Juste Lipse. 4. Nous mettons en œuvre ici le travail théorique engagé par J. KRISTEVA dans Sens et non-sens de la révolte, Fayard, 1996, puis La Révolte intime, Fayard, 1997. 5. Cette notion de posture est essentielle pour comprendre ce que Diderot entreprend dans l’Essai . Comme Paolo Casini le rappelle, « il ne s’agit pas de bâtir un système de morale. Il s’agit plutôt d’examiner et de comprendre, sans les distorsions typiques que produisent les systèmes, l’écart perpétuel qui sépare la conscience pure du sage des exigences impures de l’action, l’utopie de la réalité, la théorie de la pratique » (« Diderot apologiste de Sénèque », Dix-huitième siècle, n° 11 (1979), p. 242). Cet écart ne fait pas l’objet d’un discours mais d’une mise en scène. Il n’est donc pas représenté par une position systématique, mais par une posture intellectuelle. 6. On distingue ici la sémiotique, comme système d’organisation des signes fondé strictement sur le jeu du signifiant et du signifié, de la sémiologie, comme système d’organisation du sens, dans lequel le jeu du signifiant et du signifié n est que l’une des combinatoires possibles. 7. Diderot tire toutes les conséquences de ce principe : il n’y a pas, ou en tout cas on ne doit jamais souhaiter un despote éclaire. « Celui qui pourrait nous contraindre au bien, pourrait aussi nous contraindre au mal. Un premier despote juste, ferme et éclairé, est un fléau ; un second despote juste, ferme et éclairé, est un fléau plus grand : un troisième qui ressemblerait aux deux premiers, en faisant oublier aux peuples leur privilège, consommerait leur esclavage. » (II, 35, 299.) À juste titre Jean Deprun rapproche ce passage de la Réfutation d’Helvétius : « Le gouvernement arbitraire d’un prince juste et éclairé est toujours mauvais. Ses vertus sont la plus dangereuse et la plus sûre des séductions : elles accoutument insensiblement un peuple à aimer, à respecter, à servir son successeur quel qu’il soit, méchant ou stupide. » (T. I, section iv, ch. i.) Voir également, dans les Mémoires pour Catherine II : « Tout gouvernement arbitraire est mauvais ; je n’en excepte pas le gouvernement arbitraire d’un maître bon, ferme, juste et éclairé. Ce maître accoutume à respecter et à chérir un maître, quel qu’il soit. Il enlève à la nation le droit de délibérer, de vouloir ou de ne pas vouloir, de s’opposer, de s’opposer même au bien. Le droit d’opposition me semble dans une société d’hommes, un droit naturel, inaliénable et sacré. Un despote, fût-il le meilleur des hommes, en gouvernant selon son bon plaisir, commet un forfait. C’est un bon pâtre qui réduit ses sujets à la condition des animaux ; en leur faisant oublier le sentiment de la liberté, sentiment si difficile à recouvrer quand on l’a perdu, il leur procure un bonheur de dix ans qu’ils payeront de vingt siècles de misère. Un des plus grands malheurs qui put arriver à une nation libre, ce seraient deux ou trois règnes consécutifs d’un despotisme juste et éclairé. Trois souveraines de suite, telles qu’Elizabeth, et les Anglais étaient conduits imperceptiblement à un esclavage dont [on] ne peut déterminer la durée. » (Mélanges philosophiques, historiques etc., 1773, chapitre 24 « De la Commission », éd. G. Dulac, à paraître dans DPV, pagination provisoire p. 67). 8. « Ses prédécesseurs avaient commencé la ruine des mœurs, il la comble » (I, 82, 153). 9. La révolte fascine Diderot. Dans les Mémoires pour Catherine II, Diderot écrivait déjà : « Il est dans l’homme une qualité singulière dont je fais grand cas ; c’est de se porter à toutes les actions hasardeuses. On punit de mort un homme convaincu d’avoir affiché un placard séditieux et injurieux au roi. Le lendemain, on en affiche vingt autres plus atroces que le premier. Au moment où il y eut danger de mort, 1 action qui n’était qu’une lâcheté prit un caractère d’héroïsme. Quel plaisir que de courir le hasard de la vie ! » (Mélanges philosophiques, historiques etc., chap. 20 « Sur la tolérance », p. 55). 10. La restriction est plus forte encore dans l’ajout de la deuxième édition. Voir le texte entre crochets au haut de la p. 55 qui, identifiant le stoïcien au janséniste, le dissocie de Sénèque. 11. J. DERRIDA montre dans les premières pages d’Apories le travail de la coupure qui est à l’œuvre dans l’Essai sur les règnes de Claude et de Néron et dans la méditation de Sénèque sur finis (la fin / la frontière), laquelle doit être mise en relation avec le De finibus de Cicéron (Apories, Galilée, 1996).
77
12. A rapprocher des « importantes frivolités » citées plus haut (I, 90, 165). 13. Voir 1, 105, 188. 14. Jean-Marie
GOULEMOT
avait déjà attiré l’attention sur cette fonction herméneutique du
détachement stylistique dans l’Essai : « le commentaire n’est nullement un genre mineur ou la preuve d’une inspiration défaillante, ici écrire en marge de Sénèque, puis en marge de ce que l’on a écrit sur Sénèque, mais au contraire, formellement le moule d’une écriture fragmentaire en rebonds, reprises et retours, et stylistiquement la figure incomplète du dialogue, paradoxalement enfin, peut-être, par son éclatement même le lieu d’une synthèse par la diversité des angles d’attaque et des points de vue. » (« Jeux de conscience, de texte et de philosophie : l’art de prendre des positions dans l’Essai sur les règnes de Claude et de Néron de iderot », Revue des sciences humaines, 54, n° 182 (1981), p. 47.) 15. « Or quel écrivain a plus que lui de ces pensées saillantes, qui peuvent se détacher sans faire tort à l’ensemble ? [...] il n’a donc pas 1 empreinte du génie. » (Journal de Paris, 25 janvier 1779, p. 98 ; voir II, 10, 257.) 16. « ce qui suit ne sont plus que les réclames de ce que [Suzanne] promettait apparemment d’employer dans le reste de son récit » (DPV XI 275). 17. Jacques
PROUST,
« Diderot et l’expérience russe : un exemple de pratique théorique au dix-
huitième siècle », Studies on Voltaire, 154 (1976), p. 17/7-1800. 18. J. PROUST, art. cit., p. 1779. 19. « La maxime n’a pas d’auteur. Elle est l’expression d’une vérité qui dépasse l’auteur » (Art. cit., p. 1780) 20. « Je vais donc commencer par les Lettres, transportant dans l’une ce qu’il aura dit dans une autre, généralisant ses maximes, les restreignant, les commentant, les appliquant à ma manière, quelquefois les confirmant, quelquefois les réfutant ; ici, présentant au censeur le philosophe derrière lequel je me tiens caché ; là, faisant le rôle contraire, et m offrant a des flèches qui ne blesseront que Séneque caché derrière moi. » (p. 229) 21. Art. cit., p. 1780. 22. « Ces actions, ce n’est pas dans le fond d’une retraite paisible où la sécurité nous environne, dans une bibliothèque, devant un pupitre, qu’on les juge sainement : c’est dans l’antre de la bête féroce qu’il faut être ou se supposer, devant elle, sous ses yeux étincelants, ses ongles tirés, sa gueule entrouverte et dégouttante du sang d’une mère ; c’est là qu’il faut dire à la bête : « Tu vas me déchirer, je n’en doute pas, mais je ne ferai rien de ce que tu me commandes. » » (I, 108, 194.) C’est là qu’il faut dire... mais qui dit ? Diderot ? Sénèque ? Tout homme ? 23. La dimension polémique de l’Essai, qui à la deuxième édition répond vertement aux injures des journaux, éclate à tout instant et constitue le point de départ de la révolte : « Mais voulezvous exposer Socrate à des invectives atroces, à des imputations mille fois réfutées, ressusciter des Anites et des Mélites ? écrivez l’apologie de Socrate » (I, 50, 106) ; « on lit dans le journaliste une tirade d’invectives où l’on aurait peine à reconnaître un professeur d’urbanité ; mais je suis injurié dans la page avec tant d’honnêtes gens que j’aurais trop mauvaise grâce à m’offenser » (I, 122, 222, note de Diderot) ; « Nos bibliothèques immenses, le commun réceptacle et des productions du génie et des immondices des lettres, conserveront indistinctement les unes et les autres. Un jour viendra où les libelles publiés contre les hommes les plus illustres de ce siècle seront tirés de la poussière par des méchants animés du même esprit qui les a dictés ; mais il s’élèvera, n’en doutons point, quelque homme de bien indigné qui décèlera la turpitude de leurs calomniateurs, et par qui ces auteurs célèbres seront mieux défendus et mieux vengés que Séneque ne l’est par moi. Le vice des ignorants est d’enchérir sur les invectives des méchants, dans la crainte de n’en paraître que les échos. Les détracteurs modernes de Séneque ont été beaucoup plus cruels que les anciens : les douze lignes d’un Suilius ont enfanté des volumes d’injures atroces » (II, 37, 304). 24. Jacques Proust et à sa suite J.-M. Goulemot ont tenté de suivre les glissements du « je » au « nous » de l’énonciation.
78
25. J. PROUST, art. cit., p. 1788-1789. 26. Ibid., p. 1795. 27. Voir le texte cité plus haut (I, 74, 140). 28. Diderot insiste lourdement sur le caractère apologétique de son Essai : « C’est dans une cinquantaine d’années, c’est lorsque je ne serai plus qu’on rendra justice à Séneque, si mon apologie me survit » (I, 46, 96) ; « je ne suis point accusateur, je suis apologiste » (I, 50, 107) ; « Ce n’est point une satire que j’écris, c’est mon apologie, c’est celle d’un assez grand nombre de citoyens qui me sont chers » (I, 67, 130, noter la dilution de la figure de l’auteur) ; « je me serai du moins occupé de l’apologie d’un grand homme » (II, 91, 383) ; « pour ne pas donner à mon apologie une fausse solidité en affaiblissant les objections [de Quintilien], je vais les rapporter dans ses propres termes » (II, 102, 396) ; « Lisez [Sénèque], relisez-le en entier, lisez Tacite, et jetez au feu mon apologie » (II, 105, 399-400). Les références se multiplient à la fin du texte, notamment dans le discours rapporté de Marmontel (p. 405, 406, 408, 417, 426). 29. Honnête : conforme à l’honestum stoïcien, c’est-à-dire au devoir du philosophe. 30. Sur la confusion du philosophe et du courtisan, voir I, 48, 99-100 et I. 83, 155. 31. « Pour faire le bien, un ministre des provinces a mille occasions où le consentement de César lui est inutile ; tout autant pour prévenir ou réparer le mal ; c’est la prérogative inséparable de son poste. Les amis, les parents, les bons citoyens qui avaient été attachés au philosophe ne furent persécutés qu’après sa mort. » (I, 46, 93.) Le commentaire historique s’objective dans la deuxième partie de l’Essai en maxime : « Les hommes ne se considèrent pas assez comme dépositaires du bonheur, ni de l’honneur de ceux auxquels ils sont attachés par les liens du sang, de l’amitié, de la confraternité. » (II, 23, 279.) 32. Comme Paolo Casini le remarque, « le problème de la morale [...] se déplace du terrain du « système », et des idées « claires et distinctes », à la sphère du goût et de la sensibilité. » (Art. cit., p. 243.) 33. Comparer avec le texte des Mélanges philosophiques, historiques etc... cité note 9. 34. DPV XVI 520-525 ; CFL VII 371-376. Voir S. Lojkine, Le Dialogue et l’image : essai sur la poétique de Diderot dans les années 1760, Thèse, Paris VII, 1993, chapitre I, p. 90-97. Le rapprochement avec Le Chêne et le roseau de La Fontaine suggéré par Jean Deprun n’est guères convaincant. 35. On reconnaît bien sûr ici la formule biblique vox clamantis in deserto (Isaïe, 40, 3) reprise au début des Évangiles. 36. Contre Sénèque, Diderot réhabilite plus loin le théâtre : « "Sachons mettre de la différence entre les applaudissements de l’école et ceux du théâtre." Et pourquoi ? Ils sont accordés les uns et les autres à la vertu et au talent... » (II, 21, 274). Sur la fonction pédagogique et politique du théâtre chez Diderot, voir le Paradoxe sur le comédien, éd. S. Lojkine, A. Colin, 1992, intro. p. 53-59. 37. Paolo Casini conclut son article en faisant remarquer cette coïncidence qui travaille l’Essai de la posture moderne et de la figure antique de l’engagement : « L’apologie de Sénèque est en même temps une parabole au sujet des despotes, un véritable acte d’accusation contre tous les tyrans. On ne peut s’y tromper : l’Essai sur Sénèque est quelque chose de plus qu’une méditation sur la morale privée, qu’un testament spirituel. En 17/8 comme en 1782, c’est un acte de politique militante. Diderot ne choisit point la retraite, mais l’attitude du "sage en évidence, comme l’athlète sur l’arène" : la posture de l’orateur ancien. » (Art. cit., p. 248.) 38. Paolo Casini arrive au même constat : « Son apologie de Sénèque tourne précisément autour de la vieille question que les stoïciens romains avaient placée au centre de leur éthique : Sitne sapientis ad rem publicam accedere ? L’enjeu n’est pas une simple attitude subjective, comme la position personnelle de Sénèque face à Néron, ou de Diderot face à Catherine II. » (Art. cit., p. 247) 39. Voir à ce sujet John Hope MASON, « Portrait de l’auteur, accompagné d’un fantôme : l’Essai sur Jes règnes de Claude et de Néron », in Diderot : les dernières années, 1770-84, colloque du bicentenaire,
79
Edimbourg, 1984, éd. Peter France et Anthony Strugnell, Edimburgh University Press, 1985, p. 43-62. 40. Sénèque. 41. La position n’est pas toujours facile à tenir entre les antiphilosophes détracteurs de Sénèque et le détachement antipolitique du stoïcisme : « "Sénèque n’a donc point de défauts ?" Il en a, et je crois lui en avoir remarqué. Ne se laisse-t-il jamais emporter au-delà des limites de l’exactitude par sa manière forte et vive de sentir ? C’est un reproche que je lui ai fait, puisque je l’ai souvent contredit, j’ai donc pensé qu’il s’était trompé ? S’est-il en effet trompé ? C’est, me disait un ami, ce qu’une seconde lecture m’apprendra (II, 15, 264) ». 42. Voir également l’anecdote de Cneius Pison et des trois soldats romains, et le commentaire indigné de Diderot appelant les condamnés au meurtre de leur général (II, 46, 317). Plus loin, Diderot fait contre Sénèque l’éloge de ceux qui « toute leur vie éprouveront une profonde indignation a l’aspect de l’injustice » (II, 46, 318). 43. Allusion à l’anecdote du conseiller Prexaspe et du roi Cambyse, racontée par Hérodote (Histoire, III, 34-35), reprise dans le De ira (III, 14, 2) et évoquée quelques lignes plus haut dans l’ Essai. Mais Sénèque ne laissait pas éclater son indignation en ces termes : O regem cruentum : O dignum in quem omnium suorum arcus verterentur.’, « O roi sanguinaire, tu mériterais que les arcs de tous tes sujets se retournent contre toi ! » (III, XIV, 4.) La condamnation morale du roi ne débouche que très indirectement sur une incitation à la vengeance : Non veto patrem damnare regis sui factum, non veto quaerere dignam tam truci portento poenam, « je ne défends pas à un père de condamner les actions de son roi, je ne lui défends pas de rechercher le châtiment d’une atrocité aussi barbare » (XV, 2). On est loin du cri révolté de Diderot ; il s’agit ici plutôt d’une concession oratoire embarrassée qui permet de conclure immédiatement aux deux idées essentielles : on peut toujours réfréner sa colère (XV, 3) ; on peut toujours se libérer du tyran par le suicide (XV, 4). 44. A comparer avec les « quelques préceptes qui répugnent à la nature, et dont la pratique rigoureuse ajouterait peut-être a la misère de notre condition » (1, 127, 227). 45. manquer à : ne pas remplir ses obligations vis-à-vis de. 46. On ne peut qu’être indigné de l’interprétation que J.-M. Goulemot donne du rapport à la révolte dans l’Essai (art. cit., p. 53). On ne peut parler de filiation entre Diderot et les « libertins érudits », toujours hostiles à Sénèque : Diderot condamne sans appel Saint-Evremond (II, 37, 300-304) et La Mettrie (II, 6, 246-248). On ne peut définir ni l’énonciation diderotienne comme une « politique du retrait et du masque » ni la posture du philosophe dans l’Essai comme une posture méprisant le peuple et stigmatisant les révolutions : les citations données dans 1 article sont détournées ou tronquées. Il ne s’agit pas ici de satisfaire à tout prix à « l’image d’un Diderot progressiste chère a la critique contemporaine » (Utinam !), mais de satisfaire à la vérité. L’interprétation de J.-M. Goulemot tire probablement son origine d’un passage de l’article de Jacques Proust, parlant à propos de l’Essai « d’un mépris de fer pour le peuple en général, jugé décidément incapable de s’élever jusqu’au niveau de conscience du philosophe : "L’homme peuple est le plus sot et le plus méchant des hommes ; se dépopulariser ou se rendre meilleur, c’est la même chose." » (Art. cit., p. 1796). L’homme peuple ne désigne pas l’homme du peuple en général, mais, comme le fait remarquer Jean Deprun, l’homme qui fait peuple, le démagogue (II, 36, 297 et n. 611 et 612). Il ne faudrait pas confondre mépris pour les démagogues et mépris pour le peuple, ou même retrait vis-à-vis du peuple. La démonstration générale de J. Proust dans cet article vise d’ailleurs à prouver le contraire. 47. II, 74, 355-356 et p. 417-418. 48. Voir notre note 19. 49. Les références à Kant sont données dans la traduction de la Pléiade (dir. F. Alquié). Le texte de la Critique de la raison pratique, publié dans le tome II, a été traduit par Luc Ferry et Heinz Wismann.
80
50. Ce rapport que nous établissons ici demeure bien entendu purement théorique, Kant n’ayant probablement jamais eu connaissance de l’Essai. Il s’agit de comparer deux réactions contemporaines, deux rapports au stoïcisme. 51. Cette position n’a rien à voir ni avec un pragmatisme machiavélique (la fin justifie les moyens), ni avec une prudence politique plus ou moins opportuniste (de type vichyssois). Pour Diderot, la révolte du philosophe ne saurait être motivée par la question subjective de sa propre intégrité morale, mais par un certain travail de la chose politique dans le monde : c’est une situation générale, une accumulation d’injustices, non un cas de conscience offert à la casuistique de la vertu qui motive la révolte politique. 52. Seule la bonne action était évoquée dans les deux textes sources.
81
Joseph de Maistre, nouveau mentor du prince : le dévoilement des mystères de la science politique Jean-Louis Darcel
1
Joseph de Maistre, on l’a souvent noté, n’a pas fait œuvre d’idéologue de la ContreRévolution ; ses œuvres sont des essais fragmentés, parfois inachevés, souvent publiés après sa mort. En vingt ans, des Considérations aux Soirées1, elles touchent à l’histoire politique, à la controverse philosophique et religieuse sans construire une doctrine au sens où nous l’entendons, ce qui est surprenant de la part du plus radical des contempteurs de la modernité. Diverses raisons ont été avancées : son rejet d’une organisation rationnelle de la société l’amène à condamner toute construction intellectuelle qu’il assimile dédaigneusement à un exercice d’école de faiseurs de système ou de constitution en chambre ; le peu de temps à consacrer à son œuvre littéraire que lui laisse sa vie de magistrat et de diplomate ; son incapacité, enfin, à produire un traité en forme comme en témoigne l’abandon en 1796 de son étude sur la souveraineté qu’il avait pourtant conçue comme un anti-contrat social2. Alors, est-ce refus, impossibilité ou incapacité de sa part de faire œuvre de théoricien ?
2
Je voudrais ici envisager une autre problématique peut-être plus riche de perspectives nouvelles, en tout cas peu explorée. Puisqu’on lui attribue le statut d’écrivain, croire qu’il a écrit pour un public paraît relever de l’évidence, mais peut dans son cas relever de l’illusion. Il ne s’est jamais posé en écrivain comme plusieurs de ses connaissances ou correspondants, Germaine de Staël, Benjamin Constant, Chateaubriand, Lamartine, Lamennais, Ballanche ou Bonald. Nombre de ses œuvres sont restées dans son portefeuille et celles publiées l’ont été avec réticence, parfois à son corps défendant. Tout se passe comme si ce n’était pas le public qu’elles visaient, mais, risquons l’hypothèse, le prince, le détenteur de la souveraineté, l’unique interlocuteur très consciemment interpellé par le maçon investi d’une mission. Il nous reste à en justifier le bien fondé.
3
Il convient de rappeler d’abord que les œuvres de Joseph de Maistre sont nées des circonstances dont il fut à la fois observateur et acteur : la tentative de reconquête de la Savoie par le roi de Sardaigne en 1793 ; le rétablissement possible de la monarchie en
82
France dès 1797 ; la perspective d’un empire constitutionnel en Russie en 1808 ; l’effondrement prévisible de l’Empire napoléonien à partir de 1812 et l’urgence de penser le nouvel ordre politique et religieux européen à partir des antiques monarchies régénérées. 4
Des indices convergents issus de l’étude attentive des manuscrits3 permettent d’avancer que ses œuvres n’étaient pas destinées à la publication, mais que leur destination première était d’éclairer le souverain, de peser sur ses choix ou ceux de son entourage. Nous serions en présence de monitions ou de plaidoyers produits par un expert de la science politique et maçon mystique qui en dévoile les secrets à son lecteur privilégié, en principe omnipotent. Avec les œuvres de la période russe, dont le mysticisme martiniste s’affiche ostensiblement, où les allusions maçonniques affleurent, nous serions même en présence d’un dialogue maçonnique entre le frère Josephus a Floribus et le frère Alexandre, initié en 1803 peu après son accession au trône par le maçon mystique Ivan V. Boeber, si l’on en croit le répertoire des francs-maçons russes dressé par Tatiana Bakounine.
5
On voit alors les conséquences en terme d’intertextualité : le texte que nous connaissons serait la version établie à l’usage du profane d’un hypotexte destiné primitivement au prince initié pour infléchir ses décisions dans le sens de l’illuminisme catholique maistrien. L’œuvre serait véritablement à double entrée : une lecture ésotérique des secrets du monde en train de naître de la Révolution et une lecture exotérique, partiellement recodée, que Maistre se résout de livrer après l’échec de sa mission de conseiller occulte. Cette interprétation n’est pas nouvelle. C’était déjà celle amorcée par Emile Dermenghem dans son Joseph de Maistre mystique4, plus près de nous c’est celle d’Henry Corbin et de Gilbert Durand, familiers comme on sait de la pensée et de l’écriture maçonniques5.
6
Sur l’engagement maçonnique de Joseph de Maistre, sur sa précocité, sa profondeur et sa permanence, je renvoie aux recherches éclairantes de Jean Rebotton6. Il est néanmoins utile de rappeler que, dès 1782, dans son Mémoire au duc de Brunswick, grand maître de la Stricte Observance Templière, Maistre fixe aux maçons du second grade comme double mission « l’instruction des gouvernements et l’union des Eglises »7 : On ajoute que très souvent les princes et les dépositaires de leur puissance désirent trouver la vérité, sans pouvoir se flatter de la rencontrer. Dans ces occasions délicates où les passions déroutent si souvent l’équité la plus clairvoyante, une société dévouée par les motifs les plus sacres à faire triompher la vérité pourrait rendre des services essentiels, soit en la faisant parvenir indirectement aux agents de l’autorité, soit en entrant en correspondance avec eux, s’ils appartenaient à l’ordre, ce qui peut arriver aisément.
7
Quelques pages plus loin, à propos du Christianisme transcendant, objet d’étude du troisième grade, il écrit : « Tout est mystère dans les deux Testaments, et les élus de l’une et l’autre loi n’étaient que de vrais initiés. Il faut donc interroger cette véritable antiquité, et lui demander comment elle entendait les allégories sacrées. »8
8
Maistre a été sa vie durant fidèle à ce programme, même si la mise en accusation de la Franc-Maçonnerie dans les milieux contre-révolutionnaires le contraignit à la plus extrême prudence : sa correspondance en témoigne. Il a privilégié l’entretien personnel où son « impérieuse éloquence » faisait merveille : ses carnets intimes conservent la trace des nombreuses audiences demandées et obtenues, notamment avec Alexandre. Il a utilisé la médiation de l’œuvre manuscrite quand, suivant la conjoncture, il devenait
83
persona non grata, suivant une stratégie qui fait songer à celle d’Alceste : « Peu m’importe [...] qu’on dise de moi ceci ou cela, ou qu’on me prête telle ou telle vue. Je vais droit à ce qui me paraît juste et vrai ; et je laisse dire »9 ; ou encore : « Il faut écouter les gens qui savent la politique, et ne pas les traiter de mauvaises têtes [...] lorsqu’ils montrent très respectueusement du bout du doigt un abyme où l’on court. »10
Les œuvres de la période 1793-1803 9
Les œuvres de cette période sont à cet égard les plus difficiles à interpréter. On sait, par exemple, que les Lettres d’un royaliste savoisien, au nombre de quatre avec une cinquième esquissée, ont été destinées à servir à la propagande royaliste lors de la tentative avortée de reconquête de la Savoie en 1793. Rédigées et publiées sous le patronage de Jacques Mallet Dupan, elles appartiennent au genre du libelle destiné à agir sur l’opinion. Toutefois, Joseph de Maistre prenait soin d’envoyer son manuscrit à Turin où son appartenance à la Franc-Maçonnerie était connue et lui valait une particulière suspicion. Les maçons étaient nombreux à la cour de Turin même si les loges étaient dissoutes par ordre du roi depuis 1789. Aucun document, aucun indice ne permet d’identifier les destinataires turinois connus de l’auteur pour appartenir à l’ordre.
10
Les Considérations sur la France sont plus intéressantes. Écrites au début de 1797 dans le milieu lausannois où les maçons étaient nombreux et divisés en deux obédiences rivales : le Grand Orient acquis aux idées émancipatrices de la Révolution, et les loges mystiques rattachées au Rite Ecossais Rectifié où le Philosophe inconnu, Louis-Claude de SaintMartin, était en grand honneur. On peut conjecturer que l’amie de Joseph de Maistre, Isabelle de Polier, directrice de la Gazette de Lausanne était au cœur d’un foyer actif de maçons mystiques. Toutes ses archives ayant disparu dans un château de Prusse orientale à la fin de la seconde guerre mondiale, on ne peut aller plus loin. Toutefois, l’œuvre qui développe la thèse providentielle et une lecture mystique de la Révolution dans la perspective martiniste offre déjà une double lecture.
11
Un autre indice peut être relevé. La page de titre du manuscrit révèle que le dédicataire de l’œuvre était primitivement Niklaus-Friedrich von Steiger (1729-1799)11, premier magistrat de la ville et république de Berne et ardent adversaire de la Révolution. Comment imaginer que Joseph de Maistre ait pris le risque de compromettre la plus haute autorité bernoise par la publication d’un libelle contre-révolutionnaire aussi explosif ? N’est-ce pas, par contre, l’indice que le manuscrit des Considérations lui était destiné pour prolonger leur discrets entretiens à Lausanne entre 1793 et 1796 ? Maistre, ayant été amené à le publier à la demande de Louis Fauche-Borel, agent du comte de Provence, remania son manuscrit et fit disparaître toute référence au dédicataire.
12
Mais la plupart des œuvres de Joseph de Maistre ont été conçues à Saint-Pétersbourg. Se trouve posée de façon moins ténue la relation privilégiée quoique ambiguë entre l’ambassadeur de Sardaigne et l’entourage immédiat du tsar, puis Alexandre lui-même.
Les œuvres de la période russe : 1808-1815 13
Joseph de Maistre, dès son arrivée à Saint-Pétersbourg en mai 1803, s’intègre rapidement grâce à son frère Xavier, mais plus encore grâce aux amitiés maçonniques et ce qu’on peut aujourd’hui en connaître : il vit dans l’entourage de personnes ou de familles qui
84
jouent un rôle important dans les débuts de la franc-maçonnerie en Russie comme dans la vie politique russe : les Gagarine, Tolstoï, Pouchkine, Potocki, Razoumosky, Stedding12. Si sa position de diplomate étranger l’obligeait à se tenir à l’écart, il ne pouvait qu’être informé de « la guerre » des obédiences où l’on retrouve les trois courants de la francmaçonnerie du XVIIIe siècle, déiste, rationaliste et mystique, et leur positionnement politique face à la Révolution et l’Empire : libéralisme anglo-saxon, réformisme profrançais et adversaires de la Révolution. Les deux premiers représentaient des adversaires, le dernier des alliés. Dans un livre récent, Franck Lafage dresse un fort éclairant état de la question13. Les archives russes offrent de nouveau un champ d’étude passionnant sur la ville la plus cosmopolite d’Europe, sur la personnalité d’Alexandre I er, sur les débats d’idées et les enjeux de l’époque. Nul doute que les travaux en cours ne permettent de mieux situer le rôle du ministre du roi de Sardaigne14 dans les luttes d’influence très âpres qui se déroulent dans l’entourage du tsar. C’est dans ce contexte qu’il faut situer la genèse de l’Essai sur le principe générateur des constitutions politiques et des autres institutions humaines dont le manuscrit initial est daté de mai 180915. 14
Pour être interprété, cet essai est donc à situer dans le contexte de l’alliance franco-russe signée à Tilsitt (juillet 1807), de ses suites et de la mise en œuvre d’une constitution russe confiée à Michel Speranski. Il comporte soixante-sept articles où Maistre, sans viser apparemment le projet du principal ministre et conseiller d’Alexandre, récuse le constitutionalisme à l’anglaise et à la française, de telle sorte que sa réfutation apparaisse comme la critique permanente de la constitution d’empire en gestation. La thèse de Maistre, qui rappelons-le est juriste de formation et de profession, est de fixer la limite du droit et, par suite, des lois écrites : la loi s’arrête où commence le droit du souverain, à savoir sa maîtrise plénière - absolue - de la souveraineté. Ce qui condamne toute constitution, qu’elle soit imposée comme en France par une assemblée usurpatrice ou qu’elle soit octroyée ainsi qu’Alexandre envisageait de le faire et que Louis XVIII le fera en 1815.
15
Il réfute l’essai de Locke sur le gouvernement civil en lui opposant les jurisconsultes anciens et modernes, dont le célèbre genevois Delolme, des théologiens contemporains comme Bergier. A partir de l’article XIX, après avoir abondamment cité Platon et saint Jean Chrysostome, père de l’église d’Orient cher à l’orthodoxie, son texte se charge de réminiscences des thèses de Saint-Martin transparentes pour des lecteurs familiers de l’œuvre du théosophe16. Une moitié des articles passe en revue l’antiquité et les temps modernes pour justifier la loi immuable rappelée en conclusion : « D’un côté, le principe religieux préside à toutes les créations politiques ; et de l’autre, tout disparaît dès qu’il se retire » (LXVI). Dans le dernier article surgit l’allégorie maçonnique de « l’éternel architecte » dont l’œil observe l’Europe coupable « d’avoir fermé les yeux à ces grandes vérités » et qui s’apprête à expier « certains crimes commis par les individus, par les nations et par les souverainetés » (LXVII).
16
Derrière l’apparente généralité de la réflexion sur « le principe générateur des constitutions politique », c’est la Russie, ce sont les mauvais conseillers du tsar, c’est le souverain lui-même qui sont désignés comme les perturbateurs de l’harmonie politique voulue par Dieu. Ce mysticisme révèle un imaginaire qui est dans l’analyse politique le correspondant de la vision du monde développée par le romantisme européen. Qui d’autre la monition viserait-elle en 1809, à Saint-Pétersbourg, où Joseph de Maistre se veut théologien de la politique ? Rien ne permet de dire à qui le manuscrit était destiné. Alexandre, les adversaires de Speranski, le duc de Serra-Capriola auquel Maistre était lié
85
intimement, le comte Razoumovski qui sera le destinataire des Cinq lettres sur l’éducation publique en Russie de 1810, eux qui joueront un rôle décisif dans l’éviction du ministre réformateur et dans le retour en 1812 à l’autocratie, version russe de l’absolutisme. On voit les zones d’ombre que l’histoire littéraire a encore à dissiper pour situer avec exactitude la genèse du texte et ses enjeux. Les papiers de l’écrivain aujourd’hui accessibles aux archives départementales de la Savoie peuvent y contribuer tout en sachant que les activités de l’initié y laissent peu de traces écrites. Peut-être que les archives de Saint-Pétersourg apporteront quelque écho de la réception du manuscrit à partir de 1809, en tout cas lors de sa publication en mai 1814. 17
Avant même la rupture de l’alliance franco-russe en 1811 qui débouchera sur l’invasion de la Russie par la Grande Armée, Maistre intervient nommément dans une série de cinq lettres (juin-juillet 1810) destinées au ministre de l’instruction publique, le maçon mystique Alexis Razoumoski, lettres auxquelles il convient de rattacher une série d’opuscules17. De façon significative ces lettres sont la transcription littéraire des positions développées par Maistre lors des entretiens entre les deux hommes, à la demande du ministre d’Alexandre. Maistre y expose ses vues sur la réforme de l’instruction publique, particulièrement de l’Université, sur la place et sur le rôle des jésuites en Russie. La troisième lettre précise clairement le rôle que se fixe l’auteur 18 : Je ne prétends pas du tout, M. le Comte, changer les idées d’une nation et proposer des choses impraticables ; mais je pose les principes et je cite les exemples. Ce sera ensuite aux hommes d’État qui connaissent les hommes et les choses, de prendre les précautions qu’ils jugeront convenables pour approcher du but comme ils pourront et autant qu’ils pourront.
18
C’est bien en nouveau mentor que Maistre situe son rôle. Celui de gardien des vrais fondements de la science politique et de mémorialiste des « exemples » présentés par les civilisations passées et présentes. Sa quête de l’unité l’amène à prendre en compte la totalité de l’espace-temps : à l’observation du présent, il associe l’approche prospective et le regard rétrospectif liant le sacré et le profane. Par ailleurs, sa vaste culture allant de l’antiquité gréco-latine et du fonds judéo-chrétien aux cultures de l’Orient, de l’Inde et de la Chine telles qu’il pouvait les connaître à travers les mémoires des missionnaires jésuites en Chine et ceux des indianistes de Calcutta, s’ouvre depuis Saint-Pétersbourg aux cultures germaniques et slaves. Ce qui déroute ses lecteurs français est sans doute son impressionnante culture cosmopolite qui lui a fait franchir les frontières culturelles et temporelles, même s’il lit la société russe, la philosophie allemande ou anglaise avec ses préjugés de catholique ultramontain. La visée universelle de Joseph de Maistre en fait incontestablement l’héritier de l’encyclopédisme des Lumières pour leur opposer un encyclopédisme des anti-Lumières. Proche, Franck Lafage a raison de le souligner 19, de celui des théosophes du romantisme allemand, Heinrich Jung-Stilling, Karl von Eckartshausen et Franz Xavier von Baader.
Du Pape comme utopie politique 19
De son adhésion au catholicisme, de sa fréquentation des sources chrétiennes et de son érudition à prétention universelle, vont naître les Soirées de Saint-Pétersbourg dont le manuscrit date pour l’essentiel des années 1809-181020. On sait qu’elles circulaient à l’état de manuscrit dans la haute société pétersbourgeoise et que leur publication interviendra dix ans plus tard à la demande insistante de sa fille Constance, non sans de fortes
86
réticences de leur auteur. Là également, tout se passe comme si la publication de son chef-d’œuvre n’avait pas été la visée première de Joseph de Maistre. 20
Mais sa dernière œuvre d’envergure est Du Pape qui est, on l’oublie trop souvent, une œuvre écrite en Russie puisque le manuscrit primitif porte la date de 1817. Cette apologie de la catholicité destinée à des lecteurs russes va encore plus loin que le parallélisme classique entre la souveraineté temporelle du roi et la souveraineté spirituelle du pape, par ailleurs également souverain temporel. Maistre imagine une utopie faisant du Pape le souverain universel. Elle est déjà évoquée dans la Lettre à une dame russe de février 1810 21 : Et si l’on s’entendait tous pour une monarchie tempérée par les lois fondamentales et par les coutumes, avec des états généraux pour les grandes occasions, composée d’un souverain qui serait le Pape, d’une noblesse formée par le corps épiscopal, et d’un tiers état représenté par des docteurs et par les ministres du second ordre, il n’y a personne qui ne dût applaudir à ce plan.
21
L’allégorie représente évidemment l’Église romaine, mais elle est suffisamment ambiguë pour qu’elle n’exclut pas une souveraineté temporelle universelle. Et là nous entrons dans l’utopie d’une humanité réconciliée avec elle-même et avec Dieu sous l’égide du Pape, restauration d’une chrétienté médiévale mythique reconstituant la robe sans couture, l’unité perdue et enfin retrouvée.
22
Cette vision grandiose de la nouvelle Europe que Maistre porte en lui, dont les dynasties alliées seraient pacifiées, dont les intérêts nationaux divergents se trouveraient transcendés par le pasteur commun, révèle un imaginaire puissant progressivement libéré au contact du mysticisme slave.
23
La vision « métapolitique » de l’unification politique de l’Europe est peut-être une extension de l’expérience à laquelle Maistre a été mêlé de près, celle de la survie et du succès de la Compagnie de Jésus recueillie en terre non catholique. Histoire, en effet, extraordinaire que cet institut fondé au XVIe siècle pour assurer la défense de la papauté de la Contre-Réforme, chassé des États catholiques à partir de 1759, supprimé par Rome en 1773, et ayant trouvé refuge et reçu mission d’éducation des élites en terre protestante, la Prusse de Frédéric et, plus encore, la Russie de Catherine, de Paul et d’Alexandre. Oui l’unité est possible, elle est pour demain puisqu’elle existe déjà expérimentalement.
24
Le livre Du Pape s’achève sur un hymne mi-religieux mi-profane fort développé puisqu’il occupe l’ultime chapitre XVIII22. Il est dédié à la « sainte Eglise romaine », présenté « comme un spectacle superbe », construit comme une gloire baroque des églises de la Contre-Réforme... ou comme une de ces allégories qu’affectionnent les loges mystiques.
25
L’hymne commence par les voix alternées et réconciliées de Bossuet et de Fénelon qui accompagnent, tels des prophètes, le cortège des pontifes romains « agents suprêmes de la civilisation, créateurs de la monarchie et de l’unité européennes, conservateurs de la science et des arts, fondateurs, protecteurs nés de la liberté civile, destructeurs de l’esclavage, ennemis du despotisme, infatigables soutiens de la souveraineté, bienfaiteurs du genre humain »23. Accompagnés du cortège de tous les saints, ils montent vers la « Ville Eternelle », comme une caravane humaine allant du Panthéon antique au Panthéon chrétien, Saint-Pierre de Rome. Du Pape s’achève comme le livre de l’Apocalypse sur la vision de la « cité sainte », la « Jérusalem céleste », le livre phare de la maçonnerie mystique.
87
26
Ainsi, la spéculation théologico-politique de Maistre, si elle est lue dans la perspective d’un « illuminisme moderne » est bien une utopie de la cité idéale au sens défini par Claude-Gilbert Dubois renouant avec « les courants millénaristes médiévaux » pour qui « la cité radieuse n’est pas au-dessus de l’histoire, mais au bout de l’histoire » 24. Ne voir dans Maistre qu’un « remarquable et terrifiant prophète de notre époque » comme le fait Isaiah Berlin est réducteur25. Dans Du Pape, son œuvre ultime, il conçoit une utopie politique dans le droit fil du visionnaire de Patmos.
27
Sa vision d’une Europe de monarchies absolues régénérées en droit, limitées en fait par les pouvoirs délégués des corps constitués, sous le magistère spirituel du pape garant et « du caractère divin de la souveraineté » et de « la liberté légitime des hommes »26 est en un sens une utopie parfaite puisque restée jusqu’à ce jour à l’état de construction idéale. Elle est révélatrice de l’engagement cryptomaçonnique d’un écrivain qui déclare depuis la Révolution avoir rompu avec cette « niaiserie de franc-maçonnerie « et qui n’a jamais cessé de lui rester fidèle de cœur et d’y abreuver son imaginaire. Les obédiences mystiques de la franc-maçonnerie contemporaine ne s’y trompent pas, qui consacrent aujourd’hui à Maistre de fréquents ateliers27.
NOTES 1. Mis à part quelques mémoires chambériens antérieurs à la Révolution, son œuvre naît de l'exil au cours de la période lausannoise 1793-1797 ; six années de tribulations et de refuges temporaires l'interrompent. Le séjour à Saint-Pétersbourg est le plus fécond entre 1808 et 1817. A partir de cette année qui marque son retour à Turin, Joseph de Maistre ne compose plus, mais révise ses manuscrits, pour l'essentiel Du Pape et les Soirées de Saint-Pétersbourg. 2. Cf. mon édition, PUF, coll. Questions, 1992, p. 280. 3. Les manuscrits de Joseph de Maistre ont fait l'objet d'un don des descendants aux archives départementales de Savoie où elles sont consultables à Chambéry ou sur CD-ROM. 4. 1923 ; rééd. La Colombe, 1946. 5. Cf. Revue des études maistriennes n° 5-6, actes du colloque sur Joseph de Maistre : illuminisme et franc-maçonnerie, les Belles Lettres, Paris, 1980. 6. Maistre, alias Josephus a Floribus pendant la Révolution, Revue des études maistriennes n° 5-6, op. cit. p. 141-181 et éd. des Ecrits maçonniques, Slatkine, Genève, 1983, 145 p. 7. Ecrits maçonniques, op. cit., p. 105. 8. Ibid., p. 109. 9. Revue des études maistriennes, n° 10, p. 35. 10. Ibid., p. 47. 11. Cf. mon édition, Slatkine, Genève, 1983, p. 61. 12. Dictionnaire de la franc-maçonnerie, Dir. Daniel Ligou, PUF, 1987 ; cf. part. art. Russie, p. 1058-1064 ; et, surtout, Tatiana Bakounine, Répertoire biographique des francs-maçons russes ( XVIIIe et XIXe siècles), institut d'études slaves de l'université de Paris, 1967, 655 p. 13. Le comte Joseph de Maistre. Itinéraire intellectuel d'un théologien de la politique, L'Harmattan, 1998 ; cf. part. le chap. III, p. 121-197.
88
14. De nombreux mémoires manuscrits sont encore à exhumer de dépôts interdits de consultation durant l'ère soviétique. 15. Manuscrit revu et augmenté en mars 1812 et achevé en juin de la même année. La première édition paraîtra à Saint-Pétersbourg en mai 1814 chez Pluchart ; 1 édition parisienne paraît à la Société typographique en octobre-novembre 1814. Consulter l'excellente édition due à Robert Triomphe, Publications de la Faculté des lettres de l'Université de Strasbourg, 1959, 112 p. 16. R. Triomphe a repéré ces échos de l'Homme de désir, des Erreurs et de la vérité, du Tableau naturel, de la Lettre à un ami sur la Révolution et de l'Éclair sur l'association humaine, op. cit. 17. Publiés sous les titres : Observations sur le prospectus disciplinarum signé Philorusse ; Mémoire sur la liberté de l'enseignement public signé Philalexandre ; Quatre chapitres sur la Russie et, enfin, Réflexions critiques d'un chrétien dévoué à la Russie daté de 1812, dans O. C. Vitte, t. VIII, p. 163-447). 18. Sur l'éducation publique en Russie, 13 (25) juin 1810, O. C. VIII, p. 195-196. 19. Op. cit., p. 145-150. 20. Ed. Slatkine, Genève, 1993, t. 1, p. 14-22; 69-70. 21. O. C. VIII, p. 143. 22. Cf. la 1e éd. de 1819, Lyon-Paris, Rusand, t. 2, p. 674-681. 23. Ibid., p. 676. 24. Problèmes de l'utopie, Archives des Lettres modernes, n° 85, 1968, p. 33. 25. Le Bois tordu de l'humanité, Albin Michel, coll. Idées, 1992 ; l'essai sur Maistre est publié aux pages 100-174 sous le titre Joseph de Maistre et les origines du totalitarisme. La citation est à la page 168. 26. Du Pape, éd. citée, LUI, Chap. IV, p. 514 27. À dessein, je n'ai pas envisagé ici le cas plus complexe des Soirées. Pierre Glaudes dans son Joseph de Maistre et les figures de l'histoire (Cahier romantique n° 2, diffusion Nizet, 1997) consacre un excellent essai (p. 95-141) à l'art de la conversation sérieuse que le Comte des Soirées et ses deux compagnons portent à une rare perfection en privilégiant « la voie oblique » (p. 128). À propos du chef-d'œuvre de Joseph de Maistre, il invite le lecteur à aller au-delà du dialogue philosophique entre trois amis conversant dans un locus amoenus septentrional. La réunion peut masquer une « tenue » libre : réunion d'hommes, d'origine, de culture différentes, pratiquant une tolérance mutuelle faite d'écoute et de respect parce qu'ils se reconnaissent comme égaux. De leur dialogue réunissant les trois âges de la vie, les trois grades, naît une œuvre foncièrement cosmopolite au sens maçonnique puisqu'elle fait naître l'harmonie des trois savoirs, des trois cultures de l'Occident : la romane (le comte), la slave (le sénateur), la germanique (le chevalier). Rappelons, en effet, que le chevalier de Bray, ambassadeur de Bavière à Saint-Pétersbourg, s'il était d'origine française et admirateur de Napoléon, était un excellent connaisseur de la philosophie et de la littérature allemandes. Il avait épousé en 1805 une comtesse livonienne d'origine allemande et fera souche en Bavière (cf. Robert Triomphe, Joseph de Maistre, Droz, 1968, p. 578-582.) Dix ans après la rédaction des Soirées, Joseph de Maistre a hésité à les publier après avoir révisé et complété laborieusement son manuscrit. Est-ce l'effet de la fatigue d'un homme désabusé ? Est-ce l'aveu d'une destination primitive autre que la publication ? Primittivement, l'unique lecteur des Soirées devait-il s'appeler Alexandre ?
89
L’écrivain comme pouvoir (1778-1864) José-Luis Diaz
1
Comment l’écrivain s’est trouvé prendre symboliquement le pouvoir, entre la mort du « roi Voltaire » et le William Shakespeare de Victor Hugo : telle est la question à laquelle je vais ici tenter de répondre. Pour ce faire, je me propose d’établir une périodisation de ce phénomène.
2
C’est Paul Bénichou qui, dans un grand livre, a le premier montré comment, à partir des années 1760 et jusqu’au romantisme, s’est institué progressivement un Sacre de l’écrivain — soit à la fois une divinisation du héros littéraire et une entreprise qui a consisté à lui attribuer un « magistère » moral dont l’émergence a été favorisée par la crise de cette instance de pouvoir spirituel qu’avait été l’Église — mais aussi par la perte d’auctoritas irréversible du pouvoir royal. Mais pour mieux encore saisir la nouveauté de cet événement, il convient de jeter un coup d’œil en arrière, en deçà même de 1778.
3
Pour saisir sur le temps long l’histoire de la prise de pouvoir symbolique de l’écrivain, on doit en effet remarquer que le mouvement de balancier qui commence vers 1760, à l’époque des « secondes Lumières » — soit à l’âge de la « naissance du Panthéon » (JeanClaude Bonnet) —, constitue une nouveauté historique remarquable. Comme l’a constaté Régis Debray1, il consiste à redonner à la fois prestige et pouvoir symbolique à l’écrivain, lequel avait dû y renoncer depuis l’âge de la Contre-Réforme et l’avènement de la Monarchie absolue. Après l’époque de la Pléiade, pendant laquelle le poète-vates avait pu non seulement prétendre au couronnement symbolique sur le Capitole (à l’exemple de Pétrarque, en 1341), mais exercer aussi une sorte de régence spirituelle en une époque troublée par les Guerres de Religion et marquée par l’affaiblissement de l’autorité royale, c’est le Grand Siècle tout entier qui a réalisé une sorte de « détronisation » — ou, si l’on préfère, d’apothéose négative — de l’« auteur ». A une époque où l’État monarchique, non content d’exercer la potestas, veut récupérer aussi l’auctoritas, centraliser tous les pouvoirs pour faire concourir leur force au rayonnement de l’astre royal, il est normal qu’il veuille affaiblir le prestige des écrivains. Pour contenir leurs ambitions, les voici réduits au rang de simples artisans de luxe au service de la monarchie, et sommés de reconnaître euxmêmes leur indignité. Car le plus beau de l’affaire, c’est que ce sont les écrivains eux-
90
mêmes qui ont procédé à cette auto-dépréciation : aussi bien Malherbe clamant qu’« un poète n’est pas plus utile à l’État qu’un bon joueur de quilles », que l’auteur des Femmes savantes lorsqu’il s’en prend aux écrivains non pensionnés qui récriminent, et qui, « pour être reliés en veau, se croient dans l’État d’importants personnages2 ». Mais point besoin presque de telles censures : à l’âge des « poètes crottés », ce sont, comme l’écrit Claude Cristin, « les littérateurs [qui] sont amenés à intérioriser, à prendre à leur propre compte l’appréciation défavorable que les mécènes portent sur leur personne3 ». Pour ces écrivains portés à se regarder eux-mêmes avec les yeux méprisants de la Cour, pas question d’ambitionner autre chose qu’une simple reconnaissance académique. Ni apothéose ni lauriers : des pensions et des jetons... 4
Qu’on ne croie pas que le siècle des Lumières ait renversé d’emblée un tel état de fait. Partageant pour l’essentiel les valeurs esthétiques de l’âge classique, et le pessimisme de ses moralistes en matière d’action politique des intellectuels, les premiers philosophes, bien que gravitant dans un espace symbolique plus ouvert du fait de la mort de Louis XIV, ne furent pas portés à vouloir retrouver du prestige ni à vouloir assumer de nouveau quelque pouvoir spirituel que ce fût. Un Fontenelle acceptant d’habiter au Palais-Royal mais refusant de devenir le Malraux du Régent, tout en se montrant sceptique quant à la capacité du philosophe à éduquer le peuple ancré dans ses préjugés, voilà la figure type des premières Lumières. Le refus d’ambitionner un quelconque pouvoir n’est plus alors le fait d’une coercition exercée par l’Etat et la classe dirigeante sur les beaux-esprits et les pédants, mais devient un interdit philosophique. Comme le dira l’abbé Terrasson, il serait peu digne d’un philosophe de « se mêler du gouvernail d’un vaisseau où l’on n’est que passager4 ». Pour ces philosophes analystes qui s’exercent pour l’essentiel à la négativité critique — ce que Dumarsais appelle le « discernement5 » —, pas question de s’affirmer eux-mêmes comme des instances de pouvoir, encore moins comme des autorités symboliques para-religieuses. Car ce serait un véritable crime, pour ces négateurs patentés des prodiges et des oracles, que de trahir leur rôle de suspicion et d’analyse pour s’adonner aux mirages de l’héroïsme moral et aux simulacres de la sacralité.
5
Alors que l’essentiel était pour le premier philosophe des Lumières d’acquérir une indéfinie liberté intellectuelle, le mot d’ordre va être, après 1760, de donner à tout prix une autorité symbolique forte à « l’homme de lettres citoyen ». Renversement du tout au tout de l’ordre des urgences...
6
L’urgence était, vers 1730, du côté de la connaissance critique. La question première était d’ordre intellectuel, épistémologique. Quels préjugés mettre à bas, quels principes nouveaux établir pour percer à jour la mécanique de la Nature ? Et pas question de se mêler de politique, de rêver de changer les hommes, ni d’ambitionner le pouvoir. Avec l’« homme de lettres citoyen », avec le « sage austère » ou l’« homme de génie » dont, à partir des années 60, Thomas, Chamfort, Mercier, La Harpe vont codifier le portrait, la scène philosophique change. Délaissant la sphère du savoir critique, le philosophe — qui se met à revendiquer hautement son titre d’« homme de lettres » — se donne pour candidat à l’exercice d’une autorité spirituelle. Il se voit en « magistrat » ou en « législateur », soit donc en prêtre laïque prenant la succession du sacerdoce traditionnel tombé en déshérence. Voici qu’il ambitionne presque le pouvoir qui était celui des anciens « sages » et des anciens « législateurs » (Orphée, Zoroastre, etc.) : ceux-là même dont se gaussaient les contemporains du jeune Voltaire. Et il redéfinit sa tâche intellectuelle en fonction de ses nouvelles ambitions. Délaissant les sciences exactes et la
91
rigueur mesurée de la connaissance scientifique, il ne s’interdit plus, comme échappant à son domaine, la politique et la morale. 7
Redonnant un rôle spirituel fort, une auctoritas à l’intellectuel, la génération de l’Encyclopédie relance ainsi dans l’autre sens un mouvement de balancier qui, depuis la Contre-Réforme et les débuts de la Monarchie absolue, tendait à réduire à la portion congrue, au profit du pouvoir royal, la part de pouvoir spirituel allouée aux professionnels de l’intelligence. Mais, si l’on regarde cette fois vers l’avenir, la mutation qui commence au cœur des Lumières est d’autant plus importante qu’elle infléchit pour longtemps une histoire séculaire. En effet, cette sacralisation des intellectuels qu’initie la génération de l’Encyclopédie ne sera suspendue qu’après la retombée de l’enthousiasme romantique, à l’époque du « romantisme du désenchantement ». Ensuite, à la génération suivante, celle de Baudelaire et de Flaubert, l’écrivain, passé l’âge du sacre, sera réduit à sa fonction peu reluisante de technicien obsessionnel. Doutant sans cesse de la valeur de son œuvre, il se considérera de nouveau lui-même avec défiance, non sans continuer de rêver, par bouffées, à sa splendeur perdue.
8
Mais s’il est juste de dire avec Paul Bénichou qu’il y a eu, en matière de sacre de l’écrivain, une continuité trop longtemps négligée entre fin des Lumières et Romantisme, il est vrai aussi de rappeler que les héros intellectuels des deux périodes ne sont pas du tout les mêmes : « philosophe », « homme de lettres » ici, c’est-à-dire homme de savoir et de pensée, qu’on aime à se représenter comme un digne magistrat de la littérature, paternellement conscient de sa responsabilité sociale ; « poète » là, âme solitaire et blessée, à la fois surhomme et paria, et qui, tout en se voulant « chargé d’âmes », se vit comme une instance de pouvoir spirituel illégal, contesté, alors même qu’il s’autoproclame chargé d’une mission divine. Entre les deux époques s’est produit quelque chose comme une double rupture épistémologique : à la fois une autonomisation et une subjectivation de la littérature. Ce qui ne va pas sans changer en profondeur la structure du pouvoir spirituel ambitionné par deux héros intellectuels forts différents : le philosophe « homme de lettres », d’une part, ayant un savoir encyclopédique, soucieux de l’universel, et se voulant l’avocat du faible contre le despote ; le poète de l’autre, qui se définit comme un être solitaire et séparé, trop sublime pour se reconnaître dans le cadastre socio-politique du pouvoir — avant d’être tenté de s’y inscrire, pour assumer, à la place du philosophe et dans un tout autre style, le rôle de pasteur d’hommes.
9
De la prise du pouvoir symbolique par les philosophes, c’est, bien avant Bénichou, un grand penseur du XIXe siècle, Tocqueville, qui s’est fait l’historien. L’auteur de L’Ancien Régime et la Révolution montre comment, contre toute attente, en plein XVIIIe siècle, « les hommes de lettres qui ne possédaient ni rangs, ni honneurs, ni richesses, ni responsabilité, ni pouvoir, devinrent [...] en fait, les principaux hommes politiques du temps et même les seuls, puisque, tandis que d’autres exerçaient le gouvernement, eux seuls tenaient l’autorité ». « La vie politique, poursuit Tocqueville, fut violemment refoulée dans la littérature, et les écrivains, prenant en main la direction de l’opinion, se trouvèrent un moment tenir la place que les chefs de parti occupent d’ordinaire dans les pays libres6. » Ce qui fut rendu possible, selon lui, par la perte de pouvoir et de prestige de la noblesse, ainsi que par sa suicidaire propension à constituer elle-même le premier cercle d’approbation des philosophes.
10
Mais si l’on s’intéresse à l’imaginaire qui a soutenu l’ambition de ces philosophes candidats au pouvoir spirituel, on doit constater que les rôles idéaux qu’ils ont alors choisi de s’attribuer, ce sont, pour l’essentiel, des rôles d’autorité pacifique et laïque.
92
N’hésitant pas à se laisser comparer à des prêtres ou à des rois (le « Roi Voltaire »), pour mieux indiquer par là les deux pouvoirs déficients auxquels ils aspirent à se substituer, ils se représentent plutôt comme les dignes « Mentors des humains », les « précepteurs des peuples et des rois7 », les « législateurs paisibles de la raison8, les « magistrats » de la patrie. C’est là ce qu’est, selon Raynal, tout écrivain d’envergure : « Tout écrivain de génie est magistrat né de sa patrie. Son tribunal, c’est la nation entière, son juge est le public, non le despote qui ne l’entend pas ou le ministre qui ne veut pas l’écouter9. » Au tyran, l’exécutif ; au philosophe « législateur » et magistrat, le pouvoir législatif et judiciaire. 11
Pour bien ancrer la supériorité de ces dignes dépositaires du pouvoir spirituel, certains n’hésitèrent pas à opposer la puissance sympathique des gens de lettres et la puissance purement coercitive du pouvoir d’État. Voici ce qu’avant même 1760 écrivait Duclos dans ses Considérations sur les mœurs : De tous les empires, celui des gens d’esprit, sans être visible, est le plus étendu. Le puissant commande, les gens d’esprit gouvernent, parce qu’à la longue ils forment l’opinion publique, qui tôt ou tard subjugue ou renverse toute espèce de despotisme 10 .
12
Dans un discours académique de 1767, Chamfort reprend le même parallèle, mettant, comme il convient alors, le « génie » à la place des « gens d’esprit » : « Deux forces souveraines commandent à l’espèce humaine, et règlent partout les destinées : le pouvoir et le génie11 ». Tandis que le pouvoir « subjugue les hommes par les hommes, [...] maîtrise par les forces qui lui sont confiées les forces qui lui résistent, [...] dispose de la forme des sociétés qu’il varie à son gré, [...] l’action du génie est plus lente, mais plus forte et plus sûre12 » : Le mouvement qu’il a une fois imprimé, ne meurt point avec lui ; il tend vers l’avenir et s’accélère même par l’espace qu’il parcourt ; il subjugue l’homme pour l’ennoblir ; il dompte sa volonté par sa raison [...] ; comme Dieu, il jouit de l’étonnant privilège de régner sur elle sans gêner sa force et sans lui ôter le sentiment précieux de sa liberté.
13
Ce qui est permis, ajoute Chamfort, parce que la [...] souveraineté que l’homme de génie exerce sur la foule des hommes n’est [...] pas de notre institution : c’est une loi de la nature, aussi ancienne que la loi du plus fort et toujours plus respectable. En vain l’amour propre se révolte contre une supériorité qui l’humilie ! Nous naissons les sujets du grand homme ; c’est dans nos cœurs qu’il prend les titres de sa puissance13.
14
L’usage insidieux du mot « sujet » revient à conférer un statut de royauté symbolique aux grands écrivains, ces rois débonnaires mais paternellement responsables de leurs sujets. Magnifiés par ce germe même de « génie », les voici proposés au trône, non sans une évidente arrière-pensée polémique.
15
Point de rupture, mais au contraire une assez belle continuité, si, sautant par-dessus quelques décennies, nous en venons à évoquer la conception que se fait Mme de Staël de ce qu’on appelle alors, dans un langage emphatique à souhait, le « pouvoir du génie ». Fille des Lumières par le salon de sa mère, l’auteur de De la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales (1800) tient un langage fort proche de celui que tenaient les philosophes des années 1760-1770. Pour elle aussi, la « puissance littéraire » capable de faire « trembler toutes les autorités injustes, c’est l’éloquence généreuse, c’est la philosophie indépendante, qui juge au tribunal de la pensée toutes les institutions et toutes les opinions humaines14 ». On retrouve chez elle la même conception d’une puissance bienveillante qui tient au verbe, qui s’exprime par l’éloquence enflammée, mais
93
qui s’appuie sur la philosophie ; et aussi le même dispositif judiciaire qui tend à donner à l’intellectuel le rôle de juge suprême : celui de dernier recours face à des pouvoirs iniques. Ce n’est qu’à partir de Corinne (1807) et de De l’Allemagne (1814), que Mme de Staël va changer de héros, et mettre progressivement le poète (mélancolique) à la place du philosophe (éloquent). 16
Si, sautant de nouveau vingt années d’histoire, nous en venons maintenant aux débuts des années 1820, soit à l’époque où se constitue la première école romantique, monarchique et chrétienne, nous voici face à un tout autre paysage. Le philosophe a disparu, c’est le poète qui est en scène. « Voilà le poète, voilà enfin le messie attendu », at-on clamé, à la parution des Méditations poétiques de Lamartine (1820). Et le poète, si l’on suit la version hugolienne du magistère poétique, est alors conçu comme une puissance réparatrice : C’est surtout à réparer le mal fait par les sophistes que doit s’attacher aujourd’hui le poète. Il doit marcher devant les peuples comme une lumière et leur montrer le chemin. Il doit les ramener a tous les grands principes d’ordre, de morale et d’honneur ; et pour que sa puissance leur soit douce, il faut que toutes ses fibres du cœur humain vibrent sous ses doigts comme les cordes d’une lyre. Il ne sera jamais l’écho d’aucune parole, si ce n’est de celle de Dieu15.
17
Puissance sensible au cœur, le poète est à la fois un éclaireur de l’humanité et une instance religieuse, au triple sens du mot : piété, sens de l’ordre et des principes, sentiment du lien social. Tandis que le philosophe conspué est un « analyseur infâme » qui, de par sa démarche scientifique, nie la divine cohérence de l’univers, la puissance du poète est « sympathique » (comme diront bientôt, après Ballanche, les saint-simoniens).
18
Consoler, réparer, réunir ce qui avait été disjoint, ressouder les membres désunis du corps social, tel est le but qu’il s’assigne : « religieux », au sens étymologique du mot. Le poète est cette voix qui s’élève dans l’orage, cette « lyre qui peut le calmer », parce qu’il est « celui auquel la sagesse antique attribuait le pouvoir de réconcilier les peuples et les rois16 ».
19
Mais les poètes sont aussi requis de s’exprimer par des actions, et par des actions courageuses : ce qui fait d’eux de lointains héritiers des paladins féodaux. Alexandre Soumet, qui veut les voir se constituer en « Sainte-Alliance », les invite à vouloir « que leurs ouvrages soient jugés comme des actions, avant de l’être comme des écrits », et à ne jamais reculer « devant les conséquences, devant les dangers d’une parole courageuse17 ».
20
Si, comme à l’époque précédente, la littérature est « cette voix puissante au moyen de laquelle un individu parle à une société18 », la singularité individuelle du poète ne va pas manquer d’être accentuée. Cet envoyé du seigneur se conçoit bientôt lui-même comme un être solitaire et incompris : ce Messie a du Christ des Oliviers en lui ; ce Moïse se sait « puissant et solitaire19 ». C’est un envoyé du Seigneur dont le verbe s’avère inefficace (« Sa voix grave se perd dans leurs vaines paroles20 »), mais aussi un « roi banni superbe et solitaire21 », fatigué du « sceptre qui pèse à sa main22 », et bientôt condamné à la fuite ou à l’exil : Pourquoi traîner ce roi si loin de ses royaumes Qu’importe à ce géant ce cortège d’atomes ! Fils du monde, c’est vous qu’il fuit23.
21
Ce qui n’empêche pas Hugo de rêver, après Lamennais, à la « royauté du génie, dernière ressource des peuples éteints24 ».
94
22
Enjambons encore une décennie. Passé 1830 et le roi-citoyen bourgeoisement assis sur le trône, nous voici à l’âge qui, si l’on s’en tient aux grands poètes — Hugo, Lamartine, Vigny —, est celui du romantisme « social ». Ce n’est pas aux lendemains immédiats de 1830 que se met en place ce nouveau dispositif auctorial, mais un peu plus tard : à partir de la Préface de Lucrèce Borgia (1833) et de Littérature et philosophies mêlées (1834), en ce qui concerne Hugo ; des Destinées de la poésie (1834), en ce qui concerne Lamartine ; de la Préface de Chatterton (1834), en ce qui concerne Vigny. Ce qui constitue, notons-le au passage, un beau tir groupé autour d’une même date climatérique. Après des trajets sui generis qu’il ne me revient pas d’évoquer ici, ces trois écrivains vont se retrouver unis, à partir de ces années 1833-1835, autour d’une même conception du pouvoir spirituel du poète.
23
Le poète hugolien aura donc « charge d’âmes25 » ; le « grand écrivain » vignyen sera représenté comme tenant « un peuple dans sa main26 ». Dans un siècle qui a mis à mal l’ auctoritas traditionnellement dévolue à la figure royale27, et où est patente la défaillance du prêtre, le « grand écrivain », le « poète penseur », l’ « artiste civilisateur » s’offrent comme des pouvoirs symboliques de rechange. Et, pour légitimer cette offre, ils insistent sur l’effectivité de leur pouvoir.
24
Que l’intelligence soit une force, au même titre que la force temporelle, c’est ce qu’ils ne cessent de proclamer. Pour donner à cette idée l’allure d’une évidence fondatrice, ils mettent à contribution le vocabulaire de l’énergie : « force », « pouvoir », « puissance », etc. Comme Hugo, ils affirment que « toute pensée est une force28 ». Idée diversement modulée chez lui. Car, en partant d’un tel énoncé, on peut aller dans deux directions distinctes. Soit vers l’idée que le génie est une « force qui va », une puissance à l’état brut, individualiste et despotique —ce que Hugo a été tenté de faire à l’époque de Cromwell (1827). Soit vers l’idée qu’il se doit d’être une force maîtrisée et responsable, qui ne s’exerce que pour le bien social. Abandonnant bientôt à d’autres (Balzac, en particulier) le soin d’explorer les bouillantes arcanes prométhéennes de l’énergie sans frein, c’est dans le registre de la force limitée que se situe le romantisme paternel tel que Hugo et ses pareils veulent l’incarner à partir de 1833. Ce qui n’empêchera pas pourtant Hugo d’insister de nouveau, sur le tard, à l’âge de William Shakespeare, sur leur force véritablement « révolutionnaire », et nécessairement subversive29. Mais pour lui — comme pour Emile Souvestre et pour tous les saint-simoniens —, l’art est d’abord une « puissance gouvernementale30 ». Comme l’écrit Hugo, « écrire, c’est gouverner31 ». Manifester un pouvoir certes, mais un pouvoir directeur et organisateur.
25
Posant que « la pensée est pouvoir », Hugo corrige aussitôt : « Tout pouvoir est devoir 32. » Voilà formulée très nettement la double exigence à laquelle a constamment obéi le romantisme « paternel ». Hugo ne cesse de rappeler que le poète est puissant, que ses chants exercent un réel « empire » ; mais c’est pour ajouter aussitôt qu’il doit faire un usage limité et responsable de son pouvoir. C’est ce qu’affirment les Voix intérieures : « Le plus fort est celui qui tient sa force en bride33. » Car c’est, par excellence, le propre de la puissance paternelle — et de toute puissance légale — que de ne pas se contenter du seul pouvoir d’engendrement, mais d’être aussi une puissance « moralisatrice », qui donne l’exemple par un usage modéré de sa propre force. Cela en partant de l’idée que le père n’est pas seulement celui qui donne la vie, mais aussi celui qui « contient » ses enfants dans les limites de la Loi — et qui, pour ce faire, doit commencer par se « contenir » luimême.
95
26
Pour bien marquer que le pouvoir du génie n’est pas une force brute, s’exerçant sans contrôle, mais une puissance spirituelle circonscrite, on fait le parallèle entre le pouvoir destructeur des « hommes de force » et le pouvoir civilisateur des « hommes de pensée ». Et l’on démontre que « la souveraineté véritable est celle de l’intelligence34 ». Alors que les hommes de force veulent le pouvoir dans tout son lustre martial, dans toute sa cinglante immédiateté, les hommes de pensée préfèrent cette puissance plus sereine, plus différée aussi qui s’appelle l’« influence35 ». Affirmant vouloir « l’influence et non le pouvoir36 », Hugo fait très nettement le départ entre la potestas et l’auctoritas — ou plutôt, si l’on reprend ses propres termes, entre le pouvoir (temporel) et la puissance (spirituelle), qui « ne se laisse ici bas saisir que par le génie ». Mais s’il met la puissance symbolique plus haut que le pouvoir concret qui est celui du roi, remarquons qu’il n’en reste pas moins sous le charme de la haute figure de Napoléon, qui, à ses yeux, a incarné les deux formes d’autorité : Le grand mystère c’est d’être à la fois pouvant et puissant. Le pouvoir est un fait humain, la puissance est un fait divin. Elle vient de Dieu et ne se laisse saisir ici bas que par le génie. Le premier prince venu, un simple roi a du pouvoir. Napoléon avait à la fois le pouvoir et la puissance37.
27
Si Hugo, et avec lui les autres grands romantiques « sociaux » tout comme les divers prophètes de l’humanitarisme romantique, sont restés pour l’essentiel fidèles à une conception « paternelle » du pouvoir spirituel du poète, où pouvoir et devoir sont liés, et où le magistrat spirituel est requis de réaliser une nouvelle synthèse sociale pour mettre un terme aux dissensions du politique, c’est bien du côté de la force brute que d’autres romantiques ont cherché les symboles de leur pouvoir.
28
Force est de constater que le modèle royal, voire impérial, et que le modèle aristocratique aussi, si important pour tout le romantisme dandy, ont, après 1830, beaucoup servi de repères à ce pouvoir spirituel programmatique que tentèrent de s’attribuer les poètes et les artistes. Non satisfait de l’auctoritas, l’écrivain romantique a parfois rêvé qu’il assumait aussi une imaginaire potestas.
29
Il n’est que de songer à Balzac pour sentir combien s’en tenir au seul prêtre ne permet pas de rendre compte du tout venant des fantasmes de pouvoir de l’écrivain romantique. Car si Balzac a lui aussi, il est vrai, un côté « Cénacle de la rue des Quatre-Vents » (Illusions perdues), un côté croyant et « missionnaire », qui s’exprime par exemple dans le fragment intitulé Le Prêtre catholique38, s’il partage quelques-uns des stéréotypes de plus grande diffusion des « humanitaires », on sait qu’il préfère se voir en Titan révolté, ou bien encore en « Prince des lettres » et en « maréchal de la littérature », plutôt qu’en écrivainprêtre : Prométhée sans frein, ou Sisyphe accablé, plutôt qu’Amphion ou Orphée, responsable de l’harmonie sociale. Ce qui est manifeste jusqu’au sein même de ce solennel « Avant-Propos » de La Comédie humaine (1842) où, se réclamant de Bonald, Balzac veut faire de l’écrivain un « instituteur » des hommes. Balzac, qui définit le créateur, ce démiurge titanesque, comme quelqu’un qui veut non seulement « faire concurrence à l’état civil39 », mais aussi « fronder Dieu40 », « usurper sur Dieu41 », bouscule à l’évidence la respectabilité du Sacre. Avant Nietzsche, il préfère la puissance cinglante du Surhomme à la sage responsabilité du chargé de mission, les prestiges de la « force qui va » et de la « pensée qui tue » à la Fable du pouvoir patriarcal. Aux logiques paternelles du survol et de la synthèse, il oppose les topologies révoltées de l’oxymore. Plutôt qu’en fidèle desservant du culte, il se voit lui-même en « monarque intellectuel42 », en prince « intelligentiel », ou même en Dieu survolté, un peu illégal presque, fervent amateur qu’il
96
est de pouvoirs occultes et de sociétés secrètes. Face à un romantisme du Père et de la Mission, incarné par Hugo et par le saint-simonisme, mais aussi par Lamartine et par Vigny, il tend à définir un romantisme de l’énergie (et de la dépense), qui fait de 1’« artiste » non pas une autorité religieuse mais un héros de la puissance sans frein. Et donc aussi comme un héros de la consumation (comme disait Sartre à propos de Baudelaire), chargé de tendre à une société bourgeoise jugée trop frileuse le miroir d’une mythique aristocratie de la dépense. 30
Cela conduit Balzac à proposer des homologies — qui auraient choqué les hommes des Lumières, et plus encore Mme de Staël, contemporaine révulsée de l’Empire — entre les « artistes », d’une part, et de l’autre les « guerriers » et les « hommes de pouvoir », communément attirés, dit-il, par la « puissance des abîmes », et ensemble romantisés du fait de leur vie d’aventure43. Mettant à égalité toutes les débauches, celle du sexe, celle du sang et celle des intérêts, Balzac conclut : « Tous les excès sont frères 44. » Ce qui revient à proposer une image dramatisée des « êtres doués de puissance créatrice45 », de manière à faire d’eux les antithèses éclatantes de ce prudent gagne-petit qu’est le « bourgeois ». Portrait de l’homme de savoir en homme de pouvoir et de vouloir, brûlé par l’excès de ses désirs et par sa volonté de puissance, d’autant plus que Balzac a mis au centre de son œuvre l’idée de la « pensée qui tue46 ». Et, tout cela, pour faire la nique à M. Prudhomme... En revanche, c’est à combattre l’irresponsabilité du bourgeois et l’analytisme forcené des signes monétaires — et de la société individualiste qu’ils engendrent — que se consacre pour sa part le romantisme missionnaire.
31
Malgré l’importance que je leur ai ici accordée, qu’on ne croie pas que tout le romantisme tienne dans ces deux protocoles de figuration de l’« artiste » : comme énergie liée et liante, d’une part (c’est la voie royale du romantisme humanitaire) ; comme énergie libre et erratique de l’autre (c’est le modèle Balzac-Musset-Byron, auquel adhère parfois certain Hugo, celui de Cromwell ou, plus tard, de William Shakespeare). Dès sa naissance, le romantisme a exploré d’autres stratégies auctoriales, en particulier du côté de ce que Blanchot appellera l’« impouvoir ». Autre combat idéologique, toujours contre la même cible, le « bourgeois », mais pensé cette fois comme un être du réel, terrestre et utilitaire, alors que le « poète » exténué poursuit son envol, inutile et sublime, vers les espaces inconnus.
32
La première forme qu’a prise le romantisme de l’impouvoir, sa forme originelle, c’est celle du poète mourant, cher à Millevoye et à Chênedollé avant de l’être au Lamartine des Nouvelles Méditations (1823). Un premier romantisme « mélancolique » a pris ainsi tournure, dès René (1802), dès le « Poète malheureux » de Nodier (1807) et les Élégies de Millevoye (1812). Il a consisté à faire du poète une impuissante victime, et non une autorité morale. Non plus un Jupiter paternel (comme à l’époque des secondes Lumières), ni un Moïse conducteur de peuples (comme chez les romantiques ultras de la Restauration), mais un Christ filial ou un ange déchu, qui renonce à la vie pour conserver sa pureté, et accepte d’abandonner généreusement ses biens terrestres. La représentation conventionnelle du poète poitrinaire, mourant jeune et sans force après avoir traîné une vie d’ombre, a permis d’ancrer cette idéalisation mélancolique de l’impuissance et de la perte. Le poète alors, c’est le Coelio de Musset (Les Caprices de Marianne, 1833), céleste victime, ou le Sténio de George Sand (Lélia, 1833), être exténué, asthénique, comme le suggère son nom : un être oblatif qui vit en état d’élégie. Comme l’écrit G. Sand, le poète « c’est un jeune homme vierge, c’est une âme que Dieu envoie souffrir ici-bas pour l’éprouver avant d’en faire un ange47 ».
97
33
Alors que le grand homme de la fin des Lumières voulait l’emporter sur le « despote », en faisant appel à la postérité et en comptant sur une reconnaissance posthume de son pouvoir, le poète angélique veut se démarquer, quant à lui, de l’homme terrestre, du « vulgaire ». C’est un aristocrate de la perte, qui met une sorte d’élégance métaphysique à disparaître sans revendiquer d’héritage et sans laisser même de nom48. Car cela fait désormais partie de l’essence du geste poétique tel que l’avait défini déjà Mme de Staël que de renoncer au monde comme objet de jouissance49. Le poète est cet Orphée qui doit perdre Eurydice, ce Christ qui doit mourir, oublié de son divin père. Renonçant à cette libation qu’est la vie, renonçant à tout pouvoir ici-bas, et plus radicalement, à toute trace mémorielle de son éphémère traversée, il accepte de devenir fantôme, âme sans nom.
34
Avec plus d’espace, il serait possible de suivre, bien au-delà du romantisme et jusqu’à Blanchot lui-même, les avatars de cette stratégie mélancolique de l’impouvoir : ce n’est, bien sûr, que partie remise. Mais sachons aussi, pour finir par un dernier schéma, que le néo-romantisme d’après 1830 a pensé l’impuissance du poète et de l’artiste dans d’autres registres. D’une part, dans le registre ironique : celui de Gautier, de Musset, du romantisme dandy, mais aussi de l’artiste espiègle des Lettres d’un voyageur de George Sand, qui se moque du sérieux des républicains, et de leur appétit de pouvoir. D’autre part, dans le registre du désenchantement. Alors que, dans le premier cas, il s’agit de renoncer au pouvoir et au politique en faisant montre d’une élégante impertinence, en laissant entendre, comme Gautier, qu’une révolution se réduit à casser quelques vitres et à éteindre quelques lampions sur la tête des bourgeois50, dans le second cas, la stratégie de l’impouvoir désenchanté conduit plutôt l’artiste à donner de soi l’image d’un être dévalorisé, abject, vivant amèrement son impuissance : un bouffon, un saltimbanque, une prostituée, un « grotesque », un « irrégulier », ou pire encore, comme chez le Philothée O’ Neddy déçu et vieilli de 1863, un cul-de-jatte dans sa carriole burlesque51. Autant de symboles de la dégradation amère que vivent ces estropiés de l’utopie romantique, pauvres gloires éclopées d’avance tout comme ces grotesques du Grand Siècle dont Gautier, en 1844, propose une série de médaillons52. Et le plus amer, c’est qu’ils ont euxmêmes le sentiment de leur abjection, et de leur renonciation « sous le signe du deuil, et avec un dépit profond » — « aux ambitions spirituelles, qu’ils avaient crues et continuaient de croire légitimes53 ».
35
C’est le moment de s’apercevoir par contraste que, dans son originelle utopie de pouvoir, le romantisme a eu, en son jeune temps, quelque chose à voir, malgré tout, avec les aspirations de la classe ascendante qui voulait s’imposer par son énergie revigorée. Et que 1830, déjà, symbolise la perte de confiance en l’énergie, et donc dans le pouvoir de ceux que Saint-Simon appelait de manière programmatique les « industriels ». Au rebours de ces utopies juvéniles que le XIXe siècle avait eues à sa naissance, au moment où Bonaparte faisait la preuve, sous le soleil d’Austerlitz, de sa vitalité guerrière, voici que s’impose déjà le cauchemar d’un soleil mort et d’un univers soumis à une incontrôlable entropie. Partageant « l’obsession de la décadence et de la perte de vitalité54 », ces jeunes gens se voient comme les rejetons sarcastiques d’une humanité en léthargie, accablée par « l’astre glacial de la raison » (Musset).
36
Ce sont là des thèmes que ne fera que magnifier la génération suivante, celle de Flaubert et de Baudelaire. A elle d’exagérer ces syllogismes de l’impuissance, tandis que le Père, làbas, dans l’île, avec le Panthéon dans la tête, continue de croire au pouvoir, même si ce n’est plus qu’en celui des tables tournantes...
98
NOTES 1. Voir Régis Debray, Le Scribe, Paris, Bernard Grasset, 1980. 2. Les propos sont dans la bouche de Clitandre, défenseur de la Cour (Acte IV, sc. 4). 3. Claude Cristin, Aux origines de l'histoire littéraire, Presses universitaires de Grenoble, 1973, p. 26. 4. Mots de l'abbé Terrasson selon d'Alembert (Réflexions de M. d'Alembert de l'Académie des sciences sur la personne et les ouvrages de M. l'Abbé Terrasson, en préface à l'ouvrage de Terrasson, La Philosophie applicable à tous les objets de la raison, Paris, 1754, p. XIV). 5. Article « Philosophe » de l'Encyclopédie. 6. L'Ancien Régime et la Révolution [1856], Gallimard, coll. « Idées », 1967, p. 231. 7. « Les précepteurs des peuples et des Rois / Renoncent aux plus beaux de leurs droits. / Les Mentors des humains n'en sont que les gagistes », se plaint Sébastien Mercier (Le Génie, le Goût et l'Esprit, 1756, p. 29). 8. Chamfort, Combien le Génie des grands écrivains influe l'Esprit de leur siècle [1767], in Œuvres, Paris, 1824-1825, t. I, p. 219. 9. Abbé Raynal, Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes, Livre XIX, Genève, Pellet, 1781, t. X, p. 94. 10. Duclos, Considérations sur les mœurs [1751], Œuvres complètes, Paris, 1821-1822, t. I, p. 138-139. Duclos parle, remarquons-le, en termes de « gens d'esprit », ce qui sera bientôt archaïque. 11. Combien le génie des grands écrivains influe sur l'esprit de leur siècle, op. cit., t. I, p. 201. 12. Ibid., p. 202. 13. lbid., p. 203. 14. De la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales [1800], in Œuvres complètes de Madame la baronne de Staël-Holstein, Firmin Didot frères, 1836, t. I, p. 205. 15. Hugo, Préface des Nouvelles Odes [1823], Œuvres complètes, Club français du livre, t. II, p. 475. 16. « Quentin Durward ou l'Ecossais à la cour de Louis XI, par sir Walter Scott », La Muse française, juillet 1823, op. cit., t. II, p. 432. 17. Alexandre Soumet, « Nouvelles Odes, par Victor-M. Hugo, avec cette épigraphe : Nos canimus surdis », La Muse française, 9e livraison, mars 1824, éd.J. Marsan, t. II, p. 143. 18. Victor Hugo, « Poëmes. — Héléna, la Fille de jephtê, le Somnambule, le Bal, la Prison, le Malheur, etc. », Le Réveil, 25 septembre 1822, Œuvres complètes, op. cit., t. II, p. 41. 19. « Seigneur, vous m'avez fait puissant et solitaire, / Laissez-moi m'endormir du sommeil de la terre » (Refrain du « Moise » de Vigny [1823]). 20. Victor Hugo, « Le Poète », Nouvelles Odes [1824], Œuvres complètes, op. cit., t. II, p. 480. 21. Victor Hugo, « L'Âme », Nouvelles Odes, op. cit., t. II, p. 500. 22. Victor Hugo, « Le Poète » [1824], Nouvelles Odes, Œuvres complètes, op. cit., t. Il, p. 480. 23. lbid., p. 481. 24. Fragment d'une phrase de Lamennais mise en épigraphe à la pièce intitulée « Le Génie. À M. de Chateaubriand » [juillet 1820], Odes et poésies diverses, op. cit., t. I, p. 795. 25. « Le poète aussi a chargé a charge d'âmes » (Préface de Lucrèce Borgia, 11 février 1833, op. cit., t. IV, p. 655). 26. Voir « Dernière nuit de travail » [Préface de Chatterton], juin 1834, Œuvres complètes, éd. Baldensperger, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », t. I, p. 764. 27. Cela, depuis qu'un « tremblement de trône a secoué les rois », pour parler comme Lamartine (Réponse aux adieux de sir Walter Scott à ses lecteurs. Épître familière [1832], dans Œuvres poétiques complètes, « Bibliothèque de la Pléiade », p. 535.
99
28. « Fonction du poète », Les Rayons et les Ombres [1840], Œuvres complètes, op. cit., t. VI, p. 27. 29. C'est le cas en particulier dans cette œuvre testamentaire qu'est William Shakespeare. Il y présente les « génies » comme des « êtres impétueux, tumultueux, violents, emportés, extrêmes, chevaucheurs des galops ailés, franchisseurs de limites, "passant les bornes" » (Œuvres complètes, t. XII, p. 259). 30. « Les arts sont une puissance moralisante, et par conséquent.gouvernementale, puisque le gouvernement a mission [...] de moraliser les peuples » (Émile Souvestre, Des arts comme puissance gouvernementale et de la nouvelle constitution à donner au théâtre, Nantes, 1832, p. 2). 31. Et Hugo d'ajouter : « La question du goût est intimement liée à la question du pouvoir » (Notes de travail de William Shakespeare], op. cit., t. XII, p. 424). 32. William Shakespeare, op. cit., t. XII, p. 285. 33. Les Voix intérieures, XXXII [1836], op. cit., t. V, p. 646. 34. Victor Hugo, Littérature et philosophie mêlées, op. cit., t. V, p. 219. 35. Hugo veut « profiter de l'attention des masses pour leur enseigner à leur insu ». C'est là « pour le poète, la vraie utilité, la vraie influence, la vraie collaboration dans l'œuvre civilisatrice. C'est par cette voie magnifique et large, et non par la tracasserie politique, qu'un art devient un pouvoir » (Littérature et philosophie mêlées [mars 1834], op. cit., t. V, p. 40). 36. Lettre à Paul Lacroix, 10 décembre 1848, op. cit., t. VII, p. 753. 37. « Le Tas de pierres [1834-1839] », op. cit., t. V, p. 990. 38. La Comédie humaine, éd. P.-G. Castex, « Bibliothèque de la Pléiade »[désormais CH], t. XII, p. 794 et suivantes. Voir la présentation de ce texte par Nicole Mozet. Le passage le plus remarquable, souvent commenté, est à la p. 802 : « Aujourd'hui l'écrivain a remplacé le prêtre ; il a revêtu la chlamyde des martyrs, il souffre mille maux, il prend la lumière sur l'autel et la répand au sein des peuples, il est prince, il est mendiant, il console, il maudit, il prie, il prophétise [...], et une parole, un vers ont maintenant autant de poids dans les balances politiques qu'en avait jadis la victoire. [...] Le pontife de cette terrible et majestueuse puissance ne relève donc plus ni des rois, ni des grands, il tient sa mission de Dieu [...]. » 39. Formule de l'« Avant-propos » de La Comédie humaine (CH, t. I, p. 10). 40. La Peau de chagrin [1831], « Bibliothèque de la Pléiade », t. X, p. 197. 41. « Faire croire a la vie de René, de Clarisse Harlowe, n'est ce pas usurper sur Dieu ? » se demande Balzac dans la préface de son Histoire des Treize [1833] (« Bibliothèque de la Pléiade », t. V, p. 788). 42. L'expression est appliquée à Balthazar Claës dans La Recherche de l'absolu (CH, t. X, p. 728). 43. Voir entre autres tel passage de La Peau de chagrin : « La Guerre, le Pouvoir, les Arts sont des corruptions mises aussi loin de la portée humaine, aussi profondes que l'est la débauche, et toutes sont de difficile accès. Mais quand une fois l'homme est monté à l'assaut de ces grands mystères, ne marche-t-il pas dans un monde nouveau ? Les généraux, les ministres, les artistes sont tous plus ou moins portés vers la dissolution par le besoin d'opposer de violentes distractions à leur existence si fort en dehors de la vie commune » (CH, t. X, p. 196). 44. Ibid. 45. « Des artistes », La Silhouette, 25 février 1830, Œuvres diverses, « Bibliothèque de la Pléiade »„ t. II, p. 708. 46. La formule est déjà dans Le Médecin de campagne, en 1833 (CH, t. IX, p. 570). L'idée est reprise et orchestrée par Félix Davin qui la met au centre de 1'œuvre de Balzac : « M. de Balzac considère la pensée comme la cause la plus vive de la désorganisation de l'homme, conséquemment de la société. Il croit que toutes les idées conséquemment tous les sentiments sont des dissolvants plus ou moins actifs » (« Introduction » aux Études philosophiques [1835], CH, t. X, p. 1209). 47. Lélia, éd. P. Reboul, Garnier, 1960, p. 50. 48. Pour tout ce développement, je renvoie à mon article, « Lamartine et le poète mourant », Romantisme, n° 67, 1990-I, p. 47-58.
100
49. Dans le « Poète mourant » de Lamartine, cette image de la vie comme objet de jouissance épicurienne est symbolisée par l'image horatienne de la « coupe de [s]es jours » qui se brise dans la main du poète. 50. Voir la Préface des Jeunes-France, romans goguenards [1833], Charpentier, 1877, p. XV. 51. Voir « Épilogue général : Le Cul-de-jatte » [1863], dans Poésies posthumes, Paris, 1877, p. 275. 52. Les Grotesques [1844]. 53. Paul Bénichou, Le Sacre de l'écrivain, Corti, 1972, p. 582. 54. Paul Bénichou, L'École du désenctiantement, Gallimard, 1992, p. 50.
101
Honoré de Balzac : prince, propriétaire, maréchal, intelligentiel Stéphane Vachon
1
Peut-on être de gauche avec des idées de droite ? Ou, inversement, peut-on être de droite avec des idées de gauche ? Peut-on être conservateur en politique et révolutionnaire en littérature ? Est-on automatiquement révolutionnaire en politique parce que l'on est révolutionnaire en littérature ? Qu'on formule ou qu'on tranche la question comme on veut, il faut se rappeler qu'elle est au cœur natif de toute lecture de Balzac, et de sa postérité. Aujourd'hui encore entier, ce débat surgit le 21 août 1850, au Père-Lachaise, sur la tombe du romancier, de la bouche de Victor Hugo : « A son insu, qu'il [Balzac] le veuille ou non, qu'il y consente ou non, l'auteur de cette œuvre immense et étrange [La Comédie humaine] est de la forte race des écrivains révolutionnaires1 ».
2
Dans un article dont les arguments sont malheureusement un peu tombés dans l'oubli, Jean Pommier2 avait indiqué que l'affirmation de Hugo devait être située dans une polémique d'époque extrêmement précise. Selon cette démonstration, Hugo entendait ne pas abandonner Balzac à la droite parce que cela lui apparaissait comme un moyen de lutter contre La Gazette de France, qui avait, la veille des obsèques, conclu son article sur l'auteur de La Comédie humaine en revendiquant son appartenance : « C'était un de nos hommes : l'avenir et le triomphe des idées pour lesquelles nous combattons nous l'auraient rendu...3 ». Et cela était, du même coup, lutter contre L'Assemblée nationale, quotidien « fondé dès le lendemain de la Révolution de février, pour servir de tribune à des membres du personnel politique et administratif du régime de Juillet4 ». C'était lutter, en fait, contre La Gazette de France avec les armes de L'Assemblée nationale puisque, dans ce journal, le syntagme « littérature révolutionnaire » coiffe une série de seize articles publiés par Lerminier du 3 juin au 16 septembre 1850 (ceux des 17 et 25 juin, consacrés à Victor Hugo ne demeurèrent sans doute pas inconnus du poète). Au lendemain du discours de Hugo, le 23 août, La Gazette de France s'offusque : « M. Victor Hugo fait de M. de Balzac un écrivain révolutionnaire. Qu'entend-il par ces mots ? Il a voulu dire que l'auteur de tant de livres remarquables a été dans le sens de la révolution. Quelle révolution ? La
102
révolution sociale, apparemment5 ». L'Événement, le 24, défend l'orateur, à tort accusé « de ranger Balzac parmi les écrivains révolutionnaires. Nous sommes étonnés de trouver dans ce journal [La Gazette de France] des niaiseries qui traînent partout sur le sens du mot révolutionnaire6 ». Lerminier, enfin, le 2 septembre, dans L'Assemblée nationale, résume et tente de conclure : « Au fond, ni son siècle ni la nature humaine ne trouvent grâce devant son inexorable pessimisme. Il [Balzac] ne traite pas mieux les paysans que les bourgeois, les journalistes que les banquiers. Sans aucun doute, Balzac n'est pas révolutionnaire 7 ». 3
On voit le conflit des interprétations et la chasse aux intérêts que suscita la valeur politique d'une dépouille à peine ensevelie. Sans surprise, car le commerce avec la politique n'a cessé d'intéresser Balzac, l'auteur, le penseur, l'homme, le militant. Dès l'âge de vingt ans, ne se définissait-il pas comme « un Brutus en abrégé8 », et ne travaillait-il pas à un Cromwell dont il voulait faire « le bréviaire des rois et des peuples » (Corr., t.I, p. 66) ?
Monde 4
Nous n'entreprendrons pas ici l'étude des nombreux politiciens à l'œuvre dans La Comédie humaine, lesquels comptent parmi ses figures les plus reparaissantes et, peut-être, les plus représentatives : un premier ministre (de Marsay), un ministre de la Justice (Rastignac), un député (Canalis), un candidat (Maxime de Trailles), un adjoint au maire du deuxième arrondissement de la ville de Paris (César Birotteau), et d'autres encore, diplomates, pairs, sénateurs ; leurs auxiliaires : un magistrat (Granville), un juge d'instruction (Popinot), un espion (Corentin), un chef de la police (Vautrin) ; leurs secrétaires, obscures figures du renoncement et de la déception (Z. Marcas, Albert Savarus).
5
Il ne s'agira donc pas de relire La Comédie humaine et les œuvres qui la composent en tant que ces œuvres — comme toutes les œuvres — textualisent des visions du monde, une ou des idéologies, des représentations sociales. C'est dire qu'il ne s'agira pas, du moins pas provisoirement, du point de vue de la méthode, de voir en quoi ou comment les processus de textualisation incorporent des dits ailleurs, des dits antérieurs, organisés hors du texte dans les isotopies du discours social sur lesquelles l'œuvre littéraire opère par prélèvements pour créer les effets de référence nécessaires à sa communication. Il ne s'agira donc pas de voir en quoi, ou comment, les concrétions idéologiques que le roman fait circuler peuvent le mettre en conflit avec les lois qui le constituent par des perturbations ou des interférences qui le font dévier de son programme narratif ; c'est que le roman donne forme et figure, il « met en texte »9 le conforme et les différences. Emile Zola, bon lecteur, bon critique, bon romancier, et bon balzacien, avait bien vu cette tension, au fil des comptes rendus qu'il consacra à l'édition des Œuvres complètes de Balzac publiées par la maison Calmann-Lévy10. Ainsi, le 31 octobre 1869, dans La Tribune : « J'ai peu de place, je ne puis ici multiplier les exemples, montrer toute La Comédie humaine écrite par un démocrate sans le savoir. Mais il m'est aisé de prouver brièvement à quel point Balzac est allé contre toutes les croyances qu'il faisait sonner si haut 11 ». Il conclut, une fois la démonstration, à ses yeux, faite : « J'aurais pu prendre tout autre roman que Le Cabinet des Antiques. Il est peu d'œuvres parmi celles de Balzac qui n'aillent ainsi contre les opinions politiques et religieuses de l'auteur12 ».
6
C'est dire qu'il ne s'agira pas, du moins pas provisoirement, du point de vue du contenu, de réduire ou de résumer une certaine conception, dite balzacienne, de la France
103
révolutionnée, capitaliste et bourgeoise. D'autres que nous, et notamment Bernard Guyon 13, André Wurmser14 ou Pierre Barbéris 15, s'en sont formidablement acquittés. Acceptons, cependant, de nous installer après Juillet (date politique), autour de l'invention de La Peau de chagrin (date littéraire). Nous ne plongerons pas au cœur d'une bataille d'allégories, ni dans une méditation sur le pouvoir, sur le désir et sur le destin de la vie humaine. Nous ne serons pas face à un vaste champ ouvert par la révolution, ni face à un monde en désordre, bouleversé, chancelant. Nous serons dans une société hiérarchisée, satisfaite, à prendre, dans une citadelle protégeant les nantis. Le triomphe des forts (de la trempe de Gobseck, « capable de faire des dominos avec les os de son père16 ») et l'élimination des faibles (ceux que subjugue leur passion, ceux qui ne peuvent la canaliser, la contrôler, lui résister) : telle semble être l'inexorable loi de la fiction balzacienne, loi de la jungle, loi d'une faune de carnassiers, de reptiles et de rongeurs, de loups-cerviers, d'aigrefins, de ramasseur de restes, loi d'un univers d'ambitions et de trahisons, d'ascensions et de chutes, loi d'un monde où l'argent ne vient pas de l'accumulation des efforts et du travail, ni de la gloire ni des services rendus a la nation, mais de richesses anciennes — chênes centenaires et vieilles terres grasses (le faubourg Saint-Germain) —, ou de fortunes nouvelles qui se matérialisent en métal, en immeubles, en banques, en mines (Nucingen), liquéfiables comme le vermeil que tord Goriot pour payer les dettes de l'amant de sa fille. A ceux qui vivent dans les salons, ou qui connaissent l'errance urbaine, dans un pays encore essentiellement agricole, les arbres, les labours et les champs sont désormais inutiles. Si les trois quarts des Français vivent encore dans des communes rurales, l'aristocratie du faubourg Saint-Germain, elle, a entrepris de « vend[re] ses terres pour jouer à la Bourse » (La Duchesse de Langeais ; Pl., t. V, p. 931). 7
Il ne s'agira donc pas de cette représentation du monde de la force et du pouvoir, de la contrainte et de l'argent qui sert les appétits et les espérances qui le servent, qui trouble par les crimes qu'il entraîne toutes les vertus, qui contrarie par ses calculs les amours les plus passionnées, qui gâte par les complots qu'il engendre les sentiments les plus vrais. Il ne s'agira pas davantage de la leçon, ni de la morale, de ce monde représenté : nous ne sommes pas davantage condamnés au mal qu'au bien ; nous ne savons pas toujours, ni sur le plan individuel ni sur le plan collectif, où sont le bien et le mal ; il arrive que nous voulons le bien pour de mauvaises raisons ; il arrive que nous ne pouvons vouloir le bien.
Idées 8
Il ne s'agira pas davantage de présenter quelques-unes des idées politiques de Balzac que l'on rencontrerait plus ou moins explicitement énoncées dans tel ou tel article, plus ou moins lucidement formulées à l'occasion de tel ou tel événement public, plus ou moins directement suscitées par telle ou telle circonstance biographique. Un exemple, toutefois, donnera l'idée de la fécondité de cette démarche : le flirt de Balzac avec le parti légitimiste — ou plutôt le flirt de Balzac avec la marquise de Castries déléguée par son oncle, le duc de Fitz-James, auprès de l'écrivain. On sait que le rapprochement ponctuel de Balzac avec ce parti, et sa candidature à la députation de Chinon en 1832, s'achevèrent par une sorte de séparation à l'amiable. Balzac ne fit pas activement campagne et fut battu, le 13 juin, par le juste-milieu Girod de l'Ain arrivant avec deux cents voix d'avance sur Jules Taschereau, le candidat du « mouvement »17. L'essentiel est ailleurs : dans un long « Essai sur la situation du parti royaliste » que Balzac venait de donner au Rénovateur, en deux livraisons, les 26 mai et 2 juin18. Bernard Guyon n'a évidemment pas tort de voir
104
dans cette publication « un véritable manifeste électoral » et « pas seulement une prise de position théorique19 », la dernière et la plus importante, ajouterons-nous, des contributions de l'écrivain au journal de Pierre Laurentie. 9
De quoi s'agit-il exactement ? Le Rénovateur fait campagne, à l'intérieur du camp légitimiste, pour la présentation de candidats et pour la participation aux élections. Mais siéger en Chambre exige de prêter serment à Louis-Philippe — roi que les légitimistes ne reconnaissent pas, et serment qu'ils dénoncent. Telle est « la situation du parti royaliste » qu'analyse Balzac, se disant « chargé de ce travail par [s]es amis » (O.D., t. II, p. 1047) sans avoir, ajoute-t-il, « ni la prétention ni le vouloir d'indiquer une marche à notre parti » (ibid., p. 1048). C'est donc contre ceux qui, dans son propre camp, prônent l'abstention qu'il prend la plume. Le duc de Fitz-James, échaudé par un échec à Toulouse le 8 janvier précédent, avait refusé de se présenter à Chinon. La circonscription était libre, la candidature de Balzac y fut symbolique : le jeune écrivain de talent fraîchement rallié que vantaient les journaux monarchistes n'était pas éligible. Cette solution de compromis convenait à toutes les tendances du parti.
10
Dans son étude, Balzac propose d'abord « un résumé historique destiné à éclairer les royalistes sur les modifications apportées par le temps dans leurs intérêts matériels et dans les principes qu'ils défendent » (ibid.). Il passe ainsi en revue quatre siècles, depuis « les querelles armées du XVIe siècle », avant de formuler son objectif : « imprimer aux royalistes une pensée plus conforme au temps dans lequel nous sommes » (ibid., p. 1062). Comment ? En lui démontrant qu' « aujourd'hui, les seules armes que les royalistes doivent prendre sont celles que notre siècle a faites : la presse et la tribune » (ibid., p. 1063). Balzac a parfaitement compris que son temps — le « temps dans lequel nous sommes » — n'a rien à voir avec les siècles passés. Nous savons que cet inventeur de fables se définit comme un historien qui cherche dans le roman un « système » qui ne soit pas « inapplicable à un présent qui marche. L'auteur a devant lui pour modèle le dixneuvième siècle » (« Préface » de Une fille d'Eve ; Pl., t. II, p. 265) ; nous savons encore que ce romancier définit son entreprise comme une « histoire de la société peinte en action 20 », ou une « histoire de la société moderne en action » (Corr., t. III, p. 643). Mais le théoricien politique du légitimisme a tout à fait compris, à la différence des hommes de son parti, que ce temps nouveau, que ce monde moderne est celui d'une civilisation de la communication et de la circulation des idées, des opinions et des paroles, comme dépense (convaincre autrui), comme échange (autrui me persuade), comme compétition (différents autrui se disputent ma conviction), comme violence des uns sur les autres. En homme de la communication, en parfait médiologue, Balzac ne cesse de répéter aux royalistes que c'est « par la presse et par la parole » (O.D., t. II, p. 1065) que passent désormais le pouvoir, et la lutte pour son obtention, et les moyens de son exercice 21. Sur ce différend, se prononce cordialement le divorce entre les abstentionnistes, qui furent en quelque sorte encouragés par le désistement du duc de Fitz-James à Chinon, et celui qui croit à l'intervention de l'homme de pensée sur la place publique.
11
Retenons, pour l'heure, de l'engagement et de l'aventure légitimistes de Balzac, non pas simplement sa description de la presse et de la tribune, la tension qu'il maintient entre l'ancien (la tribune) et le nouveau (la presse), ou sa définition du journalisme — on en rencontre beaucoup sous la plume de l'écrivain, « religion des temps modernes » (La Peau de chagrin ; Pl., t. X, p. 93) ; « gouffre qui dévore tout et ne rend rien ; [...] monstre qui n'engendre pas » (XIe « Lettre sur Paris », 10 janvier 1831 ; O.D., t. II, p. 935) 22 —, mais sa sensibilité et sa réaction, qui sont celles d'un homme de l'échange et de la
105
communication, d'un homme de lettres, et non celles d'un homme de parti, ni d'un politique, ni d'un politicien. L'action (le politique) et le poétique ne lui apparaissent pas imperméables. Chez lui, l'engagement n'implique pas la suspension de l'activité littéraire, et celle-ci ne se trouve aucunement dépossédée de toute efficacité, sinon pourquoi reverserait-il, à l'automne 1832, dans Le Médecin de campagne qu'il est en train d'écrire la matière de l'article « Du gouvernement moderne » que vient de refuser Le Rénovateur 23 ? Il est vrai que « la théorie du pouvoir » que Balzac y développe invoque les principes de Machiavel en les adaptant : « Aujourd'hui, Machiavel n'eût pas intitulé son livre : Le Prince, mais Le Pouvoir. Le POUVOIR, être moral, créature de raison, devant rester un et fort, est quelque chose de plus grand que le PRINCE » (O.D., t. II, p. 1073).
Prince 12
Le prince entre les mains duquel se dépose le pouvoir, celui qui gouverne, c'est désormais, au XIXe siècle, dans le « temps dans lequel nous sommes », celui qui règne sur l'opinion. En 1834, dans l'« Envoi » du Prêtre catholique, Balzac revendique la totale indépendance de « l'écrivain a[yant] remplacé le prêtre » (Pl., t. XII, p. 802), et ne dédicaçant plus : « Le temps des dédicaces n'est plus. [...] Une œuvre ne saurait donc être cachetée aux armes d'un clan, offerte à un financier, prostituée à une prostituée » (ibid., p. 802-803).
13
Paul Bénichou a bien montré comment s'opère, dans le passage du XVIIIe au XIXe siècle, le transfert idéologique qui promeut la figure du poète à la place de celle du philosophe ayant sapé les bases de la société ancienne24. Balzac proclame autre chose : c'est l'imprimerie qui succède au prêtre, au pontife, au prophète — « La presse a organisé la pensée, et la pensée va bientôt exploiter le monde. Une feuille de papier, frêle instrument d'une immortelle idée, peut niveler le globe. Le pontife de cette terrible et majestueuse puissance ne relève donc plus ni des rois, ni des grands, il tient sa mission de Dieu [...]. L'imprimerie lui a fait avancer l'avenir [...] » (ibid., p. 803). Tel est le rôle de la presse et du journalisme comme règne et comme organisation de la pensée en parole et en communication dans l'espace public et dans l'humanité sociale. Campant le sujet d'un roman historique, 1'« Introduction » de Sur Catherine de Médicis applique au passé cette loi moderne : « L'imprimerie vint en aide à l'opposition commencée par les Vaudois et les Albigeois. Une fois que la pensée humaine, au lieu de se condenser comme elle était obligée de le faire pour rester sous la forme la plus communicable, revêtit une multitude d'habillements et devint le peuple lui-même au lieu de rester en quelque sorte divinement axiomatique, il y eut deux multitudes à combattre : la multitude des idées et la multitude des hommes » (Pl., t. XI, p. 174).
14
Commandé par madame Hanska, l'« Envoi » du Prêtre catholique qui ne fut — est-ce un paradoxe ? — jamais imprimé, sacralise la figure de celui par qui advient la littérature (« l'écrivain a remplacé le prêtre »), tout en condensant les arguments qui justifient, chez Balzac, l'importance primordiale accordée par ses analyses raisonnées de la situation de la librairie autant que par son œuvre fictionnelle, à l'imprimerie, au journal, au livre, aux conditions techniques de fabrication, de multiplication et de diffusion de la littérature et de l'écrit. Contemporaine de cette entreprise inaboutie — Le Prêtre catholique est aussi un roman abandonné —, la « Lettre adressée aux écrivains français du XIXe siècle » que Balzac donne à la Revue de Paris le 2 novembre 1834 interpelle le personnel politique en des termes voisins de ceux que nous venons de rencontrer : « Messieurs d'hier, qui vous a fait
106
rois ? [...] La pensée vient de Dieu, elle y retourne ; elle est située plus haut que ne sont les rois ; elle les fait et les défait » (O.D., t. II, p. 1238). Ce plaidoyer en faveur de la profession des hommes de lettres précise aussi la relation de communication que l'auteur entretient avec son lecteur : dans le livre, « l'auteur a mis une offrande écrite » (ibid., p. 1246). Ce don du livre se situerait hors de l'échange marchand, et constituerait l'écrivain en prince parce qu'il est donateur. Dans cette économie de l'offrande, l'œuvre et sa dédicace imprimée, son manuscrit et son envoi autographe deviennent des entités transcendantes que le don transforme en oblation de soi. 15
L'euphémisation de la relation économique n'est pas sa négation ni sa disparition. Balzac le sait mieux que quiconque. Dès le 25 février 1830, dans La Silhouette, en tête du premier d'une série de trois articles25 qui constituent une précoce tentative de définition de la figure de l'artiste, il écrivait déjà : « Un homme qui dispose de la pensée est un souverain. Les rois commandent aux nations pendant un temps donné, l'artiste commande à des siècles entiers » (« Des Artistes » ; O.D., t. II, p. 708) ; et affirmait immédiatement ensuite : « Jadis les rois traitaient de puissance à puissance avec les princes de la pensée » (ibid., p. 709). Si l'écrivain est prince parce qu'il est donateur, il l'est évidemment surtout parce qu'il dispose et dispense de la pensée. Le Traité de la vie élégante le répétera à l'automne de la même année : « Il [l'artiste] est toujours l'expression d'une grande pensée qui domine la société » (Pl., t. XII, p. 215). Balzac ne variera jamais sur ce point. Son propos ne ressemble toutefois pas à la restauration d'un statut d'Ancien Régime par lequel l'artiste travaillerait à l'image et au prestige du souverain. Le passage, sur le mode de l'être, de l'essence et de l'incarnation, est métaphoriquement simple de l'un à l'autre : tel écrivain est poète (ou romancier), tel auteur est la poésie (ou le roman), comme le prince est le pouvoir — tandis qu'en d'autres régimes, électif par exemple, les détenteurs du pouvoir ont le pouvoir (qui leur est donné par ceux qu'ils représentent) ; ils ne le sont pas. Ajoutons, cependant, que le prince représente, mais que c'est d'une autre manière : il est (le pouvoir) parce qu'il a (les signes du pouvoir).
16
Une telle conception de l'artiste, proche de l'engagement royaliste des jeunes romantiques, ressemblerait plutôt à celle des premières Odes de Hugo, qui célèbre en poète courtisan, entre 1818 et 1822, les victimes de la Révolution (« La Vendée », « Quiberon », « Louis XVII »), la restauration de la monarchie (« Le rétablissement de la statue de Henri IV »), la famille des Bourbons (« La mort du duc de Berry », « La naissance du duc de Bordeaux », « Le baptême du duc de Bordeaux ») ; de ce Hugo pensionné de Louis XVIII, puis de Charles X, décoré de la Légion d'honneur à 23 ans, invité en mai 1825 au sacre avec Lamartine et Nodier (« Les funérailles de Louis XVIII », « Le sacre de Charles X ») ; de ce Hugo qui écrit dans la préface de 1824 aux Nouvelles Odes que la poésie ne peut exister que dans une perspective monarchiste et religieuse, et que le poète, chantre d'une loi divine, « ne sera jamais l'écho d'aucune parole, si ce n'est de celle de Dieu 26 ». On objectera que la Restauration pensionne les poètes et non pas les romanciers ; nous répondrons qu'en choisissant un genre littéraire, un écrivain choisit un mode d'inscription au sein de la littérature autant qu'un certain rapport à la société et au monde, à ce qui n'est pas la littérature et qui l'environne pourtant.
Propriétaire 17
Balzac propose le pacte politique, et réactionnaire, de la propriété. Ce n'est pas exactement le pacte des riches contre les pauvres comme peut le faire entendre le Traité
107
de la vie élégante : « En octobre 1830, il existe encore deux espèces d'hommes : les riches et les pauvres » (Pl., t. XII, p. 222), et qui spécifie brutalement : « Depuis que les sociétés existent, un gouvernement a donc toujours été nécessairement un contrat d'assurance conclu entre les riches contre les pauvres » (ibid., p. 218) ; c'est plutôt le pacte de « ceux qui possèdent » contre « ceux qui n'ont rien », dont le journaliste politique des Lettres sur Paris évoque « la lutte » le 31 décembre 1830, « lutte qui existe dans toute société [...] entre les privilèges et les prolétaires » (Xe « Lettre sur Paris » ; O.D., t. II, p. 925). L'auteur du Départ, petite contribution à un keepsake carliste, L'Émeraude, publié pour les étrennes de décembre 1831 par Urbain Canel, un vieux complice, confirmera ce point de vue : « Un roi héréditaire est le sceau de la propriété, le contrat vivant qui lie entre eux tous ceux qui possèdent contre ceux qui ne possèdent pas » (O.D., t. II, p. 1024). 18
La Charte de 1814 avait fixé le cens électoral à 300 francs (et l'âge à trente ans), le cens d'éligibilité à 1 000 francs (et l'âge à quarante ans) ; les modifications introduites par la loi du 19 avril 1831 abaissèrent le cens électoral à 200 francs (et l'âge à vingt-cinq ans), le cens d'éligibilité à 500 francs (et l'âge à trente ans). Dans cette France censitaire qui réserve le droit de vote à une petite élite dont la fortune est attestée par son seuil d'imposition (quatre-vingt dix mille électeurs sous la Restauration27 ; le double sous Juillet28), selon une constitution qui distingue entre citoyens actifs — qui ont des droits politiques — et citoyens passifs (qui n'ont que des droits civiques), dans un régime de propriétaires, le plaidoyer balzacien consiste à associer l'artiste à la classe des propriétaires. Ou bien l'homme de lettres s'enrichit — c'est la voie longue — comme tout un chacun (et l'on connaît la fortune du mot de Guizot : « Enrichissez-vous par le travail et par l'épargne ») ; ou bien il se fait immédiatement reconnaître en tant que propriétaire — c'est la voie rapide. Mais de quoi peut-il être le propriétaire ? De ses œuvres, tout simplement, et, mieux, de ses œuvres complètes29, lesquelles ne révèlent pas simplement un souci d'honorabilité, ou un désir de légitimité, ou une quête de notabilité, elles exhibent une propriété, elles fondent un patrimoine, elles marquent un territoire en le clôturant. Pierre Larousse, proche à tant d'égards de Balzac, mobilisera explicitement la métaphore au tome I de son Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle : « Personne n'a le droit de venir semer et récolter dans le champ que, le premier, j'ai défriché et arrosé de mes sueurs30 » ; et la semeuse de sa maison apparaît aussi profondément juste et pertinente que l'homme à la bêche d'Alphonse Lemerre. Balzac, défendant la propriété littéraire en 1839, ne raisonnait-il pas à partir du cas des « dix ou douze maréchaux de France littéraires, [...] qui offrent à l'exploitation une certaine surface » (« Lettre au rédacteur de La Presse », 18 août 1839 ; Corr., t. III, p. 676) ? A ce titre, avec ce titre de propriété, avec cette « surface » — commerciale, et non plus territoriale —, l'écrivain peut entrer dans la lice politique, et jouter, puisque la propriété implique le droit politique.
19
Nous disions propriétaire et producteur car, en effet, sans revenir sur les rapports qu'eut — ou que n'eut pas — Balzac avec les saint-simoniens, force est de constater qu'il emprunte leur terminologie, notamment lorsqu'il affirme que la « mission » de l'artiste consiste à « produire des effets prodigieux par le rapprochement de deux choses vulgaires » (« Des Artistes » ; O.D., t. II, p. 715) ; ou lorsque sa plume dénonce « le peu de respect qu'on a généralement en France pour les hommes auxquels la nation doit sa gloire » (ibid., p. 708), les « hommes qui spéculent sur les produits de la pensée » (ibid., p. 711) et le gouvernement constitutionnel : « quatre cents propriétaires, négociants ou avocats rassemblés, qui ne concevront jamais qu'on doive envoyer cent mille francs à un artiste » (ibid., p. 709). Étonnante puissance du chiffre, chez Balzac, ce « quatre cents »
108
répété treize ans plus tard, en 1843, dans la préface de Les Souffrances de l'inventeur, troisième partie de Illusions perdues : « Il faut que les quatre cents législateurs dont jouit la France sachent que la littérature est au-dessus d'eux » (Pl., t. V, p. 120). 20
Considéré isolément, l'argument balzacien peut paraître proche de celui des doctrinaires et des membres de la fraction modérée du parti libéral, qui proposent d'adjoindre à l'élite fortunée les « capacités », les hommes cultivés qui ne sont pas forcément riches. Dans une lettre dont Thierry Bodin a récemment montré qu'elle doit être datée d'août 183131, Balzac expose au rédacteur en chef d'un journal non identifié sa doctrine : « Il ne s'agit que de hiérarchiser la capacité » (Corr., t. II, p. 597). L'année suivante, lorsqu'il énumère à Zulma Carraud les « principaux points de [s]a politique », il n'omet pas « la reconnaissance des supériorités réelles » (ibid., p. 128 ; 23 septembre 1832). Mais la prétention à l'oisiveté, à la dilapidation, à la paresse et à la prodigalité, au luxe et au dandysme, qui traverse la pensée balzacienne, « Des Artistes » autant que le Traité de la vie élégante, oblige à constater que la « capacité » des banquiers, des avocats, des médecins, de ceux qui se distinguent dans les arts libéraux n'est pas le « talent » — encore moins le « génie » — de ceux qui s'illustrent dans les beaux-arts. Le plaidoyer de Balzac s'achève d'ailleurs, dans La Silhouette, sur un rappel anti-saint-simonien contre toute utilité, contre tout bien public et contre toute préoccupation collective : « Tout homme doué par le travail, ou par la nature, du pouvoir de créer, devrait ne jamais oublier de cultiver l'art pour l'art lui-même » (« Des Artistes » ; O.D., t. II, p. 720). Il y a ici un écart irréconciliable.
21
L'argument de Balzac n'est toutefois pas davantage celui des conservateurs selon lesquels la nation doit être gouvernée par sa frange éclairée — quitte à ce que la souveraineté de la raison s'oppose à la souveraineté du peuple. Balzac, il est vrai, ne cesse de prôner l'union des « princes de la pensée, du pouvoir ou de l'industrie » (Traité de la vie élégante ; Pl., t. XII, p. 223), de défendre une triple alliance : « L'Aristocratie, l'Industrie et le Talent » (« Préface » du Cabinet des Antiques, Pl., t. IV, p. 959), « l'ambition du noble, l'ambition du négociant enrichi, l'ambition du poète. L'esprit, l'argent et le grand nom [...] » (« Préface » de Les Souffrances de l'inventeur, Pl., t. V, p. 117), « le droit d'élection ne doit être exercé que par des hommes qui possèdent la fortune, le pouvoir ou l'intelligence » ( Le Médecin de campagne ; Pl., t. IX, p. 510). Son jugement est en réalité souvent plus nuancé : « [...] l'abus nécessaire que constitue l'inégalité des fortunes s'est régénéré sous de nouvelles formes. N'avons-nous pas, en échange d'une féodalité risible et déchue, la triple aristocratie de l'argent, du pouvoir et du talent, qui, toute légitime qu'elle soit, n'en jette pas moins sur la masse un poids immense, en lui imposant le patriciat de la banque, le ministérialisme, et la balistique des journaux ou de la tribune, marchepieds des gens de talent ? » (Traité de la vie élégante ; Pl., t. XII, p. 222). C'est cette conception du corps social liée à une théorie du pouvoir qu'expose l'article doctrinal « Du gouvernement moderne » que nous avons précédemment évoqué : Il y a eu perfection dans l'ordre social parce qu'il s'est coordonné naturellement : trois classes distinctes se sont dessinées franchement, et ces trois zones se retrouveront infailliblement parmi toutes les sociétés humaines, en allant du bourg à la ville, de la ville à la contrée, de la contrée à la capitale, de la capitale au pays ; elles sont inévitables, et il n'y a pas de constitution sociale, même en faisant table rase, qui puisse les briser, les concasser perpétuellement pour obtenir des unités égales. Ces trois natures sont la masse pauvre, et ignorante, la masse moyenne, et la masse aristocratique, dans laquelle il faut comprendre toutes les supériorités créées par l'argent, le pouvoir et l'intelligence (O.D., t. II, p. 1073-1074) ;
109
22
et que les romans dits utopiques, Le Curé de village et Le Médecin de campagne, s'efforcent d'exprimer : « [...] les supériorités sont une conséquence de l'ordre social. Elles sont de trois sortes et incontestables : supériorité de pensée, supériorité politique, supériorité de fortune » (Le Médecin de campagne ; Pl., t. IX, p. 509) — intelligence, pouvoir, argent.
23
Balzac assimile, en effet, la puissance intellectuelle à la primauté de la naissance : « L'aristocratie et le pouvoir du talent sont bien plus réels que l'aristocratie des noms et la puissance matérielle » (« Des Artistes » ; O.D., t. II, p. 715-716) ; ou bien : « Le grand seigneur, niais et pauvre rôle, depuis que l'aristocratie du nom s'efface et pâlit devant celle du talent32 ». Il récuse et condamne toutefois l'aristocratie pour avoir cru que cette coordination entre la pensée et le nom fonctionnait dans le sens inverse à celui qu'il indique et qu'il défend lui-même : « L'homme du faubourg Saint-Germain a toujours conclu de sa supériorité matérielle en faveur de sa supériorité intellectuelle » (La Duchesse de Langeais ; Pl., t. V, p. 929) ; il y voit l'un des éléments constitutifs de la « fausse politique » de cette caste (ibid.).
24
Qu'en est-il, peut-on avoir envie d'ajouter, de la particule que Balzac usurpa au mépris de ses adversaires qui s'en gaussèrent, et s'en irritèrent, tant et plus ? Rappelons-nous que Bernard-François, le père, s'était nommé « de Balzac » bien avant le fils auquel il a proposé son exemple, et que la labilité et la circulation des noms propres sont aussi des phénomènes d'époque. Traditionnellement perçue comme une simple revendication nobiliaire (ce qu'elle fut, à n'en pas douter, chez le père), l'appropriation de la particule par le roturier « Honoré Balzac » nous semble être, au moins autant, si ce n'est davantage, l'affirmation d'un statut d'artiste : la revendication porte sur la noblesse de l'aristocrate et sur la noblesse de l'artiste. Si l'artiste est propriétaire, il est d'abord le propriétaire de son nom propre — du nom propre dont il signe les œuvres dont il est propriétaire — ; et son nom propre dit sa noblesse, sa propriété et sa puissance : « Quand Arouet s'est appelé Voltaire, il songeait à dominer son siècle, et voilà une prescience qui légitime toutes les audaces » (« Historique du procès auquel a donné lieu Le Lys dans la vallée » ; Pl., t. IX, p. 930).
25
On pourrait, au total, croire Balzac proche des jeunes romantiques royalistes ou des saintsimoniens, proche de la propriété foncière spoliée par la révolution, des émigrés dont les biens sont devenus nationaux comme les œuvres de l'homme de génie appartiennent à la nation (ce que détermine, le 21 juillet 1793, un décret de la Convention faisant suite à un rapport de Lakanal), ou proche encore de ceux qui ne pouvaient trouver leur place au soleil dans la France d'Ancien Régime, de ceux qui, comme l'artiste, ne sont pas propriétaires. Laissons-lui plutôt son originalité, c'est-à-dire sa solitude. Balzac est, loin des partis, un homme seul.
Sujet 26
Parce qu'il est le producteur et le propriétaire de ses œuvres, l'artiste balzacien est, de fait, un agent politique. Une activité professionnelle — qu'elle soit issue des arts libéraux ou des beaux-arts — est un affranchissement de toute forme de servitude et de contrôle : « En effet, aujourd'hui, les arts n'ont que très peu de salaire à attendre du pouvoir. Le peuple sait, seul, solder les artistes avec magnificence » (« Prospectus » de La Caricature, début octobre 1830 ; O.D., t. II, p. 796). Elle n'a à répondre que d'elle-même et ne peut être fonctionnarisée : « Quant à l'argent, jamais les arts n'en ont moins obtenu du
110
gouvernement » (« Des Artistes » ; O.D., t. II, p. 708). Cette pratique intellectuelle libre exige la propriété commerciale de son produit. Tel serait le premier fondement — tout à la fois économique et socio-culturel — d'une théorie du sujet : en droit bourgeois, l'activité libérale (comme on dit « profession libérale ») crée un sujet producteur, responsable et propriétaire de ses œuvres, de ses actes et de ses paroles. Etre écrivain, se revendiquer artiste, c'est donc se définir comme le sujet autonome d'une création libre ; l'art libéral est donc le lieu d'un engagement réel, d'une expression authentique de l'être, d'une décision de la conscience individuelle dont la vérité et l'identité peuvent entrer en rivalité avec le jeu social des intérêts, l'hypocrisie des calculs, le compromis des élections. 27
Ceci n'est pas sans conséquences. Balzac s'aperçoit très tôt, et beaucoup plus tôt que la plupart de ses contemporains, qu'en situation de marché, la propriété intellectuelle est compromise ou menacée par la propriété commerciale. D'où sa tentative de définir le rapport de propriété qui lie l'artiste à son produit, son interrogation sur le système de la librairie (il essaiera d'en être le réformateur33) et sur la situation de l'écrivain (il s'en fera le défenseur au sein de la Société des gens de lettres et militera pour le droit d'auteur et la propriété littéraire). D'où son goût pour le légitimisme : « La légitimité, système inventé plus pour le bonheur des peuples que pour celui des rois, découle de l'impossibilité de gouverner le peuple quand l'État reconnaît des droits égaux à celui qui ne possède rien comme à celui qui possède beaucoup, à celui qui n'a point d'idées comme à celui qui a conquis une puissance intellectuelle » (« Essai sur la situation du parti royaliste », O.D., t. II, p. 1059). D'où son goût pour les sociétés stables, au pouvoir fort et centralisé, qui garantissent la propriété. Et la préférence idéologique et morale pour le catholicisme, « le plus grand élément d'Ordre social » (« Avant-propos », Pl., t. I, p. 12), s'en trouve peut-être éclairée, tout comme la prédilection pour le droit d'aînesse et pour le majorât, lesquels préservent l'acquis des fortunes, les inscrivent dans une logique durable de la transmission et de la filiation, les garantissent contre les héritages, évitent le morcellement de la propriété territoriale (voir Les Paysans), et prémunissent contre le fantasme de la division, du partage, de la dépense et de la perte.
28
C'est au tout début de la monarchie de Juillet que se fixe la politique balzacienne de l'artiste, au moment d'une refonte du régime censitaire qui persiste à ignorer la propriété de l'écrivain (ses œuvres). Nous avons pu voir qu'aux yeux de Balzac, cette propriété intellectuelle est comparable à la propriété du nom, ou à la propriété foncière, ou à celle de l'argent, et doit leur être associée dans le pacte, qu'il nomme « aristocratie », des propriétés — qu'il nomme « ambitions », « supériorités », « capacités ». Ce que demande Balzac, c'est le partage — ou le bénéfice — d'un système qui ignore les droits de l'artiste alors qu'il devrait les assurer. Dans la lettre qu'il envoie à son oncle, Louis Lambert suppute une mise à l'écart délibérée : « Si le gouvernement avait une pensée, je le soupçonnerais d'avoir peur des supériorités réelles qui, réveillées, mettraient la société sous le joug d'un pouvoir intelligent » (Louis Lambert ; Pl., t. XI, p. 649).
29
Nous pourrions conclure immédiatement, en évoquant l'abandon du Député d'Arcis, ce roman des Scènes de la vie politique d'abord intitulé Une élection en province, puis Une élection en 1838. La première partie parut en feuilletons en avril-mai 1847 dans L'Union monarchique, mais le 29 juillet 1848, Balzac jette au feu les épreuves de l'ensemble « car elles étaient tellement mêlées qu'aucune puissance humaine n'auraient pu les mettre en ordre. Ça été un deuil de l'âme » (L.H.B., t. II, p. 937). Les causes de ce sacrifice et de cet abandon ont été beaucoup commentées, autant que le renoncement du génie fatigué, dont le « cerveau [...] s'est couché comme un cheval fourbu » (ibid., p. 450) 34. Mais, au
111
fond, quel intérêt y a-t-il à raconter une histoire électorale sous le régime censitaire alors que la révolution de Février 1848 vient d'instaurer le suffrage universel ?
Maréchal 30
Un phénomène doit cependant retenir encore notre attention. Si la réflexion de Balzac semble assez rapidement fixée dans le cadre national de la monarchie de Juillet, elle se transporte bientôt à l'échelle du continent. Selon Fernand Baldensperger, ce sont les années 1832-1836 qui « marquent le mieux, dans la destinée du grand romancier français, une ″européanisation″ consciente35 » qu'il nous reste à examiner.
31
À l'image de Napoléon qui se sacre lui-même sous les yeux du pouvoir spirituel, « le prince de la pensée » se sacre dans un monde qui se laïcise, tandis que la littérature revendique son autonomie, organise sa sphère publique, ses normes et ses formes institutionnelles. Dans l'imaginaire balzacien, la figure napoléonienne est une figure de synthèse qui occupe deux emplois. Elle emblématise d'abord la fonction du législateur, de l'organisateur — Napoléon est le « plus grand organisateur des temps modernes 36 » —, de celui qui pèse et qui légifère sur les mœurs, et qui est, pour cette raison même, l'alter ego et le rival du romancier-historien des mœurs, de l'écrivain dont « la loi » propre « le rend égal et peut-être supérieur à l'homme d'État » (« Avant-propos », Pl., t. I, p. 12). Napoléon est d'autre part le chef des armées dont l'écrivain achève le combat européen, car « si la France exerce une prépondérance en Europe, elle le doit surtout à ses hommes d'intelligence. Aujourd'hui, la plume a évidemment remplacé l'épée » (« Lettre au rédacteur de La Presse », 18 août 1839 ; Corr., t. III, p. 676). Balzac affirme très tôt, dans sa correspondance privée, sa volonté de « gouverner le monde intellectuel en Europe » (L.H.B., t. I, p. 57 ; 13 septembre 1833) ; et dans une lettre à Laure Surville, du 20 juillet 1832, il se disait déjà « au moment d'être à la tête des intelligences de l'Europe » (Corr., t. II, p. 62). Ce rêve, qui rejoint l'anecdote que rapporte Werdet, du bout de papier « collé sur le fourreau de l'épée » de la statuette en plâtre de l'Empereur, dans le cabinet de travail de la rue Cassini, puis à Chaillot, avec cette inscription : « Ce qu'il n'a pu achever par l'épée, je l'accomplirai par la plume »37, va, en réalité, bien au-delà. En effet, Balzac professe, en termes identiques, la même rivalité dans ses écrits publics contemporains. Ainsi, la « Lettre adressée aux écrivains français du XIXe siècle » que nous avons déjà évoquée, exige une « enquête sur l'état de la littérature, considérée comme intérêt matériel, comme produit énorme, comme moyen d'imposer l'Europe, de régner sur l'Europe par la pensée, au lieu de régner par les armes » (O.D., t. II, p. 1250). Balzac transpose le conflit sur un terrain qui n'est pas choisi au désavantage de la France : « une des gloires de la France est de remuer l'Europe par la plume comme elle l'a remuée par l'épée » (« Préface » de Une fille d'Eve, 1839 ; Pl., t. II, p. 267) ; et dans Modeste Mignon, en 1844, encore, bien que la parole soit donnée à Canalis : « Nous régnerons par le Livre peut-être plus sûrement, plus longtemps que par le Glaive » (Pl., t. I, p. 644).
32
La métaphore napoléonienne, impériale et guerrière, inscrit donc sa fonctionnalité dans le registre de la lutte de la France contre l'Europe poursuivie dans le domaine intellectuel. Elle permet à Balzac de penser son statut à l'échelle de son continent et de son siècle, et lui sert de relais. Le « prince de la pensée » gouverne l'Europe par la plume comme l'Empereur la gouverna par les armes, mais celui-ci était en outre, selon l'écrivain — il importe de ne pas l'oublier —, la fusion des pouvoirs spirituel et temporel, « un homme qui avait dans sa tête un code et une épée, la parole et l'action » (Autre étude de femme ; Pl.,
112
t. III, p. 701)38. « Des Artistes » disait déjà, en 1830, cette dualité et cette réversibilité : « Ainsi tout va de pair dans tout ce qui procède de l'intelligence, et Napoléon est un aussi grand poète qu'Homère : il a fait de la poésie comme le second a livré des batailles » (O.D., t. II, p. 711). Le poète est homme d'action, et l'homme d'action est poète (Vautrin : « Je suis ce que vous appelez un artiste. [...] Mes poésies, je ne les écris pas : elles consistent en actions et en sentiments » ; Le Père Goriot, Pl., t. III, p. 136 et p. 141). 33
On retrouve chez le « maréchal de la littérature » (le mot est de Victor Hugo), ou le « Napoléon des lettres » (le mot est de Paul Bourget), ces deux ordres, l'amalgame des institutions civiles et religieuses, les « deux Vérités éternelles » à « la lueur » desquelles le romancier prétend écrire : « la Religion, la Monarchie » (« Avant-propos » ; Pl., t. I, p. 13), une autorité à parler politique en même temps qu'une attitude qui ne s'écarte pas de l'action. C'est que Balzac se projette bien au-delà de la nostalgie partagée par les jeunes romantiques pour la gloire d'Empire qui avait tout éclipsé, pour les jeunes militaires auxquels le peu de temps séparant deux campagnes — la suivante pouvait être la dernière — donnaient toutes les audaces, pour ces officiers fougueux qui faisaient sonner leurs bottes sur les parquets cirés des salons et sous les lustres d'or des bals — désormais les seuls champs de bataille où vaincre et s'illustrer, par des conquêtes qui ne sont plus qu'amoureuses.
Intelligentiel 34
Dix jours avant d'exposer à madame Hanska le programme de sa grande œuvre complète — qu'il ne réalisera que huit années plus tard —, Balzac écrit à sa correspondante, le 16 octobre 1834 : « Nous avons atteint à l'ère de l'intelligence. Les rois matériels, la force brutale s'en va [sic]. Il y a des mondes intellectuels [...]. Il y aura des souverains dans le royaume universel de la pensée » (L.H.B., t. I, p. 202). Dix mois plus tard, en août 1835, se sentant « à la veille de commencer l'existence politique » (ibid., p. 265), il songe à s'appuyer sur la Revue de Paris et sur la Revue des Deux Mondes — « elles se réunissent à moi, me prennent pour chef » (ibid.) — pour former, avec François Buloz, un parti : « Je pense à n[ous] faire appeler le parti des intelligentiels, nom qui prête peu à la plaisanterie, et qui constituerait un parti auquel on serait flatté d'appartenir. Chef de ceci, en France, cela vaut la peine qu'on y pense. [...] Rien ne résisterait à cette ligue armée » (ibid.) 39. Rien ne se fera, car Balzac se brouillera avec Buloz et la Revue de Paris à propos du Lys dans la vallée avant la fin de l'année ; la rupture, soldée par un retentissant procès, suivra. « Parti des intelligentiels », ou des « hommes d'intelligence », si l'adjectif signifie bien « de l'intelligence », ou « relatif à l'intelligence »40 : un substantif, ici, se cherche qui désignerait, bien avant l'affaire Dreyfus41, celui qui entre dans l'arène politique, et qui lutte au moyen de la plume contre l'étouffement du pouvoir.
35
Ayant fait l'épreuve de la caducité des catégories anciennes, celles du poète et de l'artiste autant que celles du propriétaire et du producteur, celles du prêtre et du prophète autant que celle du prince et du maréchal, une pensée sûre de son droit, de sa force et de son pouvoir de transformation — elle possède un savoir certain sur des sujets importants aux hommes —, cherche à s'incarner. Le projet politique de Balzac est un projet philosophicopolitique marqué par le souci de prendre part aux débats de la quotidienneté et de rester présent à l'événement — au risque de quitter la communauté philosophante. Toujours déjà saisie par le milieu qu'elle veut éclairer, ou dont elle veut faire sortir le sens, la
113
parole balzacienne est tout à la fois réfléchissante en même temps qu'elle mène à des fins. Parole d'acteur et parole de théoricien.
NOTES 1. L'Événement, jeudi 22 août 1850 (articles de tête « Les obsèques d'Honoré de Balzac », p. 1 col. 1-4) ; repris dans Actes et paroles, tome I : Avant l'exil (Michel Lévy, 1875, p. 420-423) ; dans Œuvres complètes, édition chronologique sous la direction de Jean Massin, Club français du livre, 1968, t. VII, p. 316-318. 2. Jean Pommier : « Balzac "écrivain révolutionnaire" », L'Année balzacienne 1967, p. 247-258. 3. La Gazette de France, mercredi 21 août 1850 (p. 2 col. 1-2 ; article non signé). 4. Jean Pommier : loc. cit., p. 247. 5. La Gazette de France, vendredi 23 août 1850 (p. 3 col. 1 ; article non signé). 6. L'Événement, samedi 24 août 1850 (p. 1 col. 4-5 ; article non signé). 7. L'Assemblée nationale, lundi 2 septembre 1850 (p. 3 col. 1-5 ; « De la littérature révolutionnaire. XIV. le roman démagogique »). 8. Correspondance de Balzac publiée par Roger Pierrot, Garnier, 1960-1969, 5 vol. ; tome I, p. 45 (désormais abrégé en « Corr. »). 9. L'expression appartient évidemment à Claude Duchet : « Idéologie de la mise en texte : ouverture de Germinal », Dossiers pédagogiques de la RTS [radio-télévision scolaire], tome II, français, 1972-1973, p. 104-107 ; « La mise en texte du social », Balzac et La Peau de chagrin, Sedes, 1979, p. 79-92 ; « Idéologie de la mise en texte », La Pensée, n° 215, octobre 1980, p. 95-107 (autre publication du même article sous le titre « Enjeux idéologiques de la mise en texte », Revue de l'Université de Bruxelles, 1979-3/4, p. 316-332). 10. Édition parue en 24 volumes entre 1869 et 1876. Jean-Yves Mollier en a retracé l'histoire dans Le Courrier balzacien, n° 20, juillet 1985, p. 4-12. Les comptes rendus de Zola ont notamment paru dans Le Gaulois, 8 février 1869, 17 mars 1869 ; La Tribune, 31 octobre 1869 ; Le Rappel, 13 mai 1870 ; La Cloche, 1er décembre 1871, 15 juin 1872, 21 août 1872 ; Le Bien public, 16, 23, 30 juillet 1877. Certains d'entre eux ont fourni, en 1881, la matière du chapitre consacré à Balzac dans Les Romanciers naturalistes. 11. La Tribune, 31 octobre 1869, p. 7, sous la rubrique « Causeries » ; repris dans Œuvres complètes, Cercle du livre précieux, t. X, 1969, p. 912-916 (ici, p. 913-914). Même formule (« Balzac, ce démocrate sans le savoir ») dans l'article du Rappel intitulé « Balzac (édition complète et définitive) », vendredi 13 mai 1870 (p. 3 col. 3-6 ; sous la rubrique « Les livres ») ; repris dans Œuvres complètes, ibid., p. 926. 12. La Tribune, 31 octobre 1869 (dans ibid., p. 915). 13. Bernard Guyon : La Pensée politique et sociale de Balzac, Armand Colin, 1947, 829 p. 14. La Comédie inhumaine, Gallimard, 1970, 838 p. 15. Balzac et le mal du siècle, Gallimard, 1970, 2 vol. ; Mythes balzaciens, Armand Colin, 1972 ; Le Monde de Balzac, Arthaud, 1973. 16. Le Père Goriot, dans La Comédie humaine ; nouvelle édition publiée sous la direction de PierreGeorges Castex, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1976-1981, 12 vol. ; tome III, p. 83 (désormais abrégé en « Pl. »).
114
17. Deux cent soixante voix contre soixante. La candidature de Balzac avait pourtant été très dithyrambiquement annoncée par La Quotidienne le jeudi 24 mai, par Le Courrier de l'Europe le vendredi 25, par Le Rénovateur le samedi 26 (tome II, p. 125) ; et aussitôt moquée par Figaro le même samedi (p. 4, sous la rubrique « Bigarrures »). 18. Œuvres diverses, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1990 et 1996, 2 vol. parus ; tome II, p. 1047-1065 (désormais abrégé en « O.D. »). Pour les œuvres parues entre 1835 et 1848, il faut encore consulter le tome III des Œuvres diverses (1836-1848), dans les Œuvres complètes de H. de Balzac, texte révisé et annoté par Marcel Bouteron et Henri Longnon, Conard, 1912-1940 (désormais abrégé en « O.D.C. »). 19. Bernard Guyon : op. cit., p. 528. 20. Lettres à madame Hanska, publiées par Roger Pierrot, Laffont, « Bouquins », 1990, 2 vol. ; tome I, p. 538 (désormais abrégé en L.H.B.). 21. Voir les aperçus éclairants de Françoise Gaillard, que nous rencontrons avec plaisir sur bien des points : « Pulp story ou Balzac médiologue », Cahiers de médiologie, n° 4 (« Pouvoirs du papier »), 2e semestre 1997, p. 209-214. 22. Voir encore Une fille d'Eve : le journalisme « tue le principe des grandes œuvres, et consacre la lâcheté de l'esprit » (Pl., t. II, p. 304) ; ou la préface à Un grand homme de province à Paris, deuxième partie de Illusions perdues : « Non seulement le journal tue beaucoup de jeunesse et de talents, mais il sait enterrer ses morts dans le plus profond secret, il ne jette jamais de fleurs sur leurs tombes, il ne verse de larmes que sur ses défunts abonnés » (Pl., t. V, p. 115-116). 23. O.D., t. II, p. 1066-1083. C'est au chapitre III du Médecin de campagne que Balzac réutilise son article, dans le discours de Benassis (Pl., t. IX, p. 506 et suiv.). 24. Paul Bénichou : Le Sacre de l'écrivain 1750-1830, Corti, 1973. 25. Les suivants ont paru les 11 mars et 22 avril. Sur cette étude capitale à tous égards, voir Roland Chollet : « Des Artistes, un plaidoyer pour le créateur intellectuel », dans Balzac journaliste, Klincksieck, 1983, p. 200-211 ; et O.D., t. II, p. 1516-1518 (pour la notice). 26. « Préface » aux Nouvelles Odes, dans Œuvres complètes, édition chronologique sous la direction de Jean Massin, Club français du livre, 1967, tome II, p. 475. 27. Estimation de G. de Bertier de Sauvigny : « Le pays légal se trouve ainsi constitué par quelque 90 000 électeurs, parfois un peu plus, parfois un peu moins ; autrement dit, il y a environ un électeur pour cent Français majeurs » (La Restauration, 1974 [1955], Flammarion, « Champs », p. 295). 28. Pierre Larousse estime que les dispositions de 1831 firent « plus que doubler le nombre des électeurs » (article « Cens », Grand Dictionnaire universel du
XIXe
siècle, 1865-1876, tome III, p. 707
col. 3). 29. Sur la publication des œuvres complètes comme marque de la propriété de l'auteur, voir Roland Chollet : « Ci-gît Balzac », Balzac, Œuvres complètes. Le "Moment" de La Comédie humaine, Presses Universitaires de Vincennes, 1993, p. 283-298. 30. Article « Anthologie », exceptionnellement signé « Pierre Larousse », Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle, 1865-1876, tome I, p. 430 col. 3. 31. Thierry Bodin : « Autour d'une critique de La Peau de chagrin », L'Année balzacienne 1997, p. 289-302. 32. Compte rendu de La Confession de Jules Janin, Feuilleton des journaux politiques, 14 avril 1830 ( O.D., t. II, p. 699). On peut rapprocher de cet énoncé l'anecdote suivante, tirée du Traite de la vie élégante : « Quand M. Peel entra chez M. le vicomte de Chateaubriand, il se trouva dans un cabinet dont tous les meubles étaient en bois de chêne : le ministre trente fois millionnaire vit tout à coup les ameublements d'or ou d'argent massif qui encombrent l'Angleterre écrasés par cette simplicité » (Pl., t. XII, p. 216). 33. Voir, par exemple, les deux tentatives de Balzac publiées par Roland Chollet : « Un épisode inconnu de l'histoire de la librairie : la Société d'Abonnement général. Avec le texte inédit de
115
Balzac », Revue des Sciences humâmes, janvier-mars 1971, p. 56-109 ; « Balzac et sa "grande affaire de librairie". L'acte de société de 1833 », L'Année balzacienne 1975, p. 145-175 ; voir encore « Pour une autre librairie : la "Société d'abonnement général" », dans Balzac journaliste, op. cit., p. 513-536. Le texte de 1829 a été republié dans O.D., t. II, p. 853-863 (p. 1640-1645 pour la notice). 34. L'image est récurrente : « La semaine dernière, je n'ai pas pris en tout 10 heures de sommeil. Aussi, hier et aujourd'hui ai-je été, comme un pauvre cheval fourbu, sur le flanc, dans mon lit, ne pouvant rien faire, rien entendre » (L.H.B., t. I, p. 212 ; 15 décembre 1834) ; « Je n'ai pas une minute à moi, et je ne prends une distraction que quand la cervelle se couche comme un cheval fourbu » (ibid., p. 238 ; 11 mars 1835) ; etc. 35. Fernand Baldensperger : Orientations étrangères chez Honoré de Balzac, Librairie ancienne Honoré Champion, 1927, p. 198. 36. Préface au recueil Maximes et pensées de Napoléon recueillies par Balzac et cédée spar lui à J.L. Gaudy jeune qui les mit en vente sous son nom en 1838 ; dans Œuvres complètes publiée sous la direction de Maurice Bardèche, Club de l'Honnête Homme, 1956-1963, 28 vol. ; tome XXVIII, p. 740. Voir encore ceci : « organiser [...] est un mot de l'Empire, et qui contient Napoléon tout entier » (Autre étude de femme ; Pl., t. III, p. 692). Nous avons brièvement développé cet aspect dans « ″Le″ ″roman″ ″balzacien″ », Eidôlon, n° 52, à paraître en 1999. 37. Edmond Werdet : Portrait intime de Balzac. Sa vie, son humeur et son caractère, Dentu, 1859, p. 331. 38. Voici le début de la longue tirade sur Napoléon, encore fois placée dans la bouche de Canalis, dont ne nous retenons que quelques mots : « Qui pourra jamais expliquer, peindre ou comprendre Napoléon ? Un homme qu'on représente les bras croisés, et qui a tout fait ! qui a été le plus beau pouvoir connu, le pouvoir le plus concentré, le plus mordant, le plus acide de tous les pouvoirs ; singulier génie qui a promené partout la civilisation armée sans la fixer nulle part ; un nomme qui pouvait tout faire parce qu'il voulait tout ; prodigieux phénomène de volonté, domptant une maladie par une bataille et qui cependant devait mourir dans son lit après avoir vécu au milieu des balles et des boulets ; un homme qui avait dans sa tête un code et une épée, la parole et l'action ; [...] » (Autre étude de femme ; Pl., t. III, p. 700-701). 39. Alphonse Karr a laissé un piquant récit de quelques dîners au cabaret du Cheval rouge qui devaient concerner le projet d'association de ce « parti » (« Anecdote sur Balzac », En fumant, Michel Levy, 1861, p. 51-53). 40. On rencontre au moins deux autres occurrences du mot, chez Balzac, l'une et l'autre sous forme adjectivale ; en 1835, dans La Fille aux yeux d'or : « Mais ce pouvoir [...] était décuplé par l'intelligence européenne, par l'esprit français, le plus vif, le plus acéré de tous les intruments intelligentiels » (La Fille aux yeux d'or ; Pl., t. V, p. 1085) ; au printemps 1848, dans une « Lettre sur le travail » demeurée inédite du vivant de son auteur : « Selon nous, l'accord de la santé, de l'intelligence et de la main est au moins aussi rare chez les ouvriers de tous les corps d'état, que l'accord du talent et de la volonté chez les travailleurs intelligentiels » (O.D.C., t. III, p. 686). 41. Alain Pagès : Emile Zola. Un intellectuel dans l'affaire Dreyfus, Librairie Séguier, 1991.
116
Pouvoir - impouvoir ou fiction et réalités juridiques Sandra Travers de Faultrier
1
Considérer les aspects juridiques d’une question (chose, acte, être, situation), c’est s’intéresser à l’ensemble des règles et interprétations qui en organisent le sens. Mais considérer les aspects juridiques d’une question, c’est ensuite parfois mesurer la résistance des faits au Droit, saisir l’étendue d’une fiction juridique, ou encore déterminer ou comprendre l’origine et l’apparente légitimité d’une pratique contra legem. Le présent article s’inscrit dans cette seconde perspective.
2
Le 19 novembre 1992 le Conseil des Communautés Européennes arrête la directive n° 92/100 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (publiée au J.O.C.E. le 27 novembre 1992). La notion de prêt, qui seule ici nous intéresse, est définie par l’article 1-3 :
3
« Aux fins de la présente directive, on entend par prêt d’objets leur mise à disposition pour l’usage, pour un temps limité et non pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect, lorsqu’elle est effectuée par des établissements accessibles au public. »
4
L’article 2 énonce le principe d’un « droit exclusif d’autoriser ou d’interdire le prêt public » au profit de l’auteur. L’article L122-4 du Code de la propriété intellectuelle, énonçant de manière impérative que toute exploitation d’une œuvre doit faire l’objet d’un consentement écrit de l’auteur, à l’exception des pratiques légalement énumérées par l’article L122-51, il serait logique de considérer une telle directive comme étant inutile en France. Or celle-ci a eu un effet révélateur : bien que soumis au principe d’autorisation, le prêt public qui, juridiquement, s’analyse en une diffusion, en une exploitation de l’œuvre, fonctionne comme une dérogation au droit d’auteur. En complète contradiction avec le Droit, cette pratique usuelle, qui s’apparente à une violation pure et simple du droit de la propriété littéraire et artistique, jouit d’une légitimité telle que la directive, qui exigeait que les dispositions entrassent en vigueur au plus tard le 1er juillet 1994, n’est, à ce jour, pas encore appliquée en France. Concertations, études, rapport2 aboutissent finalement au choix d’une rémunération à titre de dédommagement ou de compensation. Le consentement, pièce maîtresse de la loi de 1957, est balayé par la rémunération, élément
117
accessoire mais non nécessaire. En effet l’article 5 de la directive européenne prévoit, en ses alinéas 1 et 3, des dérogations au principe énoncé au premier article, principe conforme à la notion de monopole exclusif reconnu à l’auteur, source, entre autres, d’un contrôle de destination. Ce texte dispose que : 5
« Les Etats membres peuvent déroger au droit exclusif prévu à l’alinéa 1 pour le prêt public, à condition que les auteurs au moins obtiennent une rémunération au titre de ce prêt ».
6
« Les Etats membres peuvent exempter certaines catégories d’établissements au paiement de la rémunération prévue aux paragraphes 1 et 2 ».
7
Comment arrive-t-on à faire d’une pratique illicite la règle ? Où se trouve la légitimité fondatrice des propositions légales et usuelles ?
8
Le XIXe siècle est, à cet égard, une période clé pour éclairer l’état de fait aujourd’hui. Si l’écriture juridique peut, par sa lenteur ou son empressement, sa fermeture ou sa « mollesse », exprimer les embarras ou les évidences que le législateur a rencontrés face au problème, son inachèvement, suscitant néanmoins une avancée sporadique par touches ponctuelles, est aveu d’aspirations et de tensions contraires aboutissant à un compromis, où vœux animés du désir d’actualisation et freins extérieurs opposés à leur réalisation sont conduits à composer ensemble. La chronologie des textes juridiques amendant, enrichissant le droit de la propriété littéraire, révèle un état de droit dont la gestation lente trahit la nature moins « naturelle » qu’il n’y paraît d’un droit pourtant objet de déclamations et proclamations emphatiques. La disparité des sources juridiques appelées à régir ce domaine, en faisant apparaître le décalage entre une jurisprudence plus favorable ou plus attentive aux auteurs et des textes légaux moins prompts à enregistrer leurs revendications, pose le décor pour une impuissance programmée de l’auteur.
9
Nous verrons donc comment la lecture publique est un révélateur de ce conflit latent en nous attardant sur la notion de reproduction posée par les textes révolutionnaires dont la finalité semblait vouloir conférer une valeur monétaire à l’œuvre plutôt que de doter l’auteur d’une légitimité, ainsi qu’en soulignant le conflit originel latent existant entre dispositions individualistes et dispositions collectivistes.
10
Globalement il s’agira d’analyser le présent comme le symptôme d’un retour du refoulé, tu longtemps par une loi de 1957 imprégnée de l’imagerie auctoriale du XIXe siècle véhiculée par les auteurs et l’institution scolaire.
L’œuvre objet d’un droit de reproduction 11
Alors que la période révolutionnaire stimula le besoin d’information, les années postérieures amorcèrent un développement de la lecture des journaux comme des ouvrages. Ces derniers cependant demeurèrent d’un prix élevé (1/3 du salaire d’un ouvrier), et plus que l’analphabétisme, le coût de l’achat constituait obstacle à l’épanouissement du commerce éditorial déjà affaibli par une concurrence déloyale favorisée à l’origine par l’abolition du privilège d’impression.
12
La lecture publique, celle qui favorise à travers un exemplaire matériel de l’œuvre de multiples accès à celle-ci, va donc se développer. Ce sont d’abord les cabinets de lecture, apparus au XVIIIe siècle, qui prennent de l’ampleur, s’organisent, éditent de fabuleux
118
catalogues. Ce sont ensuite les grandes bibliothèques de prêt, constituées à partir des confiscations révolutionnaires, puis à partir d’une politique volontariste de mise à la disposition du public des œuvres, de la connaissance. Ce sont enfin les boutiques à lire, qui développent le prêt à emporter. Ces dernières connaissent, sous la Restauration, un développement considérable, favorisant la diffusion des œuvres dans toutes les catégories sociales. 13
Pour ces lieux, institutionnels ou privés, de lecture, il ne s’agit pas de copier, de reproduire ou de s’improviser éditeur/imprimeur. Il s’agit d’organiser la jouissance, l’accès à l’œuvre, et ce à partir d’un exemplaire légitimement acquis, parce qu’acheté. Le droit mis en place par le législateur révolutionnaire semble trop étroitement entendu à l’époque pour qu’une interprétation extensive du mot reproduction puisse être perçue comme synonyme de diffusion, d’accès, de jouissance, d’usage, interprétations aujourd’hui évidentes.
14
En effet, les décrets révolutionnaires des 19 et 24 juillet 1793 consacrent le « droit de reproduction des auteurs », à savoir « le droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages dans le territoire de la République » (article 1). Le texte, en partie écrit en réaction à l’ordre ancien du privilège, fait d’une part glisser la titularité de la tête de l’imprimeur vers celle de l’auteur (mais des privilèges individuels reconnaissaient déjà sous l’Ancien Régime l’auteur comme bénéficiaire de ce type de reconnaissance3) ; d’autre part, et c’est là la vraie mutation, la qualité de la prérogative retenue n’est plus de la nature des privilèges, mais de la nature d’un droit. Il ne s’agit plus de grâce, mais d’un pouvoir ontologiquement associé à l’homme auteur. Droit, et non plus privilège, les prérogatives reconnues sont d’ordre matériel et concernent, à ce titre, le droit de consentir à l’exploitation, et le droit d’être intéressé financièrement à l’exploitation de l’œuvre. Toutefois ces droits sont subordonnés au dépôt à la Bibliothèque nationale4, et sont, par ailleurs, temporaires. A l’origine, la protection établie ne prend fin qu’au terme des dix années suivant le décès de l’auteur. Les textes de 1810, 1854 et 1866 vont accroître la durée de cette protection à vingt années, puis trente, et enfin cinquante5. Cette dernière durée sera reprise par la loi du 11 mars 1957. En 1996 la durée légale de protection est fixée à soixante dix ans post mortem par extension à partir d’une disposition européenne.
15
Plutôt que créer un droit absolu, le législateur consacre un objet, l’œuvre. Celle-ci, définie par le travail de mise en forme permettant à une idée d’être perceptible au sens, conquiert une valeur et une autonomie. Une valeur tout d’abord, puisque, objet de la reproduction, elle devient le fondement de la rémunération de l’auteur, alors qu’auparavant mécènes, rois ou autres commanditaires rémunéraient l’auteur à travers des attributions de fonctions, de libéralités ou encore de privilèges sans relation directe avec l’exploitation de l’œuvre ou sa valeur marchande. Autonomie ensuite, car l’œuvre est un concept qui n’accepte aucune discrimination reposant sur le genre d’expression, le mérite ou la destination. Le législateur protège les « écrits en tous genres, ouvrages des compositeurs de musique, œuvres de peintres ainsi que celles des dessinateurs [...] et toute la production de l’esprit ou du génie qui appartiennent aux Beaux Arts ». L’œuvre est émancipée, du moins en droit, de tout asservissement aux règles sociales et jugements de l’air du temps6, comme des liens symboliques de dépendances qui instaurent entre artistes et seigneurs une logique de reconnaissance mutuelle, de légitimité réciproque, par laquelle « le poète se divinise en divinisant le mécène »7. Cet état de fait, qui caractérise les XVIe et XVIIe siècles, était déjà connu de l’Antiquité, où « le lettré doit son
119
existence à son mécène, lui en offrant en retour ainsi qu’à lui-même la célébrité » 8. Cette émancipation, par rapport aux différents liens de dépendances, traduit l’apparente victoire d’une idéologie de l’unité de l’art. Ainsi, l’œuvre est dotée de valeur indépendamment de son objet (la laideur peut devenir objet artistique), de sa technicité ou de sa difficulté (miniatures et scènes religieuses ou guerrières de grandes dimension). Cette reconnaissance d’autonomie achève une évolution qui, depuis le XVIe siècle, oriente le regard vers la représentation elle-même plutôt que vers le sujet représenté, valorisant ainsi dans le domaine pictural « l’opacité de l’image pour elle-même plutôt que sa transparence à l’égard de l’objet représenté »9. 16
Enfin, et peut-être surtout, l’œuvre devient un objet doté de commercialité : elle n’est plus hors commerce, mais un objet destiné à circuler comme les biens et services à valeur économique. Elle ne perd pas sa valeur symbolique, mais son régime sera dorénavant celui d’un bien économique (primaire ou à valeur ajoutée) destiné à être consommé, transformé, incorporé. L’auteur célébré n’est pas l’écrivain mais celui qui produit un objet qualifié d’œuvre. C’est l’objet qui détermine la qualité de l’homme. Contrairement à la liberté d’expression et contrairement à ce qui est souvent avancé, il ne s’agirait pas d’un droit de l’homme ontologiquement entendu. C’est la nature du droit qui lie œuvre et homme, qui confère à ce dernier une place, une identité juridique et sociale. Sujet et bien sont ainsi définis et cernés dans un rapport de subordination qui les lie l’un à l’autre, la qualité d’auteur étant asservie à l’existence d’une œuvre.
17
Le droit de reproduire, droit de procéder matériellement à la fixation de l’œuvre sur un support, est un droit réel, un droit sur une chose. Mais ce droit se révèle bien limité. Car au-delà de la copie, des traitements divers de l’œuvre peuvent affecter le rapport de l’homme à l’œuvre. Pour parvenir à étendre le pouvoir de l’auteur, il convenait d’amenuiser ce rapport à la chose, de limiter la chosification de l’œuvre-marchandise et de la promouvoir au rang des réalités de nature personnelle. Pour arracher l’œuvre à son statut d’objet contractuel auquel les rapports de forces déséquilibrés entre exploitants et auteurs imposent des atteintes, il convenait d’opérer une mutation qualitative. Cette mutation, les tribunaux l’ont permise à travers une série de décisions qui ont posé les bases d’un nouveau sens, mais aussi un nouveau fondement au droit d’auteur : le Tribunal de la Seine, le 17 août 1814, impose à l’éditeur le droit au respect du nom de l’auteur ainsi que le droit au respect de l’œuvre ; la Cour d’Appel de Paris, le 11 janvier 1828 (arrêt Vergne), dégage la notion de droit de divulgation qui ne peut être mis en œuvre que par l’auteur ; la Cour d’Appel de Lyon, le 17 juillet 1845, affirme que l’édition d’une conférence recopiée sans l’accord de son auteur conférencier est une violation du droit de l’auteur de revoir, corriger son œuvre comme de veiller à la fidélité de la reproduction de celle-ci, de déterminer le moment et le mode de publication. La doctrine10, par la voix de Renouard, développera, quant à elle, des principes dont celui de l’insaisissabilité des inédits qualifiés de « sanctuaire de la conscience de l’auteur », et qui échappent dès lors à la condition de choses. Mais il ne s’agit que de jurisprudence ou de doctrine et, dans un siècle marqué par le désir de rupture avec un ordre où règne la confusion des pouvoirs, le parlement seul légifère, édicte les règles ayant force de loi. Les décisions des tribunaux jouent, certes, un rôle dynamique capital, mais ne sont plus, comme les arrêts de règlement prononcés par leurs aînés, source directe de droit écrit. Les notions qu’ils créent mettront un siècle à être consacrées par la loi, ce qui rend évidente la fragile légitimité des revendications des auteurs toujours à la merci d’un revirement de jurisprudence.
120
18
Création prétorienne, le droit moral (droit au nom, au respect de l’œuvre, droit de divulgation) va trouver une assise dans la notion d’originalité, notion étrangère au droit à l’époque et jusqu’à la seconde moitié du XXe siècle, mais familière aux non juristes qui vont développer l’idée selon laquelle l’œuvre contient son auteur, l’œuvre recèle la singularité, l’originalité au sens d’empreinte personnelle de l’auteur. Cet investissement de l’œuvre par l’auteur, destiné à renforcer la légitimité du droit de l’auteur, ne permettra que plus profondément de circonscrire les limites du pouvoir auctorial.
19
Si l’auteur dépend de l’œuvre, à son tour l’œuvre dépend de l’auteur, de sa présence incorporée. Dès l’Antiquité, le génie individuel légitime la place réservée à l’individu créateur, à côté de celle reconnue d’emblée à l’œuvre. Cicéron et Longin insistent sur le fait que le style sublime tient d’abord à la personnalité grandiose et sublime de son auteur. Mais c’est la Renaissance qui place l’individu créateur au centre de sa création, brisant avec une acception du génie extérieur à l’individu puisque, traditionnellement, d’origine divine. Les recueils biographiques s’inspirant des Hommes Illustres de l’Antiquité et des ouvrages édifiants du Moyen Âge rencontrent un franc succès11 et contribuent à personnaliser les œuvres ainsi qu’à désolidariser le génie de l’obéissance aux normes, traditions et sujets convenus. La manière de l’artiste devient un « propre », un bien « propre » qui permet d’identifier l’auteur avec certitude et ceci aussi assurément que l’écriture, la graphie, la manière dont un corps s’inscrit dans un discours, et qui révèle l’identité de celui qui parle, écrit. Puiser à soi-même devient une exigence à partir du XVIe siècle par les voix d’Erasme, de Politien, Pic de la Mirandole, Scaliger, Telesio. Si « l’originalité n’est pas née du culte de la personnalité »12, mais de l’idéal de désaffiliation par rapport au passé, à « l’excellence mesurée à l’aune de la reproduction désindividualisée des traditions »13, les notions de génie, de don, de vocation toutes réutilisées au XVIIIe siècle pour pourfendre la dérive normalisatrice de l’Académie, pourtant née pour rompre avec la tradition comme avec l’apprentissage, mettront à l’honneur la personnalisation, la présence de l’humain dans l’œuvre. C’est comme si, audelà de la signature nominale, l’auteur signait son œuvre de son sang, de sa chair, de son souffle.
20
De cet investissement physique, l’auteur attendait la rétroaction, à savoir la reconnaissance d’un droit fort, plus puissant qu’il ne l’était. Or, si cette continuité biologique va conférer à l’œuvre une valeur nouvelle, celle qui provient de cette matière humaine dont elle serait faite, et si ces accents personnalistes ont pu soutenir jusqu’à leur victoire des arguments favorables à une interprétation large du droit de propriété reconnu à l’auteur, ils n’ont pu convaincre tout à fait le législateur du XIXe siècle. Bien que, dès 1841, Alfred de Vigny soutienne que toute atteinte au monopole de l’auteur est une violation du bien et de la personne de l’auteur, la loi ne consacre le terme de monopole que bien après l’énonciation de celui-ci par la cour de cassation en 1887. On assiste donc au XIXe siècle à un effort considérable pour promouvoir le droit de l’auteur et arracher ce dernier à la condition de propriétaire et marchand d’œuvre. Si ces efforts parviennent à s’inscrire dans les raisonnements, ils n’aboutissent bien souvent qu’à faire de l’auteur le marchand de lui-même. Surtout, ces arguties ne permettent pas de clarifier la position paradoxale de ce droit temporaire par rapport au droit de propriété auquel il se rattache mais qui, lui, n’est pas frappé de servitude ou de limitation. De tels développements ne parviennent pas à masquer les accents plus collectivistes que l’on ne veut bien le voir des textes révolutionnaires.
121
21
Le droit exclusif de vendre, faire vendre, est avant tout le droit de reproduire ou d’accorder le droit de reproduire. Les autres types d’exploitation, s’il ne passent pas par un procédé de fixation matérielle concurrençant le livre, semblent échapper au contrôle de destination de l’auteur. Œuvre et livre sont trop intimement liés ou confondus pour que toute jouissance non autorisée, exclusive d’une copie, tombe elle-même sous le coup de l’illicéité. Ainsi, « selon le modèle de l’orgueil augustinien, on ne s’élève pas au-dessus de soi sans se condamner à une chute qui tout à la fois dénonce et punit l’imposture originelle »14. L’auteur est obligé de prendre conscience du clivage qui existe entre les valeurs quasi aristocratiques ou divines qu’il entend revendiquer et la réalité de son être social. La loi du contrat s’imposera encore longtemps, condamnant l’auteur à un « impouvoir radical »15 face à un univers organisé par des règles du jeu plus économiques, matérialistes, qu’éthiques ou morales.
Le livre, objet contractuel ou domaine public 22
Le livre, par sa « manière inachevée d’être dans le monde »16, serait un objet « qui n’obtient sa totalité que d’une préhension »17, ce qui semblerait faire du lecteur un coproducteur du livre, voire un créancier de l’auteur. Mais le livre est également une « révélation de soi, de l’œuvre qu’il est et d’une force de création qui se nourrit du goût qu’on affirme pour elle. Ainsi, l’appropriation du livre est non seulement celle de sa compréhension intellectuelle mais aussi celle de son achat »18. En matière de prêt, si désirs, demandes, compréhension et préhension circulent vers le livre, l’acte d’achat fait défaut. Certes un achat a eu lieu, mais il n’est pas renouvelé à chaque jouissance. Le prêt public dénierait donc au livre sa nature d’objet contractuel et serait, de ce fait, contraire aux lois de l’échange supposées régir les dons d’écriture et de lecture. En 1785, Emmanuel Kant, discourant à propos de l’illégitimité de la reproduction des livres, affirmait qu’en matière de contrefaçon « ce n’est pas l’auteur mais son éditeur fondé de pouvoir qui est lésé [...] c’est donc l’éditeur seul qui est propriétaire de cette affaire, et le contrefacteur viole les droits de l’éditeur, non ceux de l’auteur »19. A l’appui de cette thèse il énoncera que l’éditeur tient au nom de l’auteur un discours au public, qu’il est mandataire d’une affaire avec le public que l’auteur voulait mener. Cet intermédiaire qui est canal, vecteur, se fait corps conducteur, « passeur »20 d’une parole et le livre est son horizon, tandis que l’auteur transcende le livre, entre par celui-ci en dialogue avec le public. A sa manière le prêt bibliothécaire favorise le dialogue et ne léserait, en apparence, que l’éditeur et sans doute peut on voir ici une première source de passivité des auteurs face à cette pratique.
23
Si « dès qu’il y a quelque chose d’écrit sur un papier et du parchemin, ce n’est plus du papier, c’est une lettre, un livre, une mémoire », comme l’énonce Pufendorf en 1712, dans son ouvrage le Droit de la nature et des gens, c’est sans doute en partie parce que la présence humaine, la transcendance, pour reprendre l’expression de Kant pour qualifier ce phénomène, contenue dans l’œuvre, favorise une mutation qualitative de l’objet. Mais cette dimension n’est guère entérinée par les textes de loi qui restent attaché au droit de propriété pendant le XIXe siècle, droit moins individualiste qu’on ne le pense bien souvent. Le droit de propriété, bien improprement utilisé à titre mimétique, recouvre des sens multiples et latents qui peuvent faire obstacle au déploiement monopolistique des volontés de l’auteur. C’est comme si l’extension de la notion de propriété faisait perdre à celle-ci son intensité, donnant raison à Novalis qui, prophète des destins du droit de propriété, affirmait :
122
La nature est ennemie des possessions éternelles. Elle détruit selon des lois immuables tous les signes de propriété.21 24
En 1791, Le Chapelier proclame : La plus sacrée, la plus légitime, la plus inattaquable, et, si je puis parler ainsi, la plus personnelle des propriétés, est l’ouvrage fruit de la pensée d’un écrivain.
25
Et, en 1793, Lakanal reprend : De toutes les propriétés, la moins susceptible de contestation, celle dont l’accroissement ne peut blesser l’égalité républicaine, ni donner d’ombrage à la liberté, c’est sans contredit celle des productions du génie et si quelque chose doit étonner, c’est qu’il ait fallu reconnaître cette propriété, assurer son libre exercice par une loi positive ; c’est qu’une aussi grande révolution que la nôtre ait été nécessaire pour nous ramener sur ce point comme sur tant d’autres aux simples éléments de la justice la plus commune.
26
Ce droit, si fortement légitimé, est avant tout un droit patrimonial. Or, les droits de propriété sont conçus au XIXe siècle comme des droits en situation et le Code civil en ses accents collectivistes avait pour souci de « mettre la propriété en situation, de la limiter par elle-même et d’aménager les relations entre les terres »22 Ces droits étaient dès 1804 régis et justifiés par leur finalité. La propriété, présentée comme un droit naturel par la Révolution et le Code civil (par convergence d’une vision chrétienne du droit de l’homme à maîtriser la monde par délégation de Dieu qui l’a créé à son image, et d’une vision laïcisée où les choses n’ont plus d’âme ou de transcendance à opposer à la volonté humaine de les maîtriser), est aussi conçue, notamment par Grotius ou Rousseau, comme le résultat d’un accord volontariste entérinant une occupation foncière doublée d’un travail. Au XIXe siècle « le patrimoine constitue [...] le véritable être au monde juridique de la personne » 23 . L’appropriation devient la relation fondamentale et absolue structurant toutes sortes de rapports au monde. Et « les droits de propriété ne sont pas des relations entre les hommes et les choses, mais des relations codifiées entre les hommes et qui ont un rapport à l’usage des choses. Détenir des droits, c’est avoir l’accord des autres membres de la communauté pour agir d’une certaine manière, et attendre de la société qu’elle interdise à autrui d’interférer avec ses propres activités »24.
27
Or le droit que la société est prête à reconnaître à l’auteur est loin d’être absolu. Dans son rapport rédigé pour présenter et soutenir la loi sur la propriété littéraire, Le Chapelier n’hésite pas à avancer qu’à partir de la publication, « l’écrivain a associé le public à sa propriété, ou plutôt la lui a transmise toute entière ». Très logiquement la brièveté du monopole posthume aboutit à un domaine public, car « tout le monde doit pouvoir imprimer, publier les ouvrages qui ont contribué à éclairer l’esprit humain ». Si l’on parle de droit plutôt que de privilège, c’est surtout pour signifier que toute personne remplissant les conditions requises pour être reconnue auteur, jouit des mêmes droits, mais pas pour ôter aux prérogatives leur source commune, la grâce. Car la récompense, la rémunération, reconnues à l’auteur, se trouvent plus justifiées, en quelque sorte, par le service rendu à l’humanité qu’assises sur un droit naturel, par essence sans condition. La mission de service public, qui émerge de ce constat, finit de conférer à l’œuvre une destination qui n’est autre que le public, l’appropriation collective. Alors que Portalis s’interrogeait sur le fait que « l’homme puisse devenir propriétaire du sol qui n’est pas son ouvrage, qui doit durer plus que lui, et qui n’est soumis qu’à des lois qu’il n’a point faites », le législateur conteste implicitement à l’auteur son droit au nom d’une mission supérieure ! Le droit à rémunération est donc institué afin de faire vivre l’auteur et sa famille, non pour faire obstacle à la propagation de son œuvre, à la jouissance la plus
123
étendue du plus grand nombre. L’œuvre, création de forme, se distinguait des idées parce que ces dernières destinées à être objets d’appropriation pour tous et de valorisation par tous étaient dites « de libre parcours ». Or il apparaît que l’œuvre, avec un léger décalage temporaire, voire parfois simultanément, comme dans le cas de la lecture publique, est appelée à rejoindre l’idée avec laquelle elle fait corps. Rappelons que seule la contrefaçon est réprimée, tandis que le plagiat qui s’écarte de la forme pour se rapprocher des idées, se juge au civil, et ce de façons diverses selon le genre d’œuvre dont il s’agit. Ainsi la propriété, « concept clé, idée phare, pis [...] image à laquelle les juristes eux-mêmes se sont laissés et se laissent prendre »25, se révèle être, derrière une formulation unitaire, une mosaïque de propriété, comme l’évolution du droit de propriété l’exemplifiera. 28
Ce droit de propriété instaure au XIXe siècle un régime paradoxal de droits sacrés et suspects, naturels et dépendants, absolus et temporaires : l’auteur est usufruitier en sursis d’expropriation.
29
La lecture publique, en se développant empiriquement, mais néanmoins institutionnellement, illustre ces divorces. Objet d’échange, l’œuvre est vouée à l’appropriation collective, et la rémunération provisoirement accordée à l’auteur est davantage fondée sur le service rendu que sur un droit de propriété de l’auteur sur son œuvre. De nos jours, les plus récentes dispositions vont dans ce sens : elles visent l’aménagement d’un droit du public à faire circuler l’œuvre, et tendent à créer un dédommagement financier temporaire de l’auteur (photocopie, prêt bibliothécaire). Le cœur des textes qui régissent le droit d’auteur au XIXe siècle, c’est l’œuvre et non l’auteur, contrairement au discours juridique qui prétend protéger l’auteur à travers l’œuvre. Ainsi l’auteur, d’un bout à l’autre de son cheminement orienté vers la reconnaissance juridique, statutaire, politique de son droit, de sa puissance, de son pouvoir, fait l’expérience de la « béance entre vouloir et pouvoir »26. La propriété, minée par la mission et la noblesse que s’assignent ses titulaires, traduit le conflit latent existant entre le désir de l’appel de l’autre, le lecteur, et la peur de ce désir qui l’exproprie, le rend impuissant. Pris au piège de son discours de prophète et d’éclaireur, qui doit lui permettre de recomposer les vertus d’une noblesse « lavée [...] de son ancrage en une caste spécifique pour n’y voir qu’un synonyme de vertu »27, l’auteur ne peut se déployer hors du discours de la légitimité. En effet en matière de propriété littéraire « ce n’est plus en termes de qualification juridique mais en terme de fondement et de légitimité que raisonne celui qui présente la propriété de l’auteur comme la plus sacrée, la plus légitime »28. Or celui-ci n’est pas de nature à endiguer les revendications collectives. Renouard lui-même, éminent juriste et auteur de doctrine au XIXe, avouera dans son traité : On peut et l’on doit discuter beaucoup sur la nature et l’étendue du droit des auteurs. Mais nier qu’ils aient un droit à tirer profit de leurs travaux, ce serait nier la lumière. Nous ne nous arrêterons pas à démontrer une vérité si manifeste.
30
Sans fondement certain, le droit des auteurs, « droit discutable », est avant tout le droit à un salaire équitable, juste pour l’auteur, mais aussi acceptable pour le lectorat.
31
De ces paradoxes, de ces silences législatifs, de l’esprit qui circule parmi les textes, le prêt et la lecture publique ont tiré leur légitimité, s’épanouissant comme une tradition c’est-àdire « comme ce qui d’un passé persiste dans le présent où elle est transmise et demeure agissante et acceptée de ceux qui la reçoivent et qui, à leur tour, au fil des générations, la transmettent »29.
32
Telle est la petite histoire d’une contrefaçon30, jamais dénoncée car toujours légitimée, parvenant même à rendre hérétique, de nos jours, tout discours rompant avec la tradition
124
et s’employant à appeler une application littérale du droit. L’œuvre et l’intérêt général apparaissent comme les gagnants d’un droit de propriété grevé ou affligé d’une servitude qui rend impropre l’association droit d’auteur-droit de propriété. À moins que ce ne soit les droits de propriété qui se révèlent être de la catégorie des privilèges ou de la grâce, et qu’ils soient eux-mêmes grevés de servitudes !
NOTES 1. Les représentations privées et gratuites, les reproductions destinées à l’usage privé du copiste, les analyses, les courtes citations, les revues de presse, les caricatures, pastiches et parodies ; chacune de ces exceptions légales fait l’objet d’un interprétation très restrictive des tribunaux qui de ce fait réduisent plus encore la portée de cet article dérogatoire. 2. Jean-Marie Borzeix, La question du droit de prêt dans les bibliothèques, rapport pour Madame la Ministre de la Culture et de la Communication, Juillet 1998. 3. L’arrêt réglementaire du 30 août 1777 instaurait en faveur de l’auteur un privilège à perpétuité fondé sur la reconnaissance d’un travail qu’il convenait de récompenser. Ce privilège se distinguait du privilège de librairie accordé aux imprimeurs/libraires. 4. Cette condition préalable à la protection n’a été supprimée qu’en 1925 par la loi du 29 mai. 5. Décret du 5-2-1810, loi du 8-4-1854, loi du 14-7-1866. 6. Ainsi la qualité du dédicataire comme la fidélité ou la distance avec la tradition ont pu autrefois infléchir directement l’appréciation d’une œuvre. 7. Alain Viala, La Naissance de l’écrivain, Éditions de Minuit, 1985, p. 70. 8. Edgard Zilsel, Le Génie : histoire d’une notion de l’Antiquité à la Renaissance, Éditions de Minuit, 1993, p. 70. 9. Nathalie Heinich, Du peintre à l’artiste : Artisans et Académiciens à l’âge classique, Éditions de Minuit, 1993, p. 43. 10. On appelle ainsi en Droit l’ensemble des textes qui, ni législatifs ni jurisprudentiels, sont produits par les auteurs universitaires en majorité dans le cadre d’ouvrages ou d’articles de fond commentant lois et décisions de justice. 11. Publié en 1550, l’ouvrage de Vasari connaîtra de multiples éditions. 12. Edgard Zilsel, Le Génie : histoire d’une notion de l’Antiquité à la Renaissance, Éditions de Minuit, 1993, p. 278. 13. Nathalie Heinich, Du Peintre à l’artiste : artisans et académiciens à l’âge classique, Éditions de Minuit, 1993, p. 11. 14. Cité par Yves Citton, Impuissances, défaillances masculines et pouvoir politique de Montaigne à Stendhal, Aubier, 1994, p. 367. 15. Ibid., p. 371. 16. Claude Montserrat-Cals, « La reprographie », Philosophie, Éditions de Minuit, mars 1994, p. 40. 17. Ibid., p. 41. 18. 18 Ibid., p. 47. 19. Emmanuel Kant, « De L’illégitimité de la reproduction des livres », in Qu’est-ce qu’un livre ?, traduit et présenté par Jocelyn Benoît, K.U.F., 1995, p. 124. 20. Sandra de Faultrier-Travers, Le Droit d’auteur dans l’édition, Imprimerie Nationale, 1993, p. 72. 21. Novalis, Œuvres Complètes, Gallimard, 1975, p. 357.
125
22. Christian Atias, « Destins du droit de propriété », Droits, n° 1, P.U.F., 1985, p. 12. 23. Aubry et Rau, « Le sujet de droit », Archives de philosophie du Droit, Sirey, 1989, p. 250. 24. Henri Tézénas du Montcel et Yves Simon, « Théorie de la forme et de la réforme de l’entreprise », Revue économique, n° 2, 1977. 25. Gaston Bachelard, La formation de l’esprit scientifique, contribution à une psychanalyse de la connaissance objective, Vrin, 1980, p. 38. 26. Yves Citton, Impuissances et défaillances masculines et pouvoir politique de Montaigne à Stendhal, Aubier, 1994, p. 380. 27. Ibid., p. 371. 28. Christian Atias, « Destins du droit de propriété », Droits, n° 1, P.U.F., 1985, p. 9. 29. Hélène Peroz, « Réflexions sur la place de la tradition en droit », Les Petites Affiches, octobre 1998, n° 125, p. 12. 30. Toute exploitation non autorisée relevant de la contrefaçon.
126
Le roi est nu ou la tragique impuissance de l’écrivain face à l’éditeur au XIXe siècle Jean-Yves Mollier
1
Un mythe traverse l’histoire littéraire canonique, façon Lagarde et Michard, amplifié par le vecteur principal de cette construction fictionnelle – l’école de la République – celui du pouvoir exceptionnel de l’écrivain au siècle dernier. Héritier des philosophes des Lumières, intellectuel avant la lettre1, véritable artisan de la résistance à toutes les oppressions, il est parvenu à installer la France dans cet empyrée que contemplent avec admiration tous les autres peuples, celui de « nation littéraire »2. Bien présent, aujourd’hui encore, dans la vie de la cité, l’homme de lettres intervient dans le débat public, contraint les politiques à entendre si ce n’est à écouter son point de vue et il exerce par conséquent un magistère moral sans commune mesure avec celui des autres groupes sociaux maniant le verbe ou la plume, journalistes, avocats, magistrats ou élus du peuple. Donnant son nom aux rues des communes du pays, figurant en effigie sur les timbres-poste, les billets de banque, le bronze des statues, les panneaux des routes touristiques qui montrent avec gourmandise les multiples maisons d’écrivains qui irriguent l’hexagone, il fait rêver les intellectuels des pays anglo-saxons où son homologue n’exerce pratiquement aucune influence sur le débat d’idées. De ce point de vue, la juxtaposition des demeures d’Ernest Hemingway et de Harry Truman dans l’île de Key West, au large de la Floride, est édifiante. La seconde attire davantage les visiteurs américains que la première, source d’émotions pour les Européens qui se souviennent du succès de l’Adieu aux armes ou de Pour qui sonne le glas ?
2
On pourrait illustrer ce constat pessimiste en dressant une liste de mages, de prophètes ou de visionnaires qui, de Lamartine à Zola, en passant par Vigny, Hugo, Dumas père et quelques autres, se prolongerait jusque tard dans le XXe siècle en absorbant Malraux et Sartre, sans parler du poète par excellence de la Résistance, Louis Aragon. On saisirait mieux alors l’une des raisons du succès de l’émission fétiche – et fétichiste – de Bernard Pivot, « Apostrophes », dans les années 1975-1985, puisque celle-ci n’aurait fait que concrétiser cette puissance sociale de l’écrivain français, forgée pour l’essentiel au beau
127
temps du Romantisme. Ce serait toutefois s’abandonner au vertige de l’illusion rétrospective, de la reconstruction édifiante, donc sécurisante, d’un passé devenu édénique, récupérant au passage les vertus trompeuses mais délicieuses du paradis perdu. S’il est vrai en effet que le Zola de l’affaire Dreyfus demeure une magnifique figure de l’intellectuel dressé face à l’injustice et à la raison d’État, comme « un moment de la conscience universelle » selon le mot d’Anatole France, que Victor Hugo a flétri pour l’éternité l’assassin sinistre du 2 Décembre – n’en déplaise à ses thuriféraires d’aujourd’hui – le grand siècle de la littérature romanesque a connu une structuration et une maturation telles de son champ éditorial3 que toute étude qui ignore la réalité de cet espace en lui préférant quelques interstices où se logent les héros de l’histoire officielle risque de sombrer dans l’hagiographie ou l’illusion. Un mouvement souterrain et continu fait en effet tomber, aux environs de 1830, l’écrivain sous la domination presque sans partage de l’éditeur, cette figure énigmatique du premier XIXe siècle. 3
La publication de l’Histoire de l’édition française4 a permis de mieux cerner la personnalité de ce « nouveau baron de la féodalité industrielle »5 à laquelle Balzac avait accordé une place importante dans son œuvre. Le Dauriat d’Illusions perdues demeure dans toutes les mémoires comme le symbole de la transformation du marchand libraire d’Ancien Régime, uniquement mu par l’appât du gain, en un authentique éditeur faisant et défaisant les réputations, dominant désormais toute la chaîne des métiers du livre, mais exerçant bien au-delà du monde des Lettres sa nouvelle autorité morale ou spirituelle. Les correspondances d’écrivain ont également servi à éclairer les zones auparavant laissées dans l’ombre de la caverne platonicienne où se nouait la relation auteur-éditeur. L’examen rigoureux des archives des maisons d’édition, enfin, a largement mis à mal la construction idyllique évoquée plus haut6. A la lecture de ces travaux, publiés essentiellement entre 1984 et 1999, la condition de l’homme de lettres du siècle dernier se révèle plus complexe qu’on ne l’avait d’abord imaginé, très hétérogène, souffrant des attitudes radicalement opposées, de l’hommage permanent rendu au génie à l’exploitation la plus éhontée de la piétaille des littérateurs.
4
Pour justifier notre titre, volontairement alarmiste, nous partirons de la constitution achevée du champ de l’édition française au début du Second Empire, ce qui permettra d’expliquer et de justifier – en termes de loi d’airain du marché des valeurs symboliques – le traitement accordé par Michel Lévy à Gustave Flaubert lors de l’établissement du contrat d’édition de Madame Bovary. Disons-le d’emblée : oui, il était parfaitement logique que le libraire de la rue Vivienne proposât l’achat définitif de la propriété littéraire d’un débutant pour la somme de 400 F le volume inséré dans une série à bon marché destinée à un public élargi, ou de 800 F pour deux tomes de la Collection Michel Lévy à un franc. Cette évaluation rigoureuse, dénuée de toute passion, l’avarice y compris, de la production littéraire d’un jeune homme encore mal doté en capital symbolique témoignait simplement de l’achèvement d’un processus qui avait conduit le système éditorial à inverser fondamentalement les rapports entre l’auteur et l’éditeur7. Sacré et consacré au début de la période comme le prince des temps modernes, le magicien de l’avenir, l’interprète des choses du monde8, l’écrivain allait payer très cher son irruption fracassante sur la scène publique. Nu et désarmé devant son marchand, son faiseur, mais aussi son médiateur auprès des lecteurs, il allait découvrir mais rarement révéler son impuissance tragique à faire régner ses valeurs dans un univers qui anticipe celui de Kafka.
128
Le système éditorial français en 1857 5
D’une certaine façon, l’écosystème moderne qui assure la publicité des Lettres dans le pays, sur le continent européen et dans le monde, s’est façonné au moment où le futur Napoléon III violait la constitution de la République et où un intellectuel de haute volée, Louis Hachette, quittait provisoirement l’univers de l’école pour transporter dans le monde de la fiction les leçons qu’il avait apprises et mises en application dans celui des classes, ces casernes de l’esprit dépeintes par Jules Vallès et d’autres rebelles du temps. Transformé en nouveau seigneur de la diffusion des livres dans le pays afin d’approvisionner ses kiosques de gare qui vont, peu à peu, tisser leur toile d’araignée sur tout le territoire9, l’ancien normalien installé aux commandes de l’édition scolaire et universitaire du pays a lancé en 1853 sa Bibliothèque des chemins de fer dont la locomotive emblématique écœurait Flaubert, en lui appliquant les méthodes de commercialisation du livre de classe destiné à alphabétiser tous les petits Français. Le triomphe de la rationalité se lit dans les caractéristiques principales de cette collection de livres à bas prix10 : standardisation du produit, uniformisation des volumes, homogénéisation des contenus par l’effet de la sérialisation, calibrage rigoureux des manuscrits en sont quelques-unes parmi les plus importantes. Mesurée, étalonnée, industrialisée, la pensée doit se plier aux normes de cet univers mécanisé et l’auteur a tendance à disparaître pour laisser la place au produit qui lui a été commandé, l’œuvre éditée et diffusée à grande échelle ne souffrant plus l’amateurisme qui présidait jusque-là à sa conception.
6
La logique de l’offre ayant progressivement remplacé celle de la demande, c’est désormais l’éditeur qui définit a priori les besoins et les attentes du public, des lecteurs, y compris en les séparant en catégories bien distinctes : les enfants, les femmes, le peuple, les classes cultivées, les juristes, les médecins, les savants, etc. Déclinant sa production en fonction de ces cibles commerciales, il recrute pour parvenir à ses fins les hommes de lettres ou les porte-plume dont il fixe la tâche. Le cahier des charges accompagnant le traité d’édition était né dans le sous-champ de la littérature scolaire aux lendemains de 1830. Il déborde sur d’autres domaines après 1852, entraînant à peu près les mêmes effets déstabilisants que dans le précédent. Les séries de volumes imposent la modélisation des genres et l’écrivain y perd une grande part de sa liberté quand il doit se plier aux contraintes de la collection : nombre de pages prédéterminé, cadre de l’œuvre fixé à l’avance, description ou narrations pittoresques, anecdotes plaisantes semées à bon escient, moralité irréprochable, le tout décidé par le directeur ou faisant fonction d’éditeur, l’editor à l’américaine d’aujourd’hui11. La commercialisation des œuvres de la comtesse de Ségur en est l’exemple-type car elle introduit au cœur des multiples censures qui caractérisent les premières années du règne de Napoléon III, politique, idéologique, commerciale, industrielle et éditoriale.
7
La Bibliothèque rose illustrée, surgeon de la Bibliothèque des chemins de fer, devait obtenir deux autorisations spécifiques pour être vendue sur le réseau ferré français, celle de la commission du colportage siégeant au ministère de l’Intérieur, et celle des compagnies privées qui entendaient contrôler leur empire et lire tous les imprimés qui y circulaient. Si l’on ajoute les contraintes ordinaires du livre distribué en librairie, les recommandations de M. de Ségur et celles de son fils, le futur évêque, ainsi que celles de Charles Lahure, le propriétaire de La Semaine des enfants où paraissaient initialement les
129
récits et, enfin, les exhortations d’Emile Templier envers une femme de lettres jugée trop libre12, on conçoit que l’auteur fétiche de la jeunesse ait fini par s’irriter qu’on attende d’elle des portraits édifiants, même en matière de peinture des animaux, l’âne se devant d’être aussi irréprochable qu’un bon chrétien quoiqu’il n’ait pas été baptisé13. Le parcours d’un manuscrit de Sophie de Ségur ressemblait ainsi à celui du combattant moderne alors même que les intentions de l’auteur étaient tout sauf révolutionnaires. Que dire, dans ces conditions, de ceux qui souhaitaient introduire quelques libertés ou de la licence dans l’univers de leurs fictions ? Emile Feydeau, recruté à prix d’or par Michel Lévy après le succès scandaleux de Fanny et de Daniel, dut édulcorer ses récits et Henry Murger, entré à la Revue des Deux Mondes après la publication de sa Vie de Bohème, subit à peu près le même sort14. 8
Rationalisé, industrialisé, du moins dans les maisons les plus importantes qui doivent imiter leur chef de file du quartier Latin ou passer la main, le monde de l’édition change aussi vite en ces années 1853-1857 que la capitale où il est regroupé depuis des lustres. Baudelaire s’en indignera lors de la vente de la Librairie nouvelle du boulevard des Italiens en 1861 à Michel Lévy, les auteurs subissant le même traitement que les meubles 15 , mais déjà en 1855 Adolphe Joanne avait été racheté avec le fonds de Louis Maison par la librairie Hachette et de multiples auteurs avec celui de Victor Lecou la même année16. La genèse de la Collection Michel Lévy à un franc n’a pas d’autre explication que les nécessités de riposter à la concurrence sauvage de la Bibliothèque des chemins de fer qui menaçait de ruiner la Bibliothèque contemporaine à deux francs et Gervais Charpentier, pourtant l’initiateur de ces nouvelles formules en 1838, périclita après 1856 pour s’être entêté à maintenir à 3F50 la Bibliothèque portant son nom, ce qui était suicidaire. Compte tenu des coûts de production, de l’étroitesse du marché, même élargi – 5000 à 6000 exemplaires pour le premier tirage – un prix d’équilibre du livre de fiction s’était imposé à Louis Hachette comme à Michel Lévy et il s’était stabilisé autour de 400 F en 1857 lorsque parut Madame Bovary. Sordide, cette réalité est également parfaitement triviale pour l’amoureux des Lettres mais elle dessine les contours de l’univers dans lequel évoluaient les romanciers du XIXe siècle et la méconnaître ou l’ignorer conduirait à maintenir vivants les mythes qui ont servi jusqu’ici à obscurcir les règles de fonctionnement du marché des biens symboliques.
9
Du point de vue de l’histoire de la littérature, l’interrogation principale doit d’ailleurs être portée au cœur de la fonction auctoriale, trop souvent conçue comme éternelle et immuable. A partir du moment où chez Louis Hachette et quelques-uns de ses contemporains sont nés les directeurs de collection modernes et qu’ils ont reçu, par délégation, le pouvoir de décider des normes de la collection qu’ils avaient en charge, la notion même d’auteur singulier était appelée à évoluer. De même que le manuel scolaire destiné à un public large était le produit d’une équipe comprenant rédacteurs, prescripteurs et techniciens, le livre de fiction risquait de suivre un cours parallèle. Les guides de voyage, les dictionnaires, les encyclopédies, les livres pratiques et de vulgarisation les avaient précédés sur ce chemin mais ils n’étaient pas épargnés. La comtesse Dash était privée d’identité chez Michel Lévy et ses manuscrits étaient signés Alexandre Dumas père tandis que Paul Lorain, directeur de la Collection des écrivains étrangers pour le domaine britannique, chez Louis Hachette, était seul juge des coupes et modifications à apporter dans les livres qu’il dirigeait. Certes la majorité des écrivains connus était à l’abri de ces atteintes à la dignité d’auteur mais bon nombre de littérateurs moins heureux se pliaient à toutes les contraintes de leurs editors pour gagner
130
simplement leur vie. Alors que la législation internationale protégeant le droit d’auteur se mettait en place en Europe à partir de 1852, grâce aux efforts des sociétés de gens de lettres, évidemment, mais aussi grâce à la ténacité des éditeurs qui avaient encore plus à gagner dans ce combat17, le statut de l’auteur évoluait dans des proportions inconnues auparavant et la fonction auctoriale se dissolvait sans que, toutefois, le public ni les critiques littéraires ne prennent conscience de ces mutations.
Le magistère perdu ou la souffrance de l’homme de lettres 10
La République des Lettres, apparue au XVIIe siècle, s’était autonomisée après 1750, au moment où la publication de L’Encyclopédie de Diderot et D’Alembert marquait une véritable volonté de la part des philosophes et hommes de lettres d’échapper au carcan de l’Ancien Régime. Mécénat de cour et clientélisme s’effaçaient au profit de rapports plus harmonieux avec les marchands libraires, simples agents commerciaux de la nécessaire médiation des œuvres auprès des lecteurs. L’opinion publique naissante, du moins à Paris et dans les grandes villes18, la multiplication des gazettes et périodiques en tous genres, la commande d’écrits philosophiques conféraient à l’écrivain un pouvoir qui contrebalançait l’arbitraire du régime, la police de la Librairie maintenue dans les années 1770 et l’obligation de se procurer un privilège royal pour faire connaître ses écrits. Le magistère laïque détenu par les grands écrivains romantiques, Lamartine, Vigny et Hugo en tête, était certes en butte aux exigences des nouveaux barons de la féodalité industrielle, ces éditeurs qui apparaissent dans l’espace public en 183019, mais les mutations décisives dans les relations qui unissent l’homme de lettres à son marchand sont encore cantonnées au domaine du manuel scolaire ou de l’écrit spécialisé. Tocqueville désigne alors familièrement l’éditeur de La Démocratie en Amérique, Gosselin, comme « le gros joufflu »20 et Hugo profite des avantages de la pluri-édition pour mettre en concurrence tous ceux qui revendiquent l’honneur de publier Hernani.
11
Avec le système de la mono-édition – terme qui désigne la tendance pour un auteur à confier la totalité de ses écrits à un seul et unique éditeur – les choses commencent à changer dans le secteur de la littérature proprement dite. Expérimentée dans le souschamp de l’édition théâtrale par Michel Lévy en 1845-1848, cette novation dévoile d’abord ses avantages pour l’auteur dramatique qui abandonne désormais le soin de faire publier ses pièces à un intermédiaire unique. Poussant ses feux, l’entreprenant patron de la rue Vivienne obtient en outre, des Dumanoir, Clairville et autres Labiche, la faveur de se voir préférer à tout autre éditeur pour les manuscrits à venir pendant les cinq prochaines années21. Le saut dans l’inconnu, s’il immunise contre certains dangers inhérents à la gloire hasardeuse ou à la fantasque faveur du public, aboutit inéluctablement à inverser de fond en comble les rapports auteur-éditeur. Tandis que Victor Hugo, jaloux de ses prérogatives, n’abandonne jamais ce droit de suite ou de préférence, comme dit notre moderne Code de la Propriété intellectuelle, à ses marchands, ce qui lui permettra de passer de Hetzel en Lacroix et Lévy au gré des propositions des uns et des autres, Pierre Loti, beaucoup plus tard, se verra contraint de conserver sa fidélité à Calmann Lévy alors que ses préférences l’attiraient chez Flammarion22. La guerre était déclarée entre les deux grands professionnels parisiens en 1913 mais, dans cette joute sans merci, l’écrivain était démuni pour faire entendre sa voix, les tribunaux ne connaissant que les traités signés et non les changements d’humeur des hommes de lettres23.
131
12
Si l’on veut comprendre les souffrances d’un Murger, d’une comtesse Dash, d’un Théodore de Banville et peut-être même l’une des raisons du spleen tragique d’un Baudelaire24, il faut en revenir aux mutations qui se sont opérées dans le champ de l’édition de littérature générale après 1852. Un des observateurs de cette évolution pourrait être Alphonse de Lamartine si l’on esquissait l’historique de ses rapports avec le marché du livre. Ecrivain recherché, adulé, encensé et grassement payé au temps des Premières Méditations poétiques en 1820, il finira comme un Dumas vieillissant, tentant vaille que vaille de placer le moindre Cours familier de littérature au prix d’une œuvre authentique. Vigny et Hugo font exception à ce mouvement de balancier qui déplace le poids dominant du côté de l’athlète le plus musclé, l’éditeur aux joues roses en l’occurrence. Charles Baudelaire présente un autre type de profil et de parcours, lui aussi très instructif. L’honneur suprême conféré à l’ami Poulet-Malassis de mettre en vente ses Fleurs du Mal correspondait en 1857 à une vision élitiste, esthétisante et dandyste de son public mais la décision prise, en 1863, de céder à Michel Lévy, symbole des mercantis et de la puissance de l’argent, la propriété littéraire de ses Œuvres complètes sonnait comme un aveu d’impuissance et de résignation face aux lois du marché25. Pis à ses yeux, le calcul des tirages effectué sur la base des registres de l’éditeur prouve, à n’en pas douter, que le passage de Baudelaire chez Michel Lévy fut bénéfique pour la diffusion de son œuvre. Avec ses règles draconiennes, le marché semblait démontrer qu’il était plus apte que l’auteur à pénétrer dans la profondeur du pays mais c’était au prix d’une violence exercée contre les choix avant-gardistes de l’écrivain, manifestement dépassé par les mutations de son siècle.
13
Déjà ébranlés par ces changements, les hommes de lettres du début du Second Empire avaient bien d’autres raisons de regretter le paradis perdu. Les lois policières adoptées en 1852-1854 interdirent la gravure et la caricature de type politique, par peur de ses effets démoralisants sur le peuple. Le colportage fut sévèrement surveillé, contrôlé, afin d’en réduire les possibilités. De nouveaux débouchés s’offraient pourtant aux auteurs avec l’apparition des kiosques de gares mais l’obligation de soumettre leurs écrits à la commission de surveillance interdisait toute recherche de l’innovation dans le style ou le sujet, voire le genre26. La Vie de Jésus de Renan circula sans entraves dans le réseau des librairies en 1863 mais jamais le Jésus abrégé de 1864 ni la Vie de Jésus illustrée de 1869 n’obtinrent le fameux Sésame qui ouvrait la voie du public de masse. Quand Louis Hachette renonça à son monopole, fin 1859, et accepta de commercialiser sur le réseau ferroviaire les collections de ses confrères, le pli était pris et les émules de Monsieur Perrichon n’achetaient plus dans les gares que des livres standardisés, susceptibles de ne choquer ni les dames ni les demoiselles27. La librairie Hachette puait au nez de Gustave Flaubert avec ses couronnes de lauriers et ses locomotives à la vapeur28 mais les espaces de liberté se faisaient rares et son propre éditeur, Michel Lévy, se conformait scrupuleusement à la législation en vigueur même si son ancrage dans le secteur de la littérature l’amenait à se montrer plus conciliant envers les avant-gardes et les poètes. Ceux-ci commençaient alors à se regrouper en cercles, cénacles et autres micro-sociétés volatiles qui tentaient de résister en s’organisant autour d’une revue porte-drapeau29, préfigurant l’éclosion de ces publications éphémères des années 1890, mais leur poids était infime et quand ils parvenaient à trouver un prétendu mécène, tel Alphonse Lemerre, éditeur des Parnassiens, c’était un redoutable carnassier prêt à dévorer leurs économies ou celles de leurs familles.
132
14
Pour ceux qui acceptaient peu ou prou les normes du marché, l’obligation de se plier aux exigences supposées du public faisait des ravages. Après la réorganisation des théâtres parisiens opérée sous la conduite du baron Haussmann en 1864, la partie la plus populaire du public sera refoulée vers les barrières de la ville tandis que le vrai mélodrame, celui que Félix Pyat dénommait le drame social ou « le prolétaire au théâtre »30 sombrera dans la platitude, comme le vaudeville, étouffé par les pressions du triangle fatal, le mari, la femme et l’amant. Octave Feuillet ne résistera pas aux faveurs de l’impératrice et y perdra toute originalité, comme Murger, aseptisé après son séjour chez Buloz. On sait depuis longtemps que le républicain Pierre-Jules Hetzel censurait impitoyablement son auteur favori, Jules Verne, et si celui-ci ne s’en plaignait guère31, le Magasin d’éducation et de récréation, publié à partir de mars 1864, n’édita pas les auteurs dont les audaces auraient effrayé une partie des lecteurs ou les censeurs. Le malheureux Courrier du tzar devint Michel Strogoff pour ne pas perdre le marché russe32 et Proudhon dut être édité par Lacroix parce que le même Hetzel redoutait les foudres de la police impériale33. Ainsi se conjugaient des raisons économiques, politiques et idéologiques qui concouraient à faire descendre l’homme de lettres de son piédestal et à lui imposer des conditions d’existence extrêmement précaires. Nul mieux que le Murger dépeint dans sa propre correspondance n’exprima alors la souffrance de l’écrivain quand il dut venir à pied de Fontainebleau supplier Calmann Lévy de lui offrir les deux louis qui lui permettraient « de passer le pont d’un dimanche »34.
15
Sans doute l’historien Dolf Œlher a-t-il été bien inspiré de chercher dans la fracture sociale révélée par le séisme de juin 1848, formidable explosion de la faim noyée dans le sang par les Père Roque de l’époque, une des causes du spleen post-quarante-huitard35. Toutefois les logiques univoques sont rarement satisfaisantes en histoire et l’on peut proposer d’autres explications complémentaires au pessimisme qui s’empare de nombre d’écrivains après ces événements tragiques et les massacres ou déportations à outrance qui suivent le coup d’État du 2 Décembre. Demeuré optimiste, Pierre Larousse s’enfermera dans la rédaction des notices du Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle pour oublier les malheurs du temps mais de nombreux écrivains au talent prometteur se rallieront aux modes et accepteront les règles édictées par les maîtres de la littérature générale. Emile Zola apprendra tout de son futur métier pendant ses quatre années employées à diriger le service de publicité chez Hachette, de 1862 à 1866, mais, quand il proposera à un patron de prendre la tête de la jeune littérature et de soutenir les avant-gardes, il se verra opposer un silence méprisant qui en dit long sur les évolutions souterraines du champ de l’édition à l’époque de la fête impériale36. Sa réponse personnelle au nouveau défi lancé aux écrivains choquera dans le monde des Lettres mais la volonté de gagner de l’argent pour se libérer du système n’était peut-être pas aussi matérialiste qu’on le crut, l’auteur s’escrimant en réalité à retourner contre son maître les armes de la modernité industrielle.
Pour une histoire culturelle de la littérature 16
L’étude bien connue de Martyn Lyons, Le Triomphe du livre37, a commencé à mettre à mal un certain nombre de clichés en matière de succès littéraires au XIXe siècle. Sa formule lapidaire a le mérite d’être claire : en termes de statistiques et de lecture de livres, le romantisme ne fut guère que « la crête fugitive d’une vague sur un océan de classicisme et de catholicisme »38. L’histoire enseignée depuis la IIIe République aux lycéens a retenu
133
un palmarès qui n’a rien à voir avec la réalité des faits. Les petits Français du temps et leurs parents furent gorgés d’œuvres de La Fontaine, de Molière et de Fénelon alors que l’on s’était longtemps persuadé qu’ils avaient vibré aux accents des œuvres nouvelles. Certes les poésies de Lamartine connurent un réel succès parisien, comme la représentation d’Hernani souleva les passions mais, à Elbeuf ou à Miramas, la presse locale fit silence sur ces événements qui ne bouleversèrent pas la vie des populations. Zola sera l’un des premiers contemporains à connaître de son vivant l’entrée dans « l’ère des 100 000 » pour un roman, mais il suffit de relire Le Tour de la France par deux enfants. Devoir et patrie – six millions d’exemplaires vendus de 1877 à 1900 – et de regarder les vignettes consacrées aux grands écrivains qui ont fait la renommée de la France39 pour se convaincre que Martyn Lyons a vu juste et que le vrai Panthéon du XIXe siècle était consacré à Molière, Racine et Corneille et que les auteurs à la mode se nommaient Eugène Sue, Ponson du Terrail, Paul Féval, Frédéric Soulié ou Hector Malot plutôt que Balzac, Stendhal et Sand. 17
Le rappel des verdicts de l’histoire quantitative n’a pas pour but d’aplatir les gloires littéraires ni de fondre dans un magma insipide les productions du temps mais plutôt d’aider à comprendre comment ont cheminé les grandes œuvres qui ont survécu et dans quel environnement elles ont vécu. Les balzaciens savent d’ailleurs que Walter Scott est essentiel pour comprendre les premiers essais du père de la Comédie humaine comme les zoliens admettent l’attirance de leur héros éponyme pour le roman-feuilleton à l’heure où il rédigeait Les Mystères de Marseille. Elie Berthet et bien d’autres romanciers populaires l’aidèrent à se repérer dans l’univers qui deviendra celui de Germinal, ce qui n’enlève rien aux mérites de son concepteur40. Dans un autre contexte, la lecture des archives accumulées par les éditeurs éclaire certains aspects de la production de l’écriture fictionnelle. Nous l’avons montré pour Aziyadé de Pierre Loti, d’abord conçu comme un roman à la gloire des amours orientales, masculines et homosexuelles par conséquent, avant que les standards de la maison Calmann Lévy n’éliminent ces scories dues à la jeunesse de l’auteur et ne normalisent le roman au point de faire de Loti un séducteurtype de la gent féminine qui n’aurait pas supporté qu’un officier, marin de surcroît, appartenant à la Royale, révélât d’autre mœurs, officiellement inconnues à bord des navires de la République41.
18
Au delà de ces éclairages qui s’ajoutent aux matériaux fournis par la génétique textuelle, l’histoire de l’édition amène à poser d’autres questions, celle de la commande par exemple, très insidieuse puisqu’elle ôte à l’homme de lettres la paternité de son projet, ou celle de l’évolution de la fonction auctoriale, voire de la mort annoncée de l’auteur à l’ancienne, ce qui heurte bien des esprits. Sur le premier point, il ne suffit pas de considérer que seuls les livres pratiques, dictionnaires, encyclopédies, livres de vulgarisation, de jardinage ou les guides de voyage ont subi cette logique marchande. On ne résoud d’ailleurs rien de cette manière car Emile Littré est bien un auteur reconnu, singulier, élu à l’Académie française, au grand dam de Monseigneur Dupanloup, pour la publication de son Dictionnaire de la langue française alors que manifestement sa femme, sa fille et des dizaines de collaborateurs ont participé à l’entreprise42. On pourrait dire la même chose de Pierre Larousse et de son Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle43 dont on sait qu’il fut rédigé par plusieurs centaines de secrétaires même si, semble-t-il, le chef de projet revoyait toujours la copie avant de l’intégrer dans son grand œuvre. L’exploration des contrats d’édition de la maison Hachette prouve que de nombreux volumes firent l’objet d’une réflexion et de directives similaires, voire plus élaborées, ce qui signifie que
134
la commande éditoriale, dans les maisons les plus importantes de l’époque, l’emportait considérablement sur l’achat de manuscrits spontanément élaborés par les auteurs. 19
A côté de l’auteur selon la vulgate officielle, romantique celle-là, pour qui l’écrivain est un "je", même quand le lecteur ne sait pas qu’il est un autre, il faut donc admettre qu’une pluralité de figures d’auteurs s’étaient imposées au siècle dernier. Il existait des tandems tels que Erckmann et Chatrian, des troïkas ou des quadriges, surtout au théâtre que Théophile Gautier comparait au travail des ateliers de couture où l’un découpe le pantalon tandis que l’autre confectionne la chemise et le troisième la cravate44. En dehors de ces petits équipages, des usines se créaient et Dumas passait pour l’inventeur du feuilleton fabriqué à la vapeur45, mais bien d’autres formes voyaient le jour qui obligent à admettre que, pour le moins, l’auteur commençait à céder sa place à une équipe, un collectif, même si la couverture des volumes imprimés se gardait bien d’enregistrer la mutation qui venait de s’accomplir. Il y aurait eu danger à crier sur la place publique que l’auteur était mort et chacun continuait à croire en lui, le vedettariat commençant cependant, au théâtre, à consacrer l’interprète du rôle plutôt que l’auteur, phénomène qui ira croissant, au XXe siècle, avec le cinéma. De nouvelles idoles commençaient donc à détrôner les anciennes même si, à chaque génération, des auteurs nouveaux remplaçaient les précédents, Gide et la NRF symbolisant l’extraordinaire souplesse du système éditorial, capable à la fois de détruire ou de modifier la figure de l’auteur et de recruter en permanence ceux qui maintenaient l’obscurité sur ses coulisses.
20
Les frères Goncourt et quelques autres se rassuraient en flétrissant cette littérature mercantile et ces éditeurs commerciaux qui gâchaient le métier, ce qui leur permettait de continuer à croire en l’existence d’une autre littérature et en la possibilité d’une autre manière de faire de l’édition mais cela ne répond pas complètement à la question posée puisque l’on privilégie alors les humeurs de quelques-uns au détriment des attirances du plus grand nombre. Peut-être faut-il chercher du côté de la mauvaise conscience des auteurs de romans-feuilletons, souvent riches mais rarement persuadés qu’ils étaient des auteurs comme les autres, une des raisons du pessimisme qui s’était emparé de nombreux hommes de lettres à la fin du XIXe siècle. Ceux-là s’étaient laissé convaincre qu’ils étaient indignes d’être comparés à leurs grands devanciers et ils justifiaient, sans s’en douter, le préjugé qui aboutissait à réserver à une minorité de littérateurs le droit de représenter la profession. C’était préparer la voie des futures anthologies ou histoires canoniques qui sélectionnent impitoyablement dans la masse des auteurs ceux qui entrent au Panthéon et ceux qui doivent disparaître. Ces tableaux d’honneur et ces palmarès aboutissent en fait à masquer les goûts réels des hommes du passé et mystifient très largement l’histoire de leur sensibilité. *
21
Si l’on a proposé ici une mise à nu des dessous de l’édition française au milieu du XIXe siècle, ce n’est pas par voyeurisme ni par une quelconque fascination pour les bas-fonds du système. La peinture peut paraître excessive puisqu’elle masque les résistances des écrivains face aux attaques du système qui menaçait leur existence. On ne saurait en effet oublier que la Société des auteurs dramatiques, constituée en 1829, la Société des Gens de Lettres, en 1838, et la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, en 1851, tentèrent de faire naître des contre-pouvoirs capables de s’opposer aux prétentions des nouveaux maîtres du livre. On pourrait même ajouter à ces associations la naissance de
135
l’Agence générale de la littérature, sous la houlette d’Emile Aucante, l’ancien secrétaire de George Sand46, parce qu’elle manifeste véritablement une prise de conscience, chez les auteurs des années 1855-1860, et une volonté de s’unir pour ne pas subir passivement les effets de la modernité. Toutefois les efforts de la SGDL furent en grande partie contrecarrés par la division des hommes de lettres et les agents littéraires ne parvinrent pas en France, à la différence de l’Angleterre et des États-Unis, à devenir les intermédiaires habituels des auteurs face à leurs éditeurs. Quant aux revues qui, périodiquement, serviront de môle de résistance, elles disparaîtront pour la plupart ou seront elles-mêmes, telles Le Mercure de France ou la NRF à l’origine de maisons d’édition qui, sur le fond, ne changeront rien aux rapports établis par leurs devancières. 22
En fait, le véritable contre-pouvoir en ce domaine découla surtout de la puissance du mythe de la France comme nation littéraire. Dans la mesure où il était relayé par l’école, les médias, les institutions, et admis par le public, il faisait germer en permanence des talents qui ne demandaient qu’à s’affirmer. Faute de pouvoir être édités immédiatement par l’appareil constitué, il leur appartenait de créer de petites structures qui leur serviraient de tremplin vers les puissantes entreprises ayant pignon sur rue. Pierre Louÿs débuta au Mercure avant de le quitter de même que la littérature régionaliste, apparemment contestataire, démarra en province avant d’être récupérée à Paris47. Les éditeurs les plus en vue ne pouvaient ignorer les avant-gardes mais ils préféraient leur laisser le temps de faire leurs preuves, quitte à risquer de voir émerger de nouvelles concurrences, ce qui fut le cas avec la librairie Gallimard, Bernard Grasset et Robert Denoël dans l’entre-deux-guerres. Ces germinations contribuèrent à leur tour à renforcer la puissance du mythe et nul ne le résuma mieux que le futur ambassadeur nazi à Paris, Otto Abetz, lorsqu’il affirma qu’il y avait trois choses qui comptaient en France : le communisme, les grandes banques et la NRF48. Symboliquement placés au même niveau que le pouvoir financier et l’idéologie de la révolution, les écrivains étaient en droit de se réjouir mais le cri d’alarme lancé récemment par André Schiffrin à propos de l’évolution de l’édition américaine49 rappelle que le système mis en place vers 1853-1857 n’entend pas laisser aux auteurs, ou à ceux qui prétendent se mettre à leur service, la faculté de se rire des impératifs économiques.
NOTES 1. Sur la naissance et le développement de cette catégorie, les opinions varient. Pascal Ory et Jean-François Sirinelli -Les Intellectuels en France de l’affaire Dreyfus à nos jours, Paris, A. Colin, 1986 la font naître au moment de l’Affaire Dreyfus. Alain Pagès – Emile Zola, un intellectuel dans l’affaire Dreyfus, Paris, Lib. Séguier, 1991 – la situe plutôt en 1884, de même que Pierre Citti – « L’invention de l’intellectuel (1888-1910) », L’invention du
XIXe
siècle, Paris, Klinckskieck, 1999, p. 271-285. Nous
préférons parler de cycles de la vie intellectuelle et nous avons proposé de repérer l’un des premiers en 1824-1830 (Louis Hachette (1800-1864). Le fondateur d’un empire, Paris, Fayard, 1999, ch. V). 2. Priscilla Parkhurst Ferguson, La France nation littéraire, Bruxelles, Labor, 1992.
136
3. Sur cette notion, voir Pierre Bourdieu, Les Règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire, Paris, Seuil, 1992, et notre propre commentaire in Louis Hachette, op. cit. ch. XII, note 51. 4. Roger Chartier et Henri-Jean Martin, Histoire de l’édition française, Paris, Promodis, 1983-1986, 4 vol. 5. Ibidem, t. 3., p. 181. 6. J.Y. Mollier, L’Argent et les lettres. Histoire du capitalisme d’édition 1880-1920, Paris, Fayard, 1988. 7. J.Y. Mollier, Louis Hachette..., op. cit., pour l’analyse de ce processus et la description de son cheminement, de l’édition scolaire à l’édition littéraire. 8. Les travaux de Paul Bénichou sont éclairants sur ce point, du Sacre de l’écrivain, Paris, J. Corti, 1973, aux Mages romantiques, Paris, Gallimard, 1988. 9. J.Y. Mollier, op. cit., 3e partie. 10. Voir aussi Isabelle Olivero, L’Invention de la collection, Paris, Ed. de l’IMEC, 1999. 11. J.Y. Mollier, op. cit., 3e partie, pour le
XIXe
siècle, et André Schiffrin, L’Edition sans éditeurs,
e
Paris, La Fabrique, 1999, pour le XX siècle américain. 12. J.Y. Mollier, op. cit., ch. XIII. 13. Comtesse de Ségur à E. Templier, le 24 janvier 1859, in Œuvres, Paris, R. Laffont, 1990, Coll. « Bouquins », 3 vol., T. 1, p. LXXI. 14. J.Y. Mollier, Michel et Calmann Lévy ou les débuts de l’édition moderne (1836-1891), Paris, CalmannLévy, 1984, p. 181-191. 15. Ibid., p. 313. 16. J.Y. Mollier, L. Hachette..., op. cit., ch. XII. 17. Ibid. 18. Ariette Farge, Dire et mal dire. L’opinion publique au XVIIIe siècle, Paris, Seuil, 1992. 19. E. Regnault, « Les éditeurs », Revue de Paris, 12 juillet 1835. 20. A. de Tocqueville, Correspondance, in Œuvres complètes, Paris, Gallimard, T. VIII, p. 151. 21. J.Y. Mollier, Michel et Calmann Lévy...., op. cit., p. 89-90. 22. J.Y. Mollier, L’Argent et les lettres..., op. cit., p. 477-483. 23. Ibid. 24. J.Y. Mollier, « Baudelaire et les frères Lévy : auteur et éditeurs », Etudes baudelairiennes XII, Neuchâtel, La Baconnière, 1987, p. 131-225. 25. Ibid., p. 161-168. 26. Jean-Jacques Darmon, Le Colportage de librairie en France sous le second Empire, Paris, Plon 1972. 27. On se souvient que la pièce de Labiche débute gare de Lyon, au kiosque Hachette et que M. Perrichon entend faire l’achat d un livre que ni sa femme ni sa fille ne rougiraient de lire en voyage. 28. Cité in J.Y. Mollier, Louis Hachette..., op. cit. p. 405. 29. Luc Badesco, La Génération poétique de 1860, Paris, Nizet, 1971, 2 vol. 30. Guy Sabatier, Idéologie et Mimésis sous la monarchie de juillet. Le mélodrame de la Republique sociale et le théâtre de Félix Pyat, thèse de doctorat d’esthétique, dir. J.M.Thomasseau, université Paris VIII, 1996, 2 vol. 31. Alain Buisine, « Figures du contrat », Un éditeur et son siècle. Pierre-Jules Hetzel (1814-1886), Nantes, ACL éditions, 1988, p. 283-299. 32. J.Y. Mollier, L’argent et les lettres..., op. cit., p. 256. 33. J.Y. Mollier, Louis Hachette..., op. cit., p. 404. 34. Lettre de H. Murger, à Michel Lévy, Michel et Calmann Lévy..., op. cit., p. 187. 35. Dolf Oelher, Le Spleen contre l’oubli : Juin 1848, Paris, Payot, 1996. 36. Henri Mitterand, Zola, T-1 : Sous le regard d’Olympia, Paris, Fayard, 1999. 37. Martyn Lyons, Le Triomphe du livre. Une histoire sociologique de la lecture dans la France du siècle, Paris, Promodis – Ed. du Cercle de la Librairie, 1987.
XIXe
137
38. Ibid., p. 104. 39. J.Y. Mollier, « Fondements scolaires de la légitimité culturelle. L’école de la IIP République », actes du colloque de Québec sur la légitimité culturelle, à paraître, Québec, Nuit blanche éd., 2000. 40. Diana Cooper-Richet a esquissé la généalogie de ce roman dans La Mine et les mineurs.
XIX-XXe
siècles, à paraître, Plon, 2000. 41. J.Y. Mollier, « Michel et Calman Lévy... », op. cit., p. 472-473, et Bruno Vercier in P. Loti, Aziyadé, Paris, Garnier – Flamarion, 1989. 42. J.Y. Mollier, Louis Hachette..., op. cit., p. 430-431. 43. J.Y. Mollier et Pascal Ory, Pierre Larousse et son temps, Paris, Larousse, 1995. 44. P. Abraham et R. Desné. Manuel d’histoire littéraire de la France, Paris, Ed. Sociales, 1972, T. IV, 1789-1848, p. 252. 45. Louis Reyhaud l’a immortalisé sous les traits de l’industriel Granpré dans César Falempin, publié chez Michel Lévy frères en 1845. Voir J.Y. Mollier, Michel et Calmann Lévy, op. cit., p. 76-77. 46. J.Y. Mollier, L’Argent et les lettres..., op. cit., p. 411. 47. Anne-Marie Thiesse, Ecrire la France. Le mouvement littéraire régionaliste de langue française entre la Belle Epoque et la Libération, Paris, PUF, 1991. 48. Pierre Assouline, Gaston Gallimard, Paris, Balland, 1984, p. 280. 49. A. Schiffrin, op. cit.
138
Les pouvoirs de l'écriture
139
Le pouvoir des Lumières : le tableau du citoyen Dupuis (1806) Claude Rétat
1
Charles-François Dupuis est un écrivain aujourd’hui peu connu malgré la notoriété qu’il a eue pendant tout le XIXe siècle, et jusqu’au début du XXe. Il a été en même temps un homme politique, député à la Convention (1792 à 1795), membre du Conseil des CinqCents sous le Directoire (de 1795 à 1797), membre du Corps législatif après le 18 Brumaire (1799-1802). Dix ans d’action politique.
2
Je ne vais pas du tout aborder cet aspect de la carrière de Dupuis, mais analyser un imaginaire du pouvoir qui, s’il ne tient pas immédiatement à l’aspect politique de la carrière de Dupuis, marque un aboutissement de la pensée des Lumières : il s’agit d’une sorte de fantasme didactique de la révélation1.
3
Ce qu’il appelle, et ce qu’on appelle autour de lui, son « grand ouvrage », l’Origine de tous les cultes2, est apparu très vite comme le monument de l’esprit de système : l’univers y est ramené à l’unité, tout s’ouvre avec une seule « clef astronomique ». Ce système despotiquement unificateur, qui a le soleil pour centre, a été victime de la facilité avec laquelle on peut l’enclore dans une formule.
4
Il y a un malentendu au départ. Dupuis veut faire œuvre de savant (savant en mythologie et en astronomie, il explique la première par la seconde), et faire œuvre de savant, c’est par là même faire avancer les lumières, dévoiler les mystères sur lesquels reposait l’oppression des rois et des prêtres, c’est percer à jour toutes les religions, dont, bien entendu, la religion chrétienne. Etre savant, être polémique, c’est ici la même chose, c’est poser un nouveau pouvoir (la raison, la nature, la république) contre l’ancien. Ainsi, toute l’érudition de Dupuis est polémique, mais toute sa polémique est érudite. Or l’ouvrage a été accueilli comme une parfaite machine de guerre, mais par des lecteurs qui demandent surtout, dans le fond, à savoir les conclusions, l’idée générale ; des lecteurs qui, en quelque sorte, nient en Dupuis le savant et l’érudit, au moment même où ils cherchent en lui des lumières, ou des armes contre la nuit.
5
L’Origine de tous les cultes, dont l’impression a été accélérée sur les instances du club des Cordeliers, et dont le premier exemplaire a été offert en hommage à la Convention, en
140
septembre 1795, est un monument du savoir-pouvoir. Il repose sur la conviction que toute l’oppression tombera, quand tous les hommes seront éclairés sur son origine. Il entre ainsi dans le drame de son propre pouvoir à répandre la science, à rendre la vue aux hommes, ou plutôt, il vit le drame du pouvoir même qu’il prête aux lumières : le pouvoir d’une évidence lente à régner, une sorte de révélation, mais qui passe par les lenteurs de la raison, un éblouissement laborieux. L’Origine de tous les cultes tend vers la simplification (en pratiquant continûment le style de la réduction : chaque dieu ou héros, Apollon, Bacchus, le Christ, Osiris, etc., « n’est que » le soleil), mais en même temps vers la complication : si Dupuis favorise une sorte de slogan, c’est en l’accompagnant d’une montagne de recherches et de démonstrations, en réclamant, non qu’on répète le slogan, mais qu’on refasse le chemin de la démonstration, car il s’agit absolument pour lui d’une œuvre de science et de raison. Le lecteur a intérêt à se procurer un globe spécial, construit sur les instructions de Dupuis par le Citoyen Loysel, « rue du Plâtre-Jacques, N° 9, au premier sur le devant » : c’est la condition pour bien suivre. Alors l’évidence apparaîtra, on verra vraiment, le « flambeau de l’érudition » montrera comme il éclaire. On fera pivoter sur le globe des croix mobiles avec des épingles : le texte dit comment faire, prévoit pour lecteur une sorte d’élève à distance, qui soit capable de recommencer ou de compléter par lui-même la série des preuves, de faire les applications tout seul. 6
Il y a consensus entre les amis et les ennemis pour trouver que le « grand ouvrage » est un gros ouvrage : quatre volumes in-4°, dont trois de texte serré, sur deux colonnes, avec un système peu commode de pagination, et l’atlas en quatrième volume (planches et planisphères). Le format in-8°, en douze volumes, auxquels s’ajoute l’atlas in-4°, est peutêtre plus abordable par son prix, mais également lourd à manier (sinon plus).
7
L’activité de l’écrivain Dupuis, après le grand ouvrage de 1795, va dans deux sens. D’une part il abrège pour mieux diffuser : l’Abrégé de l’Origine de tous les cultes paraît en 1798 ; « Je l’ai dépouillée », dit Dupuis, autant que la matière l’a permis, de la haute érudition, afin de la mettre a la portée d’un plus grand nombre de lecteurs ; car l’instruction et le bonheur de mes semblables ont été et seront toujours le but de mes travaux.3
8
L’œuvre monumentale, et qui a été aussitôt consacrée comme un monument, avait besoin d’une sorte de guide portatif. Mais le texte de l’Abrégé ne cesse de dénoncer sa propre insuffisance, de pousser le lecteur vers le grand ouvrage, vers son irremplaçable intégrité érudite. L’Abrégé n’a pas proprement d’existence dans l’œuvre de Dupuis : alors qu’elle ne cesse de se référer à elle-même, on ne trouve jamais aucun renvoi à ce texte. C’est un produit second, marginal, qui n’appartient pas à l’édifice scientifique.
9
D’autre part, l’œuvre continue de vouloir s’accroître, d’aller vers plus énorme encore. Même l’Abrégé, au lieu de faire simplement retour sur la publication passée, tend vers un supplément, sert d’annonce, en en donnant un extrait, à « notre manuscrit des Cosmogonies comparées, qui est depuis longtemps prêt à être imprimé ». De 1798 à 1806, Dupuis ne publie aucun livre, mais ses travaux à l’Institut, ainsi qu’un article publié dans La Décade, en 1804, déclarent à la fois de grands projets et la nécessité d’y renoncer : les Mémoires sur les Pélasges, lus à l’Institut, sont les fragments d’une sorte de super-Origine, un grand ouvrage encore plus grand, qui devait « faire tourner le globe sous les yeux du lecteur ». L’article dans La Décade, en 1804, se présente comme le prospectus d’un « nouvel ouvrage » sur les Cosmogonies, mais, en note, on apprend que l’auteur a retiré son manuscrit. Enfin le dernier livre que Dupuis ait publié, le Mémoire explicatif du Zodiaque chronologique et mythologique, en 1806, se donne comme ce qui reste, ou ce qui arrive à
141
percer, de cet autre grand ouvrage sur les Cosmogonies : c’est, écrit Dupuis dans les dernières pages, un « aperçu très abrégé de notre travail sur les Cosmogonies comparées »4, et les premières pages renvoyaient déjà à cette somme inédite : « c’est surtout dans notre manuscrit des Cosmogonies que nous le faisons remarquer »..., « nous [en] parlons avec plus de détail dans [...] les suppléments manuscrits de notre grand ouvrage »5. Les notes, particulièrement abondantes et minutieuses, renvoient pourtant à un trésor d’érudition pire encore : « Nous réservons pour nos Cosmogonies les explications des autres faits », « description [...] dont nous réservons l’explication pour nos Cosmogonies »6. 10
Ainsi, tout ce qui suit le grand ouvrage de 1795 est pris dans une logique de l’abrègement : d’un côté il y a ce qui abrège le livre fait, et qui couronne une notoriété, de l’autre côté il y a ce qui abrège, ébranche, émiette un livre à venir qui ne viendra jamais. Les travaux de Dupuis qui précédaient l’Origine (une série d’articles donnés à partir de 1779, et un Mémoire très remarqué, en 1781, sur l’origine des constellations et sur l’explication de la fable par l’astronomie) se présentaient eux aussi comme les éclats d’un « système » dont l’expression complète devait suivre ; mais elle a effectivement suivi : c’est l’Origine. Dupuis recommence à fonctionner après l’Origine comme il avait fait auparavant : mais cette fois, il est sur le versant descendant de sa carrière. Autant l’Origine voit triompher « la raison et la justice éternelles », dans un « peuple éclairé comme le nôtre7 », autant l’Abrégé est amer, constate la lèpre inguérissable de la religion, le « petit nombre des sages », le recul des lumières8. Alors que l’Abrégé de l’Origine est une version diminuée pour lecteur non érudit, et vulgarise un ouvrage consacré, le Mémoire de 1806, autre « aperçu abrégé », selon la formule de Dupuis, cherche, quant à lui, le sage qui saura lire, pour lui faire passer sous forme concentrée, par ces temps de nuit qui reviennent, le maximum du système. Le livre n’est pas gros (148 pages in-4°), et surtout il contient une sorte d’hiéroglyphe de la science de Dupuis : un tableau savant, dont le livre entier n’est que le commentaire explicatif. Voici le mot ultime : Il se trouvera tôt ou tard un homme d’esprit qui fera usage de ce Tableau, et c’est à lui que je le dédie.
11
Ce tableau est proprement lumineux : il doit faire voir l’antiquité des mythologies, et donc l’antiquité du monde (ce qui ruine les dates des chronologistes). Et il fait voir en même temps la méthode de Dupuis, car il réalise, dans un espace de 51 sur 68 cm, la perfection du rapprochement : C’est le tableau abrégé des dates astronomiques prises depuis la Chine jusques en Grèce, c est-à-dire dans tout l’Orient et en Europe, ainsi qu’en Égypte dans les siècles les plus éloignés, et dont la plus rapprochée est celle du Souria-Sidantha, que nous mettons sous les yeux des amis de la Philosophie et de la Science ancienne ; car c’est pour eux seuls que nous écrivons. Nous citons les autorités dont nous nous appuyons [...] Il n’y a presque rien de nous que les rapprochements ; mais ces rapprochements faits pour la première fois, sont tout. En effet, tant que les diverses parties du tableau sont isolées elles sont presque nulles pour les conséquences qu’on doit en tirer ; rapprochées elles jettent de toutes parts des rayons de lumière qui nous éclairent dans l’étude de l’antiquité.9
12
Tableau d’autant plus parfait que Dupuis n’a pas voulu le « charger » trop, et qu’il ne demande ainsi qu’à fonctionner sous la main du lecteur et du disciple : il est prévu pour se réactiver, pour délivrer à la demande les autres aspects du même message. Il est livré, en quelque sorte, avec un dynamisme programmé : Il m’eût été facile de faire ressortir cette différence qui existe entre les dates de la Chronologie historique et celles de la Chronologie astronomique, en marquant sur
142
le cercle gradué le lieu qui répond aux équinoxes, aux époques que supposent ces dates fournies ou supposées par nos historiens. Mais j’aurais trop chargé le tableau ; et c’est un travail que chacun peut faire à l’aide de la méthode que nous avons indiquée plus haut [...] J’invite même le lecteur à faire ce travail ; ce sera le moyen de rendre ce tableau plus complet, plus utile, et de lui faire naître à lui-même des réflexions qui nous auraient échappé, ou que nous n’aurions pas cru devoir faire. 10 13
C’est un tableau qui commande : trouve toi-même, dit-il au lecteur, ce que je te montre. Epouse intégralement mon raisonnement. Les « réflexions que nous n’aurions pas cru devoir faire » sont retirées de l’affichage du texte (nous ne sommes plus en 1795), mais elles sont mises en sécurité dans la logique du tableau : une évidence et un silence.
14
Cet abrégé, qui arrive à la brièveté et à la totalité sous forme de tableau, exerce, d’une façon testamentaire, un pouvoir double : pouvoir du visible, pouvoir de la raison. Voir ce tableau, plonger les yeux, grâce à lui, dans la révélation de l’antiquité du monde, cela suppose une science de l’astronomie, et de plus une science de cette espèce d’astronomie archéologique que développe Dupuis. Évidence de savant. Évidence lente à éblouir : il faudra, dit Dupuis, relire plusieurs fois le mémoire explicatif. Éblouissement laborieux, mais labeur éblouissant : car le tableau se ramasse sous l’œil pour s’exposer comme un tout, et un tout-ensemble, merveilleusement figuré par la forme circulaire : Il est curieux d’envisager d’un seul coup d’œil l’antique et immense chaîne qui lie le système général des connaissances astronomiques sur une grande partie du globe, d’en apercevoir les filiations, d’en saisir les rapports, et de se former une idée juste de l’état de la science astronomique, et par une conséquence assez naturelle, de celle des arts et des autres connaissances humaines, dans des siècles où l’on prétend que les hommes étaient à peine réunis en société, au moins venaient d’éprouver une destruction presque générale.11
15
Le tableau est la présence efficace de l’évidence : « Il suffit de jeter un coup d’œil sur notre tableau », « Ainsi l’on verra, du premier coup d’œil, l’origine de la fête de la purification par l’eau », « D’un seul coup d’œil on embrassera ce vaste Tableau »12, etc. Ces expressions sont récurrentes.
16
C’est bien une révélation, le dévoilement de la vérité, mise sous les yeux, impressionnante. Le texte qui développe le système en déroulant la diachronie du discours trouve son achèvement dans cette synchronie, qui ne s’adresse pas seulement à l’intelligence, mais à l’œil : car le tableau ne fonctionne pas seulement comme une sorte de machine qui donnera à celui qui sait s’en servir la solution des problèmes qu’il pose, il fonctionne aussi, dans son ensemble visible, comme un signe du système, et comme un signe du monde que ce système suppose : tout se tient, tout s’ordonne, à l’intérieur d’un cercle qui est le cercle du visible même, la clôture des apparences célestes. Toute la fabulation religieuse de l’humanité est enfermée dans ce cercle du zodiaque qu’elle voit circuler devant ses yeux. Le Tableau de Dupuis va avec l’esprit systématique de son auteur, mais aussi avec l’apologie particulière du visible que ce système comporte. Le spiritualisme, la métaphysique, c’est-à-dire l’invention d’un au-delà invisible, sont pour Dupuis un produit tardif et dégénéré. A l’origine, c’est-à-dire avant la chute de l’homme en métaphysique, seul le visible existait : et la religion, close dans les bornes indépassables du temple-univers, était une science et une représentation du visible, des phénomènes astronomiques. Le Tableau rend visible que le visible est tout. Il est pour ainsi dire une exclusion d’invisible, et par lui Dupuis trouve la forme qui exerce le pouvoir même des lumières : exclusion d’invisible, ou encore exclusion de mystères 13 et
143
d’ignorance, exclusion des oppresseurs. En même temps, il rend visible une époque où le visible fut tout, une sorte de paradis du matérialisme savant : On voit [...] que les beaux temps de l’Astronomie, ceux des fictions poétiques et des monuments religieux, auxquels l’Astronomie a servi de base, remontent à 4700 ans au moins avant notre ère.14 17
C’est ce « bel âge de la poésie et des sciences15« que l’Origine a déjà décrit avec une sorte d’enthousiasme poétique, trouvant dans la nuit de cette antiquité profonde un « siècle de lumières, où les prêtres de toutes les nations peignaient et chantaient la nature et consacraient ces monuments ingénieux et savants16 ». C’est l’ère du Taureau (l’époque où le printemps commence quand le soleil entre dans le signe du Taureau).
18
La diffusion de Dupuis jusqu’au début du XXe siècle tient essentiellement à son abrégé de 1798, que la propagande raccourcit encore parfois, en le réduisant à son chapitre IX. Or il apparaît, par son mode de vulgarisation, comme un hapax, voire comme une anomalie dans l’œuvre de Dupuis. Il trahit au fond l’idée que Dupuis se fait du pouvoir des lumières, il ne correspond pas au pouvoir qu’il veut que ses propres lumières exercent sur le public. Quoique l’Abrégé regorge lui aussi des formules de l’évidence, il n’éclaire pas comme il convient. Il a dépouillé ce que l’Origine offrait à la fois de résistance et de visibilité : le taillis d’un texte archi-savant, gorgé de notes, et tout cet appareil de la démonstration, les grands tableaux à déplier, les planisphères, les planches. Pour être diffusable et populaire, il a perdu tout ce qui faisait du livre un livre cher, mais aussi tout ce qui, pour Dupuis, avait une valeur, la science indispensable au dévoilement.
19
Le Mémoire de 1806 retourne à une forme et à un format qui sont ceux de l’Origine. Il enjambe le populaire pour retourner au savant : foisonnement de notes, déploiement d’un Tableau qui fait tout voir à celui qui aura maîtrisé le texte. Mais le Mémoire se rassemble en un seul tableau rayonnant, alors que l’Origine propose plusieurs tableaux, partiels et en colonnes, ainsi que divers planisphères. Ce qui, dans l’Origine, se rapprocherait le plus du Tableau de 1806, c’est, me semble-t-il, le frontispice même, qui occupe une place unique, liminaire et finale : c’est une gravure rassemblant les allégories de tous les cultes aux époques où le Taureau puis le Bélier correspondaient à l’équinoxe de printemps. Dupuis conclut son « Explication du frontispice » en montrant en lui le « Tableau raccourci de l’ Origine de tous les cultes », qui « sert à en fixer les bases principales, d’une manière aussi ingénieuse que piquante ». On pourrait le décrire, selon les définitions de Dupuis, grand admirateur de la science des prêtres égyptiens, comme un hiéroglyphe composé d’hiéroglyphes : une écriture simultanée attendant qu’on la décompose, supposant à côté d’elle la longue explication, la traduction. La recherche du « raccourci », qui apparaît ainsi en même temps que le monument du grand ouvrage, en même temps que l’immense discours, et en complémentarité de lui, aboutit en 1806 à une nouvelle forme : à ce Tableau du Zodiaque qui, dans le cercle des signes du Zodiaque, ordonne et rapproche non plus des figures composées, mais des mots. Mais c’est toujours une grande composition qui est, à la fois, à voir d’un coup et à décomposer. Ce raccourci est compliqué. Faire voir, ou dévoiler, exercer le pouvoir de la lumière et des lumières, c’est chez Dupuis, trouver un certain mode d’écriture, auquel la vulgarisation de 1798 est étrangère, et qui repose sur la conjonction d’un excès du discours savant, et d’un superconcentré graphique. Faut-il suggérer pour finir que cet imaginaire de la révélation peut aboutir, non pas à la parfaite clarté, mais à deux surenchères d’obscurité dans l’érudition, à deux effrois pour l’œil du lecteur ?
144
NOTES 1. Rappelons que Dupuis (1742-1809) a été fondamentalement un professeur : quarante-quatre ans d’enseignement littéraire, de 1766 à sa mort. 2. Origine de tous les cultes, ou Religion universelle, par Dupuis, citoyen françois, Paris, H. Agasse, l’an III de la République une et indivisible. 3. Abrégé de l’Origine de tous les cultes par J.B. [sic] Dupuis, avec une notice et des notes critiques par B. Saint-Marc, Paris, Garnier, sa [1895], p. XII. 4. Mémoire explicatif du zodiaque chronologique et mythologique ; Ouvrage contenant le Tableau comparatif des Maisons de la Lune chez les différents Peuples de l’Orient, et celui des plus anciennes observations qui s’y lient, d’après les Egyptiens, les Chinois, les Perses, les Arabes, les Chaldéens et les Calendriers grecs, par Dupuis, Paris, Courcier, 1806, p. 76. Nous modernisons l’orthographe.
5. P. 18 et p. 31, note 1. 6. P. 33, 134. 7. Origine de tous les cultes, t. II, 2ème partie (Traité des Mystères), p. 118, 121. Tomes et pages, dans tous nos renvois à l’Origine, sont ceux de l’édition in-4° de l’an III. 8. Abrégé de l’Origine, p. 269, 305. 9. Mémoire explicatif..., p. 60 (je souligne). 10. Р. 62. 11. P. 60. 12. P. 66, 71, 121. 13. Voir Cl. Rétat, "Lumières et ténèbres du citoyen Dupuis", à paraître dans les Chroniques d’histoire maçonnique (Paris, IDERM), n° 50. 14. P. 62. 15. Origine de tous les cultes, t. I, livre III, ch. IV, p. 457. 16. T. II, suite du livre III, ch. VI, p. 98.
145
« Rois inconnus ». De l’usage du secret dans le roman de Balzac Chantal Massol-Bedoin
1
Philippe Sollers, assez récemment, intitula Le Secret1 un roman que lui inspira L’Envers de l’histoire contemporaine : ce titre mettait l’accent, sur ce qui, en effet, est une caractéristique notable2 de l’univers balzacien : omniprésent sur le plan thématique, le secret y est également une figure3 qui commande la dramaturgie de l’œuvre, comme sa poétique. Les secrets foisonnent dans le monde diégétique, le partagent (voir César Birotteau). La volonté d’occultation vise aussi, très souvent, le lecteur lui-même, écarté de la connaissance d’un fait, et à qui l’on promet un dévoilement. Je m’intéresserai, ici, à ces secrets réservés par le roman, et que font surgir les récits à énigme que Balzac utilise si volontiers. Les remarques qui vont suivre s’inscrivent dans une réflexion plus vaste4 portant sur l’intérêt et les fonctions de ce type de récit, qui se développe au début du XIXe siècle, et que le roman balzacien contribue grandement à développer.
2
Je passerai rapidement sur le fait (évident) qu’une telle manière de raconter est génératrice d’intérêt romanesque. Je noterai en revanche, avec M. Condé, que l’opposition de l’apparent et de l’occulte (dont cette forme est l’une des manifestations) est devenue, pour le réalisme auquel vise la Comédie humaine, une « structure nécessaire de la représentation »5. Apporter un savoir sur le monde, dans un type de roman qui n’est plus soumis à l’exigence du vraisemblable, et qui se caractérise par l’abandon de toute intention axiologique, n’est possible que si est postulée l’opacité de ce monde. Ce sont des connaissances inédites, en effet, que le romancier se propose désormais de délivrer, et cela n’est possible que si un obstacle en interdit l’accès au plus grand nombre. La fiction romanesque est le lieu où doit se délivrer une vérité échappant « au savoir commun de l’apparence »6. Ainsi, le roman balzacien pose inlassablement la société comme énigme, pour mieux la déchiffrer ; il y aperçoit sans relâche des secrets, pour mieux les révéler.
3
Le jeu avec le secret auquel se livre assidûment (ou presque7) le récit balzacien est donc au service de stratégies romanesques : il est l’un des moyens de la redéfinition du rôle du roman, en ce début du XIXe siècle, et de sa promotion à l’intérieur du champ littéraire. C’est l’une de ces stratégies que je voudrais mettre plus particulièrement en évidence.
146
Sociologues et ethnologues ont depuis longtemps montré que la pratique du secret, dans le monde social, renvoyait à des rapports de pouvoir. Le secret (l’étymologie nous le dit) a une fonction discriminante8 : il sert à distinguer des groupes (plus ou moins éloignés de sa possession), à instaurer entre eux des hiérarchies. Par ailleurs, si le pouvoir est pouvoir de dire9 (l’exercice du pouvoir est lié à celui de la parole 10), il est, également, pouvoir de ne pas dire : il est, tout autant, l’effet d’un « savoir-taire » que d’un « pouvoir-dire » : [...] l’avancement dans la hiérarchie nécessite et implique un savoir-taire. [...] savoir tenir sa langue, c’est savoir tenir sa place et distribuer celle des autres. Cela pourrait être une de ces lois du silence qui autorise la confiscation et l’accumulation des savoir et des pouvoir-dire et qui implique la mise en œuvre de savoir et de devoir-taire11. 4
Selon J. Jamin, primitives ou avancées, toutes les sociétés sont régies par de telles « lois du silence ».
5
La pratique balzacienne du secret relève manifestement d’une stratégie d’affirmation d’un pouvoir12. Le récit qui donne à désirer des révélations à son lecteur ne cesse d’attirer l’attention sur son non-dire13. Il use, dans le même temps, de la tactique du « faire savoir que l’on sait »14. Il fait donc abondamment la preuve de son savoir-taire. Or, ce savoirtaire définit (nécessairement) un pouvoir-dire15. Il y a représentation, dans ce type de récit, d’une confiscation de savoirs, accompagnée d’une appropriation de la parole, en même temps que d’une revendication du droit d’usage des savoirs confisqués. Le savoir, nous estil signifié, n’est pas l’objet d’une répartition égalitaire. Sa distribution est fonction d’une hiérarchie dont le secret est l’argument. Dans l’univers diégétique, celui qui détient les secrets exerce, sur les autres, un pouvoir quasi-illimité16, c’est un maître (l’expression « maître du [des] secretfs] » se retrouve, à plusieurs reprises, dans La Comédie humaine 17. Une identique place de maître se trouve dès lors assignée à celui qui détient les secrets dans l’univers narratif. Les représentations que la fiction offre de ce pouvoir insistent sur son étendue, et sa réalité : celui qui maîtrise les lois du silence est aussi un acteur important du monde social. Gobseck, qui tire sa puissance de sa connaissance des secrets d’autrui, est, à cet égard, l’une des figures du romancier les plus frappantes.
6
Le récit balzacien, en outre, aime à mettre l’accent sur la fonction affiliatrice 18 du secret. En d’autres termes, il désigne volontiers la limite que celui-ci trace entre initiés et exclus. Les expressions « [s]’initier aux secrets » [aux mystères], « être dans le secret », reviennent avec constance, d’un texte à l’autre : Les personnes les moins initiées au secret de cette scène commencèrent à en comprendre l’intérêt (Les Chouans, VIII, 1134). Vautrin [...] lui jeta un de ces regards par lesquels cet homme semblait s’initier aux secrets les plus cachés du cœur (Le Père Goriot, III, 118). Quelques jours après cette scène qui m’avait initié aux terribles mystères de la vie d’une femme à la mode [...] (Gobseck, II, 994). Elle [...] l’initia aux secrets de la cachette où se trouvait le sénateur (Une ténébreuse affaire, VIII, 652).
7
Les initiés de la fiction, dont la présence est plus ou moins fugitive (Derville, confident de Gobseck, est l’un des plus insignes19), indiquent au lecteur la place que lui-même est invité à occuper, auprès du maître des secrets. Ils lui font comprendre l’enjeu que représente l’acquisition des savoirs occultés. Ils sont constamment présentés comme rares, voire exceptionnels « lui seul », « elle seule »20), et, de ce fait, privilégiés (admis à partager le secret des dieux21).
147
8
C’est la société secrète qui fournit ainsi au romancier l’image du pouvoir dont il rêve. Pouvoir souvent représenté, comme on le sait, dans les récits de La Comédie humaine : les usuriers (une dizaine) qui se rassemblent autour de Gobseck dans un café près du PontNeuf sont des « rois silencieux et inconnus » – ils se « révèl[ent] les mystères de la finance », « possèd[ent] le secret de toutes les familles » (II, 976-77). Les Treize, « flibustiers en gants jaunes » unis par un « secret de haine » (V, 791), sont, de la même manière, « treize rois inconnus, mais réellement rois » (Préface à Histoire des treize, V, 792). Autour de Vautrin s’est constituée la Société des Dix Mille, « association de hauts voleurs, de gens qui travaillent en grand, et ne se mêlent pas d’une affaire où il n’y a pas dix mille francs à gagner » (Le Père Goriot, III, 190-91). La société secrète des Frères de la Consolation, qui apparaît dans L’Envers de l’Histoire contemporaine, conspire pour le Bien, mais à ce détail près, elle ressemble fort aux autres (Mme de la Chanterie, épaulée par le banquier Mongenod, offre l’image d’un pouvoir occulte)22.
9
Cette image du pouvoir, qui se retrouve ainsi d’un bout à l’autre de La Comédie humaine 23, vient, tout droit, d’une « mythologie »24 qui s’est développée, en France, à partir de la Révolution : on se représente volontiers, alors, l’association secrète comme « instrument, voire moteur, de la révolution politique et sociale »25. Ce sont souvent, outre les Philosophes, les Francs-Maçons et les Illuminés (promoteurs de la philosophie des Lumières) qui sont désignés comme responsables du déclenchement de la Révolution française – idée que défendent par exemple les Mémoires pour servir à l’histoire du jacobinisme de l’abbé Barruel, eux-mêmes influencés par les thèses illuministes 26 : on enseignait, à la fin du XVIIIe siècle, dans l’Ordre des Illuminés de Bavière, que les associations occultes, par leurs conspirations, jouaient un rôle essentiel dans le déroulement de l’Histoire27 – pour Adam Weishaupt, fondateur de cet ordre, le secret était d’ailleurs le moteur même de l’Histoire.
10
S’il peut permettre, dans la plupart des associations secrètes qui se sont multipliées à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe28, d’assurer la sécurité de ses membres, protégés par la clandestinité, là n’est pas, il faut le souligner, sa fonction primordiale ; il est, encore, le principe même d’existence, et d’organisation, du groupe, il reçoit une justification doctrinale. Les organisations secrètes de la seconde moitié du XIXe siècle, en revanche, ne seront plus des sociétés initiatiques ; elles perdent dans l’ensemble ce caractère après 183029 – c’est, par conséquent, un modèle légèrement anachronique qui s’offre à Balzac.
11
Cette représentation du pouvoir comme produit même du secret, et de l’affiliation, paraît fortement liée au développement, dans la société pré-révolutionnée et révolutionnaire, d’une nouvelle forme de « sociabilité politique »30 qui commence à réunifier un corps social morcelé. Sous l’Ancien Régime, la monarchie – absolue – était « le centre organisateur de la vie sociale » : toute la société se trouvait rangée concentriquement et hiérarchiquement autour d’elle »31. Les nouveaux « centres » de cette sociabilité (les sociétés de pensée, par exemple, ou les loges maçonniques) sont étrangers aux institutions de l’ancienne monarchie, au regard desquelles32 ils sont l’expression d’un principe inavouable – d’où leur caractère souvent secret : ils sont, en effet, le produit d’une société qui se réorganise autour de l’individu, recrée du tissu social et politique à partir de l’individuel. Mais l’image qu’ils donnent du pouvoir (désormais attribué au peuple, au nom duquel parlent clubs et sociétés) est celle d’un pouvoir sans partage, calquée sur celle de l’ancien pouvoir royal, héritée de l’absolutisme. C’est par un « retournement » de l’imaginaire d’Ancien Régime que se constitue, comme le souligne F. Furet, le nouvel imaginaire politique : en élisant ses nouveaux centres de sociabilité, la
148
société « recompose » le pouvoir « dans une exterritorialité radicale » par rapport à celui de l’absolutisme, et pourtant, « sur son image »33. 12
C’est ce que dit bien l’expression de « rois inconnus » (cf. supra) par laquelle se trouvent désignés les membres des sociétés secrètes de la Comédie humaine. La figure du romancier, dans la fiction balzacienne, se dessine – par Gobseck ou Vautrin interposés 34 -comme celle de l’un de ces « rois inconnus ». Le pouvoir sans partage qui s’y trouve affirmé est celui de la parole, et de la parole romanesque. Annonçant la mise au secret initiale d’un savoir, pour en laisser augurer la révélation, le récit à énigme qu’aime tant Balzac est une mise en scène perpétuelle des pouvoirs de dire/ne pas dire du romancier. Montrer que la parole romanesque doit être interprétée en terme de pouvoir, affirmer avec force le pouvoir du romancier, tel paraît être l’un des intérêts stratégiques majeurs de l’emploi insistant de cette forme narrative. On peut se demander s’il existe d’autres formes de récit capables de remplir cette fonction avec autant d’efficacité : celui-ci joue directement, en effet sur, et avec, les lois du silence (ces dernières sont à l’œuvre, sans doute, dans n’importe quel texte, mais pas forcément exhibées comme elles le sont ici).
13
On ne s’étonnera pas que le pouvoir de la parole du romancier cherche à s’affirmer avec une telle force précisément en ce début du XIXe siècle : jusqu’à la Révolution, l’homme de lettres a une place définie dans les structures sociales d’Ancien Régime ; il s’intègre, horizontalement, à l’un de ces corps dont la société se compose, aux côtés du savant, de l’artisan ; certains réseaux par ailleurs lui permettent une intégration verticale, le rapprochant des élites35. Après la rupture révolutionnaire, plus aucun circuit n’intègre l’écrivain en amont du processus de création36. Celui-ci se trouve simultanément éloigné du lieu réel du pouvoir et en quête d’une légitimité nouvelle. Il fait sien, alors – dans le cas de Balzac -, le fantasme de pouvoir que lui offre le nouvel imaginaire politique.
14
La figure du romancier qui se dessine à la faveur de ce jeu avec le secret tient de celle du monarque et de celle de l’Artiste37. Tel qu’il est peint par Balzac lui-même, en 1830, dans un article où se reconnaît aisément l’influence saint-simonienne, ce dernier a pour prérogative d’être « intime avec les causes secrètes »38 : d’où sa mission, qui est de « saisir les rapports les plus éloignés »39, les vrais rapports, cachés, entre les choses, ceux que le « vulgaire »40 ne perçoit pas et, ainsi, d’éclairer ses semblables...
15
L’Artiste fait partie – l’expression est de C. Charle41 – de la « galerie des ancêtres » de l’intellectuel moderne42. C’est bien dans un champ « intellectuel » (dont il trace, imaginairement, les contours) que Balzac semble vouloir inscrire le roman : celui-ci devient, je l’ai dit, un lieu où se délivrent des « vérités » inédites sur le monde. Et en promettant une affiliation à des lecteurs jugés dignes d’être associés à son entreprise cognitive, le romancier sélectionne ceux qu’il veut reconnaître comme ses pairs : leur commune appréhension du monde sera fonction d’une hiérarchie – on a vu tout ce qu’il y avait d’élitiste dans la figure qui se construit – dont le fondement sera dans l’activité de l’esprit.
16
Mais s’il mime volontiers, par les moyens que j’ai décrits plus haut, une prise de pouvoir, le romancier s’emploie, on le constate vite, à mettre ce pouvoir à l’épreuve de la fiction romanesque, d’une manière qui, souvent, semble parfaitement délibérée.
17
Et, d’abord, il la laisse questionner la validité du modèle de pouvoir dont il se réclame. Les Treize sont, chronologiquement, l’une des premières sociétés secrètes43 qui apparaissent dans ce qui deviendra La Comédie humaine. Or, les trois récits (rédigés entre 1833 et 1835) dans lesquels Balzac évoque leur Histoire retracent, de fait, celle d’un effacement
149
progressif, d’un « pouvoir [...] brisé »44 ; et dans la préface à cette trilogie, qui, pourtant, au moment de sa rédaction, ne précédait encore que Ferragus, le narrateur nous annonce l’ « abdication » (V, 792) – postérieure au temps de la diégèse – de ces souverains occultes. La chose est claire : c’est un pouvoir révolu que représente, d’entrée de jeu, leur association ; on ne peut qu’en raconter la ruine. Il n’est pas inutile, ici, de s’interroger plus précisément sur la nature de ce pouvoir que la fiction détruit : les Treize incarnent, du fait de leur cohésion invisible, un principe de centralité secret ; de là découle leur pouvoir, plus réel que le pouvoir en place (qu’ils ne songent pas, d’ailleurs, à détrôner), sur une société atomisée. Ils sont, à ce qu’il semble, chargés de signifier la permanence, dans la société désunie d’après la Révolution, de ce principe qui s’exerçait de façon manifeste autrefois, et dont tout paraît dire la disparition ; mais dont l’action serait à présent souterraine... Le lieu qu’ils occupent est à la fois celui du secret, et celui d’où se dévoilent les arcanes de la société. Il semble bien être l’une des actualisations fictionnelles de ce « centre intelligent » qu’est censé occuper le « poète », dans l’Introduction aux Etudes de mœurs au XIXe siècle45, de 1835. 18
Mais au fil des épisodes, on constate un amenuisement de leur savoir miraculeux, ainsi que l’affaiblissement de l’étonnante capacité d’agir qu’il leur donne. Leur rôle se réduit progressivement, et dans La Fille aux yeux d’or, le dernier des trois récits, ils ne sont plus que périphériques. Ferragus, appelé à la rescousse par de Marsay, ne parvient qu’à être témoin auditif du meurtre perpétré, au dénouement, par la marquise : brève apparition après laquelle le récit l’oublie. Il est, alors, assimilé à un « critique » : « Ta marquise n’a pas pensé que les sons sortiraient par la cheminée, dit le chef des Dévorants avec le rire d’un critique enchanté de découvrir une faute dans une si belle œuvre » (V, 1106). Celui qui n’a pas su – bien que chef des Dévorants – être sujet de l’action est ainsi rejeté sur les marges de l’œuvre, qu’il se borne à commenter. Il se trouve, également, dissocié de l’instance énonciatrice de l’histoire. Or, la Préface à Histoire des treize avait nettement affirmé la contiguïté de l’instance narrative et du lieu du secret : « l’auteur » y était censé avoir obtenu de l’un des Treize, son confident, la « permission » de raconter « quelquesunes des aventures arrivées à ces hommes » ; il ne s’y présentait guère que comme la « créature » de cet « inconnu », comme l’ « Ossian » d’un « Macpherson » réfugié dans l’« incognito » (V, 788). Devenus de simples « critiques » en la personne de Ferragus, bannis du « centre intelligent » qui devait être leur place, les Treize entraînent avec eux, dans leur exil, celui qui tient la plume46.
19
Histoire de secret et de pouvoir, Histoire des Treize raconte de fait l’impossible existence de ce « pouvoir occulte » qu’exalte (non sans nuances) sa Préface : les Treize cèdent finalement le lieu du secret à un personnage (la marquise de San Réal) dont le mystère reste entier à leurs yeux, un personnage dont le pouvoir inconnu est supérieur au leur, et dont l’apparition face à son double parfait, de Marsay, révèle, en dernière analyse 47, la victoire du principe de division et d’éclatement sur le principe de centralité et de cohésion qu’ils devaient incarner. L’histoire est celle, aussi, de l’impossible constitution de la figure du romancier comme « roi inconnu ». Anachronique, on l’a vu, et avoué comme tel48 par le récit, le modèle de pouvoir convoqué ne pouvait guère se montrer, dans l’aventure, qu’inadéquat : il est clair que Balzac s’amuse, dans ce triptyque, à déconstruire ses propres fantasmes de romancier.
20
Il peut être éclairant de mettre en regard de ces textes des années 30 le tardif Envers de l’histoire contemporaine (1846-48). Balzac y reprend, pour la dernière fois, en se parodiant lui-même, la forme du récit « à secret » dont il a tant usé. On découvre, dans ce dernier
150
roman de la La Comédie humaine49, une jeune femme, que ses proches dissimulent avec le plus grand soin : elle est victime de la « plique polonaise »50, maladie terrible, qui la paralyse (maladie allégorique : il faut voir en Vanda de Mergi une enfant du siècle). Ce sont les Frères de la Consolation qui nous mènent jusqu’à elle : regroupés occultement pour agir sur un monde plus que jamais morcelé, et y rétablir les valeurs du passé, ils ont décidé, sans rien connaître des secrets de la famille, de compter le père de Vanda parmi les bénéficiaires de leurs secours. Mais celui qui sauvera la jeune femme sera extérieur à l’organisation secrète : un médecin aux méthodes quelque peu déroutantes, Halpersohn, libère Vanda de sa « plique », et ainsi, remet symboliquement le monde en marche. Pour ce faire, il arrache sa patiente au lieu secret qui la protège, il fait voler en éclats la sphère du secret autour de laquelle s’organisait jusque-là tout l’univers diégétique. Comme les Treize, les Frères de la Consolation voient une force supérieure à la leur venir lui faire concurrence : elle est, cette fois, fatale pour l’ordre du monde auquel ils appartiennent. Le modèle que la fiction semblait encore, au départ, vouloir imposer, se trouve comme irrévocablement détruit : tout se passe comme si l’action salvatrice d’Halpersohn mettait fin, tout bonnement, à une organisation du monde devenue inconcevable. 21
Non content de laisser ainsi planer le doute sur l’efficience du modèle de pouvoir en vertu duquel il se sacre roi (modèle qu’il finit, donc, par révoquer), le romancier balzacien s’applique, d’une manière qui, au fil des lectures, a l’air d’être méthodique, à mettre en péril le pouvoir que par ailleurs il prétend s’arroger. Le jeu, que l’on observe tout au long des années 30, devient parfois plus savant encore, à ce qu’il me semble, dans certains récits des années 40 (comme Albert Savarus). C’est bien volontiers que le maître des secrets se piège lui-même, en s’engageant dans une logique qui veut qu’il dise effectivement ce qu’il prétend pouvoir dire. Or, l’entreprise de révélation est un danger : celui qui tire sa puissance de la possession déclarée d’un secret s’expose, en dévoilant celui-ci, à décevoir. Parce que le secret peut se réduire à peu de choses ; parce que l’information réservée perd, de toute façon, de son intérêt, dès lors que l’abolition du secret la replace dans l’ordre de la banalité ; parce que l’affirmation de la possession d’un secret peut n’être qu’un leurre ; et, de manière générale, parce que le pouvoir-dire s’annule, tout simplement, dans le dire – Stendhal l’a bien compris, qui, à la fin d’Armance, se garde bien de livrer le secret d’Octave51...
22
Il n’est pas rare, dans La Comédie humaine, que les secrets, au bout du compte, se dérobent. Parfois, des « oublis » empêchent le narrateur de lever tel ou tel d’entre eux. On ne saura pas la cause de la mort de Mme Willemsens, dans La Grenadière (1833), alors que depuis longtemps on en attendait la révélation, ni les raisons pour lesquelles, dans La Bourse (1832), la mère et la fille portent un nom différent (I, 419). Simples négligences ? On pourrait le penser si ces lacunes ne prenaient pas, ailleurs, plus d’étendue : dans Une ténébreuse affaire (1843), les informations livrées dans l’épilogue laissent dans l’ombre bien des aspects de l’histoire. Le narrateur est-il bien en possession de tous les secrets qu’il se targue de pouvoir mettre au jour ? Dans La Peau de chagrin (1831), c’est sur le constat de l’impossibilité qu’il y a à percer le secret de Foedora que s’achève la seconde partie. Et j’ai évoqué, ailleurs52, ces « murs » qui, à la fin de certaines histoires, se dressent devant les personnages investigateurs, leur interdisant (et au lecteur avec eux) l’accès aux savoirs qu’ils recherchent : « mur » véritable obstruant l’entrée du cabinet de Mme de Merret – lui-même entouré de murs – dans La Grande Bretèche (1832 ; placé à la fin de Autre étude de femme, en 1845) : Bianchon (il n’est pas indifférent qu’il soit une figure de l’auteur du conte), pour reconstituer l’histoire de la bâtisse mystérieuse, devra collecter des récits et
151
s’appuyer pour finir sur un témoignage confus, que, de son propre aveu, il devra réécrire ; aucune certitude n’est possible ; « Muraille » de peinture, dissimulant à tout jamais, dans Le Chef-d’œuvre inconnu (1831-37), la Catherine Lescault de Frenhofer (œuvre d’un peintre génial ou d’un fou ?). 23
Le plus souvent, le secret est levé, mais le lecteur n’en reste pas moins perplexe – ou, pour reprendre un mot balzacien, « pensif »53. Marie de Verneuil finit par confier le sien à Montauran (Les Chouans, 1829) ; est-elle, après cela, plus explicable aux yeux du lecteur ? Le récit qu’elle fait de sa vie échoue à nous faire comprendre comment la fille (même naturelle) du duc de Verneuil a pu devenir une « fille »54 : la révélation de son secret laisse son énigme entière. Dans Maître Cornélius (1832), on découvre que l’auteur des vols qui se commettent dans la demeure du personnage éponyme n’est autre que lui-même : sujet à des crises de somnambulisme, l’argentier de Louis XI puise, la nuit, dans son propre trésor. Si le secret est percé, c’est pour nous donner accès à un mystère55... car le comportement du somnambule (surtout au début du XIXe siècle), on en conviendra, est pour le moins singulier. C’est sur un mystère, encore (ou une énigme), que débouche la recherche du secret du comte Octave, dans Honorine (1844) ; on apprend, certes, ce qui, en lui, fait fuir sa jeune épouse : sa brutalité amoureuse. Mais celle-ci entre en contradiction avec tout ce que nous savons par ailleurs, du personnage – et ce dernier est, manifestement, incompréhensible à lui-même. Là encore, en nous promettant de nous éclairer, le récit nous mène vers de nouvelles obscurités... Comme il le fait dans Sarrasine (1831) : on est informé, par le prince Chighi, de l’« affreuse vérité » concernant Zambinella (« Est-il jamais monté de femme sur les théâtres de Rome ? »—VI, 1072), mais la passion que le musico inspire au sculpteur n’en devient que plus étrange... Et ce secret qu’on prétend nous dévoiler, a-t-il un nom ? A aucun moment les termes de « castrat », ou de « castration », ne figurent dans le texte de la nouvelle (qui, ostensiblement, recule devant leur emploi). Au moment où il fait irruption dans le salon des Lanty, le petit vieillard mystérieux (Zambinella âgé) nous est présenté comme une « créature sans nom dans le langage humain » (VI, 1051) ; et, deux pages plus loin, comme « un homme en poussière » (VI, 1053). Le personnage du castrat transgresse en effet la frontière qui sépare la vie de la mort, il est la vie hantée par son néant même. L’innommable. Comment dire, de même, ce qui se révèle dans le dernier récit d’Histoire des treize, au moment où de Marsay se retrouve « face à face » avec son sosie féminin, sa sœur inconnue ? En quels termes formuler ce qui, brutalement, se fait jour alors ? Seuls s’expriment, de fait, à cet instant capital, la surprise et l’effroi des deux protagonistes.
24
Sans doute y a-t-il lieu, ici, de revenir, pour la définir plus précisément, sur la notion de secret. Comme nous l’enseigne la belle étude de V. Descombes56, le secret est l’une des catégories de l’interdit, non de l’indicible : les propos que le sujet écarte de son discours pourraient être énoncés (ils ne doivent pas l’être) ; son non-dire n’est aucunement le signe d’une incapacité à dire. On voit, dans ces conditions, que le jeu balzacien avec le secret consiste, souvent, à annoncer comme dicible (« je vais vous dévoiler un secret ») ce qui, pour diverses raisons, échappera au dire. Supercherie, qui se dénonce d’elle-même : le romancier n’est visiblement pas maître des savoirs qu’il promet de délivrer. Et il est clair qu’il est en plein faire-semblant lorsqu’il affirme, dans ce cas, son pouvoir-dire.
25
C’est en mystificateur qu’il apparaît encore lorsqu’il nous laisse supposer qu’il n’y a pas de secret. Le lecteur de la Grande Bretèche peut parfaitement émettre l’hypothèse qu’il n’y a rien derrière les murs de la propriété vendômoise. Les dernières lignes du récit, qui racontent l’édification de la cloison destinée à emprisonner l’amant de Mme de Merret,
152
mentionnent l’apparition fugitive, dans la pièce condamnée, d’« une figure d’homme sombre et brune », de « cheveux noirs », d’ « un regard de feu » (III, 728). Mais c’est dans le cadre d’une relation de séduction que la servante Rosalie a confié à Bianchon son témoignage, qu’il transcrit, sur les événements mystérieux qui ont eu la « Grande Bretèche » pour cadre : elle est dès lors suspecte d’avoir livré au jeune médecin non pas l’histoire, mais l’histoire désirée par lui... 26
Nous sommes tout aussi incertains de l’existence du secret du Chef-d’œuvre inconnu : dans un premier temps, Poussin et Porbus, examinant le portrait de femme que Frenhofer a accepté de leur montrer, ne voient « rien » (X, 435) sur la toile. Le regard de Porbus discerne bientôt quelque chose : le fameux « pied », « fragment échappé [...] à une lente et progressive destruction » (X, 436). C’est un « pied vivant » (ibid.) : Frenhofer a peut-être bien été possesseur du secret de donner la vie aux êtres peints. Quelques lignes plus loin, c’est Poussin qui fait voir le tableau, ruinant l’idée de l’existence d’un secret : « Mais tôt ou tard, il s’apercevra qu’il n’y a rien sur sa toile » (X ; 437). Les versions des années 30 laissent le lecteur, de manière quelque peu fantastique, dans l’hésitation. En 1845, Balzac ajoute au conte sa fameuse dédicace, faite de cinq lignes de points -représentant un texte effacé, ou non écrit. On a souvent vu dans ces lignes de points la réplique, dans l’ordre de l’écriture, de ce qu’est le tableau de Frenhofer, dans l’ordre de la peinture. Ce texte absent ne représente-t-il pas le secret, autour duquel s’est construit le récit lui-même, comme un espace vide ? Si révélation il y a, elle porte sur la nature du secret lui-même, qui en dernière analyse, se définit comme un « simulacre »57 : il est, comme je l’ai suggéré plus haut, le produit d’énoncés performatifs ; et il s’abolit aussitôt que le non-dit qu’il signale trouve à s’énoncer. Le secret comme « contenu » est ainsi impossible à concevoir. Il est, selon la formule du psychanalyste P. Fédida, une « enveloppe vide »58. Or, donner à entendre que le secret est « comparable à un leurre »59, n’est-ce pas faire soupçonner que « le roi est nu »60 ?
27
Mais la communication61 secrète peut se trouver perturbée plus grandement que par cette dérobade du secret – et, à y regarder de près, on s’aperçoit que Balzac la dérègle à une plus large échelle. Rappelons qu’elle met en relation trois actants. Le couple actantiel de base lie le détenteur du savoir tu, réservé, à son destinataire. L’acte constitutif du secret étant un acte de séparation, le destinataire est celui qui est visé par le refus du détenteur : par définition, c’est un non-initié (ce tiers est appelé, par Louis Marin, « tiers excluinclus »62). Il est à distinguer du dépositaire63 : celui à qui le secret est communiqué, l’initié.
28
Or, cet actant fondamental qu’est le détenteur du secret peut s’avérer être, à son tour, une absence. C’est ce qui se produit, par exemple, dans Sarrasine. Le narrateur de la nouvelle est un acteur diégétique reconnaissable, mais qui, cependant, ne possède pas d’identité véritable. Il se place, au début de la nouvelle, au même rang que les « chercheurs de mystère » (VI, 1044) qui s’interrogent sur la famille Lanty. On est donc bien surpris lorsque ce personnage annonce à Mme de Rochefide qu’il peut lui « révéler [le] mystère » (VI, 1056) du petit vieillard qui est apparu brusquement dans le salon. Il ne donnera jamais l’explication de sa connaissance des faits. L’histoire qu’il raconte s’est déroulée bien avant sa naissance, et n’a pu être révélée par aucun des protagonistes. Ancune mention n’est faite d’une chaîne de narrateurs, dont le premier serait un contemporain des événements, témoin ou confident. « Personne », nous dit le narrateur dans le prologue, « ne chercha [...] à découvrir un secret si bien gardé » (VI, 1049) : il s’inclut, de ce fait, dans la catégorie de ceux auxquels la connaissance du secret est refusée. Si l’on sait qui raconte, dans la nouvelle, on ne parvient pas à savoir qui parle 64.
153
Impossible de trouver le maître du jeu. Cette figure devient floue – bien plus, fuyante... C’est dans une situation impossible du même ordre que nous place la fin d’Autre étude de femme : Bianchon, le narrateur de La Grande Bretèche, s’exclut, tout comme celui de Sarrasine, de la connaissance du secret qu’il prétend dévoiler : il annonce d’entrée de jeu, et de manière identique, que le « mot » de l’énigme « n’est connu de personne » (III, 711). 29
Après avoir été confronté aussi formellement à l’inexistence du détenteur du secret, on en vient à douter de sa présence dans des textes où il s’efface plus discrètement. Dans Une ténébreuse affaire, de Marsay fait le récit d’une « histoire » que lui « seul » sai[t] » (VIII, 689), celle d’une nuit où se fomente une conspiration contre Bonaparte – par elle doivent s’expliquer les événements mystérieux qui ont été relatés au fil des pages. Or, il n’a pas été témoin de la scène qu’il raconte65. Celle-ci s’est déroulée à huis clos. Il n’a pu être informé, c’est clair, que par l’un des cinq conspirateurs. Mais cela, jamais le récit ne le dit, insistant au contraire sur les « verrou[s] » (ibid.) qui se poussent pour protéger les conjurés. Tout se passe, de fait, comme si ce secret, conservé jusqu’à la fin, n’avait été transmis par personne...
30
Autre menace planant sur le maître du jeu : il peut se trouver dépossédé de son pouvoir par celui même qu’il cherche à se soumettre : le destinataire. C’est ce qui arrive à Albert Savarus, manipulateur de secrets au début du roman (1842) qui porte son nom (il cherche à reconquérir le cœur de la duchesse d’Argaiolo, grâce à un récit à énigme qui met en scène deux protagonistes ressemblant à ceux du couple à ressouder). Rosalie de Watteville, lectrice imprévue de cette nouvelle, s’éprend de l’écrivain et intercepte les lettres qu’il envoie à la duchesse. Elle contrecarre dès lors par ses propres machinations celles de Savarus, occupant le lieu du secret qu’il occupait jusque-là, créant pour lui des énigmes qui font de lui un tiers exclu. Si cette lectrice indocile et entreprenante oppose victorieusement son pouvoir à celui de l’écrivain représenté (Savarus), il faut noter qu’en outre elle semble capable de rivaliser tout aussi victorieusement avec le narrateur anonyme de l’histoire. Celui-ci ne sait guère dire de qui il tient son savoir : il se réfère à un vague « on »66, à la rumeur. Comment l’histoire des malheurs de Savarus, aux prises avec Mlle de Watteville, s’est-elle propagée dans Besançon ? Un passage en revue des différents personnages susceptibles de l’avoir ébruitée permet conclure que seule Rosalie elle-même est une source vraisemblable du récit67. Cette dernière possède toute l’histoire. Elle possède en outre tous les documents permettant d’attester la véracité de celle-ci. Ces documents, elle les transmet – et elle est seule, dans la diégèse, à transmettre visiblement des renseignements sur ce qui s’est passé. Elle les transmet... à la duchesse d’Argaiolo, excluant ainsi le narrateur des circuits de l’information ! Sujet immaîtrisable de la réception, Rosalie dépossède le maître des secrets de ses prérogatives. Celui-ci, dans Savarus, n’est pas qu’une simple absence, dissimulée par une instance narrative incapable de désigner l’origine de son savoir ; dans ce « traité de la lecture comme vol » 68, il s’avère être dans le camp où on ne l’attendait pas...
31
Le moment du dévoilement, on l’a vu, est un moment critique pour le maître de la communication secrète. Un dernier péril69, en cet instant, le guette. C’est à la manière dont ce dévoilement s’effectue qu’il convient à présent de prêter attention. Il faut soigneusement distinguer la communication du secret, qui préserve celui-ci, en ne faisant que déplacer la limite de la séparation qui le fonde (il est, dans ce cas, « confié », ou « transmis », à des confidents – des dépositaires -qui ne peuvent être que choisis), avec sa révélation70, qui s’adresse au destinataire (le secret est alors « divulgué » ou « trahi », voire
154
« confessé » ou « avoué ») ; la révélation, elle, abolit le secret (et porte atteinte à la puissance de son détenteur). 32
La situation peut paraître simple : la place qui est donnée à désirer au lecteur par le discours du roman est, sans conteste, celle de l’initié, de celui qui a été distingué, jugé digne de la confidence, et de participer du pouvoir de celui qui sait. Celle qui lui est affectée par le jeu de la communication secrète lui-même est celle d’un tiers exclu. On s’attend à ce qu’à la fin du jeu, la barrière se soit déplacée : au terme du parcours initiatique que représente la lecture du roman, le tiers exclu doit être devenu dépositaire. De nouveaux tiers exclus, alors, se profileront : ceux qui n’auront pas lu le livre, n’auront pas eu accès au savoir.
33
Il me semble pourtant qu’une réelle tension existe, dans le récit balzacien, entre les deux visées distinctes impliquées par la révélation d’un secret (à un tiers exclu) et sa communication (à un dépositaire). Ce sont, bel et bien, des révélations de secrets que la diégèse ne cesse de représenter, sous toutes les formes possibles (aveux, confessions, divulgations, trahisons) à l’issue des récits. Les dévoilements auxquels le narrateur procède lui-même (par le biais, notamment, des analepses) sont de même mis en scène comme des divulgations plutôt que comme des confidences (il y a, par exemple, dans le « voici pourquoi » – ou autres formules équivalentes – qui souvent les précède, une manière de théâtraliser la prise de parole, bien peu en accord avec la discrétion qu’exige l’acte de confier). S’il y a intention, de la part du narrateur balzacien, de communiquer des savoirs cachés, force est de constater que la communication, destinée à préserver le secret et à faire des initiés, s’effectue souvent avec toutes les marques de son contraire, la révélation, au cours de laquelle le secret s’annule.
34
En outre, la ligne de partage qui définirait de nouveaux exclus, et permettrait au secret de se reconstituer, n’est pas systématiquement tracée, au moment où celui-ci se livre. Elle l’est dans Z. Marcas (1841), nouvelle dont le cadre d’ensemble est confidentiel : on découvre à la fin le cercle d’auditeurs qui entoure le narrateur, Rabourdin – un « nous » (« Nous nous regardâmes tous tristement en écoutant ce récit »). Ce nous postule un « vous » : le, les narrataires. « Vous » se trouve, par rapport à « nous », dans une relation homologue à celle qui existe entre « nous » et Charles Rabourdin : il y a réduplication de la situation de confidence. Le lecteur, visé à travers le narrataire, est convié à s’agréger à un groupe d’élus. Il se voit assigner la place du dépositaire.
35
Le cas d’Une ténébreuse affaire est, à première vue, semblable : c’est dans le salon de la princesse de Cadignan que de Marsay dévoile les agissements secrets de Fouché. Les dépositaires de la confidence sont, de toute évidence, les membres de l’aristocratie du faubourg Saint-Germain (de Marsay n’attend-il pas, pour mettre au jour les ficelles du drame, le départ de l’ancien sénateur Malin de Gondreville, littéralement chassé des lieux par les autres convives – VIII, 687-688 ?). La ligne d’exclusion se trouve bien nettement tracée : à l’intérieur du cercle, les narrataires intradiégétiques du récit de l’homme politique. Mais de quel côté de la ligne le narrataire extradiégétique se trouve-t-il ? Rien, dans le récit, ne le désigne comme aristocrate, appartenant au même monde que les personnalités rassemblées, dans l’histoire, rue du Faubourg du Roule. Il est difficile, de la sorte, de voir en lui un dépositaire de la confidence de De Marsay. Il fait figure, plutôt, de destinataire exclu. Il est convié, par le narrateur extradiégétique, à une révélation. Ce secret surpris pourrait, naturellement, faire de lui un initié. Mais les limites de ce second cercle d’initiés ne sont pas indiquées. A ce second niveau de communication, la confidentialité du secret n’est en aucune façon notifiée, de sorte qu’aucun obstacle à son
155
ébruitement n’est mis en place. Ce ne sont pas des confidents que vise, de fait, le texte. C’est le monde ouvert des destinataires exclus. 36
Que dire, alors, de ces nombreux romans dans lesquels le récit publie les informations qu’il avait tues sans s’occuper en aucune façon de distinguer son destinataire ? Je mentionnerai ici le récit de la vie de Goriot, fait par M. Muret à Rastignac, et reproduit, par le narrateur, sans sélection d’auditoire (Le Père Goriot, III, p. 123-126).
37
Il n’est pas exclu que cette tension entre deux formes de dévoilement opposées soit un effet du paradoxe qu’il y a, pour le romancier, à se vouloir « roi inconnu » : celui qui vise ce pouvoir occulte vise, dans le même temps, à se faire reconnaître – à apparaître, au-delà d’un petit cercle d’élus. Double exigence, qui se traduit par la mise en œuvre d’une stratégie quelque peu déconcertante.
38
Ainsi, le secret balzacien me paraît tendre, en règle générale, vers son abolition. Il a tout l’air de s’éventer au lieu de se préserver, protégé, dans un groupe qu’il cimente.
39
Comme le montrent les stratégies dont il esquisse la mise en œuvre, et le discours qu’il tient sur ses propres prérogatives, le romancier balzacien revendique donc une place dans le champ du pouvoir71, et conçoit sa pratique littéraire comme analogue à d’autres pratiques de pouvoir – selon les représentations qui sont celles d’un imaginaire de l’époque. Mais ces représentations sont en décalage par rapport aux pratiques réelles : le pouvoir attribué à un romancier entouré de sa société secrète ne pourra être que fiction, une fiction que le roman ne parvient pas, toujours, à accréditer. Il est même probable qu’il ne cherche pas véritablement à le faire : le recours persistant au secret, dans les textes, se présente, de fait, comme un jeu à peu près constant avec un impouvoir plus ou moins clairement avoué. Balzac, qui pose si volontiers au monarque intellectuel, n’est finalement pas si loin que cela des romantiques « mélancoliques » – même si son renoncement ne se manifeste pas d’emblée, s’il n’est évidemment pas total, et s’il prend des formes infiniment plus discrètes que chez un Gautier ou un Musset.
40
Cette reconnaissance ludique de l’impouvoir de l’artiste-roi (de celui qui se rêve « intime avec les causes secrètes ») se fait, néanmoins, démonstration de la puissance du romancier (du producteur de fictions cette fois). J’ai cherché à donner en ces quelques lignes une idée de exploration assidue, par celui-ci, des possibilités qu’offre une forme, de la virtuosité avec laquelle sont construits certains récits, parfaitement lisibles en dépit des situations de communication a priori improbables sur lesquelles ils reposent. La stratégie du secret, qui se présente de prime abord comme un moyen d’agir sur le monde, se mue en moyen d’éprouver les capacités de l’écriture romanesque. N’oublions pas que les années 1830-1840 marquent une étape72 dans le processus d’autonomisation de la littérature...
NOTES 1. Gallimard, 1992.
156
2. Voici longtemps, déjà, Curtius se pencha, dans le premier chapitre de son Balzac (1923), sur le « culte du secret » que l'on observe chez l'écrivain. 3. C'est ce qu'a montré, en particulier, J.-P. Richard (« Balzac, de la force à la forme », Poétique, n ° 1, 1970. 4. Elle devrait donner lieu à un ouvrage (Poétique de l'énigme. Le Récit herméneutique balzacien), tiré d'une thèse soutenue en 1997 à 1 Université de Paris VIII. 5. M. Condé, Genèse sociale de l'individualisme romantique, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 1989, p. 60. 6. ibid., p. 61. La vérité réaliste se distingue donc fondamentalement du « vraisemblable » classique.
7. Les récits « à secret » tendent à se faire plus rares à la fin de la carrière du romancier. J'ai tenté d'expliquer ce phénomène dans ma thèse, mentionnée ci-dessus. 8. secretum est le participe passé de se-cernere ; discrimen est un substantif de la famille de discernere. Cernere : passer au crible, séparer...
9. « La question du secret » écrit V. Descombes, est « la question politique par excellence, puisque le pouvoir est pouvoir de dire » (L'Inconscient malgré lui, Minuit, 1977, p. 29). 10. Les liens entre parole et pouvoir ont souvent été montrés par les ethnologues : la parole a une fonction distributive et régulatrice ; en outre, elle autorise, légitime, accuse (voir J. Jamin, Les Lois du silence. Essai sur la fonction du secret, Maspero, 1977). 11. ibid., p. 60. 12. Je n'entends nullement affirmer que les fonctions du secret se réduisent à celle-là !
13. En signalant, par exemple, et en répétant, souvent, « il y a secret » (exemple : « Son attitude annonçait un secret » – La Grande Bretèche, III, 722). Celui-ci n'est que l'effet d'énoncés performatifs de cet ordre. N.B. : mes références aux textes de Balzac renverront à l'édition en douze tomes, numérotés de I à XII, de La Comédie Humaine dans la Bibliothèque de la Pléiade. 14. J. Jamin, op. cit., p. 28. Le narrateur balzacien se présente comme apte, a priori, à lever les secrets dont il mentionne l'existence. 15. Ibid., p. 13. 16. La princesse de Cadignan, qui s'invente un secret pour séduire d'Arthez et le tenir en son pouvoir, n'agit-elle pas exactement comme le romancier balzacien, dont elle paraît être une représentation (Les Secrets de la princesse de Cadignan, 1840) ?
17. Elle désigne Gaudissart, par exemple, « maître des secrets de Popinot » (L'Illustre Gaudissart), ou encore du Tillet (« Maître du secret de Roguin, du Tillet s'en servit pour établir à la fois son pouvoir sur la femme, sur la maîtresse et sur le mari » (César Birotteau, VI, 87). 18. M. Couëtoux, dans un ouvrage collectif de chercheurs en sciences sociales, distingue deux fonctions du secret : la fonction d'affiliation (un groupe social se distingue de ce qui n'est pas lui), et la fonction de relation (la séparation due à l'effet discriminant du secret est en elle-même une relation au monde) (« La justice et les fonctions sociales du secret », in Figures du secret, Presses Universitaires de Grenoble, 1981, p. 21 et 25).
19. avec Godefroid, l'« Initié » de L'Envers de l'histoire contemporaine, bien sûr ; mais le postulant à l'initiation peut n'être qu'un observateur anonyme dont le récit ne se soucie qu'au détour d'une phrase (« [...] un observateur initié au secret des discordes civiles [...] » Les Chouans, VIII, 907). 20. « [...] elle seule était initiée aux mystères [...] » (Les Chouans, VIII, 970).
157
21. La place de Gobseck dans le monde parisien est celle de Dieu dans l'univers (se reporter au discours qu'il tient à Derville).
22. Ce sont là des associations fantaisistes et il est bien connu, par exemple, que les Dévorants de Ferragus n'ont qu'une lointaine ressemblance avec les Compagnons du Devoir (ou Devoirants) qui leur prêtent leur nom. Balzac ignorait vraisemblablement les secrets du compagnonnage, et ses Treize (voir sur ce point l'introduction à Histoire des Treize de l'édition de la Pléiade, V, 746) sont une sorte d'amalgame des différentes sortes de sociétés secrètes que pouvait offrir son époque. Ils sont la société secrète, et celle-ci est le pouvoir secret. 23. Ferragus (premier récit d'Histoire des Treize) : 1833 ( Revue de Paris) ; L'Envers de l'Histoire contemporaine : 1844/1848 (Balzac meurt en 1850). 24. D.-P. Lobreau, « La société secrète, forme marginale de la sociabilité. L'exemple des bons cousins charbonniers », in Le Secret, textes réunis par Ph. Dujardin, Presses Universitaires de Lyon/ éd. du C.N.R.S., 1987, p. 134. 25. P. A. Lambert, « Les justifications doctrinales et pratiques du secret : des Illuminés de Bavière à la Charbonnerie » ibid., p. 157. 26. Ibid. 27. Ibid.
28. Philippe Buonarotti, par exemple, qui, en 1796 organisa avec Babeuf la Conspiration pour l'Egalité, en créa, entre 1797 et 1837, de nombreuses, dans lesquelles était sensible l'influence maçonnique, ainsi que celle des Illuminés de Bavière (dont l'ordre disparut en 1785-86). Sous la Restauration, la Charbonnerie est, comme on le sait, la plus importante des sociétés secrètes à travers lesquelles s'organise le mouvement libéral. Les groupes occultes sont nombreux encore pendant les premières années de la Monarchie de Juillet. 29. Source : P. -A. Lambert, encore (ibid., p. 166). Dans les sociétés secrètes républicaines, le secret aura pour intérêt essentiel de permettre au groupe de se cacher. 30. Entendons par là, avec F. Furet, « un mode organisé de relations entre les citoyens (ou les sujets), et le pouvoir, aussi bien qu'entre les citoyens (ou les sujets) eux-mêmes à propos du pouvoir » (Penser la Révolution, Gallimard, 1978, p. 58). 31. ibid. 32. Les deux types de « sociabilité politique » coexistent encore, comme l'indique F. Furet, au début de la Révolution (p. 61). 33. Ibid., p. 60. 34. Gobseck, comme l'a montré J. Grange, apparaît comme une figure du romancier en ce qu'il est le « miroir » du monde (Balzac, l'argent, la prose, les anges, p. 186). Vautrin, comme lui (mais la fiction nous le montre plus faillible), est censé avoir du monde une connaissance totale, et donc, sur lui, un pouvoir absolu. 35. Voir, sur ce point, l'article d'A. Vaillant, « Entre personne et personnage. Le dilemme de l'auteur moderne », in Colloque de Cerisy, L'Auteur, Presses Universitaires de Caen, 1996, p. 38-39.
36. Ce sont « les structures nées du développement du commerce et de l'industrie culturelle (les journaux, l'édition de romans, les théâtres de boulevard) » qui viendront se substituer, par défaut, à ces réseaux, « surtout à partir de la Monarchie de Juillet », ibid. p. 39. 37. Vautrin, représentant du romancier dans la fiction, est un « artiste » (III, 136), Gobseck un « poète » (II, 968). L'article de J.-L. Diaz met en évidence la charge sémantique de ces termes : j'y renvoie.
38. « Des artistes », Balzac, Œuvres diverses, t. II, Pléiade, 1996, p. 715. Cet article parut en trois livraisons dans La Silhouette.
158
39. ibid. 40. ibid., p. 713 41. Naissance des « intellectuels », Minuit, 1990, p. 20. Bien entendu, je renvoie aussi, et surtout, aux travaux de P. Bénichou, qui ont montré la constitution, à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe, d'une « corporation intellectuelle », assumant le rôle de guide spirituel de la société, substituant en cela une « autorité laïque » à l'ancienne autorité religieuse (Le Sacre de l'écrivain, Corti, 1973 ; Le Temps des prophètes, Gallimard, 1977). 42. qui n'existe, bien sûr, que depuis l'affaire Dreyfus. 43. Celle des usuriers apparaît déjà dans la première version de Gobseck : Les Dangers de l'inconduite , 1830.
44. Postface à la première édition de La Duchesse de Langeais (Ne touchez vas la hache – V, 1038). Ce texte annonçait le dernier roman de la trilogie (La Fille aux yeux d'or). 45. Texte inspiré à F. Davin par Balzac (I, 1163). Il insiste sur l'importance du principe de « spécialité » (de species, le miroir) dans la définition de l'écrivain. C'est l'un des principes qui définissent, de même, l'Artiste : « Habitué à faire de son âme un miroir où l'univers tout entier vient se réfléchir », celui-ci a, dans ce monde qui fait l'expérience de la « dispersion », la « faculté puissante de voir les deux côtés de la médaille humaine » (« Des artistes », art. cit., p. 713, 709, 713). 46. L'origine de l'énonciation est finalement illocalisable dans cet ensemble de récits – comme elle l'est, très souvent, dans La Comédie humaine. 47. Je me permets de renvoyer, pour une analyse plus détaillée que je n'ai guère la place de mener ici, à l'étude que j'ai consacrée naguère à La Fille aux yeux d'or (« La charade et la chimère », Poétique, n° 89, février 1992). 48. « les liens de la vie secrète » des Treize se sont dissous, annonce la Préface, après « la mort de Napoléon » (V, 187). Cette Préface est datée de 1831... 49. C'est, du moins, le dernier qui soit tout entier écrit de la main de Balzac.
50. Les manifestations en sont celles de l'hystérie. 51. L'impuissance présente au niveau thématique, à en croire la lettre que Beyle écrit à Mérimée, est dès lors combattue au niveau de l'énonciation. 52. « Le mot de l'énigme », in Balzac. Une poétique du roman, S. Vachon éd., Saint-Denis, Presses Universitaires de Vincennes et Montréal, XYZ, 1996. 53. On se souvient de la dernière phrase de Sarrasine, où cette « pensivité » est représentée dans le texte, par celle de Mme de Rochefide : « Et la marquise resta pensive » (VI, 1076).
54. Voir, à ce sujet, l'analyse de F. Schuerewegen, dans « L'Histoire et le secret. A propos des Chouans de Balzac », in Vendée, chouannerie, littérature, actes du colloque d'Angers, 12-15 décembre 1985, Presses de l'Université d'Angers, 1986. 55. C'est ce que montre fort bien l'étude de G. Moyal, « Position de l'énigme et la lecture de Maître Cornélius » in Le Roman de Balzac, études réunies par R. Le Huenen et P. Perron, Montréal, Didier, 1980. 56. op. cit., p. 18 sq. 57. C'est ainsi que l'a défini Louis Marin, « Logiques du secret », Traverses (Centre G. Pompidou) n ° 30/31, mars 1984, p. 64 (« Le secret n'est pas une chose ou un être mis à part, mais l'effet – négatif – d'un jeu de relations et d'interactions », ibid.).
58. « L'exhibition et le secret de l'enveloppe vide », Nouvelle Revue de Psychanalyse, n° 14, p. 280. Le secret « est un œuf », dit pour sa part R. Chambers, analysant une fable de La Fontaine (« Les Femmes et le secret », Fables, VIII, 6) : une forme « palpable » de l'extérieur, une enveloppe, encore une fois, non un contenu (Versants, n° II, hiver 1981).
159
59. H.-P. Jeudy, « Les jeux du dévoilement », Traverses, n° cité, p. 121. 60. La nudité du roi, visible de tous, reste secrète, dans le conte d'Andersen (Les Habits neufs de l'Empereur), jusqu'à ce que l'enfant prononce cette phrase – qui dénonce le simulacre... 61. C'est la fonction de relation du secret que j'examine dans ces quelques exemples. Dans cette perspective, celui-ci instaure un mode de communication (certes paradoxal). Sur ce point, voir plus précisément l'ethnologue A. Zempléni, « Sujet et sujétion », Traverses, n° cité, p. 102 sq. 62. art. cit., p. 64. 63. J'adopte ici la terminologie proposée par A. Zempléni, art. cit., p. 104-105. 64. Souvent illocalisable, comme je l'ai dit à propos d'Histoire des Treize, l'origine de l'énonciation est fréquemment aussi un pur mystère dans les récits de la Comédie humaine. 65. En témoigne l'emploi, dans son discours, de certains modalisateurs : « De quoi s'agit-il ? [...] – De la république, a certainement dit Fouché. – Du pouvoir, a probablement dit Sieyès » (VIII, 689). 66. « dit-on », I, 998 ; « disait-on », I, 1020 ; « on ne sait pas encore », ibid. 67. Une étude de F. Schuerewegen a fort justement montré que Rosalie « cosign[ait] » le texte (« Ce que savait Rosalie », Balzac contre Balzac, SÉDES/Paratexte, ch. VII, p. 130). 68. ibid., p. 139. 69. C'est, du moins, le dernier de ceux que j'ai recensés ! 70. Cette distinction est faite par A. Zempléni, toujours (art. cit.). 71. Le champ littéraire, au moment où Balzac entreprend d'écrire ce qui sera La Comédie humaine, n'est pas séparé, encore, du champ politique (voir P. Bourdieu, Les Règles de l'art, Seuil, 1992). 72. J. Dubois l'a montré naguère (L'Institution de la littérature, Nathan, 1978, p. 43). Cette autonomie, on le sait bien, n'est acquise qu'à l'époque de Flaubert (voir encore P. Bourdieu, sur ce point).
160
Ultima verba : pouvoir du condamné et du proscrit David Charles
1
Poser, dans l'œuvre de Hugo, la question du pouvoir du sujet de l'énonciation aboutit nécessairement à une confrontation entre Châtiments et Le Dernier Jour d'un condamné 1. D'un côté, sous « un titre qui brûl[e] »2, le poème d'un proscrit qui proscrit un empereur ; de l'autre, un « livre qui rend malade », un roman qui tue son lecteur3. Pouvoir de l'écrivain exorbitant dans les deux cas. Leur lecture conjointe est en revanche une entreprise parfaitement raisonnable, qui enregistre la communauté de leur isolement dans l'histoire littéraire (les deux textes n'ont pas d'équivalents : il faudrait au moins que La Modification tutoie son lecteur et que Le Coup d'État permanent ne soit pas le programme d'un candidat), et compare l'absolument incomparable, qui ne peut se comparer qu'avec lui-même. Les positions du proscrit et du condamné ne sont effectivement assimilables à aucune autre, sinon entre elles puisque l'absolu ne se mesure pas au relatif.
2
Cela n'empêche pourtant pas qu'à première lecture, tout semble opposer les deux textes particulièrement les sujets de leur énonciation.
3
Ici, un sujet auquel le monde survivra (« il tombait une pluie [...] qui durera plus que moi »4) ; un sujet réifié (« je serai quelque chose d'immonde qui traînera sur la table froide des amphithéâtres »5), pris dans une tautologie sans espoir (« les témoins ont bien témoigné, les plaideurs ont bien plaidé, les juges ont bien jugé »6) ; sous le coup d'une parole performative, la lecture d'un verdict, qui le tue plus tôt et plus sûrement que l'exécution de la peine (« Jusqu'à l'arrêt de mort, je m'étais senti respirer, palpiter, vivre dans le même milieu que les autres hommes ; maintenant je distinguais clairement comme une clôture entre le monde et moi. »7) ; dont on parle « comme d'une chose »8, chose du châtiment que la société tout entière lui fait subir, de la marchande de fleurs au juge et du bourgeois au misérable ; qui cherche dans l'écriture, non à adopter un quelconque point de vue éthique - une préface tardive s'en chargera -, mais seulement à se prouver qu'il est encore parmi les vivants (« ce moi que je touche et que je sens, et dont le vêtement fait les plis que voilà »9) et à conserver la qualité de sujet qu'Autrui - le médecin, le gendarme, l'architecte, le prêtre, le bourreau, jusqu'à sa propre fille - lui refuse à chaque fois qu'il lui en demande la reconnaissance ; dont le discours se
161
condamne à un inventaire de sensations corporelles (« il me semble qu'il y a un liquide qui flotte dans mon cerveau, et qui fait battre ma cervelle contre les parois du crâne » 10) ; un texte enfin, resté isolé dans l'œuvre de Hugo, maintenu hors des séries (celles de La Légende des siècles) et des trilogies romanesques (celle de l'anankè), si économe de ses moyens stylistiques et si peu confiant en son destin qu'il se conçoit, au pire, dans l'informe, comme des « morceaux de papiers » promis à la boue des préaux, au mieux dans des formes, « procès-verbal » ou « autopsie », dont l'objectivité dément le projet initial11. 4
Là, un sujet si absolu que, débarrassé du moi historique et personnel dont les déterminations le relativiseraient autant qu'elles légitiment son discours, sans le secours de l'Autre pour se penser lui-même (« Dans la chute d'autrui je ne veux pas descendre »), il pense pouvoir survivre à tout comme le seul et dernier sujet parmi les « viveurs » (« Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là ») ; le sujet d'un châtiment qu'il prononce et exerce dans le même temps — sa parole est performative, c'est « la parole qui tue » — seul entre tous (« Je juge, ce que n'ont pas fait les juges »), puisque le peuple lui-même a acquitté le criminel et que d'autres proscrits « s'en vont qui devraient demeurer ; un intarissable déluge verbal — il y a une Suite de Châtiments, il n'y en a pas au Dernier Jour — qui emprunte à tous les genres, dialogue, fable, chanson, épopée, pour renvoyer le pouvoir à sa tautologie (« Les sauveurs se sauveront ») ; une œuvre, enfin, qui relève d'un ensemble concerté : Histoire d'un crime témoigne, c'est la table froide de l'histoire, le procès-verbal, l'autopsie ; Napoléon le Petit juge ; Châtiments condamne, c'est l'égout où l'autopsie déverse ses rebuts, « chiens crevés » et « césars pourris »12.
5
Les deux textes partagent néanmoins de nombreux discours. Au premier chef le discours produit sur la peine de mort elle-même, examinée (et rejetée) à propos d'un quidam dont on ignore le nom et le crime parce que le plaidoyer doit être « aussi vaste que la cause » 13 (il manque au roman le chapitre intitulé « Mon histoire ») ; ou à propos d'un empereur, dont le nom et le crime, qui s'illégitiment l'un l'autre, sont sanctionnés par plébiscite, et font d'autre part l'objet d'une histoire, fût-ce pour être finalement congédiés de l'Histoire elle-même comme de la Légende - « Déposition d'un témoin » dans Histoire d'un crime, « Biographie » de l'accusé dans Napoléon le Petit.
6
D'autre part, le condamné et le poète entretiennent un rapport commun au monde. Rapport réglé par le spectacle, dont ils sont tous deux et tour à tour acteurs et spectateurs. Acteurs, parce que « des curieux » regardent le condamné « comme une bête de la Ménagerie » et que l'on regarde dans l'exil « comme dans une fosse aux bêtes » 14. Spectateurs, parce que l'un et l'autre décrivent le réel comme une « fantasmagorie ». « Fantasmagorie des juges, des témoins, des avocats, des procureurs du roi, [...], tantôt grotesque, tantôt sanglante, toujours sombre et fatale » ; « fantasmagorie » du ferrement des forçats auquel le condamné assiste « comme à un "spectacle » en « trois actes », depuis une cellule qui ressemble à une « loge » de théâtre15 ; fantasmagorie de l'Empire reconverti en cirque Beauharnais, elle aussi grotesque (« On loge à la nuit »), et sanglante (« Souvenir de la nuit du 4 »), mais jamais fatale (Lux succède à Nox). Spectacle de la ruine du peuple en foule, constatée par le condamné au moment même de la proclamation du verdict (« - Condamné à mort ! dit la foule ; et tandis qu'on m'emmenait, tout ce peuple se rua sur mes pas avec le fracas d'un édifice qui se démolit. ») bien avant l'exécution (« Cette foule où tous me connaissent et où je ne connais personne »16) ; dénoncée par le proscrit dans l'absence de réaction au coup d'État et dans le plébiscite. La condamnation
162
de Louis Napoléon Bonaparte ne serait qu'une occasion de plus de réunir la foule du plébiscite, du sacre et des grands spectacles de l'Empire. 7
Chacun songe donc au roi et à l'empereur comme à son Autre auquel le lient pour le premier la grâce, qui ne vient pas, pour le second l'amnistie, qu'il ne veut pas. Il est singulier que je pense sans cesse au roi. J'ai beau faire, beau secouer la tête, j'ai une voix dans l'oreille qui me dit toujours : — Il y a dans cette même ville, à cette même heure, et pas bien loin d'ici, dans un autre palais, un homme qui a aussi des gardes à toutes ses portes, un homme unique comme toi dans le peuple, avec cette différence qu'il est aussi haut que tu es bas. En face de l'empereur se dresse le proscrit. L'empereur damne, le proscrit condamne.17
8
Hugo lui-même autorise une lecture conjointe des deux textes — il l'effectue deux mois seulement après la publication de Châtiments, en prenant comme proscrit, dans un texte intitulé « Aux habitants de Guernesey », la défense de John-Charles Tapner, condamné à mort pour le meurtre d'une femme. On cherche, et on trouve, dans « Ce que c'est que l'exil » — la préface à l'édition des Actes et Paroles pendant l'exil —, l'explication de texte de Châtiments, et la légitimation des figures du sujet poétique distribuées dans le recueil. Mais c'est une explication tardive (1875) et qui délaisse Le Dernier Jour d'un condamné. L'homme qui est dans l'exil tend la main à l'homme qui est dans le sépulcre. Laissez [...] le proscrit intercéder pour le condamné. [...] Je me mêle des choses du malheur ; c'est mon droit, puisque je souffre. L'infortuné a pitié de la misère, la douleur se penche sur le désespoir. Dailleurs, cet homme et moi, n'avons-nous pas des souffrances qui se ressemblent ? ne tendons-nous pas chacun les bras à ce qui nous échappe ? moi banni, lui condamné, ne nous tournons-nous pas chacun vers notre lumière, lui vers la vie, moi vers la patrie ?18
9
Les trois chiasmes successifs qui échangent les positions respectives du proscrit et du condamné : « cet homme » / « moi », « moi » / « lui », « lui » / « moi » disent aussi l'interchangeabilité des positions du « je » de Châtiments et du « je » du Dernier Jour d'un condamné. Ce texte désindividualise « Victor Hugo », nommé d'abord - dans le chapeau du texte - en tant qu'il « intervient » alors qu'« une condamnation à mort est prononcée dans les îles de la Manche », et, conjointement, « John-Charles Tapner », rappelé au troisième paragraphe comme le meurtrier de « Mme Saujon », « le mardi 18 octobre 1853, à Guernesey »19 : [...] cet assassin n'est plus un assassin, cet incendiaire n'est plus un incendiaire, ce voleur n'est plus un voleur ; c'est un être frémissant qui va mourir. [...] ce qui vous parle en cet instant, ce n'est pas moi, qui ne suis que l'atome emporté n'importe dans quelle nuit par le souffle de l'adversité ; ce qui s'adresse à vous aujourd'hui, c'est [...] la civilisation tout entière, c'est elle qui tend vers vous ses mains vénérables.20
10
Cette association réunit deux instances que Le Dernier Jour d'un condamné et Châtiments séparent, et manifeste la similarité de leur construction progressive. Le texte abstrait le condamné de son nom et de son crime, qui ne seront pas plus désignés par la suite qu'ils ne le sont dans le roman ; il dépossède le proscrit de son propre discours.
11
C'est là, après l'effacement du sujet historique et personnel qui déjà parle comme le Christ (« je vous le dis »), puis sa désincarnation dans la fonction de Proscrit (« L'homme qui est dans l'exil »), la dernière étape de la construction du sujet poétique de Châtiments (« ce qui vous parle en cet instant, ce n'est pas moi »). Il devient une voix, une bouche par laquelle parle Dieu (dernier mot de la préface de Châtiments, dernier mot de ce texte, cette
163
fois-ci pas même suivi des initiales « V. H. »), ou la Vérité - ici, « la civilisation » 21. Le roman fait évoluer son narrateur de la même façon, sauf qu'il part en quelque sorte de moins loin parce qu'en 1829 la biographie du « Victor Hugo référentiel », exploitée dans quelques chapitres, est moins connue et moins longue qu'en 1853 et que le roman paraît d'abord sans nom d'auteur : c'est d'abord « un condamné » qui fait son autopsie ; c'est ensuite « une intelligence qui avait compté sur la vie », « une âme qui ne s'est point disposée pour la mort » ; c'est finalement « la pensée agonisante » qui rédige son « procès verbal »22 : « je pense que je ne penserai plus ce soir »23. 12
Le texte adressé « A Lord Palmerston », après l'exécution de Tapner, aboutit d'ailleurs à cette formule dont la réversibilité légitime notre lecture : Exsul sicut mortuus. Je vous parle de dedans le tombeau.24
13
Aussi sûrement que le condamné du Dernier jour est un proscrit, le proscrit est un mort qui parle et dit ses « Ultima verba ». Mais des deux tombeaux, celui du condamné et celui du proscrit, un seul « ne s'ouvre pas en dedans.25 » La porte de l'exil ne s'ouvre pas du dehors : Hugo refuse l'amnistie.
14
Vient ensuite, mais plus tard et rétrospectivement, « Ce que c'est que l'exil » : la toutepuissance du sujet fondée sur l'impuissance de l'individu « accablé, ruiné, spolié, expatrié, bafoué, insulté, renié, calomnié », « traqué, trahi, hué, aboyé, mordu », « gisant », « jeté aux ténèbres », « balayé dehors ». « La plus inexpugnable des positions résulte du plus profond des écroulements »26. Le condamné et le proscrit sont en effet déjà « dehors » « hors la loi, hors la raison, hors le respect, hors la vraisemblance » pour le proscrit 27, hors du salon et de sa « comédie » pour le condamné - et on ne saurait donc les déloger. Deux exils aussi complets l'un que l'autre, et divers dans leurs formes : Tout est prison autour de moi ; je retrouve la prison sous toutes les formes, sous la forme humaine comme sous la forme de grille ou de verrou. Ce mur, c'est de la prison en pierre ; cette porte, c'est de la prison en bois ; ces guichetiers, c'est de la prison en chair et en os. Le proscripteur est curieux et son regard se multiplie sur vous. Il vous fait des visites ingénieuses et variées. Un respectable pasteur protestant s'assied à votre foyer, ce protestantisme émarge à la caisse Tronsin-Dumersan ; un prince étranger qui baragouine se présente, c'est Vidocq qui vient vous voir ; [...] un professeur gravement doctrinaire s'introduit chez vous, vous le surprenez lisant vos papiers. 28
15
L'anticipation de la mort du condamné, exécuté comme sujet par le verdict bien avant de l'être comme individu par la guillotine, redoublée par la supercherie qui lui permet de raconter ses pensées jusqu'au pied de l'échafaud (il a demandé à la dernière minute qu'on le laisse écrire ses dernières volontés, si bien qu'il peut écrire son dernier chapitre au retour de la guillotine), a sur l'énonciation du roman le même effet que l'exil sur l'énonciation du recueil. « Être mort, c'est être tout-puissant [...]. »29. A l'inverse, « que peut » Napoléon III ? « Tout. Qu'a-t-il fait ? Rien. »30 Le pouvoir de Châtiments tient tout entier dans la performativité de la parole poétique proférée d'outre-tombe. Dans le roman, faire et dire d'abord ne coïncident pas : « Est-ce que je puis avoir quelque chose à dire, moi qui n'ai plus rien à faire dans ce monde ? » Et l'utilité du texte, quand elle n'est pas déniée (« pourquoi ? à quoi bon ? qu'importe ? ») ou compromise par le destin matériel de ce qui est écrit, est caractérisée négativement (« ce que j'écrirai ainsi ne sera peut-être pas inutile ») — toujours différée : Peut-être cette lecture leur [ceux qui condamnent] rendra-t-elle la main moins légère, quand il s'agira quelque autre fois [...]
164
Ces feuilles les détromperont. Publiées peut-être un jour, elles arrêteront quelques moments leur esprit sur les souffrances d'un esprit [...]. 16
Surtout, elle est constatée rétrospectivement : » Un jour viendra, et peut-être ces mémoires [...] y auront-ils contribué... »31 Mais l'identification immédiate du lecteur au condamné comble ce hiatus et rapproche le discours du régime performatif de Châtiments. Les deux textes disent ce qu'ils font et font ce qu'ils disent.
17
Dans les deux cas, c'est finalement de la littérature elle-même, et de l'exercice de son pouvoir, qu'il est question. La distinction entre l'individu et le sujet, ou la personne et le personnage, qui est à son principe même, est ignorée par la proscription - confusion qui n'a d'autre effet que de grandir le sujet de toute l'humiliation subie par l'individu32. Aucun autre livre de Hugo n'aura été aussi efficace que ces deux-là.
NOTES 1. Tout a été dit des sujets respectifs de l'énonciation des deux textes, par J.-M. Gleize et G. Rosa dans « Celui-là. Politique du sujet poétique : les Châtiments de Hugo », Littérature, n° 24, décembre 1976, et G. Rosa dans son édition du roman au Livre de Poche (1989) — mais ces travaux n'ont jamais été rapprochés. Toutes nos citations de Hugo sont, sauf indication renvoyant à l'édition J. Seebacher et G. Rosa des Œuvres complètes (Laffont, « Bouquins », 1985-1990), prises à cet article et à cette édition du roman, où l'on trouve aussi les textes relatifs à l'affaire Tapner. 2. Art. cité, p. 85, n. 7. 3. « Comédie à propos d'une tragédie », p. 29. 4. XXII, p. 107. 5. XXVI, p. 121. 6. XV, p. 96. 7. II, p. 68. 8. V, p. 72. 9. XXVI, p. 123. 10. XXXVIII, p. 138. 11. Voir VI, p. 73-74. 12. Voir art. cité, p. 84-90. 13. Préface de 1832, p. 15. 14. Le Dernier Jour d'un condamné, XIII, p. 91 ; « Ce que c'est que l'exil », IV, Œuvres complètes, tome « Politique », p. 400. 15. Voir II, p. 63, XIII, p. 84-90 et XIV, p. 94. 16. II, p. 68, et XLVIII, p. 158. 17. Le Dernier Jour d'un condamné, XL, p. 140 (Bicêtre a « un air de château de roi », IV, p. 70) ; « Ce que c'est que l'exil », XIII, p. 414. 18. L'affaire Tapner, p. 206 et 216. 19. lb.,p. 205. 20. lb., p. 216-218. 21. Voir art. cité, p. 84 et 88. 22. Voir VI, p. 73-74. 23. XXII, p. 110.
165
24. L'affaire Tapner, p. 232. 25. Le Dernier Jour d'un condamné, XII, p. 83. 26. Voir II, p. 398, V, p. 402, VI, p. 403, et XIII, p. 414. 27. lb., IV, p. 399. 28. Le Dernier Jour d'un condamné, XX, p. 102 ; « Ce que c'est que l'exil », IV, p. 399. 29. Art. cité, p. 92. 30. Napoléon le Petit, II, 10, Œuvres complètes, tome « Histoire », p. 35-37. 31. Pour ces dernières citations, voir VI, p. 72-74, et VII, p. 75. 32. Voir art. cité, p. 92-93 — les émissions littéraires télévisées s'emploient avec succès à réaliser l'opération inverse.
166
Écriture et fantasme du pouvoir chez Barbey d'Aurevilly : la violence et l'harmonie Pascale Auraix-Jonchière
1
Écrivain légitimiste reprenant à son compte la plupart des thèses maistriennes, Barbey d'Aurevilly participe a priori du courant de pensée contre-révolutionnaire, défini par Paul Bénichou comme « une sociologie fondée sur les volontés supposées de Dieu et sur la tradition qui les manifeste »1 avec pour fondement un pouvoir fort et théocentrique. Telle est bien l'idée défendue dans Les Prophètes du Passé (1851), qu'il présente, dans la préface de la seconde édition, comme un « livre polémique, écrit aux jours des plus tristes combats de ce siècle »2, idée qui s'enracine dans une conviction profonde et continûment réaffirmée. Les opinions de l'auteur sur « les philosophies qui dominent le monde et sur les partis révolutionnaires qui l'agitent, sont restées fermes en lui. Elles n'ont pas bougé », précise-t-il, mettant ainsi en place un principe d'immutabilité que l'on retrouve à chaque étape de sa pensée. Or, l'écrivain se positionne très nettement en faveur d'une Autorité selon lui idéale en son essence : « [...] il ne peut y avoir que deux thèses en présence, - la thèse de l'Autorité (qui implique Dieu) avec toutes ses conséquences, et la thèse de la Liberté (qui implique l'homme sans Dieu) avec toutes les siennes » 3. « Or il n'y a pas à discuter », explique Barbey au début de l'ouvrage, « Dieu une seconde écarté, le chaos reprend la tête humaine »4 ; il est donc le seul garant véritable de l'ordre, d'un pouvoir stable et harmonieux, tandis que la Liberté fauteuse de troubles conduit paradoxalement au « nihilisme » mortifère qui caractérise le XIXe siècle. En outre, on l'aura compris, toute pensée intermédiaire est proscrite : « le Juste-Milieu, comme mot et comme chose, ne s'est-il pas irrémédiablement perdu dans un vaste mépris ? »5.
2
Cette apologie de l'Autorité a pour corollaire une réflexion sur la philosophie, frappée d'inanité car conçue comme une forme de dissidence par rapport au principe divin : « Arrivé à un certain moment de son effort, à un certain point de sa théorie, l'homme s'achoppe et se brise ; et par là, il est démontré qu'entre son intelligence et la Vérité, s'ouvre éternellement un abîme »6. Barbey reprend donc à son compte la critique contrerévolutionnaire qui, au début du siècle, condamne l'Homme de Lettres, jugé responsable
167
de la Révolution7, et donc détenteur d'un pouvoir subversif ; mais il en élargit considérablement la portée. Pour lui il s'agit d'une hérésie, d'une pensée anthropocentrique perverse qui dénature la vie sociale en fissurant sa cohésion première, alliance de la « Science » et du « Pouvoir », du « Sacerdoce » et des « Gouvernements » 8, exemplairement illustrée par le Moyen Age. Dans cette optique, seule la poésie, pensée intuitive et naturelle, peut remédier semble-t-il aux désordres du temps, en replongeant l'individu dans un passé originaire, à reconstruire par le verbe. Tel est bien le credo de Barbey d'Aurevilly, qu'il expose à l'orée de son roman L'Ensorcelée : à la société d'une époque « grossièrement matérialiste et utilitaire » d'où toute spiritualité et, partant, toute unité sont absentes, s'oppose cette « poésie [sacrée] primitive et sauvage, [...] poésie de l'âme »9 seule susceptible de restaurer l'harmonie perdue. Le « sacre de l'écrivain », pour reprendre l'expression de Paul Bénichou, est donc ici consubstantiel à l'idée de pouvoir, dans la mesure où cette « poésie de l'âme », fille de l'imagination, pourrait seule en permettre la restauration. Banni de l'Histoire, le pouvoir serait ainsi l'apanage de l'écrivain poète aux prises avec ses fantasmes.
De la néantisation à la célébration du pouvoir dans l'Histoire 3
Les Memoranda comme la Correspondance reflètent de part en part la lecture aurevillienne de l'Histoire contemporaine, lecture doloriste qui ne trouve pour s'exprimer que les arpèges mélancoliques de la complainte.
4
Deux idées forces se dégagent de l'ensemble : la viduité et le chaos. L'Histoire du XIXe siècle en effet est d'abord absence, comparable à ces blancs qui interrompent volontiers le flux de l'écriture diariste, et que Barbey assimile à un gouffre. Car seuls des substituts grimaçants du pouvoir s'offrent à l'écrivain en ces temps où la monarchie se dégrade alors même qu'elle prétend se restaurer. La Restauration, de fait, est image fantomale et déliquescente d'un pouvoir exténué, ce que traduisent en écho les lettres et la fiction. Le récit rétrospectif sur lequel s'ouvre « Le Dessous de cartes d'une partie de whist » en propose un aperçu éloquent : [...] on était dans une de ces périodes tranquilles, en 182.... Le libéralisme, qui croissait à l'ombre de la Charte constitutionnelle comme les chiens de la lice grandissaient dans leur chenil d'emprunt, n'avait pas encore étouffé un royalisme que le passage des Princes, revenant de l'exil, avait remué dans tous les cœurs jusqu'à l'enthousiasme. Cette époque, quoi qu'on ait dit, fut un moment superbe pour la France, convalescente monarchique à qui le couperet des révolutions avait tranché les mamelles, mais qui, pleine d'espérance, croyait pouvoir vivre ainsi, et ne sentait pas dans ses veines les germes mystérieux du cancer qui l'avait déjà déchirée, et qui, plus tard, devra la tuer10.
5
L'immixtion de la mort dans la vie est assurément l'une des images les plus fréquentes qu'utilise Barbey pour dénoncer un abâtardissement du pouvoir, pouvoir tempéré donc dégradé. Selon Paul Bénichou, l'idéologie contre-révolutionnaire, pour être viable, doit faire preuve de souplesse et d'adaptabilité : « Aux réflexes de la contre-révolution devaient [...] s'allier des pensées d'un autre ordre. [...] il est naturel que [aristocratie et bourgeoisie ayant désormais des intérêts communs], tout en argumentant contre la subversion on accueillît des valeurs modernes, et le principe même de mutabilité et de progrès propre à la nouvelle société »11. Bien au contraire, pour Barbey, aucun compromis n'est envisageable, le pouvoir étant par définition tout-puissant et inaltérable, quitte à
168
s'imposer par la force. Dans ces conditions, la Monarchie constitutionnelle correspond à un degré supérieur de corruption, puisque le pouvoir s'y voit définitivement altéré. Elle ne peut que générer déception, ennui, dégoût. Le 29 septembre 1836, il déplore le « rien », la « misérable politique expectante » qui caractérisent le gouvernement juste-milieu12, et il explique à son ami Trebutien, dans une lettre datée du mois de mars 1848 : « Mon ami, les êtres foudroyés restent debout. On croit qu'ils vivent. On les touche du doigt, ils disparaissent. C'est l'histoire de la monarchie constitutionnelle qui nous a paru vivre dixhuit ans. Ma era moría »13. « La monarchie de 1830 a péri comme la monarchie de 1815 », reprend Barbey en 1851, « parce que ni l'une ni l'autre n'était, en fin de compte, la monarchie. Toutes les deux sont mortes de leurs constitutions »14. Mort-né ou mortvivant, tel est donc le pouvoir du siècle, qui n'existe plus qu'à l'état d'idéal ou d'illusion : les familles nobles du « Dessous de cartes » avaient vu le moment où le droit d'aînesse, relevé par le seul homme d'état qu'ait eu la Restauration15, allait rétablir la société française sur la seule base de sa grandeur et de sa force ; puis, tout à coup, cette idée, doublement juste de justesse et de justice, qui avait brillé au regard de ces hommes, dupes sublimes de leur dévouement monarchique, comme un dédommagement à leurs souffrances et à leur ruine, [...] périr sous le coup d'une opinion publique qu'on n'avait su ni éclairer ni discipliner16. 6
Pas de pouvoir sans hiérarchie, l'absence d'ordre parfait faisant surgir le spectre de l'anarchie, conçue comme chaos et fin du monde. À l'ordre enfui s'est en effet substitué le désordre, celui de la Liberté, c'est-à-dire de l'homme sans Dieu. L'attitude de Barbey face à la révolution de février 1848 est tout à fait instructive à cet égard. Si dans un premier temps, les événements reçoivent sa sympathie, dans la mesure où ils mettent un terme à une agonie grotesque et insupportable - celle du gouvernement de Louis-Philippe -, il y décèle rapidement les symptômes d'un désordre forcément destructeur : « Ne sommesnous pas condamnés à tâtonner, et les tâtonnements dans une société plus libre qu'organisée, ne seront-ils pas des déchirements ? »17. Finalement, il choisit, contre la liberté, « dont nous commençons à avoir trop », le « côté de l'ordre »18. C'est que ce libéralisme, suspect à ses yeux de socialisme, se donne implicitement comme l'héritage d'un cartésianisme et d'un luthérianisme conjugués, double manifestation selon lui du choix funeste de la suprématie de l'homme sur Dieu, finalement érigée en principe politique et social. Les sociétés de 1848 d'abord, de 1870 ensuite, sont envisagées à travers le filtre de mythes sataniques ou apocalyptiques en raison de leur idolâtrie coupable pour « le Moi, qui ne veut ni de l'Autorité ni du Châtiment, ces deux Non-Moi terribles, ni de tout ce qui s'oppose, sous une forme ou sous une autre, au développement de son Moi sacré »19. C'est la raison pour laquelle on note l'image particulièrement récurrente de Babel pour désigner le « pouvoir à refaire »20, un pouvoir forcément délétère puisque vecteur de dispersion. L'idée est également présente dans Les Prophètes du passé : la spécificité de l'époque est « ce besoin de se jeter en avant, parce qu'on est mal à sa place ; cette rêverie colossale et confuse comme Babel, d'un monde nouveau qui va éclore sur un type inconnu aux siècles passés »21. Le pouvoir est rétablissement d'un ordre disparu ; il suppose le respect de « quatre mots sublimes : Crois, Renonce, Respecte, Obéis ! » 22 ; le choix de l'homme contre Dieu condamne quant à lui au morcellement : l'« Hérésie, la Bête aux mille langues »23, est source de confusion, c'est pourquoi les gouvernements mis en place, symptomatiquement, « ne gouverne[nt] pas »24.
7
En revanche, Barbey célèbre comme irruption salvatrice du pouvoir le coup d'État du deux décembre 1851, qu'il interprète comme un retour providentiel de l'Harmonie :
169
Mon cher Trebutien, je suis, vous le savez, un légitimiste, mais un légitimiste catholique qui croit deux choses que tous les légitimistes n'admettent pas. Primo : qu'il y a des races qui tombent justement frappées par les péchés des ancêtres ; secundo : que là où le droit n'est pas, là où il ne vit plus que comme une abstraction, les pieds sur son drapeau plié, inactif, impuissant, impossible, la Force est le droit du moment et doit être considérée comme telle. Toute force qui sauve les Nations de l'anarchie est un fait de l'Ordre divin. Celle-ci nous sauvera-t-elle ? Dieu le sait seul. Mais c'est déjà beaucoup qu'elle ait voulu nous sauver 25. 8
Il n'hésite pas à justifier « les détails » contestés du coup d'État au nom de la Providence. « Voilà donc le premier pouvoir décidé que les hommes de ma génération aient vu ! », ajoute-t-il. « Le monde oubliait trop que la volonté est tout et non l'esprit ; que vouloir est toute la force humaine ». Si le pouvoir idéal est indissolublement lié à la notion cardinale d'ordre, il l'est tout autant à celles de volonté et d'autorité. Barbey pousse le raisonnement jusqu'au paradoxe : « L'autorité défaite par les légitimes doit peut-être dans les vues de Dieu, être refaite par les pouvoirs illégitimes. [...] Toute autorité refaite est un service rendu au Droit divin ». Pour lui comme pour Joseph de Maistre, il y a conjonction de la volonté individuelle et de la Providence tant que l'homme n'a pas fait acte de sécession26. Le législateur, qui promulgue des lois écrites, « ne peut se faire obéir, ni par la force, ni par le raisonnement », ajoute Maistre : « Pour être Prométhée, il faut monter au ciel »27. Autrement dit, l'être volitif détenteur d'un droit divin agit en corrélation avec la Providence. Cette harmonie supérieure, que revendique aussi Barbey, peut donc pour s'instaurer faire violence, le droit divin l'emportant toujours sur le droit commun.
9
Seule occurrence d'une célébration du pouvoir dans l'Histoire, l'avènement de Napoléon III est significativement l'occasion d'un rapprochement entre action et écriture. « Pendant que nous causions Romans, le président Bonaparte écrivait, avec la baïonnette et le canon, une page d'histoire ». L'antinomie entre action héroïque et écriture n'est en effet qu'apparente. Bonaparte écrit l'Histoire en la saisissant. Or on constate, dans les écrits autobiographiques, mais aussi dans les fictions, que Barbey investit les mêmes fonctions et s'évertue à mettre en place une souveraineté de l'écriture.
La souveraineté de l'écriture 10
Norbert Dodille, en étudiant les stratégies de l'écriture dans les textes autobiographiques 28 , propose un commentaire particulièrement suggestif de la lettre consacrée au coup d'État du deux décembre. L'adhésion politique de Barbey, justifiée par sa philosophie de l'Histoire, serait également imputable à un phénomène d'identification tout à fait exemplaire. « Napoléon réalise en effet le programme narratif de l'ambitieux » dont Barbey fixe les composantes dans ses échanges épistolaires avec Trebutien. « Napoléon opère immédiatement la conjonction du vouloir et du pouvoir que la biographie barbeyenne ne cesse de différer. À ce lieu du texte, le coup d'État figure comme la narration d'une biographie [...] spéculaire »29. Il y a donc correspondance et interrelation des deux figures : si Napoléon est écrivain dans l'Histoire, c'est que Barbey s'institue héros dans l'écriture, héros bien sûr volitif et tout-puissant.
11
La souveraineté de l'écrivain s'édifie en premier lieu de façon indirecte par le biais d'une assimilation à des figures d'emprunt, centrées, pour la plupart, autour de la notion de pouvoir. Par comparaison ou identification, Barbey se représente « à partir d'un faisceau de repères culturels »30 dont la sérialisation, effectuée toujours par Norbert Dodille, permet de dégager un certain nombre de rôles récurrents parmi lesquels apparaissent
170
« les héros de l'action et de l'ambition »31, dont la liste excède de loin celle de tous les autres types de modèles. Dans le deuxième Memorandum, en août 1838, Barbey note : « Pensé à Bonaparte, à la gloire, au néant de ma vie »32 et de nouveau, en septembre de la même année, « Heureux Abd-el-Kader, qui à mon âge est homme de guerre déjà renommé et ne s'ennuie pas comme moi ! »33. Mais si dans un premier temps, le héros vaut comme contrepoint et dévalorise le statut d'écrivain, il devient bientôt son semblable et, de figure impuissante et ennuyée, le promeut au statut de figure active, détentrice d'une nouvelle forme de pouvoir, comme l'atteste une lettre en date de décembre 1849 (jeudi) : « Et puisque dans ce monde à l'envers, ce monde politique où il n'y a pas encore d'action efficace possible, il ne peut saisir un rôle d'agir comme il le voudrait, il serait bien aise de se recommander aux esprits qui lui ressemblent par des œuvres plus sérieuses que des conversations après le café ou des billets doux »34. Le phénomène de glissement et de substitution d'une forme de pouvoir à une autre est patent et en révèle la dimension très nettement - et parfois dangereusement - fantasmatique chez Barbey. Il devient indifféremment Napoléon, César, Metternich, Cromwell, ou Abd-el-Kader, en même temps qu'il fait de son écriture une force préhensive, à laquelle le lecteur se soumet nécessairement, transfert compensatoire du schéma politique déficient dont l'écrivain ne cesse de rêver. 12
Là encore, c'est Norbert Dodille qui a mis en évidence le premier la prégnance indiscutable de l'image du crochetage employée par Barbey pour désigner l'écriture. Il parle d'« une esthétique du croc », d'histoires qui « accrochent »35, en s'appuyant sur une kyrielle d'exemples empruntés aux romans et à la correspondance, qui se répondent inlassablement pour souligner l'importance de ce « métalangage ». Je ne reprendrai donc qu'un seul de ces exemples, particulièrement représentatif de la démarche aurevillienne ; dans une lettre adressée à Trebutien le 31 décembre 1849, il se met en scène comme sujet écrivant, c'est-à-dire désormais sujet dominant : « On [...] reconnaîtra [dans ce volume] la main du Normand, cette main crochue qui prend et qui garde, cette main de la force, moitié serre d'aigle, moitié pince de crabe, qui devrait étreindre une poignée d'épée et n'a qu'une plume, mais dans laquelle il coule la vertu de l'acier »36. Non seulement s'y décline le paradigme de la force et du pouvoir - du pouvoir par la force -, mais l'écriture s'y donne comme un ersatz de la force physique, elle-même indissociable, dans le système de pensée de Barbey, de l'affirmation d'une autorité efficace, et de plus, on a bien l'impression que ce transfert est consécutif à la révolution de février 1848, tournant décisif puisque s'y instaure, nous l'avons vu, un non-pouvoir37.
13
Bien sûr, l'espace de la fiction est tout indiqué pour servir de chambre d'écho à cette structure fantasmatique. Le dispositif narratif met en relief l'assujétion d'un auditoire à un conteur tout-puissant, double reconnu de l'écrivain. La force singulière du « causeur » tient en effet à son « audace »38, comme à son « extraordinaire éloquence », conçue comme une forme de « puissance » superlative qui lui confère un ascendant déterminant sur son entourage. Il n'est que de rappeler le tableau que brosse le narrateur de Mesnilgrand en orateur dans la nouvelle « À un dîner d'athées » : Il fallait le voir, à la moindre discussion, sa poitrine de volcan soulevée, passant du pâle à un pâle plus profond, le front labouré de houles de rides, - comme la mer dans 1 ouragan de sa colère, - les pupilles jaillissant de leur cornée, comme pour frapper ceux à qui il parlait, - deux balles flamboyantes ! Il fallait le voir haletant, palpitant, l'haleine courte, [...] l'ironie faisant trembler l'écume sur ses lèvres, longtemps vibrantes après qu'il avait parlé [...]39.
171
14
L'intervention des porte-voix de l'auteur dans les nouvelles se fait toujours sur le mode de l'excès et prend l'allure d'un coup de force. Ce sont « rugissements de mauvais ton, pour lesquels ne sont faits ni les salons, ni les âmes qui les habitent ». Le narrateur aurevillien s'érige contre la loi, celle de la conversation, qu'il brise par ses intrusions violentes, mais tout aussi bien contre l'anarchie débridée de ses corréligionaires, « espèces de belluaires et de gladiateurs »40, lorsque leurs « conversations à bâtons rompus et à vitres et à verres cassés » font feu de tout bois, introduisant dans la parole ce désordre forcené dont Barbey redoute plus que tout l'émergence. Autrement dit le conteur, en imposant sa parole, impose son ordre, image de l'écrivain reproduisant dans le domaine de l'écriture ce qui représente pour lui la configuration idéale de l'Autorité politique.
15
Or cette écriture saisissante, au sens premier du terme, se focalise à son tour sur un schéma diégétique récurrent, qui pose en son centre la présence d'un personnage en figure rêvée du pouvoir.
Fiction, mythologie et fantasmatique du pouvoir 16
Il n'est évidemment pas fortuit que le protagoniste, pourtant toujours situé dans un contexte historique dégradé où, précisément, la notion même de pouvoir est dévoyée, soit comparé à quelqu'un de ces « grands hommes » qui recueillent tous les suffrages de Barbey. Le vicomte de Brassard en est un exemple frappant, lui qui se distingue « par une bravoure à la Murat, compliquée de Marmont »41, et dont l'apparence physique évoque à la fois François 1er et l'empereur Nicolas42, « le héros parmi les rois alors que l'Europe odieusement s'embourgeoisait »43, tandis que Mesnilgrand fait songer « au fameux Charles le Téméraire, duc de Bourgogne »44. Barbey réaffirme ainsi sa conviction que seule importe la force, que « les nations [...] n'existent que par leurs chefs » 45. Dès lors, le système de comparaisons développé dans les récits vaut comme conjuration du réel. C'est pourquoi s'opère à l'intérieur de ce système un glissement significatif des figures de l'Histoire aux figures de la mythologie.
17
On connaît l'essor extraordinaire des mythes de la révolte au cours du XIXe siècle : Prométhée ou Caïn deviennent figures de proue d'un imaginaire que l'on pourrait qualifier d'idéologique. Pierre Albouy notamment a bien montré comment le Titan hugolien est force insurrectionnelle au service du droit : « Chez lui, le Titan figure le peuple et en représente la révolte, mais cette révolte va contre les rois, jamais contre Dieu - l'allié suprême du peuple et du Titan »46. Prométhée serait même, par la grâce d'une palengénésie propre aux enfants du siècle, « symbole de la lutte contre la tyrannie, [...] prophète de la Démocratie »47, chez Michelet, par exemple. En ce sens, sa réhabilitation s'inscrit dans un courant général qui revalorise la révolte titanique, désormais comprise « comme rejet d'une éthique de soumission et de foi aveugle au nom d'une exigence de liberté et de responsabilité »48. Il va de soi que le Titan aurevillien est chargé d'un tout autre message.
18
Barbey, qui récuse la société contemporaine parce qu'elle « ne voit que l'avenir, [...] ne parle que d'avenir, [...] invente tous les matins l'avenir qu'elle refait tous les soirs » 49, attitude selon lui négative car source d'instabilité, rêve d'une immutabilité de principe, garante d'ordre : il croit, avec ceux qu'il appelle « Prophètes du passé », « que les principes régulateurs des sociétés ne changent pas plus que la couleur du sang dans les
172
veines »50. Dans cette optique, la mythologie dont il se réclame prend une coloration rétrograde. Le Titan en effet est incarnation fictionnelle de l'être volitif, mais dans le sens où il serait susceptible de rétablir un pouvoir dégradé ; et s'il s'oppose à l'usurpateur, sans doute faut-il attribuer à ce terme une signification nouvelle : ce serait le non-pouvoir, sous toutes ses formes, qu'il faudrait combattre. C'est pourquoi le Titan aurevillien est voué à l'écrasement. Le narrateur, à l'ouverture du roman Une histoire sans nom (1882), se dit réduit « à l'état de Titan écrasé »51. Or, cette remarque s'inscrit dans le contexte d'une description à valeur politique : les montagnes qui l'oppressent et justifient la comparaison sont équivalent géographique d'une mutation historique, celle-là même qui entraîne l'abolition du pouvoir monarchique autoritaire dont se réclame Barbey. L'ombre accablante des montagnes de Bourg-Argental est mise en relation avec « une autre ombre qui ajoutait à celle-là et qui l'épaississait », celle de la Révolution française 52. Le personnage de Menilgrand annonçait déjà cette configuration. Autre incarnation de Prométhée - « Il n'était pas homme à se laisser manger le cœur par le vautour, sans essayer d'écraser le bec du vautour »53 -, il est resté quant à lui « pris comme un Titan sous la montagne renversée de l'Empire »54. Car après l'Empire, toute velléité de pouvoir paraît dérisoire : « les idées démocratiques sur lesquelles les Impérialistes s'appuyèrent sous la Restauration, pour mieux conspirer, lui répugnaient d'instinct »55. 19
Pétrifié, le Titan ne s'efforce pas moins de restaurer une forme de pouvoir absolu, mais qui a alors pour effet d'introduire dans le raisonnement de Barbey une insurmontable contradiction. Caïn et Prométhée surgissent dans l'œuvre à la faveur de la fissure occasionnée par la Révolution de 1789 ou de ses suites directes : si Menilgrand est enfant de l'Empire, Sombreval ressort du « cratère qui [a] vomi la Révolution française »56 en Satyre révolté et l'abbé de la Croix-Jugan dans L'Ensorcelée devient figure caïnique après et à cause de la Révolution57. Cette mutation du personnage, désormais investi d'une dimension mythique, est donc imputable au séisme historique qui, aux yeux de Barbey, renverse l'ordre en désordre et pervertit toute forme de pouvoir légitime. Or, le rêve de restauration par la force de ce pouvoir se confond avec une rébellion sacrilège qui porte atteinte à la définition aurevillienne du pouvoir, fondée sur la notion d'obéissance à Dieu et d'accord de la volonté de l'homme et des voies de la Providence. Il est remarquable en effet que Barbey s'oppose sur ce point à Joseph de Maistre, qui choisit de faire de Prométhée une préfiguration du Christ58. La description de Sombreval en satyre est l'illustration de ce renversement : « son œil et ses sourcils dignes d'un Jupiter Olympien [...] disaient, en traits de flamme, que le Satyre, dans sa peau de bête, avait l'intelligence d'un Dieu »59. Le portrait affirme la collusion de deux figures normalement antinomiques, celle du Titan et celle de Jupiter. De la sorte, le volitif aurevillien se substitue à Dieu et rejette la notion même de Providence, contre laquelle il s'insurge. On constate d'ailleurs que, paradoxalement, ces incarnations d'un rêve d'ordre absolu s'avèrent bien plutôt vecteurs de désordre et de dispersion, dénonçant l'impuissance et la perversion du fantasme, mais peut-être aussi une confusion minant de l'intérieur l'édifice idéologique aurevillien. En effet, il est clair que Prométhée est figure du poète, comme le suggère le personnage de Mesnilgrand : réduit au néant de sa condition, il « se précipita dans la peinture ». « Il travailla..., poursuit le narrateur, avec la furie de la fuite devant l'ennemi » et « passa sa vie piqué devant un chevalet, sabrant la toile de son pinceau »60. Le rapport ici établi entre Mesnilgrand en peintre et Barbey en écrivain poète, rêveur d'Histoire, est donc suffisamment évident pour qu'opère un dernier rapprochement, celui de l'auteur et des révoltés de la mythologie. Mesnilgrand « sabre la toile de son pinceau » comme Barbey « crochète » l'attention de son lecteur en maniant sa plume à la façon d'un sabre,
173
comme Napoléon « écrit, avec la baïonnette, [...] une page d'histoire ». L'écrivain serait donc bien ce nouveau Prométhée, figure de l'excès allant jusqu'à renverser ses propres convictions dans une ivresse de la révolte conçue comme antidote à un monde d'où s'est absenté tout référent historique acceptable. 20
La fantasmatique du pouvoir telle qu'elle se manifeste chez Barbey d'Aurevilly suppose une collusion de la révolte et de la poésie, toujours sous-tendue par la dialectique de l'ordre et du désordre. Par l'imagination, l'écrivain s'efforce de « corporiser la rêverie », c'est-à-dire de redonner forme à un monde originel qu'a évacué l'Histoire et de l'imposer à ses lecteurs. Mais il le fait avec une violence telle -compensatoire et mimétique de l'impossible - qu'elle a finalement pour effet de rompre l'équilibre fragile et difficilement concevable posé par son idéologie extrémiste entre la force et l'harmonie. La théorie du pouvoir de Barbey d'Aurevilly en vient donc à se fissurer en raison même de l'intensité des rêveries qu'elle inspire et sur lesquelles elle semble bien, depuis toujours, reposer.
NOTES 1. P. Bénichou, Le Sacre de l'écrivain, Paris, Corti, 1973, p. 115. 2. Barbey d'Aurevilly, Les Prophètes du passé, Paris-Bruxelles, Société générale de Librairie catholique, 1880, p. 1. 3. Ibid., p. 35. 4. Ibid., p. 11. 5. Ibid., p. 35. 6. Ibid.,p. 8. 7. Voir à ce propos P. Bénichou, op. cit., chap. IV / 1, « Décri de l'homme de Lettres », p. 116. 8. Les Prophètes du passé, op. cit., p. 16. 9. Barbey d'Aurevilly, L'Ensorcelée, Œuvres romanesques complètes, Paris, Gallimard, bibliothèque de la Pléiade, 1964, t. I, p. 555-556. 10. Barbey d'Aurevilly, Les Diaboliques, op. cit., 1966, t. II, p. 137. 11. P. Bénichou, op. cit., p. 151. 12. Barbey d'Aurevilly, Premier Memorandum, op. cit., t. II, p. 756. 13. Correspondance générale, Paris, Les Belles-Lettres, 1982, t. II, p. 115. 14. Les Prophètes au passé, op. cit., p. 79. Il se place toujours dans le sillage de Maistre qui, dit-il, « avait pressenti ces ruines ». 15. Villèle, en 1826. 16. Les Diaboliques, op. cit., p. 165-166. 17. Correspondance générale, op. cit., p. 115. 18. Ibid.,p. 116, [24 mars 1848]. 19. Les Prophètes du passé, op. cit., p. 34. 20. Correspondance générale, op. cit., p. 114 : « Nous voilà donc en face d'une Société à refaire, d un pouvoir à refaire, d'une Tour de Babel à élever ». 21. Les Prophètes du passe, op. cit., p. 55. 22. Ibid., p. 38. 23. Ibid., p. 16.
174
24. Correspondance générale, op. cit., p. 116. 25. Ibid., 1983, t. III, p. 119. 26. « Ce qu'il y a de plus admirable dans l'ordre universel des choses, c'est l'action des êtres libres sous la main divine. Librement esclaves, ils opèrent tout à la fois volontairement et nécessairement ». J. de Maistre, Considérations sur la France, cité par P. Glaudes dans Joseph de Maistre et les figures de l'Histoire, Cahier romantique n° 2, Clermont-Fd., 1997, diffusion : Librairie Nizet, p. 26. 27. Ibid., cité p. 54. 28. N. Dodille, Le Texte autobiographique de Barbey d'Aurevilly, Genève, Droz, 1987. Pour cette partie, nous sommes grandement redevable à cette étude. 29. Ibid., p. 208. 30. Ibid, p. 181 31. Ibid., p. 183. 32. Deuxième Memorandum, Œuvres romanesques complètes, op. cit., t. II, p. 941. 33. Ibid., p. 958. 34. Correspondance générale, op. cit., t. II, p. 137. 35. N. Dodille, op. cit., p. 255. 36. Correspondance générale, op. cit., t. II, p. 141. 37. N. Dodille confirme que « le rôle d'écrivain » en figure du pouvoir « n'est vraiment posé [...] qu'en décembre 1849 ». Op. cit., p. 196. 38. Les Diaboliques, « Le Dessous de cartes d'une partie de whist », op. cit., p. 131. 39. Ibid., « A un dîner d'athées », p. 184. 40. Ibid., p. 195. 41. Ibid., « Le Rideau cramoisi », p. 12. 42. Ibid., p. 17. 43. Les Œuvres et les Hommes, Mémoires historiques et littéraires, cité par P. J. Yarrow, La Pensée politique et religieuse de Barbey d'Aurevilly, Genève, Droz, 1961, p. 143. 44. Ibid., « Le Dessous de cartes d'une partie de whist », p. 180. 45. Cité par P. J. Yarrow, op. cit., p. 141. 46. P. Albouy, La Création mythologique chez Victor Hugo, Paris, Corti, 1985, p. 209. 47. Ibid., p. 220. 48. Cette thèse est redevable à V. Cerny, Essai sur le titanisme dans la poésie romantique occidentale entre 1815 et 1850, Prague, éd. Orbis, 1935, reprise par R. Trousson dans l'article « Prométhée » du Dictionnaire des mythes littéraires, sous la direction de P. Brunei, Monaco, éd. du Rocher, 1988, p. 1150. 49. B. d'Aurevilly, Les Prophètes du passé, op. cit., p. 46. 50. Ibid.,p. 57. 51. B. d'Aurevilly, Une histoire sans nom, op. cit., t. II, p. 268. 52. Ibid., p. 326-327. 53. B. d'Aurevilly, « À un dîner d'athées », op. cit., p. 181. 54. Ibid., p. 187. 55. Ibid., p. 182. 56. B. d'Aurevilly, Un prêtre marié, op. cit., t. I, p. 890. 57. « [...] cette Révolution, fille de Satan, avait renversé toutes les têtes, et elle doit porter le poids de bien des iniquités. L'abbé de la Croix-Jugan [...] aurait-il jamais quitté son monastère sans la persécution de l'Église ? » (L'Ensorcelée, t. I, p. 627). C'est alors qu'il combat aux côtés des chouans et se transforme, après sa tentative de suicide, en un double de Caïn, marqué comme lui d'un signe, et révolté impénitent. 58. Voir à ce propos J. de Maistre, Soirées de saint-Pétersbourg, IX e entretien. 59. B. d'Aurevilly, Un prêtre marié, op. cit., t. I, p. 889-890.
175
60. « À un dîner d'athées », op. cit.
176
Rhétorique et pouvoir au miroir du récit Corinne Saminadayar-Perrin
Confrontations 1
Exercer un véritable pouvoir spirituel doué d'une authentique puissance d'action sur le réel : ainsi se définit, chez maints auteurs du XIXe siècle, la haute mission de l'Écrivain face à toutes les formes d'autorité politique et temporelle qui gèrent le présent. La parole littéraire, visionnaire ou du moins éclairée, tirerait donc son pouvoir de la transcendance qui la fonde et l'appelle à infléchir concrètement le devenir historique. Une telle affirmation repose sur une impavide bonne conscience rhétorique, que le traumatisme de 1848 fissure irrémédiablement : le discours littéraire justifierait son autorité par son origine éminente, indépendamment de la forme qu'il revêt ; or la parole, si elle se veut puissance pragmatique, ne peut guère asseoir son efficacité que sur une éloquence consacrée, et par là même suspecte d'être contaminée par la rhétorique du pouvoir.
2
Ce paradoxe constitutif s'impose irrésistiblement lorsque l'écrivain cherche à représenter, sous une forme narrative, l'affrontement entre l'autorité politique et le pouvoir « autre », apanage de la parole littéraire. Il s'agit alors de mettre en scène un imaginaire des pouvoirs : face au pouvoir en place et à son discours, s'imposerait la puissance d'une parole réfractaire, projection diégétique du rôle de l'Écrivain dans la société. Reste qu'une telle structure narrative fait inévitablement surgir une question fondamentale : si la parole inspirée prétend incarner le seul pouvoir grandiose du Verbe, comment peut-elle, dans le texte, marquer efficacement cette essentielle différence qui fonde sa valeur ? Si, pour les Mages romantiques, la plume est un sceptre, la littérature peut-elle éviter d'emprunter ses armes à la rhétorique du Pouvoir, et de recourir aux mêmes techniques d'assujettissement par le discours ?
3
Cette tension aporétique s'affirme avec évidence dans la période 1871-1877 — période politiquement trouble, où l'art oratoire que Quinet qualifie de « réactionnaire » (le mot y remplace la chose) maçonne une fausse République réduite à une pure (impure ?) forme
177
rhétorique2. Temps de l'imposture du discours, conçu comme ruse du pouvoir ; temps aussi où la parole de l'opposition ne peut passer que par la littérature — puisque la presse reste, comme sous le Second Empire, soumise à la censure que dénonce Julien Lemer dans sa préface aux Enfants du peuple (1879), recueil d'articles de Vallès dont la publication, symptomatiquement, était prévue en 1869. Temps enfin où l'écrivain se voit sommé de prendre position face à une situation politique instable, ouverte, mal résolue, qui instaure une rupture douteuse3 après le long silence imposé par Napoléon le Petit et le choc — l'autre traumatisme — de la Commune. Malaise rhétorique, entredeux, exigence pragmatique confrontée à l'essentielle suspicion caractéristique de la modernité : voilà ce que donne à lire, dans cette période, la représentation du pouvoir.
Sémiotique du pouvoir 4
Mettre en récit l'imaginaire du pouvoir : tel est précisément le projet de Zola dans Son Excellence Eugène Rougon, ambition proclamée dès l'ébauche : « Étudier l'ambition dans un homme. L'amour du pouvoir pour le pouvoir lui-même, pour la domination.4 » Précisons d'emblée la visée immédiate, pragmatique, du romancier ; il s'agit de représenter non pas une réalité du pouvoir spécifique au Second Empire, mais bien le fonctionnement général de toute autorité politique — c'est pourquoi, d'ailleurs, Zola s'appuie sur sa connaissance directe des mécanismes de la vie parlementaire en 1871-75, dont la routine voire les acteurs ont peu changé d'un régime à l'autre.
5
La littérature dessine alors l'espace de vérité où se révèlent le fonctionnement terroriste et la vacuité essentielle d'une rhétorique d'autorité. Car le pouvoir politique est avant tout délayage oratoire d'un seul principe, comme en témoigne une scène exemplaire : « Au Ministère de l'Intérieur, Rougon était dans son cabinet, très occupé à rédiger une circulaire confidentielle que les préfets devaient recevoir le lendemain. Il s'arrêtait, soufflait, écrasait la plume sur le papier. / "Jules, donnez-moi donc un synonyme à autorité, dit-il. C'est bête, cette langue !... je mets autorité à toutes les lignes. / — Mais pouvoir, gouvernement, empire", répondit le jeune homme en souriant » (p. 216). Passer de l'écrasement brutal aux sourires de la rhétorique : la politique est affaire de langage, dont l'efficacité repose non sur la signification mais sur l'effet ; c'est pourquoi, dans Son Excellence Eugène Rougon, l'action proprement dite se disloque et se dissout en interminables entretiens, en situations de parole qui constituent (au sens propre) l'exercice du pouvoir.
6
Cette rhétorique spécifique repose sur un fonctionnement verbal particulier : l'impact du discours se trouve déplacé du contenu proprement dit à la mise en scène qui en assure l'efficacité. Zola s'intéresse ainsi à « l'ensemble des manifestations par lesquelles le pouvoir entend signifier son existence et sa prééminence, se donner pour un fait et un bienfait de nature »5 ; l'éloquence du pouvoir est affaire non de persuasion mais de dispositifs, de places, de positions respectives — ce que comprennent fort bien les bourgeois d'Arcis chez Balzac ; ceux-ci préparent une réunion électorale non en peaufinant un discours programmatique, mais en transformant l'espace de la conversation mondaine (le salon) en espace de la parole d'autorité : « [Mme Marion] ordonna de disposer les chaises sur quatre rangs de profondeur, entre chacun desquels elle fit laisser un passage d'environ trois pieds. Chaque rangée présenta bientôt un front de dix chaises d'espèces diverses. Une ligne de chaises s'étendit le long des fenêtres et de la porte vitrée. A l'autre bout du salon, en face des quarante chaises, Mme Marion plaça
178
trois fauteuils derrière la table à thé qui fut recouverte d'un tapis vert, sur lequel elle mit une sonnette » (Le Député d'Arcis, p. 7166). Cette organisation spatiale favorise une mise en scène de la parole qui tient de la comédie et de la cérémonie — peut-être la meilleure définition du politique : « Pigoult s'élança vers la table à thé, s'y tint debout, les doigts légèrement appuyés sur le bord, et fit preuve d'audace, en parlant sans gêne, à peu près comme parle l'illustre M. Thiers » (p. 734). 7
Si audivisses bestiam mugientem... La valeur éminente accordée à Vactio dans la rhétorique classique se pervertit en pure fascination pour le spectacle oratoire que donne le Pouvoir. « [Clorinde] racontait qu'elle aurait adoré jouer la comédie. [...] "Monsieur Rougon, voulez-vous que je vous fasse, lorsque vous parlez à la Chambre ?" Elle se gonfla, se rengorgea, en soufflant, en lançant les poings en avant » (Son Excellence Eugène Rougon, p. 66)7. À la limite, on peut même ne rien dire ; face aux mugissements de Rougon, son collègue Delestang a pour principale éloquence le silence : « Delestang hocha la tête, ne trouvant rien à dire. Il avait une tête magnifique. [...] Son crâne nu agrandissait démesurément son front. Sa face rosée, un peu carrée, sans un poil de barbe, rappelait ces faces correctes et pensives que les peintres d'imagination aiment à prêter aux grands hommes politiques » (p. 34). Dans Le Député d'Arcis, l'orateur le plus minable de l'assemblée, président de séance dévolu aux formules consacrées et creuses, s'appelle justement... Beauvisage !
8
S'imposer par (et non malgré) le cynisme du non-sens : tel est le fonctionnement ordinaire de la rhétorique du Pouvoir, que Zola met en scène par la stratégie éprouvée de la disjonction révélatrice. Alors que tout le récit n'est que tissu d'intrigues où triomphent la corruption et le népotisme, Eugène Rougon n'hésite pas à tenir à la jolie Mme Bouchard, venue le séduire, un discours éminemment moral : « Ce fut un sermon en forme, avec de très belles paroles [...] Sans la vertu, un gouvernement lui semblait impossible. Et il termina en mettant ses adversaires au défi de trouver dans son administration un seul acte de népotisme, une seule faveur due à l'intrigue » (p. 231). L'usage du style indirect libre, qui enfile impavidement (et en accéléré) les clichés les plus éculés, tout en soulignant lourdement le plan très convenu de la tirade, accentue la dimension farcesque de la situation — d'autant plus burlesque que l'angélique Rougon, qui exige que les romanciers plongent dans le remords les femmes adultères (p. 245), n'hésite pas à se jeter sur la belle Clorinde immédiatement après son édifiante leçon de morale !
9
Inconcevable naïveté donc que de lire le discours du pouvoir comme acte de langage : il s'agit plutôt de l'accompagnement sonore (musical) d'un dispositif terroriste fondé sur les rituels, la dimension cérémonielle, bref l'impérialité du signe. C'est pourquoi la meilleure performance oratoire se réalise souvent dans un au-delà de la parole, en un système qui fonde son autorité non sur le pouvoir idéologique de l'objet représenté, mais sur le mode même de la représentation ; ainsi, le baptême du Prince Impérial offre au public fasciné un « vieux tableau, pareil à ceux du Louvre, cuit par l'âge, empourpré et doré » (p. 102), et Napoléon III fait d'une chasse à courre dans ses domaines « un sujet de tableau ancien, une chasse sous Louis XV, ressuscitée dans l'air blond » (p. 179). L'essentiel n'est pas l'éloquence, mais l'appareil idéologique et institutionnel qui l'enchâsse : le Second Empire inscrit dans le réel une sémiotique du pouvoir qui le légitime et le sanctifie ; rien ne sert de répliquer au discours qui accompagne ces mises en scène, puisqu'il a valeur au mieux de faire-valoir — le plus souvent d'écran. Le pouvoir
179
relève d'un système sémiotique dont l'efficacité s'appuie sur une combinatoire, et non sur un quelconque rapport au réel ou à la vérité.
Dissections, disjonctions 10
Représenter le discours du pouvoir revient à dévoiler par la mise en récit son fonctionnement perverti et médusant : mais comment inscrire dans la fiction la puissance que revendique la littérature face à ce détournement des pouvoirs du Verbe ? Force est de constater que la diégèse d'un roman comme Son Excellence Eugène Rougon ne propose guère d'alternative : ni écrivain engagé, ni journaliste combattant pour se dresser face au discours terroriste des institutions politiques. Il est vrai que l'argument réaliste justifie ce silence. La grande éloquence des rhéteurs de 1848 est définitivement morte, comme en témoigne la nouvelle organisation de l'espace parlementaire (si l'on peut dire) : « Le nouveau Corps législatif n'aurait pas de tribune (donc pas de discours, pas d'éloquence,pas de critique, pas d'appel aux grands principes), on y parlerait de sa place, en termes de technique, comme dans un conseil d'administration8 ». La presse est dûment muselée, voire décapitée : « Il faudrait leur couper le cou à tous ! », tempête Rougon, qui significativement refuse l'entrée de son cabinet, cercle du pouvoir, au directeur de journal qu'il a convoqué. L'entrevue qui finit par avoir lieu ne donne d'ailleurs pas une haute idée de la liberté de parole des journalistes. Faute de pouvoir ne fût-ce qu'achever une phrase (Si Son Excellence daignait m'expliquer, je ne comprends pas bien pourquoi... Je jure à Son Excellence... Je suis désespéré que Son Excellence ait pu supposer un instant..., p. 244), le directeur se coupe lui-même non la tête, mais la langue, et s'anéantit en tant que locuteur en adoptant une attitude purement psittaciste : « Alors, [il] cria avec Rougon ». Quant aux romanciers, le pouvoir impérial les condamne sans appel au silence, pour leur immoralité et leur « style lubrique » (p. 114) qui s'ajoute à un penchant coupable pour « les théories subversives, les monstruosité antisociales », lesquelles tantôt forment la matière de romans à thèse, tantôt sont diffusées par les ouvrages de vulgarisation comme Les Veillées du Bonhomme Jacques (p. 284-285).
11
Le discours explicite du roman dénonce donc clairement l'hostilité efficace qu'exercent les êtres de pouvoir contre le Verbe littéraire. Au premier degré, on pourrait voir là l'indice d'une incompatibilité radicale entre le Pouvoir comme dispositif terroriste et la littérature : Rougon se fait ainsi un principe de ne lire jamais de romans (p. 284), et Clorinde, son double et sa rivale, partage son aversion quasiment physique : « Elle tenait, d'ailleurs, les livres en horreur. Dès qu'elle s'entêtait à lire, elle devait se mettre au lit, avec des crises de nerfs. Elle ne comprenait pas ce qu'elle lisait » (p. 114). Significativement, Zola marque dans l'espace même de l'action politique l'incongruité de la littérature ; à l'écart de la parade rhétorique du Corps législatif, la bibliothèque présente la solitude muette d'une nécropole : « La bibliothèque était vide. Les livres dormaient dans leurs casiers de chêne ; toutes nues, les deux grandes tables étalaient la sévérité de leurs tapis verts ; aux bras des fauteuils, rangés en bon ordre, les pupitres mécaniques se repliaient, gris d'une légère poussière. [...] M. La Rouquette dit tout haut, en faisant claquer la porte : "Il n'y a jamais personne, là-dedans !" » (p. 356).
12
Mais cette opposition apparemment irréductible, et somme toute rassurante (la littérature, victime des abus du pouvoir, garderait son innocence), n'est guère que l'écran verbal qui voile, et révèle, une affinité beaucoup plus inquiétante qui fait du pouvoir une sorte d'envers de la littérature, et du roman une interrogation sur les pouvoirs de la
180
fiction9. On connaît la célèbre formule de Paul Alexis, qui affirme que Rougon fut pour Zola « le rêve de ce qu'il eût été s'il eût appliqué son ambition à la politique »10 ; et de fait, le méticuleux Rougon avec ses dossiers comme l'imaginative Clorinde, reine de l'intrigue, figurent dans le roman les deux faces complémentaires du romancier naturaliste. Si, en matière politique, le Pouvoir est d'abord maîtrise symbolique, puissance sémiotique, alors il est naturel (mais perturbant) qu'y réussissent avant tout les "professionnels de la fiction" — si Rougon ou Clorinde ne lisent pas de romans, c'est sans doute parce qu'ils en font, l'Histoire elle-même n'étant que la fiction qui peut revendiquer l'appui du Pouvoir. 13
La littérature comme le régime politique de la Parole participent ainsi des mêmes pouvoirs de la fiction — ce qui explique pourquoi, au-delà des impératifs du réalisme, le contrediscours de l'écrivain relève de l'irreprésentable. A ce malaise premier s'ajoute une interrogation sur le rapport du discours au sens : si la rhétorique du pouvoir tire son efficacité de la désertion de la vérité qu'elle suppose, si elle n'est efficace que par la vacuité du sens, alors le Poète ne peut rien lui objecter. C'est ce qu'explique le DocteurNoir à Stello : « Hélas, dit Stello, à quelle odieuse et continuelle résistance le Pouvoir condamne le Poète ! Ce Pouvoir ne peut-il pas se ranger lui-même à la vérité ? / — Il ne le peut, vous dis-je ! [...] Et nos trois exemples politiques ne prouvent point que le Pouvoir ait tort d'agir ainsi, mais seulement que son essence est contraire à la vôtre et qu'il ne peut faire autrement que de chercher à détruire ce qui le gêne. »11
14
Il est révélateur que les trois exempla sur lesquels s'appuie la démonstration confirment cette fatale aphasie. Ainsi, l'événement révolutionnaire se définit essentiellement comme performance rhétorique : la Parole est en elle-même Pouvoir (« [Robespierre] avait frappé d'un discours puissant ses ennemis de la Convention », p. 776), et les convulsions thermidoriennes se cristallisent en affrontements verbaux : « La Dispute foudroyante hurla encore tout le jour dans le Palais qu'elle faisait trembler. Quand un cri, quand un mot s'envolait au-dehors, il bouleversait Paris, et tout changeait de face » (p. 777). A cette rhétorique de la violence politique, Vigny oppose la figure héroïsée du poète André Chénier ; on pourrait donc légitimement s'attendre à ce que le héros martyr prenne la parole dans l'espace du texte, pour donner voix à la Vérité dont la littérature est le sanctuaire. Or, il n'en est rien : le récit évite sans cesse le face-à-face Robespierre-Chénier (c'est Joseph, le frère du poète, qui affronte le « tyran », et en lui retournant ses propres paroles) ; de plus, l'œuvre de Chénier, si elle prend place dans l'œuvre sous forme épigraphique (des vers inscrits sur une chaise) ou en manière d'esquisse (articles en projet), n'est jamais explicitement citée. La parole autre, salvatrice, du poète reste exilée hors du récit, hors frontière qui ne peut figurer dans la page que sur le mode de la désignation. De manière significative, Vigny évite d'exploiter les "lieux rhétoriques" traditionnellement dévolus au déploiement de l'éloquence. Emprisonné pour avoir fait entendre une parole de liberté et de justice, le poète ne s'exprime dans l'œuvre que sur le mode du cri, de la citation émiettée, de la médiation sous toutes ses formes : « Puisque vous connaissez ces misérables qui nous déciment, citoyen, vous pouvez leur répéter de ma part tout ce qui m'a fait arrêter et conduire ici, tout ce que j'ai dit dans le Journal de Paris, et ce que j'ai crié aux oreilles de ces sbires déguenillés qui venaient arrêter mon ami chez lui. Vous pouvez leur dire ce que j'ai écrit là, là... [...] Il tira [...] un papier de sa poche, et le montra en frappant dessus » (p. 731). Stratégie d'éviction donc, qui va jusqu'à ne pas citer les ultima verba du poète sur l'échafaud (site rhétorique éminent, pourtant...) !
15
Cette impossibilité de représenter dans le texte même les pouvoirs de la littérature renvoie à un malaise profond : « La plasticité du langage politique le rend fascinant pour
181
les écrivains. Il est à la fois l'image même de la littérature et de sa capacité à faire croire à l'existence des choses à travers les mots, et l'envers de la littérature pour qui les mots sont l'être même »12. En ce sens, tout face-à-face risquerait de révéler, au-delà de la structure d'opposition, une déroutante symétrie — comme la littérature, la rhétorique du pouvoir est puissance de représentation, et, au sens le plus fort du terme, de fiction. C'est pourquoi la seule manière authentiquement efficace d'affirmer une différence de valeur essentielle consiste non à figurer les pouvoirs de la littérature, mais à les mettre en œuvre comme puissance de destruction. Face au silence du Poète, Vigny se garde bien de reproduire la rhétorique révolutionnaire : il en présente les coulisses. Robespierre, déambulant en robe de chambre, teste par oral son prochain discours à la Convention — si bien que les « mots sublimes » qu'il entend y enchâsser, loin de valoir comme signes de l'enthousiasme révolutionnaire, apparaissent comme autant d'incongruités voyantes, basse pacotille rhétorique sortie de l'atelier du politicus fabricator. Quant à Saint-Just, qui prétend avoir part aux pouvoirs de la Littérature, Vigny le représente en pleine furie d'auto-citation — disloquant son propre discours en poudroiement de maximes tape-àl'œil réchampies des Anciens, ce que souligne la typographie : « Je sens bien que j'étais Poète, moi, quand j'ai dit : "Les grands hommes ne meurent pas dans leur lit. — Et — Les circonstances ne sont difficiles que pour ceux qui reculent devant le tombeau. — Et — Je méprise la poussière qui me compose, et qui vous parle. — Et — La société n'est pas l'ouvrage de l'homme. — Et — Le bien même est souvent un moyen d'intrigue ; soyons ingrats si nous voulons sauver la patrie." » (p. 762). 16
Au renversement de perspective (montrer les coulisses de l'éloquence politique) s'ajoute la subversion de l'acte même de représentation — procédé des plus efficaces face à une rhétorique qui s'affiche elle-même comme spectacle. De la scène où parade en sa gloire la rhétorique du Pouvoir, la littérature offre un reflet grimaçant. La parole politique, on l'a vu, assure son emprise par un véritable terrorisme du signe, où le discours proprement dit ne fonctionne jamais comme production de sens : le récit va donc disqualifier ce dispositif par une représentation dégradée. Ainsi, dans L'Éducation sentimentale, la suspicion et la dérision frappent toutes les enceintes sacrées de la rhétorique politique, par la parodie qu'en offre le Club de l'Intelligence ; chez Balzac, le salon des Giguet, réplique au petit pied de l'espace parlementaire, transforme les rites de l'éloquence politique en bouffonnerie pleine de gravité. Inversement, le discours du Pouvoir, dès qu'il sort de ses espaces consacrés, est victime de toutes sortes de dysfonctionnements hautement significatifs ; Eugène Rougon, invité à inaugurer une ligne de chemin de fer en pleine campagne, s'inquiète de devoir parler dans un cadre peu propice (p. 258), aussi peu adéquat aux effets de rhétorique que celui des Comices agricoles où Lieuvain (nom symbolique) déploie (tente de déployer) son éloquence boiteuse. Zola fait d'ailleurs de toute la séquence une réécriture de Flaubert13, reprenant le tissu de métaphores incohérentes ([Le prince] nous a pris par la main, et nous conduit pas à pas vers le port, au milieu des écueils ») et la dissolution du discours en poudroiement de signes (« Par moments, sa voix se perdait dans le plein air. Alors, on ne voyait plus que ses gestes, un mouvement régulier de son bras droit ; et le millier de curieux étagés sur le coteau, s'intéressaient aux broderies de sa manche dont l'or luisait dans un coup de soleil ») 14.
17
La dissection est une vengeance, écrit Flaubert. De fait, rien de plus dérisoire que cette éloquence soit inaudible15, soit désopilante, dont le mendiant de Villiers de L'isle-Adam, dans Vox Populi, offre une parodie clownesque : par son extraordinaire longévité, par sa mélopée obstinée et toujours recommencée, il dénonce les parentés profondes qui, au-
182
delà des oppositions politiques de surface, constituent en un discours unique l'éloquence du Pouvoir. Si la rhétorique politique se veut, par définition, une pragmatique, le résultat obtenu peut s'avérer paradoxal ; l'apprenti-candidat à la députation d'Arcis réussit à endormir littéralement ses auditeurs par la puissance envoûtante de son Verbe : « À trois heures, Simon Giguet expliquait encore le progrès, et quelques-uns des candidats faisaient entendre des ronflements réguliers qui dénotaient un profond sommeil. Le malicieux Achille Pigoult avait engagé tout le monde à religieusement écouter l'orateur qui se noyait dans ses phrases et périphrases » (p. 741).
L'invention d'un autre discours 18
De la dissection comme vengeance : soit, mais la tactique n'est pas exempte d'ambiguïtés. Car les mêmes récits qui ironisent sur les faiblesses de la rhétorique du Pouvoir sanctionnent en même temps son efficacité : après tout, la réunion électorale de Simon Giguet est un plein succès dont s'inquiètent ses adversaires ; quant à Eugène Rougon, qui pratique la formule réversible (« Un parlement qui se tait est un parlement qui travaille » devient, après le "tournant libéral" du Second Empire, « Un parlement qui discute est un parlement qui travaille »), il assoit sur cet imperturbable cynisme rhétorique un pouvoir durable. Pire : le discours de l'opposition, lorsqu'il figure dans le récit, n'a aucune portée. Si lourde, filandreuse et plâtreuse qu'elle soit, l'éloquence de Rougon réduit toute parole autre au silence et au non-sens, pour finalement lui voler son discours : tel est le sens de la dernière scène du roman, où le député républicain voit son argumentation neutralisée par la puissance d'absorption et de récupération propre à la rhétorique du pouvoir. La harangue de Gwynplaine à la Chambre des Lords, dans L'homme qui rit, a valeur exemplaire ; si Gwynplaine porte en lui une parole de vérité venue d'ailleurs et introduite indûment dans l'espace politique (il vient « du gouffre », et son exorde commence par « Je suis celui qui vient des profondeurs »), l'incongruité de cette intrusion rhétorique est impitoyablement sanctionnée quand le Pouvoir réel la renvoie au néant — non par une quelconque réponse, mais par le rire, brutale puissance d'assassinat. Le propre de la rhétorique du Pouvoir est de créer autour d'elle soit un cercle d'aphasie, soit un espace de détournement et de corruption (cette puissance corruptrice du pouvoir est l'une des grandes obsessions du siècle) : le discours ne pourra pas faire l'économie d'une révolution.
19
Aporie irréductible : l'essentielle dignité que revendique le discours de la littérature, face au totalitarisme rhétorique du Pouvoir politique, tient à sa valeur de vérité. D'où l'utopie hugolienne d'une parole autre : « La parole sociale est implicitement décrite comme lacunaire : elle ne peut gérer que des rapports de pouvoir entre les individus et elle substitue la force au vrai. À ce régime social de la parole, le jeune Hugo oppose une parole que l'on pourrait qualifier de "naturelle", dans la mesure où elle révèle l'être de son énonciateur en-deçà de tout masque social, en dehors de toute stratégie visant à assurer un pouvoir sur l'autre. »16 Or, cette parole de vérité, qui prend son origine dans la nature, tire sa légitimité non pas de son contenu (sa valeur argumentative ou pragmatique), mais de son énonciation même ; par définition, elle ne peut entrer dans le cercle qui la confronterait avec le discours du Pouvoir : « Il s'agit d'opposer une conception de la poésie dénoncée comme une pratique historique et politique disqualifiée, et dont l'instrument est la rhétorique la plus classique, à une poésie authentique fondée sur la naturalité »17. D'où un jeu de déplacement reposant sur la disjonction, dont Les Misérables
183
offrent un exemple éclairant. Dans le livre « Le 5 juin 1832 » (la date ne peut manquer de rappeler un autre mois de juin...), au cœur d'une réflexion sur l'émeute et la Révolution, l'écrivain enchâsse une analyse sur la puissance du Poète face au Pouvoir politique : « Chaque époque de l'histoire apporte avec elle la protestation qui lui est possible. Sous les Césars, il n'y avait pas d'insurrection, mais il y avait Juvénal. / Le Facit indignatio remplace les Gracques. / Sous les Césars il y a l'exilé de Syène ; il y a aussi l'homme des Annales. »18 Mais cette parole authentique a besoin, pour se déployer, d'un autre espace : seule la construction d'un site d'énonciation prophétique, aux portes du tombeau, confère au discours d'Enjolras sur la barricade sa puissance de vérité19. Le pouvoir de la littérature ne se peut affirmer sur le lecteur qu'en niant toute efficacité pragmatique dans le dispositif narratif. 20
Si la parole prophétique ou utopique peut ainsi trouver à s'inscrire dans le récit, c'est par la mise en scène de sa fondamentale altérité : le face-à-face dialogique reste impossible, la Vérité n'a rien à répondre, au sens propre, à la parole du Pouvoir. Un roman comme Quatre-vingt treize évite les effets de clivage en déployant tout le récit sur le terrain du politique, avec une grande virtuosité dans le pastiche : « Prononcé par Gauvain, Cimourdain et Lantenac ou par Danton, Marat et Robespierre, le discours garde le même objet : il rend compte d'informations historiques et met en discussion des thèses politiques »20. A la technique narrative pulvérisant le récit en un véritable poudroiement de micro-séquences répond d'autre part le refus de représenter la Convention — Himalaya oratoire pourtant, point culminant de l'éloquence révolutionnaire — comme champ d'affrontement rhétorique : la mise en scène des « mots sublimes » reproduit, à plus grande échelle, la « querelle de tonnerres » de Robespierre, Danton et Marat, corpsà-corps violent où la parole devient coup. Face à ce régime polémique du discours dans l'arène du Pouvoir comme praxis, la parole de Vérité que profère Gauvain s'inscrit dans la séquence prophétique de la prison-tombeau, hors de toute visée pragmatique dans la diégèse — et non, déplacement riche de sens, dans la rhétorique de l'échafaud que Hugo élude magistralement.
21
Le silence du Christ face à Pilate, procurateur de Judée : tel semble donc être le seul mode rhétorique de la vérité face à la parole du Pouvoir. Ainsi, dans Cinq-Mars, le peuple s'attaque à l'oppression politique de Richelieu en accablant d'un silence méprisant la première représentation de sa tragédie Mirame. Sur le mode autre du sublime brut, le mot de Cambronne, jeté « au passé au nom de la Révolution » (Les Misérables, p. 357), tire son pouvoir de son irréductible marginalité, qui le place délibérément hors d'un territoire rhétorique pourtant balisé par le lieu commun du type "Dernières paroles de Decius Mus" 21 — d'où l'importance de son inscription (en toutes lettres, véritable épigraphie du scandale) dans le texte littéraire. Et, dans Quatre-vingt treize, les harangues vendéennes — de Lantenac à Halmalo ou à Gauvain, de l'Imânus aux Bleus — n'appellent pas d'autre réponse que le silence ou le mot sublime. La République s'inscrit dans le texte non comme discours, mais comme vision : cette opposition est essentielle dans le contexte politique des années 1872-74, où, après le traumatisme de la Commune et l'établissement d'une république outrageusement postiche, un récit centré sur les bella plus quam civilia de 93 prend valeur immédiatement pragmatique. C'est pourquoi le récit hugolien multiplie les substituts à la parole comme instrument de pouvoir. La solution radicale consiste à remplacer le discours, en ses lieux consacrés, par d'autres dispositifs d'échange non verbaux ; les armées de Lantenac et de Gauvain, face à face, se placent d'emblée horsrhétorique, au mépris de tous les topoï que suggère ce type de situation dans le récit
184
historique : « À travers le silence de la nuit tombante, un son de trompe se fit entendre. Ce son de trompe venait du haut de la tour. À ce son de trompe répondit un coup de clairon qui venait d'en bas »22. 22
Trompe contre clairon : à cette opposition à la fois référentielle et poétique (les connotations des deux termes ne sont pas innocentes) correspond le duel des affiches, en très grand nombre dans le roman. Rien de plus significatif qu'un tel choix, plus proche du cri que de la performance rhétorique : « Le "coup de gueule" reste l'archétype de toute écriture insurrectionnelle. Coup de gueule répété en cent exemplaires sur les murs de la ville, c'est l'affiche révolutionnaire [qui] s'affirme comme le langage le plus "propre", le plus viscéral et le plus spontané du mouvement populaire.23 » Préférer l'affiche au discours permet d'éviter les ambiguïtés du discours républicain, et la question de sa légitimité (on sait quelles interrogations a suscitées la figure éminemment rhétorique de Mirabeau, chez Lamartine, Michelet et Hugo — avant, et surtout après la cassure de 1848). En outre, le dispositif d'affichage permet de superposer à l'affrontement discursif une opposition d'ordre stylistique : le Verbe révolutionnaire évite ainsi toute compromission avec les techniques d'assujettissement propres au discours du Pouvoir, et reste à l'abri de l'ultime ruse de la rhétorique — toujours susceptible d'invalider le discours d'opposition qu'elle investit24. Les murs de la Vendée répètent donc inlassablement la violence brute de la guerre civile : « Le marquis de Lantenac a l'honneur d'informer son petit-neveu, monsieur le vicomte Gauvain, que, si monsieur le marquis a la bonne fortune de se saisir de sa personne, il fera bellement arquebuser monsieur le vicomte. / — Et, poursuivit l'hôtelier, voilà la réponse. / Il se retourna, et éclaira de sa lanterne une autre affiche placée en regard de la première sur l'autre battant de la porte. Le voyageur lut : Gauvain prévient Lantenac que s'il le prend il le fera fusiller. » (p. 290).
23
À la limite, l'affiche peut même aller jusqu'à nier toute dimension discursive — il n'est pas innocent que Hugo, dans Les Misérables, placarde au détour d'une page (non loin de la barricade républicaine...) cette enseigne aussi efficace que l'éloquence des Châtiments (p. 1108) :
24
Un panier ayant la forme de Napoléon le Grand avec cette inscription :
25
NAPOLEON EST FAIT TOUT EN OSIER
26
Et, puisque la rhétorique du Pouvoir s'appuie sur la puissance de fascination que recèlent les signes, rien de plus efficace que de les détourner. Point de discours pour s'opposer à la tyrannie de Napoléon le Petit, qui emprunte la voix de Son Excellence Eugène Rougon ; mais le baptême du Prince Impérial, triomphe de la sémiotique du Pouvoir, doit subir pour contrepoint le discours muet et éloquent d'une affiche géante : « Ce qu'on apercevait de toutes parts, des quais, des ponts, des fenêtres, c'était, à l'horizon, sur la muraille nue d'une maison à six étages, dans l'île Saint-Louis, une redingote grise géante, peinte à fresque, de profil, avec sa manche gauche pliée au coude, comme si le vêtement eût gardé l'attitude et le gonflement d'un corps, à cette heure disparu. Cette réclame monumentale prenait, dans le soleil, au-dessus de la fourmilière des promeneurs, une extraordinaire importance »25 (p. 86). Extraordinaire, parce que la redingote se donne à lire non seulement, au premier degré, comme allégorie (Napoléon-le-Petit n'a emprunté à son illustre ancêtre que le nom vide, et une symbolique de la continuité impériale que le baptême actualise, avec un effet-tableau qui renvoie au Sacre de Napoléon par David), mais aussi comme symbole : le Pouvoir fabrique des signes vides, et les dote d'une autorité d'autant plus irréfutable qu'elle est, à tous les sens du terme, vide.
185
27
La rhétorique n'est pas l'instrument du Pouvoir politique : elle constitue en elle-même le pouvoir26 — troublante puissance de fiction qu'elle partage avec la littérature. D'où un paradoxe vertigineux : comment revendiquer, et représenter, un pouvoir spécifique à la parole littéraire, définie et légitimée par sa valeur de vérité ? Après 1848, après la Commune, l'innocence rhétorique n'est plus possible : d'où un certain nombre de stratégies narratives de méfiance et d'éviction, dont témoignent, outre Eugène Rougon, plusieurs romans caractérisés par la volonté d'agir sur le réel politiquement instable des années 1871-77 — Quatrevingt-treize, ou la trilogie de Vallès. Il s'agit de penser le fait littéraire non seulement comme acte de parole, mais comme réflexion sur le système même des signe ; c'est, pour Barthes, la définition même de la littérature : « Cette tricherie salutaire, cette esquive, ce leurre magnifique, qui permet d'entendre la langue hors-pouvoir, dans la splendeur d'une révolution permanente du langage, je l'appelle pour ma part : littérature »27.
NOTES 2. Sur cette question, voir Laurence Richer, « Elle a survécu à tous les régimes [...] », Ecriture/ Parole/Discours : littérature et rhétorique au XIXe siècle, Printer, 1997, p. 77-88. 3. C'est pourquoi la représentation du pouvoir dans Son Excellence Eugène Rougon n'a pas seulement valeur historique ; il y a, d'un régime à l'autre, une singulière continuité que voile mal l'écran du discours républicain : « En 1875, le pouvoir appartient encore à un ancien maréchal de Napoléon III, et aux mêmes castes qui ont porté et soutenu l'Empire — seuls les porte-parole ont changé —, et [...] aux yeux de Zola, la vitupération de l'ancien régime n'a pas encore épuisé ses vertus d'avertissement. » (Henri Mitterand,, Le Regard et le signe, PUF-Ecriture, 1987, p. 194). 4. Son Excellence Eugène Rougon (désormais SEER), Gallimard, bibliothèque de la Pléiade, préfacée et annotée par Henri Mitterand, 1961, p. 1495. Toutes les références à cette œuvre renverront désormais à cette édition. 5. Henri Mitterand, Op. cit., p. 204. 6. Toutes les références au Député d'Arcis renvoient à l'édition Gallimard, bibliothèque de la Pléiade, La Comédie humaine, tome VIII, 1977. 7. On songe aux fausses prouesses rhétoriques que Vallès dénonce chez Gambetta, champion de la parade politique, athlète de la parole vide et sonore : « Superbe à voir aussi, tirant sa coupe d'un geste large dans le flot gras de ses périodes, et secouant sa crinière, et haussant sa poitrine comme un nageur qui se débat dans la tempête. [...] Il n'était qu'un gymnaste de forte encolure et pectoraux d'Hercule qui se disloquait et s'échevelait dans le verre d'eau sucrée de la tribune. » (« Gambetta », Le Réveil, 8 janvier 1883, éditions Gallimard, bibliothèque de la Pléiade, préfacée et annotée par Roger Bellet, II, p. 861 ; toutes les références à Vallès renverront désormais a cette édition). 8. Maurice Agulhon, Marianne au combat, éditions Flammarion, 1979, p. 158. 9. Tout ce développement s'appuie sur l'excellent article de R. Lethbridge, « Zola et la fiction du pouvoir : Son Excellence Eugène Rougon », Les Cahiers naturalistes, n° 72, 1998, p. 291-304. 10. Paul Alexis, Emile Zola. Notes d'un ami, Charpentier, Paris, 1882, p. 105. 11. Vigny, Stello, Gallimard, bibliothèque de la Pléiade, 1948, p. 794 (toutes les références à cette œuvre renverront désormais à cette édition).
186
12. Paule Petitier, Littérature et idées politiques au XIXe siècle, Nathan, 1996, p. 120. 13. En 1875, Zola venait justement de publier sa grande étude consacrée à Flaubert dans Le Messager de l'Europe — pour maintes raisons, on pourrait dire que SEER est le plus « flaubertien » des romans zoliens. 14. Le clin d'œil à Flaubert est clair ; Lieuvain, lui aussi, tresse des images de "tartinier" politique au mépris de toute cohérence : « Ce roi bien-aimé [...] qui dirige à la fois d une main si ferme et si sage le char de l'État parmi les périls incessants d'une mer orageuse ». Quant au nombreux public venu assister à la performance oratoire, il doit se contenter d'une gestuelle muette, parodie cruelle de la grande actio rhétorique : « La place jusqu'aux maisons était comble de monde. On y voyait des gens accoudés à toutes les fenêtres, d'autres debout sur toutes les portes. Malgré le silence, la voix de Lieuvain se perdait dans l'air. » (Madame Bovary, édition GF, 1986, p. 208 et p. 213). 15. Les journalistes chargés des comptes rendus des Chambres, sous la Monarchie de Juillet, utilisent sans pitié ce moyen économique d'assassiner un homme politique : « M. Gabillot monte à la tribune et prononce un discours que l'éloignement, - la faiblesse de l'organe, - le son de sa voix, - l'accent méridional ou alsacien de l'orateur, - ou - que le bruit de la Chambre - nous empêchent d'entendre. » (Balzac, Monographie de la presse parisienne, Arléa, 1998, p. 44). 16. Ludmila Wurtz, « Le dialogue amoureux dans la poésie lyrique de Victor Hugo avant l'exil », Écriture / Parole / Discours : littérature et rhétorique au
XIXe
siècle, Alain Vaillant (dir.), éditions
Printer, 1997, p. 201. 17. Pierre Laforgue, « Rhétorique et politique chez Hugo », Écriture / Parole / Discours : littérature et rhétorique au XIXe siècle, p. 69. 18. Les Misérables, IVe partie, livre X, chapitre II. 19. Sur cette question de la rhétorique prophétique comme effet d'énonciation, voir notre communication au colloque de Grenoble Utopie, pamphlet, manifeste (novembre 1997), à paraître aux éditions de l'Harmattan, 2001. 20. Guy Rosa, « Quatrevingt-treize, ou la critique du roman historique », Revue d'histoire littéraire de la France, mars-juin 1975, p. 333. 21. Pour une très académique et drolatique actualisation de cet exercice de rhétorique scolaire, voir France (A.), Le Livre de mon ami (le chapitre s'intitule justement « Les dernières paroles de Decius Mus »). 22. Victor Hugo, Quatrevingt-treize, édition GF, 1965, p. 244. Toutes les références à cette œuvre renverront désormais à cette édition. 23. C. Bernard, Le Passé recomposé, Hachette Supérieur, 1996, p. 290. 24. L'éloquence comme pouvoir, on l'a vu, est affaire de forme plus que de contenu — ce qui a des conséquences redoutables : « Il suffit de lire quatre pages d'un homme pour savoir s'il est ami ou ennemi, avec nous ou contre nous. Son style dénonce sa pensée. Je reconnais un autoritaire dans celui que se dit le plus enragé libertaire ». (Vallès J., fin de l'article « Lachaud » refusé par Le Réveil du 12 décembre 1882, cité par Roger Bellet, II, p. 1799). 25. « Il s'agit d'une affiche-enseigne réelle créée par l'affichiste Rouchon, pionnier de l'affiche en couleurs sur grandes surfaces. Cette affiche, qui semble avoir frappé les écrivains (G. Nouveau, Laforgue, Céard dans Une belle journée, E. de Goncourt dans La Fille Élisa, etc., en parlent) se retrouve également dans tous les journaux de l'époque. » (Philippe Hamon, Expositions, José Corti, 1987, p. 179). 26. Un écrivain comme Vallès eut toujours la conscience la plus aiguë de cette dimension inquiétante : « Les parlements ne tiennent debout que grâce à l'épaisseur de salive dont est gâché le mortier qui cimente leurs murs » (« Brisson la Bégueule », Le Cri du Peuple, 20 janvier 1884, II, p. 1111). 27. Roland Barthes, Leçon, p. 16.
187
La génétique littéraire
188
Présentation Sylvie Triaire
1
La génétique est aujourd’hui l’un des espaces de recherche les plus dynamiques dans le paysage des études littéraires. Il bénéficie d’une reconnaissance et d’un soutien institutionnels, dont témoignent les équipes CNRS, tout particulièrement celles de l’ITEM, mais aussi les ouvertures vers le grand public — expositions de manuscrits, articles dans la presse non spécialisée. Depuis peu, un public plus large encore est sensibilisé, les programmes de français du secondaire intégrant désormais la génétique textuelle — ce qui ouvre la redoutable question de la cohérence d’un enseignement littéraire qui, au moment où il révoque l’histoire littéraire, lui substitue l’histoire d’un texte, au risque de laisser, sans fil, les perles éparses...
2
Née aux lendemains du structuralisme, la génétique a relayé les exigences d’immanence et de relation mesurée à un objet, conditions expresses à une étude soucieuse de se garder de toute dérive subjective, tant du point de vue de l’analyste que du côté de ce « sujet » créateur, l’auteur.
3
La génétique a relayé le structuralisme en amont des textes : découvrant et transmettant les avant-textes, véritable terra incognita jusque-là, mais continent à aborder en tant que socle sur lequel se génère l’œuvre.
4
De ce point de vue, il semble évident que la génétique ne se réduit nullement à un compte rendu exhaustif des différents états d’un texte λ — prise de possession de la page, marges, ajouts, paperolles ; classement de centaines de feuillets — mais doit ouvrir, par essence, sur la question de l’esthétique. La genèse de l’œuvre d’art se donne à lire dans ce travail de l’écrivain, d’ordre plastique, où le réagencement d’un mot témoigne de ce qu’une œuvre est en n’étant pas, plus, ce qu’elle aurait pu être — antériorité dont elle garde toujours quelque chose, fût-ce la trace invisible d’une suppression, via une arythmie dans le texte « final ».
5
Qu’en est-il aujourd’hui, plus de vingt ans après ses débuts, de la génétique textuelle ?
6
P. M. Wetherill, chercheur confirmé en ce domaine, propose une réflexion large : centrée sur les XIXe et XXe siècles, elle amène à interroger le statut historique de l’approche génétique, en posant notamment la question du statut du manuscrit aux XVIe et XVIIe siècles. La génétique coexiste avec la naissance de l’histoire littéraire qui, dans un
189
mouvement de mémoire similaire, pousse les écrivains à conserver la trace de leur travail, à constituer ce travail en « histoire », strates successives devenant la nécessaire base — la même qui alors ferait défaut « dehors », dans le monde désorienté du siècle ? Le manuscrit, production historique, suscita la génétique, non moins historique manifestation — parmi d’autres — d’une pensée du fragmentaire, d’une sensibilité à l’« éclat », notre contemporaine, née elle aussi à l’aube des temps nouveaux, chez les romantiques allemands. 7
F. Pellegrini fait, bibliographie à l’appui, le point méthodologique sur une critique génétique qui, trente ans après ses premiers pas, s’est dotée d’une terminologie et d’une typologie éprouvées. L’article propose ensuite une application pratique de la méthode génétique : la micro-lecture d’un épisode de Bouvard et Pécuchet montre de manière détaillée comment s’élabore le sens, selon de grainé fin des modifications, au fil d’une valse hésitation qui finit par imposer le mode flaubertien majeur, celui de la suppression, de l’ellipse. Cette micro-lecture, lecture de « myope » au sens noble que Flaubert donne à ce regard-là, présente les brouillons comme opera pour un inachèvement, arraché au terme d’une véritable stratégie rédactionnelle, opératoire dans ce micro-récit comme en bien d’autres.
8
M. Berthomier propose d’articuler génétique des textes et musicologie, par la voie comparatiste, sur le moment de bascule de l’alphabet musical, soit au seuil du XXe siècle, dont les révolutions formelles induisent la quête explicative de la genèse d’une telle mutation. L’analyse cherche chez Debussy, engagé avec Pelléas et Mélisande dans une double genèse, musicale et dramatique, la « trace » originelle, littéralement mention de la voix, à partir de laquelle s’élabore, en en déplaçant la littérarité, le travail vocal opératique. La génétique, avec la musicologie, révélant ici le point par où la lettre se fait musique — le musicien, musicien avant toute chose.
9
Ch. Chelebourg montre, dans le cas particulier de Nerval, l’importance des variantes, pour qui souhaite construire une poétique du sujet. Postulant que l’écriture opère, au fil du travail de réécriture, une réparation narcissique du sujet, sensible à travers la construction d’un idiolecte. Au fil des versions, « El Desdichado » cherche son titre, marque ou démarque ses signifiants majeurs du sceau de la majuscule, souligne ou estompe ses référents intertextuels. Ainsi la génétique se révèle-t-elle essentielle au travail de « poéticien du sujet », en montrant la quête identitaire s’accomplissant dans le trajet qui mène, chez Nerval, des lectures à l’écriture.
10
Si la génétique relève d’une esthétique du fragmentaire, inaugurée par les romantiques allemands et devenu un poncif du post-modernisme, ce dossier s’inscrit consciemment dans ce moment culturel : fait de bribes d’une réflexion qui se poursuit ailleurs, notamment dans les revues et publications spécialisées.
11
Il laisse ouvertes bien des perspectives — notamment celle de l’établissement des textes, qu’il s’agisse de les produire avec un choix de variantes et de brouillons, ou de la stricte question de l’établissement puis de l’édition du texte, combat à mener avec la génétique, dès lors que les manuscrits imposent, par exemple, une ponctuation qui, quoique non strictement normée, relève de la singularité d’une écriture et de choix esthétiques. La perspective, également, des correspondances, qui accompagnent le travail d’élaboration poétique par un processus analytique d’ordre esthétique, aparté ou monologue de l’écrivain confronté aux normes de son temps, aux libertés qu’il prend. Celle, aussi, d’une curiosité (fantasmatique ?) de l’origine de l’œuvre d’art ; celle, afférente, quoique
190
d’obédience psychanalytique, du fondamental dérobement de cette origine. N’y a-t-il pas, toujours, au-delà des traces conservées, en amont du premier scénario, l’incompréhensible imposition, chez un sujet, d’un signifiant que l’œuvre cache, et partiellement révèle, en une circulation d’autres signifiants ? L’on sait ce que les surréalistes firent de cette imposition traditionnelle : un credo, et comme le premier mot balbutié d’un cadavre exquis. La génétique trouve son plein sens à se nouer à d’autres modes d’investigation des textes, notamment esthétique ou psychanalytique. 12
Sa richesse et sa pérennité résident peut-être dans ces couvertures dont elle est porteuse. Car elle est alors production de cette volonté de savoir qui, en amont comme en aval, ouvre le texte, considéré non comme achevé, mais comme état momentanément arrêté dans une production plastique « en mouvement ». Ultime point de convergence de la « Modernité » et de la critique génétique, celle-ci appuyée sur celle-là, nourrie de ses œuvres.
191
Une culture fragmentaire1 Peter Michaël Wetherill
1
L'essor des études génétiques2 depuis le début des années 1970 n'a rien d'étonnant, car le phénomène des manuscrits est non seulement méthodique mais historique. Il explore comme tant d'autres la rupture des valeurs et des mentalités qui intervient vers la fin du XIXe siècle. Dans un espace humain où le fragment joue un rôle de plus en plus important, l'achevé est en somme dévalué ; on est de plus en plus attiré par tous les éléments disjoints qui jalonnent l'élaboration d'un texte et la pensée qui la sous-tend et qui constituent l'épaisseur même du processus de fabrication.
2
Déjà l'émergence de la vision impressionniste privilégie la psychologie multiple et simultanée (voir Proust) aux dépens de celle, immuable, que fondent les premières pages des romans de Balzac ou de George Eliot : ce qui nous intéresse, en fin de compte, à des niveaux variables, ce sont les cassures narratives, multiples, simultanées, contradictoires, les « pentimenti » que l'ultra violet révèle. La génétique relate précisément ces cassures, et le succès de toute une série d'expositions génétiques à la National Gallery de Londres le démontre, comme la présence au musée d'Orsay des différents états de La Grande Jaïte 3 ou la popularité de films qui montrent Picasso ou Pollock au travail. On voit déjà que ce n'est pas une simple préoccupation d'universitaires, car la publicité elle aussi reproduit ces tendances et en confirme l'universalité.
3
L'intérêt qu'on porte aux manuscrits en cours d'élaboration, promis à un refaçonnage radical, abandonnés même, relève donc logiquement de cette mentalité nouvelle.
4
La différence d'avec ce qui s'observe aux XVIIe et XVIIIe siècles est frappante. Il s'agit depuis la deuxième moitié du XIXe siècle d'une mutation culturelle d'envergure. Jusqu'alors, on jetait les manuscrits et les épreuves corrigées avec, ou bien, comme la veuve de Mozart (mais c'est sans doute déjà un début de valorisation), on en découpait des morceaux pour les offrir à ses amis. C'est le dépôt des manuscrits d'Hugo, légués par Hugo lui-même, à la Bibliothèque nationale, et la constitution par Spœlberch de Lovenjoul de sa grande collection (de manuscrits balzaciens notamment) au cours du troisième tiers du XIXe siècle qui marquent ce virage. Voilà pourquoi l'édition de Bordeaux, annotée de la main de Montaigne, ou le manuscrit des Confessions de Rousseau, déposé à l'Assemblée nationale, sont autant de survivances miraculeuses d'un âge où on
192
se préoccupait peu de la manière dont l'auteur parvenait, si l'on peut dire, à ses fins. D'habitude, une fois composé à l'imprimerie, toute trace du processus génétique était supprimée. C'est pourquoi l'établissement du texte des pièces de Shakespeare pose tant de problèmes : faute de manuscrits, on n'est toujours pas sûr que la version qu'on imprime soit vraiment de lui. On ne peut pas parler de texte correct et de texte fautif mais seulement de versions approximatives, l'une étant sans doute préférable à (ou moins discutable que) l'autre. On ne sera jamais sûr d'avoir devant soi le vrai texte (formule bien moderne en tout cas) de Hamlet. On est même confronté à trois versions, celle d'un « good » quarto basé selon toutes les apparences sur un manuscrit d'auteur ; celle basée sur un « bad » quarto inspiré de manuscrits d'acteurs (réécriture d'un manuscrit authentique ?), et le Folio posthume de 1623 qui donne un texte apparemment revu et corrigé - pour compliquer les choses, la pièce de Shakespeare semble avoir connu plusieurs faux départs -, ce qui fait que, même quand le texte semble être basé sur un manuscrit, on n'est pas sûr qu'il s'agisse d'autre chose que d'une hypothétique version provisoire.4 5
L'optique a pourtant changé, car le provisoire qui accompagne le devenir de la pensée créatrice (non seulement en littérature et en peinture, mais aussi en Histoire, sociologie, biologie, psychologie - on pense aux carnets de Pasteur et aux manuscrits de Freud...) n'a plus le même statut : le « mauvais folio » a autant d'intérêt que le « bon ». Le « mauvais » vaut le bon. Et, bien sûr, on s'intéresse à la fois au devenir du texte (c'est-à-dire aux différents stades de la composition d'un texte en tant que moments fixes et stables), et au processus qui le sous-tend.
6
Dans ce contexte historique qui aurait besoin d'être nuancé, l'avant-texte est roi. Ces traces écrites, antérieures à l'émergence du texte final, accompagnent l'élaboration d'un texte. Ce terme d'avant-texte est utile, car il permet d'éviter les ambiguïtés et les limitations contenues dans le terme de manuscrit.
7
Une petite mise en garde : la notion de création littéraire est bien vague, et celle de littérarité chère aux structuralistes, trop circonscrite, est un leurre. Si l'on s'intéresse exclusivement aux manuscrits, on risque de négliger leur interférence avec ce pullulement d'éléments extra-littéraires, biographie, éducation, voyages, rapport à la mère, carrière, maladies qui est au cœur de la création. L'écrit fusionne partiellement avec le reste, d'ailleurs, car l'élaboration d'un texte comporte une activité cérébrale où images, valeurs plus ou moins bien formulées, émotions, sensations et fragments d'écriture mentalement représentés s'entremêlent de façon inextricable. Cela étant dit, la seule trace stable, vérifiable, visible qui résiste, tant bien que mal aux élucubrations journalistiques (ou psychanalytiques), ce sont les traces physiques laissées par le travail de l'écrivain : manuscrits, éditions antérieures, correspondance5, sources annotées. Ce semblant d'objectivité rassure, on s'y accroche.
8
Pour quoi faire ? Dans un premier temps, c'est-à-dire, sans doute, depuis l'essor des études classiques et bibliques, au moment de la Renaissance, et de l'esprit d'authenticité qui l'accompagne, on veut, en se reportant aux manuscrits et aux éditions primitives, s'assurer que le texte qu'on va imprimer (il s'agissait de la Parole de Dieu...) soit aussi fidèle que possible au texte original. Cette pratique, bien sûr, sous l'impulsion parfois exacerbée de la « scientificité »6, se poursuit encore, sur une grande échelle, de nos jours. Elle prend des formes très variées, qu'il s'agisse, comme on l'a vu, de reproduire un texte shakespearien « authentique » (c'est-à-dire tel qu'il pouvait être avant que les acteurs et les protes trop pressés ne s'en emparent) - ou bien, plus simplement, de se reporter aux
193
manuscrits de Balzac déposés à l'Institut pour réaliser une nouvelle édition d'Illusions perdues. On veut publier le texte tel que l'auteur l'a lui-même écrit. Ce n'est pas toujours simple, car il faut du flair et une certaine indépendance d'esprit, non seulement pour concilier la mentalité d'époques qui attachent une valeur très variable au manuscrit d'auteur, mais pour contourner les écueils d'une édition moderne qui confronte une première version imprimée et des variantes que l'auteur fait intervenir ultérieurement (quel texte privilégier ?). D'où la polémique qui entoure depuis quelque temps l'édition de la Pléiade d'À la recherche du temps perdu réalisée sous la direction de Jean-Yves Tadié, qui ne semble pas tenir suffisamment compte de la version « corrigée » de La Fugitive/ Albertine disparue que Proust réalisa peu avant sa mort, et qui est très largement en porteà-faux avec la fin de La Recherche, qu'il n'eut pas le temps de réviser. 7 9
À côté de ces problèmes traditionnels (la polémique autour de la Recherche que je viens d'évoquer est en somme une polémique « traditionnelle »), on assiste, surtout depuis une cinquantaine d'années, à l'émergence de préoccupations plus « modernes »8, privilégiant l'idée non pas que le manuscrit est une preuve d'authenticité9, mais qu'il est révélateur de cette dimension de la pensée10 (vécu, événements, et valeurs) qu'est la littérature. Loin de se contenter de l'analyse d'un problématique texte « final », on veut donc préciser et interpréter les mécanismes qu'un auteur met en œuvre, pour élaborer son texte et cerner l'évolution constante des différents états d'une œuvre en voie d'élaboration.
10
Schématiquement, la genèse d'un texte possède trois dimensions : chronologie, dynamique, thématique. Cet ordre d'approche est souvent celui du travail critique et non de la création, car celle-ci est parcourue de chevauchements de toutes sortes : au milieu d'un plan, on relève souvent des élaborations textuelles, ou des tronçons documentaires qui appartiennent en principe à un autre moment de la genèse. 11 On s'intéresse donc à la fois à la méthode de travail et aux stades traversés par ce texte - c'est-à-dire les états de pensée successifs ou simultanés de la matière textuelle : élaboration de l'histoire/du sujet, documentation, traitement des sources, articulation narrative, descriptive, thématique... Et, au-delà de ces considérations générales (trop vastes la plupart du temps vu l'importance des dossiers), on peut s'intéresser à la manière plus circonscrite dont un (e) auteur(e) élabore la fin d'un texte, à la façon dont il/elle fait surgir avec toutes sortes de retouches la vision sociale ou historique, ou à la présence « scripturale » de tel auteur (Flaubert par exemple) dans les avant-textes d'un autre (Proust...).
11
Il est clair que cette genèse n'est pas compréhensible tant que la chronologie n'a pas été établie. C'est surtout l'étude des dossiers avec leurs ratures, additions, insertions, apports factuels, expansions, qui permet de suivre à la trace les différents états d'un texte (s'appuyant souvent sur d'autres indices, la correspondance d'un auteur par exemple, ou les filigranes). Soulignons qu'il ne s'agit pas à chaque fois d'un procédé unique particulier à tel ou tel auteur. Ici comme ailleurs, la dimension culturelle de la genèse a son mot à dire. Elle explique que les méthodes de travail des auteurs réalistes du XIXe siècle sont autant de variantes d'un schéma de base : documentation, plans, scénarios, plans récapitulatifs, brouillons, copie autographe, copie de copiste, épreuves, première, deuxième, troisième éditions. Il ne s'agit pas forcément d'un ordre rigoureux : la documentation par exemple, intervient à des moments différents, les menus détails du récit étant souvent en place au moment où l'auteur entreprend la documentation qui le sous-tend. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la documentation réaliste sert de preuve, après coup, et non de fil conducteur qui détermine le déroulement du récit.
194
12
Le schéma que je viens d'indiquer est celui des dossiers flaubertiens, avec des variantes qui personnalisent son travail. Si donc Flaubert fait des scénarios très détaillés, il réserve le plus gros de ses efforts au travail des brouillons. La recherche d'un texte dont le rapport linguistique au réel soit un rapport unique le pousse parfois à l'élaboration de neuf, voire dix brouillons. Par contre, une fois livré au/ à la copiste, son roman l'intéresse beaucoup moins. Nous ne possédons pas ses épreuves12 mais il semble les avoir mal corrigées, car certaines éditions comportent encore des erreurs notoires : c'est le cas des « fossés pleins d'eau » du début de Saint Julien, alors que les manuscrits révèlent que c'est plus logiquement de « fossés pleins d'herbes » qu'il s'agit.
13
Le travail de Zola est assez similaire, mais, comme nous possédons très peu de ses brouillons, l'analyse génétique porte forcément sur autre chose que le travail de la phrase. Il y a de plus des variantes méthodologiques importantes : surtout, les plans détaillés et l'ébauche, comme il les appelle, sont marqués par l'interférence de discours hétérogènes13 où, à la diégèse, se mêle un intense monologue : Zola pense tout haut, évoquant le thème qu'il veut développer (« Je veux faire le poème de la terre »), ou, pour L'Assommoir par exemple, les options auxquelles il est confronté et ses volte-face (« non, pas de drame », « pour mettre de l'équilibre dans l'œuvre »), les écueils à éviter (« je veux rester dans la simplicité des faits »14). Cette dimension génétique existe bien chez Flaubert : mais, comme elle se situe chez lui au niveau des longues discussions de travail qu'il eut avec Bouilhet, il n'en reste aucune trace15. Le monologue de Zola est essentiellement solitaire. C'est une autre façon de penser son travail.
14
Si pour certains romanciers (Flaubert, par exemple), le travail du texte est essentiellement un travail de planification et de contraction, la chronologie génétique chez Proust et Balzac, par exemple, est bien différente. Pour Balzac, à cause de la dynamique essentiellement « expansionniste » de son travail, et de l'absence générale de plans et de scénarios16, la correction des épreuves représente un stade très important du travail du texte : les épreuves assument alors une fonction de brouillons, comme elles en témoignent, bardées qu'elles sont de substitutions, de suppressions, d'insertions, de becquets, de paperolles longues parfois de plusieurs dizaines de centimètres. C'est une caractéristique de la littérature moderne17 : certains auteurs ont une méthode de travail qui n'est rien moins que linéaire. Les termes de plan, scénario, etc. ne sont alors guère de mise : Proust, par exemple, travaille (comme Perec ou Robbe-Grillet d'ailleurs) sur plusieurs « lieux », sur plusieurs états de son manuscrit à la fois. Il se livre constamment au découpage et au transfert d'éléments d'un épisode à un autre (le début primitif d'Un amour de Swann disparaît pour refaire surface, dans la version imprimée, dans les premières pages du Temps retrouvé...). Plutôt que de composition linéaire, on a donc tendance à parler de montage. Souvent, à cause du découpage physique (ciseaux et colle) du manuscrit primitif et du déplacement des éléments, et de la difficulté d'identification du cahier d'origine, la chronologie est très difficile à établir. La dynamique de la genèse sur laquelle on travaille est, on le voit, pour des raisons souvent fortuites, très variable.
15
Cela étant dit, on saisit plus objectivement cette dynamique en réalisant non pas une transcription simplifiée18, mais, grâce à une transcription diplomatique, la « topographie » même de la pensée littéraire, la genèse d'un texte étant aussi la gestion de l'espace physique de l'écriture : la feuille de papier avec ses quatre marges, ses interlignes, son verso, ses ajoutages collés.19 Un tel semblant d'objectivité permet de mieux encadrer la mise en place et l'élaboration thématique (vision métaphorique et temporelle chez Proust, mentalités stéréotypées, religieuses chez Flaubert) qui constitue
195
le fil conducteur du travail d'un auteur. On a déjà vu la définition du projet de Zola pour La Terre ; les premiers plans de Flaubert (reproduits entre autres par Marie-Jeanne Durry, Yvan Leclerc et Tony Williams20) en donnent d'autres exemples. Avec ou sans scénarios, on sait où on va. 16
C'est la narration qui donne une forme concrète à la thématique (réaliste, moderniste), et là non plus, évidemment, il ne s'agit pas de structures inventées de toutes pièces, mais de variantes sur la mentalité caractéristique d'une époque. Les récits de Flaubert ou de Zola incarnent celle du XIXe siècle, tout comme le récit proustien possède les caractéristiques, qu'on retrouve chez Joyce et Döblin, de l'impressionnisme tardif, du cubisme, de la psychologie freudienne (que Proust ne connaissait pas). Notons qu'il ne s'agit nullement dans tout ceci d'« expliquer » le texte final à partir du texte primitif21, mais bien de décrire minutieusement et d'interpréter la dynamique et le cheminement d'une pensée et d'une méthode (distinction artificielle), avec tous les changements d'optique et d'accent et de sens que les modifications textuelles font intervenir, qu'il s'agisse d'ajouts, d'expansions (Balzac, Proust) ou de suppressions problématisantes (Flaubert), « d'ambiguïsations » qui réduisent sensiblement la portée documentaire de l'œuvre. Et puis, on relève l'impact de censures stratégiques/thématiques22 ou dues au climat moral (pudeurs, passé politique douloureux) de telle ou telle époque.
17
On voit donc que d'autres facteurs ont pu déterminer le caractère de l'œuvre en cours : les éléments culturels et biographiques qu'on prend de plus en plus au sérieux depuis que s'est quelque peu relâchée l'emprise a-historique, inhumaine du structuralisme. On tient compte, dans le processus génétique, de la formation intellectuelle et affective de l'auteur. On cherche aussi à savoir ce que tel auteur lisait à tel moment de son activité, ou quels ouvrages il pouvait consulter chez lui, par exemple. C'est tout l'intérêt du travail qui se poursuit sur la bibliothèque de Flaubert déposée à la mairie de Croisset-Canteleu et du programme de reconstitution numérisée en cours de la bibliothèque de Proust23. Une telle valorisation souligne l'importance, en génétique, du contexte culturel24 qui « forme » les auteurs travaillant à la même époque - et l'on n'est pas étonné de constater que la méthode de travail d'un auteur n'a rien d'absolument autonome, même si elle peut être distinctive. Si Flaubert et Zola travaillèrent en fait à peu près de la même façon, il ne pouvait en être autrement, étant donné l'éducation qu'ils avaient reçue, car l'esprit scientifique et historique du XIXe siècle était passé par là. D'autre part, les procédés génétiques ne « progressent » pas. On relève même une certaine circularité : bien que la substance de leurs œuvres soit assez différente (moins pourtant qu'on ne le pense), Balzac 25 et Proust, on l'a vu, se ressemblent. Grâce à de telles convergences, un nouveau type, voire une redéfinition de l'histoire littéraire, se fait jour, fondé sur l'évolution et la récurrence des méthodes de travail.26
18
Des techniques nouvelles surgissent pourtant qui restructurent la genèse des textes : l'invention de la machine à écrire d'abord, et du papier carbone qui l'accompagne creuse l'abîme culturel qui sépare Zola et Proust (bien que Zola, qui meurt en 1902, eût pu en profiter). Elle encourage la multiplication des versions et donc des possibilités de révision. Surtout, depuis une vingtaine d'années, le traitement de textes fait progresser notre vision de l'histoire littéraire. Avant l'invention du CD ROM scriptible, on a même pu craindre un certain temps la disparition des avant-textes27, mais on retient surtout maintenant la (trop grande ?) facilité avec laquelle on peut modifier, supprimer, fusionner et déplacer du texte et parvenir à une plus grande souplesse de composition disloquant encore davantage la linéarité qui, même pour le public, a cessé d'être l'une des
196
composantes de notre vision des choses. L'effet de ces nouvelles techniques commence à se manifester. En attendant, on peut parler de grandes réussites éditoriales qui mettent en lumière des genèses « traditionnelles » : l'édition des Rougon-Macquart réalisée à la Pléiade par Henri Mitterand, l'Ulysse de Joyce publié par H.W. Gabier, Les carnets de Flaubert édités par P.M. de Biasi. D'autres éditions sont sans doute aussi notoires, mais plus discutables : ainsi le Proust réalisé sous la direction de J.Y. Tadié aux éditions de la Pléiade, contient une grande quantité de transcriptions, mais un souci de lisibilité, déplacé mais compréhensible étant donné le public auquel cette édition s'adresse, fait disparaître les marques d'insertion et de déplacement, de substitution, voire d'hésitation - ce qui cache à notre vue tout un pan de l'activité créatrice de Proust, et en réduit très sensiblement l'utilité scientifique. 19
Il faut admettre cependant que toutes les éditions, toutes les approches génétiques, sont discutables, car, inévitablement, elles sont subjectives et fondées sur des transcriptions qui comportent toujours des ambiguïtés et des erreurs. Et puis, comme on l'a vu, on ne dispose de tous les avant-textes d'aucun auteur. A l'avenir, en dépit de la réticence de certaines grandes bibliothèques, c'est la numérisation sur une grande échelle, la création d'hypertextes, qui, grâce aux possibilités de consultation multidimensionnelle (manuscrit et transcriptions, confrontation simultanée des différents états) qu'elle procure, permettra à la génétique de progresser : on pense ici à l'immense travail (en voie d'achèvement) de transcription et de reproduction numérisée de la troisième partie de L'Éducation sentimentale réalisé par Tony Williams, et qui fait de l'Université de Hull un grand centre d'études flaubertiennes.
NOTES 1. Pour l'élaboration de cet article, je suis redevable pour ses conseils à Odile de Guidis de l'ITEM. Je suis bien sûr responsable de toutes les imperfections qui subsistent. 2. En dehors d'un petit nombre de remarques préliminaires plutôt banales, et pour plus de cohérence, je me limite ici au roman français des XIXe et XXe siècles. Les textes médiévaux, la tragédie du XVIIe siècle ne soulèvent pas nécessairement les mêmes problèmes. Si je parle surtout de Flaubert, de Zola et de Proust, c'est que je connais mieux leurs avant-textes que ceux de George Eliot ou de Joyce. 3. - alors que, cassure planétaire, la version « définitive » du tableau se trouve à Chicago... 4. Voir Park Honan, Shakespeare, a life, Oxford University Press, 1998, p. 275 et seq. 5. Celles de Flaubert, de Proust, de V. Woolf sont particulièrement riches. 6. « Exacerbée » parce que les études littéraires ne sont pas une activité scientifique. La subjectivité y joue un trop grand rôle, même au niveau du choix de telle ou telle leçon manuscrite... 7. ... alors que la version « primitive » d'Albertine remaniée par le frère de l'auteur et publiée en 1929, semble en continuité directe avec le TR tel qu'il nous est parvenu. Voir Nathalie MauriacDyer, « Un drame de l'inachèvement, À la recherche du temps perdu », in L'Œuvre inachevée, A. Rivara, G. Lavorel éd., Universités de Lyon II et III, CEDIC 1999, p. 227-236.
197
8. La grande pionnière, c'est sans doute Gabrielle Leleu qui dès 1936 publia chez Conard en deux volumes une transcription des avant-textes de Madame Bovary. 9. À l'instar des personnages proustiens il n'y a pas d'authenticité, il n'y a que des états mal différenciés. 10. Pensée spécifique, quoiqu'aux contours flous. 11. Alors que, si des doutes subsistent quant à la date précise (fin 1863 ?) à laquelle Flaubert commença à travailler sur L'Éducation sentimentale, les différents stades de composition qui conduisent à sa publication en 1869 sont relativement clairs. Voir Bernard Brun, Bulletin d'Informations proustiennes, n° 30, 1999, p. 78. 12. Notre connaissance de la génétique flaubertienne est donc, comme de tout autre auteur, partielle. 13. Tous les dossiers comportent des niveaux de discours qui appartiennent en propre à un autre moment de la genèse. La documentation contient des élaborations de phrases qui se maintiendront jusque dans la version imprimée, tandis que les brouillons contiennent très souvent des indications de régie... 14. Dossiers plans f°85, 170, 167. Cité par O.Lumbroso, « Quand détruire, c'est créer », Poétique n ° 125, février 2001, (p..33-50), p. 38. 15. La survie ou la disparition des avant-textes (les discussions avec Bouilhet sont des avanttextes) illustrent le caractère aléatoire des études génétiques. 16. ... autre dimension, en somme, de la révolution temporelle réalisée par Proust. 17. En quoi Balzac révèle la modernité de sa façon de penser. 18. C'est le défaut de certaines éditions. Voir plus loin. 19. Voir les volumes du Corpus flaubertianum, G.Bonaccorso etc., éds (Klincksieck 1983 et seq), qui reproduit très fidèlement l'ensemble des avant-textes des Trois contes de Flaubert. 20. Voir respectivement M-J. Durry, Flaubert et ses projets inédits, Nizet, s.d., Y. Leclerc, Plans et scénarios de Madame Bovary, CNRS/Zulma, 1995, T. Williams, Flaubert, l'Éducation sentimentale, les scénarios, Corti 1992. 21. ... ni même pour certains chercheurs (mais je ne suis pas de leur avis) de porter un quelconque jugement critique. 22. Voir O.Lumbroso, art cit. 23. Voir les actes de la journée d'études sur la bibliothèque de Flaubert, à paraître sous la direction d'Yvan Leclerc aux Presses universitaires de Rouen -et J. Lambiriolle, « La bibliothèque de Marcel Proust, de la lecture à l'écriture », Bulletin d'Informations proustiennes, n° 30, p. 81-89. 24. Sans qu'on puisse pour autant parler d'influence, ce serait trop simpliste. 25. - qui pourtant attache bien plus d'importance que Proust à la linéarité temporelle de son récit. 26. Voir P. M. Wetherill, « Manuscripts and literary history », Dalhousie French Studies, Vol. 8, Spring/Summer 1985, p. 3-18. 27. La création d'un nouveau logiciel « Genesis » permettra cependant d'enregistrer les différents états des avant-textes en cours d'élaboration. Voir « Libération », 27 février 2001.
198
Un exemple d'étude microgénétique : le début du second chapitre de Bouvard et Pécuchet de Gustave Flaubert Florence Pellegrini
1
Depuis une trentaine d'années, la critique littéraire s'est enrichie d'une nouvelle approche, la critique génétique, qui se propose, par l'étude des manuscrits de travail des écrivains, de mettre en évidence le processus créateur qui a donné naissance à l'œuvre. Contrairement aux autres méthodes critiques, elle n'a pas pour visée ultime le texte mais l'écriture, « entendue comme avènement et événement, comme processus d'énonciation écrite. »1 Elle opère donc un déplacement d'intérêt du texte vers les étapes de son élaboration, vers le « brouillon », état mouvant et incertain, « laboratoire secret » de l'écrivain. Elle opère également une série de déplacements critiques : parce qu'elle recherche et exhibe ce qui, par essence, ne doit pas être publié ; parce qu'en considérant le texte édité comme une étape du processus à l'égal des précédentes — étape ultime, certes, mais pas « meilleure » — elle le désacralise ; parce qu'elle renferme toujours une part d'incertitude liée aux difficultés d'établissement des dossiers génétiques ou aux erreurs de déchiffrement des manuscrits, elle provoque parfois scepticisme et méfiance. Quant aux éditions génétiques, qui pourraient participer de la diffusion et de la reconnaissance de cette approche critique, elles restent marginales, les manuscrits abondants et protéiformes des écrivains se prêtant mal au format livresque.
2
Pourtant, la critique génétique, loin de s'opposer aux autres approches critiques, peut s'allier à elles afin de compléter, d'affiner la perception que l'on a d'une œuvre, la connaissance de la poétique d'un écrivain. Et pour certains textes marqués par l'indétermination, où opèrent des « stratégies d'inachèvement »2, l'approche génétique peut s'avérer particulièrement efficace et « éclairante » : l'étude des manuscrits de travail est alors un moyen de contrôler et d'enrichir les hypothèses formées à partir du texte final. Ainsi pour Flaubert, et en particulier pour Bouvard et Pécuchet, œuvre ultime et « hénaurme », l'étude des « brouillons » permet de valider, de préciser des
199
interprétations que « le texte laisse souvent à l'état d'hypothèses, et parfois même à l'état de simples conjectures. »3 Dans ce roman monumental, au sens souvent « indécidable », l'analyse du dossier de genèse, si elle permet de mieux cerner le processus d'élaboration de l'œuvre flaubertienne, est aussi une aide précieuse pour la compréhension même du texte.
Qu'est-ce que la critique génétique ? État des lieux4 3
Apparue au début des années 1970, la critique génétique, en tant qu'étude des traces écrites de la genèse d'une œuvre littéraire, a progressivement défini son objet propre et s'est peu à peu dotée d'outils adaptés. Comme le précise Almuth Grésillon, il s'agit d'étudier « les manuscrits de travail des écrivains en tant que support matériel, espace d'inscription et lieu de mémoire des œuvres in statu nascendi. »5 La génétique textuelle s'intéresse donc tout autant au papier — il faudrait d'ailleurs mettre l'expression au pluriel, tant est grande la diversité des supports utilisés par les écrivains : carnets, calepins, feuilles volantes ou, plus insolites, cartes à jouer comme dans le cas de Rousseau — et à l'aspect matériel des manuscrits qu'au processus créateur dont ils portent la trace. La critique génétique vise en effet à rendre compte d'une dynamique, à restituer et à rendre visible le travail d'élaboration d'une œuvre. Elle « traque à la fois l'écriture débordante du désir et la scription réglée du calcul »6, c'est-à-dire que loin de sacraliser le dernier état du texte — publié ou non — elle s'attache à mettre à jour les différents possibles narratifs envisagés par l'écrivain avant que ne s'établisse un choix et que ne se « fabrique » le texte définitif. L'approche génétique se propose ainsi de déplacer l'interrogation critique « de l'écrit vers l'écriture, de la structure vers le processus, de l'œuvre vers sa genèse. »7 Considérant que le texte définitif d'une œuvre littéraire est le résultat « d'un travail, d'une élaboration progressive, [elle] s'est donné pour objet cette dimension temporelle de devenir-texte. »8 Un premier problème apparaît donc, intimement lié à la nature même de la critique génétique : celui de la conservation de la genèse de l'œuvre.
Spécificité du manuscrit moderne 4
L'approche génétique nécessite comme préalable indispensable l'existence même et la conservation des manuscrits de travail des auteurs : qu'ils soient brouillons rédactionnels, plans ou simples notes, tous n'ont pas été conservés, détruits par le temps ou les auteurs ou tout simplement égarés voire perdus. Le statut extrêmement fluctuant du manuscrit au cours des siècles a contraint la critique génétique à circonscrire son champ d'étude aux manuscrits « modernes », en particulier les manuscrits du XIXe et du XXe siècles.
5
Le manuscrit « moderne », objet de la critique génétique, se distingue du manuscrit « ancien » par sa fonction : c'est un manuscrit de travail, destiné à un usage privé de l'écrivain, contrairement au manuscrit ancien qui, jusqu'à l'apparition de l'imprimé au XV e siècle, permettait d'assurer la diffusion, la circulation des textes. Le manuscrit ne présente d'intérêt pour le généticien que comme brouillon au sens large, trace individuelle d'une création, témoin d'un travail d'élaboration et marque d'une originalité. Les manuscrits médiévaux, généralement anonymes et transcrits par des copistes — avec
200
toutes les « variantes » et modifications textuelles qu'une telle pratique peut engendrer —, n'entrent donc pas dans le cadre des études génétiques. 6
Quant à la conservation des brouillons des écrivains, elle n'a pu s'effectuer qu'avec l'émergence progressive du concept « d'auteur ». Comme le précise Bernard Cerquiglini, « le brouillon devient désirable, quand le texte se fige et que son auteur a des droits. » 9 Et il faudra attendre la fin du XVIIIe siècle pour qu'une loi garantisse à l'écrivain des droits d'auteur. C'est donc sous l'influence conjuguée de progrès techniques et de mutations sociales et idéologiques qui aboutissent à la reconnaissance de l'écrivain comme créateur original et singulier qu'apparaît le brouillon moderne.
7
Dernier facteur important pour la conservation des manuscrits de travail, le changement radical de l'attitude des écrivains eux-mêmes. Abandonnant peu à peu une esthétique de la perfection qui voulait que l'auteur masquât toute la phase d'élaboration de son œuvre, les écrivains ont scrupuleusement gardé leurs manuscrits en vue d'une communication — souvent posthume — au grand public : ainsi Stendhal qui fit relier ses manuscrits autobiographiques en vue d'une publication ultérieure, ou Victor Hugo qui légua par codicille testamentaire tous ses manuscrits à la Bibliothèque nationale. Très nettement au XIXe siècle, en liaison avec le changement de statut social de l'écrivain, le brouillon acquiert une valeur officielle et publique — une valeur marchande aussi —, ce qui explique que nombre d'écrivains aient gardé leurs manuscrits de travail. Et c'est ce manuscrit spécifique, « historiquement déterminé entre la fin du XVIIIe et le XXe siècle »10 que la critique génétique se propose d'étudier.
Constitution et analyse d'un dossier génétique 8
L'observation des manuscrits de travail des écrivains révèle que les démarches créatrices varient considérablement d'un auteur à l'autre, générant des manuscrits d'aspect très divers. Toutefois, à l'intérieur de cette diversité, il est convenu de distinguer deux grands types d'écritures littéraires : les écritures « à déclenchement rédactionnel » — type Stendhal — et les écritures « à programmation scénarique » — type Flaubert11. De ces deux démarches résultent des dossiers de genèse différents et la méthode critique doit prendre en compte cette diversité afin de restituer au mieux le cheminement de l'écriture. Si la plupart des dossiers de genèse font apparaître, comme le précise PierreMarc de Biasi, « la succession de plusieurs phases de travail : les phases prérédactionnelle, rédactionnelle, pré-éditoriale, éditoriale »12, le nombre des manuscrits se rapportant à chacune de ces phases fluctue selon les écrivains et selon les œuvres. Ainsi, pour les écritures « à déclenchement rédactionnel », la phase prérédactionnelle est pratiquement inexistante. Et que dire de la phase éditoriale voire de la phase pré-éditoriale pour des œuvres inachevées, comme le Second volume de Bouvard et Pécuchet de Flaubert ou la Vie de Henry Brulard de Stendhal ? « Chaque genèse singulière traverse le champ des étapes virtuelles de l'écriture à son rythme propre et selon un itinéraire unique. »13
9
À l'hétérogénéité des manuscrits provoquée par les démarches divergentes des écrivains vient s'ajouter celle liée à la phase d'élaboration dans laquelle les manuscrits s'inscrivent : pour une même œuvre, un écrivain peut accumuler notes documentaires, plans, ébauches, brouillons, le dossier de genèse devenant alors un ensemble disparate qu'il convient, avant même de procéder à l'analyse, de répertorier, spécifier et classer 14, afin de proposer des outils d'étude adaptés.
201
10
De fait, le travail du généticien s'articule autour de quatre étapes : tout d'abord il convient de collecter — et de dater — les manuscrits se rapportant à l'œuvre étudiée, manuscrits qui peuvent être dispersés dans diverses collections, divers lieux ou pays. Dans un second temps doit s'effectuer un travail de spécification, c'est-à-dire une reconnaissance et un classement des manuscrits par type (plan, notes, brouillons, mise au net...) et par phase. La troisième opération, plus précisément centrée sur les brouillons, vise à restituer « l'ordre chronologique de leur production »15. Le généticien n'est donc pas seulement un critique littéraire interrogeant les divers états du texte, c'est aussi un archiviste, un bibliothécaire qui doit organiser le matériau brut, support de son travail. Quant à la dernière étape, le déchiffrement des manuscrits, elle est concomitante des précédentes : « classer et déchiffrer les documents d'un dossier génétique sont deux opérations conjointes et solidaires qui s'effectuent dans un va-et-vient permanent. »16 Le déchiffrement doit être le plus exhaustif possible. Il s'agit non seulement de « lire à la lettre » le manuscrit — et lorsque l'on a approché la graphie de certains écrivains, on sait combien cette opération peut s'avérer délicate —, mais également de lire « les mots sous les mots », « deviner sous le trait de la biffure le signifiant supprimé, savoir chercher son substitut dans l'espace alentour. »17 Une fois ce patient travail d'organisation et de déchiffrement achevé, il s'agira pour le généticien d'en rendre compte dans une transcription la plus fidèle et la plus complète possible, ce qui n'est pas sans poser problème tant l'aspect des manuscrits peut s'avérer confus et hétéroclite.
11
Une autre cause d'hétérogénéité qu'il faut évoquer : le genre littéraire dans lequel s'inscrit l'œuvre. En effet, les dossiers génétiques seront très différents selon qu'il s'agit d'un roman, d'une nouvelle, d'une pièce de théâtre ou de poésie. Différents en volume, tout d'abord — et l'on comprend aisément qu'une nouvelle ou un conte fournisse un dossier de genèse plus réduit qu'un long roman — mais différents également par la nature, l'aspect des manuscrits. Ainsi la critique génétique se démultiplie en fonction des objets à étudier, de façon d'autant plus considérable qu'une telle approche peut s'appliquer non seulement à la genèse d'œuvres littéraires mais également aux autres domaines artistiques.
12
Cette méthodologie rigoureuse et complexe traduit bien le déplacement d'intérêt qu'opère la critique génétique : rétablissant une chronologie dans la masse confuse des manuscrits de travail, elle permet la mise à jour du processus créateur, le dernier état du texte prenant sa place dans la chronologie au même titre que les autres. Si pour l'établissement de l'avant-texte18 un regard « téléologique » reste inévitable — comment reconstituer un ordre dans les brouillons rédactionnels si ce n'est en comparant les divers états du texte à la version finale ? —, le dernier état du texte n'est pas privilégié. L'enjeu de la critique génétique n'est pas « l'édition du meilleur texte, mais l'élucidation du travail d'écriture »19. Il s'agit de « rendre intelligible une étape de [la] genèse [d'une œuvre] ou le processus qui lui a donné naissance », de donner à lire « ce qui se trouve en amont : un certain état, inachevé et encore virtuel, de l'écriture. »20 Chaque étape du texte, chaque rature, chaque ajout ou suppression doit être considéré, dans cette mise à jour du « mouvement vers l'œuvre », comme le suggère Jean Starobinski : « suffit-il de lire les « avant-textes » en fonction du texte final qui veille en eux comme leur avenir caché ? N'y a-t-il pas illusion rétrospective, à croire que le texte définitif se cherchait lui-même dès sa première mise en train, comme si une intention première devenait de plus en plus sûre d'elle-même à mesure qu'elle progresse ? [...] Si c'est « l'expérience » qui compte [...] tout aura, à titre égal, valeur d'indice pour le lecteur qui veut savoir. »21
202
Un exemple d'étude microgénétique : le début du chapitre II de Bouvard et Pécuchet de Gustave Flaubert. 13
Appliquée à Flaubert, l'analyse génétique s'avère particulièrement efficace : parce que la « méthode de travail » de l'auteur étayée d'une solide recherche documentaire est productrice de nombreuses traces écrites (notes de voyage ou de lecture) ; parce que Flaubert a conservé ses manuscrits de travail, depuis la plus petite note jusqu'aux scénarios et aux brouillons rédactionnels, qui nous sont parvenus par l'intermédiaire de sa nièce Caroline Franklin Grout ; parce que Flaubert, enfin, « piochait » inlassablement ses textes, les retravaillait sans cesse jusqu'à l'obtention de la phrase idéale, digne d'être clamée dans le « gueuloir ». Pour chaque page de chacune des œuvres de Flaubert, nous possédons plusieurs états du texte, à des degrés divers d'achèvement. Si l'on met de côté les plans et scénarios pour ne considérer que les brouillons rédactionnels, les versions d'un même passage sont nombreuses qui nous révèlent le perfectionnisme de leur auteur.
Établissement du dossier génétique 14
Cette analyse porte sur le début du second chapitre de Bouvard et Pécuchet, ultime roman de Flaubert qui aborde successivement tous les domaines du savoir et se donne à lire comme un répertoire critique des sciences et des arts. Le fragment étudié correspond aux trois paragraphes inauguraux du second chapitre du texte final.22 Il s'agit du début de la phase expérimentale du récit, sorte de nouvel incipit qui présente le cadre essentiel de l'action : la ferme acquise par les deux bonshommes et la campagne environnante. Quelle joie le lendemain en se réveillant ! Bouvard fuma une pipe, et Pécuchet huma une prise qu'ils déclarèrent la meilleure de leur existence. Puis ils se mirent à la croisée pour voir le paysage. On avait en face de soi les champs, à droite une grange, avec le clocher de l'église, — et à gauche un rideau de peupliers. Deux allées principales, formant la croix, divisaient le jardin en quatre morceaux. Les légumes étaient compris dans les plates-bandes, où se dressaient, de place en place, des cyprès nains et des quenouilles. D'un côté, une tonnelle aboutissait à un vigneau, de l'autre un mur soutenait les espaliers ; — et une claire-voie, dans le fond, donnait sur la campagne. 11 y avait au delà du mur un verger, après la charmille un bosquet, derrière la claire-voie un petit chemin. (p. 74)
15
La constitution du dossier génétique s'est révélée assez aisée dans la mesure où, comme le fait remarquer Almuth Grésillon, « les manuscrits [de Flaubert] sont tombés « dans le domaine public » et méticuleusement répertoriés par des chercheurs passionnés par les manuscrits de « l'homme-plume ». »23 J'ai choisi de réduire mon étude aux manuscrits de la « phase rédactionnelle », rassemblés en trois volumes de « brouillons » (1 203 feuilles) et un volume de trois cents feuilles réservé au manuscrit autographe. Tous ces manuscrits sont conservés à la Bibliothèque municipale de Rouen.
16
La consultation des manuscrits de Bouvard m'a permis de rassembler neuf versions différentes de la première page du second chapitre : huit versions appartenant aux brouillons (ms g 225) auxquelles s'ajoute la page de mise au net du manuscrit autographe (ms g 224, f° 16). Parmi les huit feuillets du brouillon, on peut établir deux sousensembles : trois feuillets de type scénarique, comportant des indications qui concernent l'ensemble du second chapitre (f° 70, f° 76 v°, f° 71) et cinq feuillets de réécritures
203
successives de la première page du chapitre (f° 81 v°, f° 77 v°, f° 84 v°, f° 75 v°, f° 103 v°). L'ordre dans lequel je présente ces feuillets correspond à mon propre classement. 24 17
Ce passage, qui rapporte l'installation des deux personnages principaux dans un petit village, Chavignolles, situé entre « Caen et Falaise », et leur découverte émerveillée de la campagne environnante le matin qui suit leur arrivée dans leur nouvelle demeure, est esquissé très tôt par Flaubert. Sa correspondance ainsi que ses « Carnets de travail » en portent la trace. Il s'agit pour l'auteur de « planter le décor » dans lequel les personnages vont évoluer jusqu'à la fin du roman puisque l'action, initialement située à Paris (chapitre I), se déplace dans la campagne normande pour les chapitres II à X.
18
L'observation des brouillons rédactionnels révèle que le passage descriptif inaugural figure dès les premières versions du texte, précédé d'une présentation rapide des protagonistes.
19
Le f° 70 condense la présentation des personnages en une formule symétrique — « une pipe et une prise » — qui ne mentionne pas le propriétaire de chacun des accessoires, pipe et tabatière. On retrouve le même phénomène dans les f° 76 v° et 71, avant que n'apparaissent des initiales dans le f° 81 v° (« B. fuma une pipe et P. huma une prise qui leur parut la meilleure de toute leur vie »). Au folio suivant (f° 77 v°), les personnages sont nommés. On retrouve donc en ce début de chapitre le parallélisme et la complémentarité qui président à l'organisation des portraits des deux bonshommes. Comme le souligne Yvan Leclerc, l'indétermination présente dès le scénario, qui « divise mais ne distribue pas (« L'un prise, l'autre fume. ») [...] aboutit à la répartition Bouvard - Pécuchet, en particulier dans ce petit chef-d'œuvre de parallélisme syntaxique, morphologique, prosodique et phonétique [...] : « Bouvard fuma une pipe, Pécuchet huma une prise ». »25 Quant à l'état d'esprit de Bouvard et de Pécuchet en ce premier matin chavignollais, il est, à leur « réveil » — le terme figure au début de la première ligne des f° 70, 76 v° et 71 —, rigoureusement identique : leur enthousiasme est traduit par l'usage du superlatif « la meilleure de leur vie » dans les f° 70 et 76 v°. Le f° 71 propose une variation en « merveilleuse », adjectif remplacé par « suave » dans les f° 84 v° et 75 v°. Le choix final du seul superlatif, s'il évoque un paroxysme de bonheur, a estompé la douceur, la sensualité suggérées par le qualificatif « suave ».
20
Une autre atténuation que révèlent les brouillons consiste en la suppression du déterminant de totalité dans la même expression. Apparu tardivement dans le f° 77 v° — « la meilleure de toute leur vie » —, il se maintient dans le f° 84 v° — « la plus suave de toute leur existence ». Le f° 75 v° montre une hésitation (le terme est raturé à deux reprises) qui se conclura par l'élimination du terme dans le manuscrit autographe. Or ce déterminant de totalité n'aura de cesse de proliférer dans la suite du roman, en particulier dans les paragraphes évoquant les ouvrages consultés par Bouvard et Pécuchet, références obligatoires de chacune de leurs « expériences ». Les « résumés » sont en effet élaborés selon une même technique, caractérisée par la récurrence de tournures à valeur impérative où se trouvent associés tours impersonnels ou pronoms indéfinis, présents de vérité générale et déterminants de totalité : - Toutes les affections proviennent des vers. (p. 128) - Toutes les viandes ont des inconvénients, (p. 135) - Tous les corps animés reçoivent et communiquent l'influence des astres. (p. 280)
21
Si le mode de présentation systématique et péremptoire peut, dans certains cas, renvoyer à une forme adoptée par les ouvrages eux-mêmes (manuels techniques ou guides, par exemple), le lecteur a le plus souvent l'impression qu'il relève de la méthode de lecture
204
particulière des deux bonshommes, et des déformations qu'ils font subir au texte original. Les parallélismes de construction sont trop nets pour ne pas alerter le lecteur. Les énoncés deviennent alors incertains, suspects, sans qu'il soit possible de déterminer où s'arrête la citation littérale de l'ouvrage et où commence l'interprétation défaillante des personnages. Car c'est bien un « défaut de méthode » qui se manifeste dans leur volonté de tirer des enseignements pratiques de tous les livres qu'ils parcourent. Ils « pèchent par excès », comme le révèlent certains passages du roman qui évoquent l'application par Bouvard et Pécuchet des préceptes lus : - Excité par Pécuchet, [Bouvard] eut le délire de l'engrais. Dans la fosse aux composts furent entassés des branchages, du sang, des boyaux, des plumes, tout ce qu'il pouvait découvrir [...] et poussant jusqu'au bout ses principes, ne tolérait pas qu'on perdît l'urine. (p. 89) - [Leur manie] était si forte qu'ils regrettaient les monuments sur lesquels on ne sait rien du tout. (p. 167) - [...] et pour Bouvard et Pécuchet tout devint phallus. (p. 180) - [La métaphysique] revenait à propos de la pluie ou du soleil, d'un gravier dans leur soulier, d'une fleur sur le gazon, à propos de tout. (p. 310) 22
Une nouvelle fois, l'emploi répété du déterminant de totalité attire l'attention du lecteur sur le caractère excessif des agissements des personnages. Qu'il s'agisse d'interprétation ou d'expérimentation, chaque démarche devient douteuse. Dans un tel contexte, comment analyser la suppression par Flaubert du déterminant de totalité au début du second chapitre ? Peut-être s'agit-il de ne pas trop discréditer les héros en ce début de roman ? Dans cette « revue de toutes les idées modernes »26, cette « encyclopédie critique en farce »27 qu'est Bouvard et Pécuchet, une disqualification trop nette et immédiate des protagonistes irait sans doute à l'encontre de l'effet recherché. Et l'indétermination prévaut dans un texte dont la charge ironique, quoique partout présente, reste souvent « indécidable » parce qu'elle ne se réduit pas à une forme conventionnelle et que son objet n'est pas définitivement circonscrit.
23
Une autre hypothèse possible serait un refus de redondance, puisque les sentiments de Bouvard et Pécuchet ouvrent le chapitre de façon tonitruante : à partir du f° 81 v° apparaissent la tournure exclamative et la mention explicite de leur enthousiasme (« Quelle joie à leur réveil ! ») ; le f° 84 v° intègre le complément de temps qui perdurera jusqu'au dernier état du texte (« Quelle joie le lendemain en se réveillant ! »).
24
La modification la plus intéressante se trouve sans doute au début du passage descriptif qui fait suite à la présentation de Bouvard et Pécuchet. Si l'on se réfère à la correspondance et aux « Carnets de travail », on remarque que Flaubert évoque en des termes identiques le lieu où il va implanter son roman : l'accent est mis sur la « platitude »28 de l'endroit, voire sa « stupidité » 29. Dans les « brouillons », la description de la campagne chavignollaise restitue fidèlement cette impression de médiocrité. Le paysage est décrit en des termes qui font écho aux expressions figurant dans le Carnet 18 bis : le f° 71 mentionne, en marge, un paysage « simple, car ils avaient entrepris, dans ce pays superbe [...] de choisir un endroit plat ». Dans les feuillets suivants, l'idée de simplicité est reprise et amplifiée par l'utilisation d'un adjectif à valeur adverbiale « fort » (« Il était fort simple », ms g 225, f° 81 v°, f° 77 v°, f° 84 v°, f° 75 v°, f° 103 v°). Quant à la platitude du lieu, elle est développée de la même manière jusqu'à occuper un paragraphe entier dans le f° 103 v° : « Il était fort simple, car au lieu de s'établir dans un endroit charmant, comme on en trouve partout aux environs, ils avaient choisi le plateau qui sépare la vallée de l'Orne de la vallée d'Auge, et ne fait qu'une plaine d'une monotonie
205
continue. » Initié dès le troisième brouillon rédactionnel (f° 71) sous forme d'un ajout marginal (« il était simple car ils avaient entreprit [sic], dans ce pays superbe entre deux vallées de choisir un endroit plat »), ce paragraphe s'élabore progressivement et se déploie jusqu'au feuillet de mise au net. 25
Afin de rendre compte du processus d'amplification du passage, je propose ci-dessous une transcription linéarisée des différents états du texte.30
26
f° 81 v° : à leur réveil une pipe et
une prise la meilleure de leur vie.
27
Ils se mirent à la leur [fenêtre] pour regarder le paysage. Il était fort simple car [cinq mots illisibles] la vallée de l'Orne ou dans la vallée d'Auge ils avaient [eu l'esprit de choisir] un endroit tout plat.
28
f° 77 v° : Quelle joie à leur réveil ! [Quand le premier étonnement dissipé, ils reconnurent où ils étaient] Bouvard fuma une pipe et Pécuchet huma une prise [qu'ils déclarèrent] [> la meilleure de toute leur vie.
29
Ils se mirent [à leur] croisée pour [regarder] le paysage. Il était fort simple, car [dans cette région où les endroits accidentés sont nombreux] [ [trois mots illisibles] plaine [d'une] monotonie [fastidieuse].
30
f° 84 v° : Quelle joie [à leur réveil ! Bouvard fuma une pipe et Pécuchet huma une prise qu'ils déclarèrent [< l'un et l'autre>] la meilleure de toute leur vie]